Syndromes Myasthéniques Congénitaux : Guide Complet 2025 | Symptômes, Diagnostic, Traitements
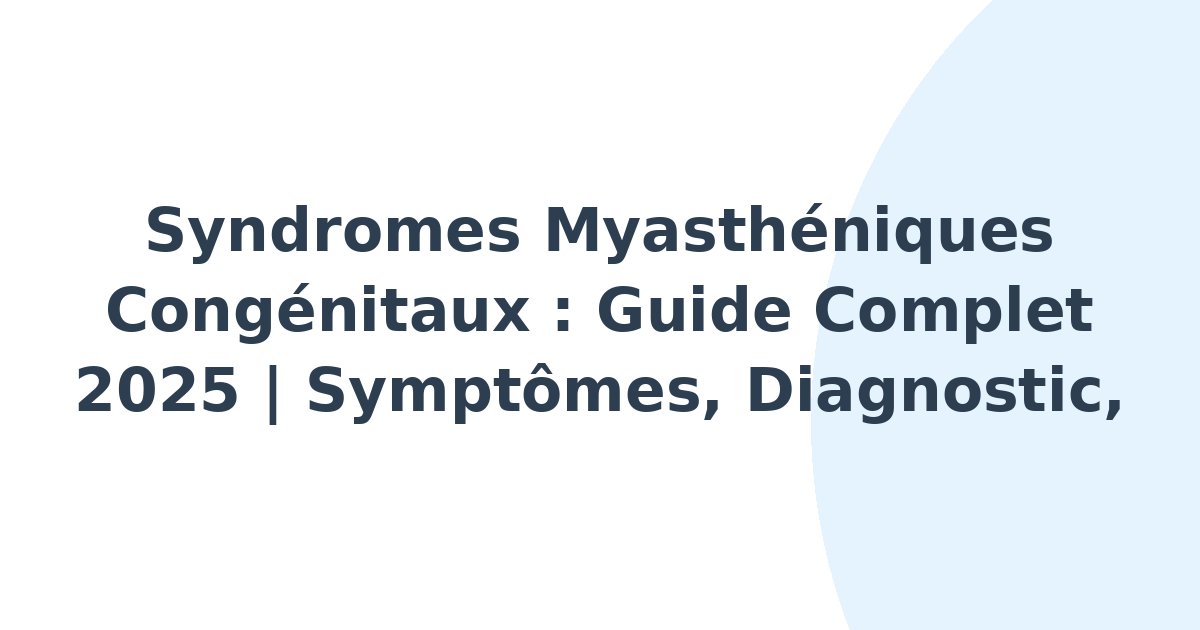
Les syndromes myasthéniques congénitaux représentent un groupe de maladies neuromusculaires rares présentes dès la naissance. Ces pathologies affectent la transmission des signaux nerveux aux muscles, provoquant une faiblesse musculaire caractéristique. Contrairement à la myasthénie auto-immune, ces troubles sont d'origine génétique et touchent environ 1 personne sur 500 000 en France selon les dernières données de la HAS [1]. Comprendre ces maladies complexes est essentiel pour un diagnostic précoce et une prise en charge adaptée.
Téléconsultation et Syndromes myasthéniques congénitaux
Téléconsultation non recommandéeLes syndromes myasthéniques congénitaux nécessitent un diagnostic spécialisé complexe avec examens électrophysiologiques (électromyogramme) et tests génétiques spécifiques. La prise en charge initiale requiert impérativement un neurologue expérimenté en pathologies neuromusculaires pour établir le diagnostic différentiel et adapter le traitement.
Ce qui peut être évalué à distance
Description des épisodes de faiblesse musculaire et de leur évolution dans le temps, analyse de l'historique familial de pathologies neuromusculaires, évaluation de la réponse aux traitements anticholinestérasiques en cours, discussion des facteurs déclenchants ou aggravants identifiés, orientation vers les examens spécialisés nécessaires.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examen neurologique complet avec tests de fatigabilité musculaire, électromyogramme avec stimulation répétitive, tests pharmacologiques spécialisés, biopsie musculaire si nécessaire, consultation en centre de référence des maladies neuromusculaires.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Diagnostic initial de syndrome myasthénique congénital nécessitant des examens électrophysiologiques spécialisés, ajustement thérapeutique complexe nécessitant une surveillance neurologique étroite, évaluation de complications respiratoires ou de déglutition, bilan pré-thérapeutique pour nouveaux traitements.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Crise myasthénique avec détresse respiratoire aiguë, troubles de déglutition sévères avec risque de fausse route, faiblesse musculaire rapidement progressive, détérioration neurologique inexpliquée.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Difficultés respiratoires ou essoufflement au repos
- Troubles de déglutition sévères avec risque de fausse route
- Faiblesse musculaire généralisée et rapidement progressive
- Impossibilité de maintenir la tête droite ou fermer complètement les paupières
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Neurologue — consultation en présentiel indispensable
Les syndromes myasthéniques congénitaux requièrent une expertise neurologique spécialisée en pathologies neuromusculaires pour le diagnostic et la prise en charge. L'examen clinique neurologique et les tests électrophysiologiques sont indispensables.
Syndromes myasthéniques congénitaux : Définition et Vue d'Ensemble
Les syndromes myasthéniques congénitaux constituent un ensemble de maladies génétiques rares qui perturbent le fonctionnement de la jonction neuromusculaire dès la naissance [7,8]. Cette zone de contact entre le nerf et le muscle est cruciale pour la contraction musculaire normale.
Imaginez la jonction neuromusculaire comme une prise électrique défectueuse. Le courant (signal nerveux) ne passe plus correctement, ce qui empêche l'appareil (le muscle) de fonctionner normalement. C'est exactement ce qui se passe dans ces pathologies [9].
Contrairement à la myasthénie auto-immune qui survient plus tard dans la vie, ces syndromes sont présents dès la naissance et résultent de mutations génétiques spécifiques [1,14]. Les gènes impliqués codent pour différentes protéines essentielles au bon fonctionnement de la transmission neuromusculaire.
On distingue plusieurs sous-types selon la localisation du défaut : pré-synaptique (avant la jonction), synaptique (au niveau de la fente) ou post-synaptique (après la jonction) [7]. Cette classification est importante car elle influence directement le choix du traitement.
Épidémiologie en France et dans le Monde
Les données épidémiologiques récentes révèlent une prévalence estimée entre 1/500 000 et 1/200 000 habitants en France selon les protocoles nationaux de diagnostic et de soins de la HAS [1]. Cette variabilité s'explique par l'amélioration progressive des techniques diagnostiques.
L'incidence annuelle française est évaluée à environ 2 à 3 nouveaux cas par million d'habitants par an [13]. Ces chiffres, bien qu'apparemment faibles, représentent une réalité significative pour les familles concernées. D'ailleurs, les registres européens montrent des variations importantes entre pays, avec une prévalence plus élevée en Belgique (1/150 000) selon l'étude de Smeets et Gheldof [13].
La répartition par âge montre que 60% des cas sont diagnostiqués avant l'âge de 2 ans, 25% entre 2 et 10 ans, et 15% à l'âge adulte [12]. Cette distribution reflète la sévérité variable des différents sous-types génétiques.
Concernant la répartition par sexe, aucune prédominance significative n'est observée, contrairement à la myasthénie auto-immune qui touche davantage les femmes [11]. Les projections épidémiologiques pour 2025-2030 suggèrent une augmentation apparente des cas, principalement due à l'amélioration des capacités diagnostiques et à la sensibilisation médicale croissante [3].
Les Causes et Facteurs de Risque
Les syndromes myasthéniques congénitaux résultent exclusivement de mutations génétiques héréditaires [7,10]. Plus de 30 gènes différents ont été identifiés à ce jour, chacun codant pour une protéine spécifique de la jonction neuromusculaire.
Les modes de transmission varient selon le gène impliqué. La plupart suivent un mode autosomique récessif, ce qui signifie que les deux parents doivent être porteurs pour que l'enfant soit atteint [10]. Certaines formes plus rares suivent un mode autosomique dominant ou sont liées au chromosome X.
Parmi les gènes les plus fréquemment mutés, on trouve CHRNE (codant pour la sous-unité epsilon du récepteur à l'acétylcholine), RAPSN (codant pour la rapsyne) et DOK7 [7,10]. Chaque mutation entraîne un dysfonctionnement spécifique de la transmission neuromusculaire.
Il n'existe pas de facteurs de risque environnementaux connus pour ces pathologies. Le seul facteur de risque identifié est la consanguinité parentale, qui augmente la probabilité d'expression des mutations récessives [10]. C'est pourquoi ces syndromes sont parfois plus fréquents dans certaines populations isolées géographiquement.
Comment Reconnaître les Symptômes ?
La faiblesse musculaire constitue le symptôme cardinal des syndromes myasthéniques congénitaux [5,12]. Cette faiblesse présente des caractéristiques particulières qui la distinguent d'autres pathologies neuromusculaires.
Chez le nouveau-né et le nourrisson, les signes d'alerte incluent des difficultés d'alimentation, une succion faible, des pleurs faibles et une hypotonie généralisée [5]. Les parents remarquent souvent que leur bébé se fatigue rapidement pendant les tétées ou les biberons.
La fatigabilité représente un symptôme pathognomique : la force musculaire diminue avec l'effort et se restaure partiellement au repos [12]. Cette caractéristique peut être subtile chez les très jeunes enfants mais devient plus évidente avec l'âge.
Les symptômes oculaires sont fréquents et incluent un ptosis (chute des paupières), une diplopie (vision double) et une limitation des mouvements oculaires [12]. Ces signes peuvent être les premiers à apparaître et orienter vers le diagnostic.
D'autres manifestations peuvent inclure des difficultés respiratoires, particulièrement lors d'infections, une faiblesse des muscles faciaux donnant un visage peu expressif, et des retards dans l'acquisition de la marche [5]. Bon à savoir : contrairement à d'autres maladies neuromusculaires, l'intelligence reste normale.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic des syndromes myasthéniques congénitaux nécessite une approche méthodique combinant clinique, électrophysiologie et génétique [1,9]. La démarche diagnostique a considérablement évolué ces dernières années grâce aux avancées technologiques.
L'électromyographie (EMG) avec stimulation répétitive constitue l'examen de première intention [9]. Elle révèle un décrément caractéristique de l'amplitude des potentiels d'action musculaire lors de stimulations répétées à basse fréquence. Cet examen, bien que parfois inconfortable, reste indispensable au diagnostic.
Le test à l'édrophonium (Tensilon) peut être réalisé chez l'enfant plus âgé, mais ses résultats sont moins fiables que dans la myasthénie auto-immune [11]. Ce test consiste en l'injection d'un médicament qui améliore temporairement la transmission neuromusculaire.
Les analyses génétiques représentent aujourd'hui l'étape diagnostique définitive [1,7]. Le séquençage de nouvelle génération permet d'analyser simultanément tous les gènes connus, réduisant considérablement les délais diagnostiques. Cette approche a révolutionné la prise en charge depuis 2020.
Parfois, une biopsie musculaire peut être nécessaire pour analyser la morphologie de la jonction neuromusculaire [6]. Cet examen, plus invasif, n'est réalisé que dans des cas particuliers où les autres examens restent non concluants.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
La prise en charge thérapeutique des syndromes myasthéniques congénitaux s'est considérablement enrichie ces dernières années [2,3]. Le traitement doit être personnalisé selon le sous-type génétique identifié, car certains médicaments peuvent être inefficaces voire délétères selon la mutation.
Les inhibiteurs de l'acétylcholinestérase comme la pyridostigmine (Mestinon®) constituent souvent le traitement de première ligne [1]. Ces médicaments augmentent la disponibilité de l'acétylcholine au niveau de la jonction neuromusculaire. Cependant, leur efficacité varie considérablement selon le type de syndrome.
Pour certains sous-types, notamment ceux liés aux mutations de DOK7, les agonistes bêta-2 adrénergiques comme le salbutamol montrent une efficacité remarquable [3]. Cette découverte thérapeutique majeure a transformé le pronostic de nombreux patients depuis 2015.
La 3,4-diaminopyridine peut être bénéfique dans les formes pré-synaptiques en augmentant la libération d'acétylcholine [2]. Ce médicament, initialement utilisé dans le syndrome de Lambert-Eaton, trouve ici une nouvelle indication prometteuse.
Les traitements symptomatiques incluent la kinésithérapie respiratoire, l'orthophonie pour les troubles de déglutition, et parfois une assistance ventilatoire nocturne [1]. L'approche multidisciplinaire reste essentielle pour optimiser la qualité de vie.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024 marque un tournant dans la recherche sur les syndromes myasthéniques congénitaux avec plusieurs avancées prometteuses [2,3,4]. Les approches thérapeutiques innovantes ouvrent de nouveaux horizons pour les patients et leurs familles.
Les thérapies géniques font l'objet d'essais cliniques préliminaires pour certains sous-types [3,4]. L'Institut de Myologie développe actuellement des vecteurs viraux capables de corriger les défauts génétiques spécifiques. Ces approches, encore expérimentales, pourraient révolutionner la prise en charge dans les prochaines années.
De nouveaux modulateurs pharmacologiques de la jonction neuromusculaire sont en cours d'évaluation [2,4]. Certaines molécules agissent directement sur les récepteurs à l'acétylcholine pour en améliorer la fonction, tandis que d'autres ciblent les voies de signalisation intracellulaires.
L'intelligence artificielle commence à transformer le diagnostic et le suivi des patients [4]. Des algorithmes d'apprentissage automatique analysent les données électrophysiologiques pour prédire la réponse aux traitements et optimiser les protocoles thérapeutiques.
Les biomarqueurs sanguins émergents permettent un suivi plus précis de l'évolution de la maladie [3]. Ces marqueurs biologiques pourraient remplacer certains examens invasifs et faciliter l'évaluation de l'efficacité thérapeutique. La recherche collaborative internationale s'intensifie, avec des consortiums européens et américains partageant leurs données pour accélérer les découvertes.
Vivre au Quotidien avec les Syndromes Myasthéniques Congénitaux
Vivre avec un syndrome myasthénique congénital nécessite des adaptations quotidiennes, mais une vie épanouie reste tout à fait possible [14]. L'important est de comprendre sa maladie et d'adapter son rythme de vie en conséquence.
La gestion de la fatigue constitue l'enjeu principal du quotidien. Il est essentiel d'apprendre à reconnaître ses limites et à planifier ses activités en fonction de ses capacités. Beaucoup de patients développent des stratégies personnelles : faire les tâches importantes le matin quand la force est maximale, prévoir des temps de repos réguliers.
L'activité physique adaptée joue un rôle crucial dans le maintien de la fonction musculaire [14]. Contrairement aux idées reçues, l'exercice modéré et régulier améliore souvent les symptômes. La natation, par exemple, permet de travailler l'ensemble des muscles sans surcharge excessive.
Au niveau professionnel et scolaire, des aménagements sont souvent nécessaires. Cela peut inclure des horaires adaptés, des pauses supplémentaires, ou l'utilisation d'outils d'assistance. La reconnaissance du handicap permet d'accéder à ces aménagements légaux.
Le soutien psychologique ne doit pas être négligé. Accepter une maladie chronique dès l'enfance représente un défi important. Les groupes de patients et les associations spécialisées offrent un soutien précieux pour partager expériences et conseils pratiques.
Les Complications Possibles
Les syndromes myasthéniques congénitaux peuvent entraîner diverses complications, particulièrement en l'absence de prise en charge adaptée [5,6]. La connaissance de ces risques permet une surveillance appropriée et une intervention précoce.
Les complications respiratoires représentent le risque le plus sérieux, surtout chez les jeunes enfants [5]. La faiblesse des muscles respiratoires peut conduire à des infections pulmonaires récurrentes, voire à une insuffisance respiratoire nécessitant une assistance ventilatoire. Ces épisodes surviennent souvent lors d'infections virales banales.
Les troubles de la déglutition exposent au risque de fausses routes et de pneumonies d'inhalation [5]. Chez le nourrisson, ces difficultés peuvent compromettre la croissance et nécessiter une alimentation par sonde gastrique temporaire ou permanente.
Certaines études récentes suggèrent une association entre les syndromes myasthéniques congénitaux et des anomalies mitochondriales [6]. Cette découverte pourrait expliquer certaines manifestations systémiques observées chez quelques patients, bien que le lien exact reste à élucider.
Les complications orthopédiques peuvent survenir à long terme : scoliose, contractures articulaires, déformations des pieds. Ces complications sont généralement prévenables par une kinésithérapie régulière et un suivi orthopédique approprié. Heureusement, avec une prise en charge précoce et adaptée, la plupart de ces complications peuvent être évitées ou considérablement atténuées.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic des syndromes myasthéniques congénitaux varie considérablement selon le sous-type génétique et la précocité de la prise en charge [1,13]. Cette variabilité explique l'importance cruciale d'un diagnostic précis et d'un traitement personnalisé.
Les formes légères, souvent diagnostiquées à l'âge adulte, permettent généralement une vie quasi-normale avec un traitement approprié [13]. Ces patients peuvent exercer une activité professionnelle, fonder une famille et maintenir une bonne qualité de vie. L'espérance de vie n'est habituellement pas affectée.
Les formes sévères diagnostiquées dans la petite enfance nécessitent une prise en charge plus intensive [1]. Cependant, même dans ces cas, les progrès thérapeutiques récents ont considérablement amélioré le pronostic. Beaucoup d'enfants atteignent aujourd'hui l'âge adulte avec une autonomie satisfaisante.
Un facteur pronostique majeur est la réponse au traitement initial. Les patients qui répondent bien aux inhibiteurs de l'acétylcholinestérase ou au salbutamol ont généralement une évolution favorable [13]. À l'inverse, les formes résistantes aux traitements conventionnels nécessitent des approches thérapeutiques plus complexes.
L'évolution est généralement stable ou lentement progressive chez l'adulte. Contrairement à certaines maladies neuromusculaires, on n'observe pas de dégradation rapide. Cette stabilité relative permet aux patients de planifier leur avenir avec plus de sérénité. Les grossesses sont possibles chez les femmes, bien qu'elles nécessitent une surveillance spécialisée.
Peut-on Prévenir les Syndromes Myasthéniques Congénitaux ?
La prévention des syndromes myasthéniques congénitaux repose essentiellement sur le conseil génétique et le diagnostic prénatal [10]. Ces maladies étant d'origine génétique, la prévention primaire n'est pas possible, mais des stratégies préventives existent pour les familles à risque.
Le conseil génétique s'adresse aux couples ayant déjà un enfant atteint ou ayant des antécédents familiaux [10]. Un généticien évalue le risque de récurrence et explique les options disponibles. Cette consultation est particulièrement importante dans les familles consanguines où le risque est plus élevé.
Le diagnostic prénatal peut être proposé lorsque la mutation familiale est connue. Il s'effectue par amniocentèse ou biopsie de villosités choriales vers 15-18 semaines de grossesse. Cette démarche reste un choix personnel du couple, accompagné par une équipe pluridisciplinaire.
Le diagnostic préimplantatoire (DPI) représente une alternative pour certains couples. Cette technique permet de sélectionner des embryons non porteurs de la mutation avant implantation lors d'une fécondation in vitro. Cependant, cette procédure complexe n'est disponible que dans quelques centres spécialisés.
Il n'existe pas de prévention environnementale connue pour ces pathologies. Aucun facteur externe (alimentation, exposition, mode de vie) n'influence le risque de développer ces syndromes. La recherche se concentre donc sur l'amélioration des techniques diagnostiques et thérapeutiques plutôt que sur la prévention primaire.
Recommandations des Autorités de Santé
La Haute Autorité de Santé (HAS) a publié en 2024 des recommandations actualisées pour la prise en charge des syndromes myasthéniques congénitaux [1]. Ces protocoles nationaux de diagnostic et de soins (PNDS) constituent la référence pour tous les professionnels de santé français.
Les recommandations diagnostiques préconisent une approche en trois étapes : évaluation clinique spécialisée, explorations électrophysiologiques, puis analyses génétiques [1]. La HAS insiste sur l'importance d'un diagnostic précoce pour optimiser la prise en charge thérapeutique.
Concernant le suivi médical, les recommandations prévoient une consultation spécialisée au minimum tous les 6 mois chez l'enfant et annuelle chez l'adulte stable [1]. Ce suivi doit inclure une évaluation respiratoire, nutritionnelle et orthopédique régulière.
Les critères de prise en charge à 100% par l'Assurance Maladie sont clairement définis dans le cadre de l'Affection de Longue Durée (ALD) [1]. Cette reconnaissance permet l'accès aux traitements spécialisés et aux équipements d'assistance sans reste à charge pour les patients.
La HAS recommande également la coordination des soins autour d'un centre de référence ou de compétence des maladies neuromusculaires [1]. Cette organisation attendut une expertise spécialisée et facilite l'accès aux innovations thérapeutiques. Les recommandations européennes, bien qu'harmonisées, présentent quelques variations nationales concernant l'accès à certains traitements innovants.
Ressources et Associations de Patients
L'AFM-Téléthon constitue la principale association française soutenant les patients atteints de syndromes myasthéniques congénitaux [14]. Cette organisation offre un accompagnement complet aux familles, de l'annonce du diagnostic jusqu'à l'âge adulte.
Les services proposés incluent une ligne d'écoute téléphonique, des groupes de parole, des week-ends familles et un soutien pour les démarches administratives [14]. L'association publie également des guides pratiques et organise des formations pour les aidants familiaux.
Au niveau international, la Myasthenia Gravis Foundation of America propose des ressources spécifiques aux syndromes congénitaux [2]. Leur site web offre des informations actualisées sur les recherches en cours et les essais cliniques disponibles.
Les centres de référence maladies neuromusculaires constituent des ressources médicales essentielles. En France, ces centres sont répartis sur l'ensemble du territoire et coordonnent la prise en charge spécialisée. Ils organisent également des consultations multidisciplinaires regroupant neurologue, pneumologue, cardiologue et autres spécialistes.
Les plateformes numériques se développent pour faciliter les échanges entre patients. Des forums spécialisés permettent de partager expériences et conseils pratiques. Cependant, il convient de toujours vérifier les informations médicales avec son équipe soignante avant toute modification de traitement.
Nos Conseils Pratiques
Vivre avec un syndrome myasthénique congénital nécessite quelques adaptations pratiques qui peuvent considérablement améliorer le quotidien. Ces conseils, issus de l'expérience des patients et des équipes soignantes, ont fait leurs preuves.
Organisez votre journée en fonction de vos pics de forme. La plupart des patients se sentent mieux le matin, profitez-en pour les tâches importantes. Planifiez des temps de repos réguliers, même courts, plutôt que d'attendre l'épuisement complet.
Pour la gestion des médicaments, utilisez un pilulier hebdomadaire et programmez des rappels sur votre téléphone. Gardez toujours une réserve d'urgence et emportez vos traitements lors de vos déplacements. N'hésitez pas à informer votre entourage professionnel de vos besoins médicamenteux.
Côté alimentation, privilégiez des repas légers et fréquents plutôt que trois gros repas. Les aliments faciles à mâcher et à avaler réduisent la fatigue liée à la déglutition. Hydratez-vous régulièrement, surtout si vous prenez des anticholinestérasiques qui peuvent assécher la bouche.
Pour l'activité physique, choisissez des exercices en piscine chauffée ou des étirements doux. Évitez les efforts intenses qui épuisent rapidement les muscles. La marche régulière, même courte, maintient la maladie physique sans surmenage.
Enfin, communiquez avec votre entourage sur vos besoins et limites. L'incompréhension vient souvent de l'invisibilité de la maladie. N'hésitez pas à expliquer que votre fatigue n'est pas de la paresse mais un symptôme médical réel.
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes doivent vous alerter et justifier une consultation médicale rapide, voire urgente dans certains cas. La connaissance de ces signaux d'alarme peut éviter des complications graves.
Consultez en urgence si vous présentez des difficultés respiratoires, une aggravation brutale de la faiblesse musculaire, ou des troubles de la déglutition avec fausses routes répétées. Ces symptômes peuvent signaler une crise myasthénique nécessitant une hospitalisation.
Une consultation rapide (dans les 48h) s'impose en cas de fièvre associée à une aggravation des symptômes, de difficultés d'élocution nouvelles, ou de chutes répétées. Les infections peuvent décompenser temporairement la maladie et nécessiter un ajustement thérapeutique.
Prenez rendez-vous dans la semaine si vous constatez une diminution progressive de vos capacités physiques, des effets secondaires de vos médicaments, ou des difficultés psychologiques liées à la maladie. Ces situations nécessitent une évaluation médicale sans caractère d'urgence.
Pour le suivi de routine, respectez les consultations programmées avec votre neurologue, même si vous vous sentez bien. Ces rendez-vous permettent d'ajuster les traitements et de dépister précocement d'éventuelles complications.
N'hésitez jamais à contacter votre équipe médicale en cas de doute. Il vaut mieux une consultation de trop qu'une complication évitable. La plupart des centres disposent d'une ligne téléphonique pour les urgences ou les questions des patients.
Questions Fréquentes
Les syndromes myasthéniques congénitaux sont-ils héréditaires ?
Oui, ces pathologies sont d'origine génétique et peuvent se transmettre aux descendants. Le mode de transmission varie selon le gène impliqué, mais la plupart suivent un mode autosomique récessif.
Peut-on guérir de ces syndromes ?
Il n'existe pas de guérison définitive, mais les traitements actuels permettent de contrôler efficacement les symptômes chez la majorité des patients. Les recherches sur les thérapies géniques ouvrent de nouveaux espoirs.
Ces maladies s'aggravent-elles avec l'âge ?
L'évolution est généralement stable chez l'adulte. Contrairement à d'autres pathologies neuromusculaires, on n'observe pas de dégradation progressive rapide.
Peut-on faire du sport avec ces syndromes ?
L'activité physique adaptée est même recommandée. Il faut éviter les efforts intenses mais privilégier les exercices modérés et réguliers comme la natation ou la marche.
Les femmes peuvent-elles avoir des enfants ?
Oui, les grossesses sont possibles mais nécessitent une surveillance médicale spécialisée. Le conseil génétique est recommandé pour évaluer le risque de transmission.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Maladie de Steinert » Texte du PNDS. HAS. 2024-2025.Lien
- [2] Texte du PNDS Protocole National de Diagnostic et de Soins - Syndromes myasthéniques congénitaux. HAS.Lien
- [3] MG dans l'actualité | Fondation américaine pour la myasthénie. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [4] Institut de Myologie - Rapport d'activité 2023. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [5] Congenital Myasthenic Syndrome (CMS) - Données cliniques 2024-2025.Lien
- [6] Feeding Difficulties and Respiratory Failure in Congenital Myasthenic Syndromes. Pediatrics in Review 2024.Lien
- [7] Mitochondrial disorders associated with morphological changes in congenital myasthenic syndromes. Science Direct 2024.Lien
- [8] Kediha MI, Tazir M. Les syndromes myasthéniques congénitaux avec anomalies cinétiques du récepteur à l'acétylcholine. Médecine/Sciences 2023.Lien
- [9] Seutin V, Wang FC. Les syndromes myasthéniques et myotoniques congénitaux: rencontre des sciences fondamentales et cliniques. 2022.Lien
- [10] Melouane D, Menaoum D. Physiopathologie de la jonction neuromusculaire et syndromes myasthéniques. Université de Tizi-Ouzou 2023.Lien
- [11] Eymard B. In memoriam: Emmanuel Fournier. Cahiers de Myologie 2022.Lien
- [12] Rafai MA, Berrada M. Congenital myasthenic syndrome due to homozygous mutation in Moroccan child. African Journal of Medicine 2022.Lien
- [13] Irsaa Z. La myasthénie juvénile. Thèse de médecine 2022.Lien
- [14] Prud'homme L, Gitiaux C. Myasthénie chez l'enfant avec atteinte oculaire. Science Direct 2024.Lien
- [15] Smeets N, Gheldof A. Congenital myasthenic syndromes in Belgium: genetic and clinical characterization. Neuromuscular Disorders 2024.Lien
- [16] Syndromes myasthéniques congénitaux. AFM-Téléthon.Lien
- [17] Syndromes myasthéniques congénitaux: Le diagnostic génétique. Médecine/Sciences 2019.Lien
Publications scientifiques
- Les syndromes myasthéniques congénitaux avec anomalies cinétiques du récepteur à l'acétylcholine (2023)[PDF]
- Les syndromes myasthéniques et myotoniques congénitaux: rencontre des sciences fondamentales et des sciences cliniques (2022)[PDF]
- Physiopathologie de la jonction neuromusculaire et étude rétrospective des syndromes myasthéniques diagnostiqués à l'hôpital Belloua (Tizi-Ouzou) (2023)
- In memoriam: Emmanuel Fournier (2022)[PDF]
- Congenital myasthenic syndrome due to homozygous mutation of the cholinergic receptor nicotinic epsilon subunit in a Moroccan child Syndrome myasthénique … (2022)
Ressources web
- Syndromes myasthéniques congénitaux (afm-telethon.fr)
3 déc. 2020 — Les différents syndromes myasthéniques congénitaux provoquent une fatigabilité excessive et une faiblesse musculaire qui tend à s'aggraver à l' ...
- Texte du PNDS Protocole National de Diagnostic et de ... (has-sante.fr)
Ces traitements améliorent la fonction motrice dans la plupart des syndromes myasthéniques congénitaux en augmentant la quantité et l'activité de l'Ach par ...
- Syndromes myasthéniques congénitaux: Le ... (medecinesciences.org)
de B Eymard · 2019 — Salbutamol, éphédrine, anticholinestérasiques ou encore quinidine, différents médicaments sur le marché depuis longtemps sont aujourd'hui prescrits aussi dans ...
- Savoir reconnaître les symptômes évoquant un syndrome ... (realites-pediatriques.com)
2 avr. 2024 — Le signe principal est une fatigue musculaire. Les premiers symptômes apparaissent dès la première année de vie. La mise en place d'un ...
- Syndromes myasthéniques congénitaux (has-sante.fr)
25 mars 2021 — Ce protocole national de diagnostic et de soins (PNDS) explicite aux professionnels concernés la prise en charge diagnostique et thérapeutique ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
