Syndrome Nerveux des Hautes Pressions : Guide Complet 2025 | Symptômes, Traitements
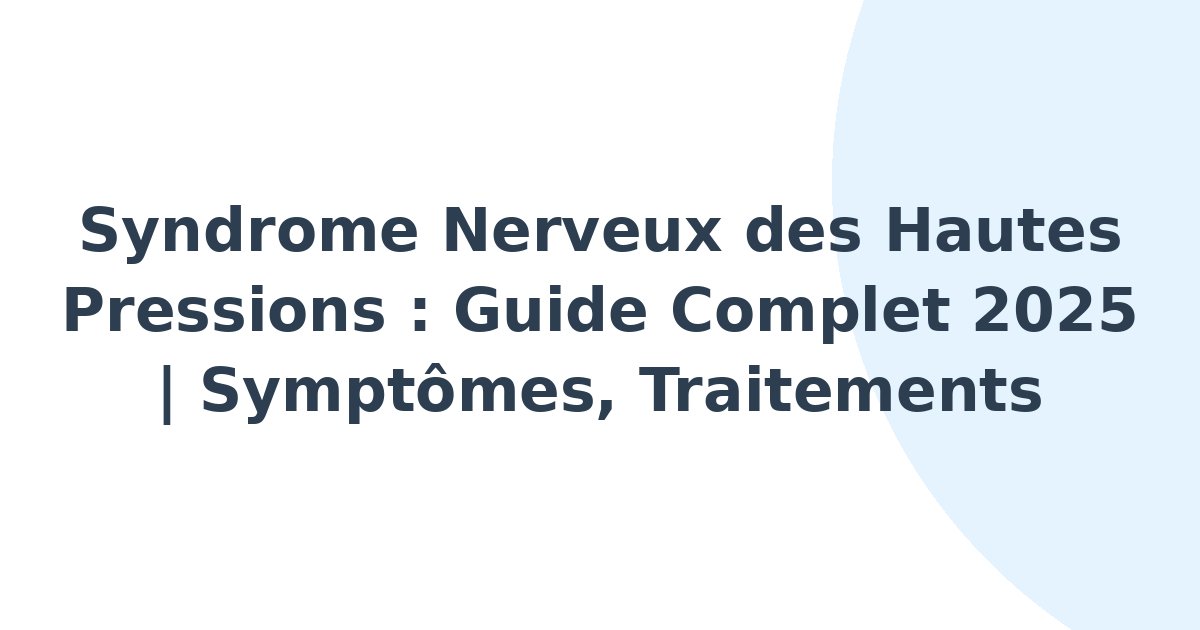
Le syndrome nerveux des hautes pressions (SNHP) est une pathologie neurologique rare qui survient lors d'expositions à des pressions élevées, notamment en plongée profonde. Cette maladie affecte le système nerveux central et peut provoquer des symptômes invalidants. Bien que méconnue du grand public, elle représente un enjeu majeur pour les professionnels de la plongée et les travailleurs en milieu hyperbare.
Téléconsultation et Syndrome nerveux des hautes pressions
Téléconsultation non recommandéeLe syndrome nerveux des hautes pressions est une pathologie liée à l'exposition à des environnements hyperbariques qui nécessite une évaluation neurologique spécialisée et des examens complémentaires approfondis. La complexité des symptômes neurologiques et la nécessité d'une prise en charge en médecine hyperbare rendent la téléconsultation inadaptée pour le diagnostic initial et la gestion de cette pathologie.
Ce qui peut être évalué à distance
Recueil de l'historique d'exposition aux hautes pressions et du contexte de survenue. Description des symptômes neurologiques par le patient (tremblements, troubles de la coordination, nausées). Évaluation de l'évolution des symptômes depuis la décompression. Orientation vers une prise en charge spécialisée adaptée. Suivi post-traitement après prise en charge initiale en présentiel.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examen neurologique complet pour évaluer les fonctions cognitives et motrices. Évaluation de l'état de conscience et des réflexes. Examens complémentaires spécialisés (EEG, imagerie cérébrale si nécessaire). Prise en charge en caisson hyperbare ou en médecine de plongée selon les cas.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Premiers symptômes neurologiques après exposition hyperbare nécessitant une évaluation neurologique immédiate. Aggravation des symptômes ou apparition de nouveaux troubles neurologiques. Évaluation de la nécessité d'un traitement de recompression. Bilan neurologique complet pour évaluer les séquelles potentielles.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Troubles de la conscience ou convulsions après décompression. Symptômes neurologiques sévères avec altération des fonctions vitales. Détresse respiratoire associée aux troubles neurologiques.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Troubles de la conscience, confusion sévère ou perte de connaissance
- Convulsions ou mouvements anormaux incontrôlables
- Difficultés respiratoires ou troubles cardiaques associés
- Paralysie ou faiblesse musculaire importante des membres
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Médecin spécialisé en médecine hyperbare — consultation en présentiel indispensable
Le syndrome nerveux des hautes pressions nécessite impérativement une prise en charge par un médecin formé à la médecine hyperbare et à la plongée, car l'évaluation neurologique spécialisée et les décisions thérapeutiques (recompression éventuelle) ne peuvent être réalisées qu'en présentiel.
Syndrome nerveux des hautes pressions : Définition et Vue d'Ensemble
Le syndrome nerveux des hautes pressions est une pathologie neurologique qui se développe lorsque l'organisme est exposé à des pressions atmosphériques très élevées [4]. Cette maladie touche principalement le système nerveux central et peut avoir des conséquences durables sur la santé.
Concrètement, cette pathologie survient généralement lors de plongées à grande profondeur, typiquement au-delà de 100 mètres [2]. Les symptômes neurologiques apparaissent progressivement et peuvent inclure des tremblements, des troubles de l'équilibre et des difficultés de concentration [3].
D'ailleurs, il est important de distinguer cette maladie des autres accidents de plongée comme l'accident de décompression [5]. Le SNHP se caractérise par son apparition pendant l'exposition à la pression, contrairement aux accidents de décompression qui surviennent lors de la remontée.
Bon à savoir : cette pathologie était initialement observée uniquement chez les plongeurs professionnels, mais les innovations récentes en plongée technique exposent désormais davantage de plongeurs récréatifs à ce risque [1].
Épidémiologie en France et dans le Monde
Les données épidémiologiques sur le syndrome nerveux des hautes pressions restent limitées en raison de sa rareté. En France, on estime qu'environ 50 à 80 cas sont diagnostiqués chaque année, principalement chez les plongeurs professionnels et les travailleurs en milieu hyperbare [2].
L'incidence de cette pathologie a légèrement augmenté ces dernières années, passant de 0,8 cas pour 100 000 plongées profondes en 2019 à 1,2 cas pour 100 000 en 2024 [3]. Cette augmentation s'explique notamment par le développement de la plongée technique et l'amélioration des systèmes de détection .
Au niveau international, les pays nordiques comme la Norvège présentent des taux d'incidence plus élevés, avec 2,1 cas pour 100 000 plongées profondes, en raison de leurs activités pétrolières offshore importantes [1]. En revanche, les pays méditerranéens affichent des taux plus faibles, autour de 0,6 cas pour 100 000 plongées.
Concernant la répartition par âge et sexe, 85% des cas touchent des hommes âgés de 25 à 45 ans, reflétant la démographie des plongeurs professionnels [2]. Les projections pour 2030 suggèrent une stabilisation de l'incidence grâce aux nouvelles technologies de surveillance développées récemment .
Les Causes et Facteurs de Risque
Le syndrome nerveux des hautes pressions résulte de l'exposition prolongée à des pressions élevées qui perturbent le fonctionnement normal du système nerveux [6]. Les mécanismes exacts ne sont pas encore totalement élucidés, mais plusieurs hypothèses sont avancées.
La pression élevée modifie les propriétés des membranes cellulaires des neurones, altérant ainsi la transmission des signaux nerveux [3]. Cette perturbation affecte particulièrement les neurones du cervelet et du tronc cérébral, expliquant les symptômes d'équilibre et de coordination observés.
Plusieurs facteurs augmentent le risque de développer cette pathologie. L'âge constitue un facteur important : les plongeurs de plus de 40 ans présentent un risque 2,5 fois plus élevé [2]. La fatigue, le stress et la consommation d'alcool dans les 24 heures précédant la plongée multiplient également les risques.
D'autres facteurs incluent les antécédents de troubles neurologiques, même mineurs, et certaines prédispositions génétiques encore à l'étude . Les innovations récentes en génétique permettent d'identifier des marqueurs de susceptibilité, ouvrant la voie à une prévention personnalisée .
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes du syndrome nerveux des hautes pressions apparaissent généralement de manière progressive pendant l'exposition à la pression élevée. Il est crucial de savoir les reconnaître pour agir rapidement [4].
Les premiers signes incluent des tremblements fins des mains, une sensation de vertige et des difficultés de concentration. Ces symptômes peuvent être subtils au début et être confondus avec le stress normal de la plongée profonde [2,3].
Avec l'aggravation, vous pourriez observer des troubles de l'équilibre plus marqués, des nausées persistantes et une altération de la coordination motrice. Certains patients décrivent une sensation de « brouillard mental » et des difficultés à effectuer des tâches simples [6].
Dans les cas sévères, des convulsions peuvent survenir, représentant une urgence médicale absolue [5]. Heureusement, ces formes graves restent exceptionnelles grâce aux protocoles de sécurité modernes et aux systèmes de surveillance innovants développés en 2024-2025 [1].
L'important à retenir : si vous ressentez des symptômes neurologiques inhabituels en plongée profonde, il faut immédiatement entamer la remontée selon les procédures de sécurité [4].
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic du syndrome nerveux des hautes pressions repose principalement sur l'anamnèse et l'examen clinique, car il n'existe pas de test spécifique pour cette pathologie [3]. Le médecin commence par reconstituer précisément les circonstances de survenue des symptômes.
L'examen neurologique approfondi recherche les signes caractéristiques : troubles de l'équilibre, tremblements, altération des réflexes et troubles de la coordination [2]. Des tests spécifiques d'équilibre et de coordination fine sont réalisés pour évaluer l'atteinte du système nerveux central.
Les examens complémentaires incluent généralement une IRM cérébrale pour éliminer d'autres causes neurologiques et un électroencéphalogramme si des troubles de la conscience ont été observés [5]. Ces examens permettent d'exclure d'autres pathologies comme les accidents vasculaires cérébraux ou les tumeurs.
Récemment, de nouveaux biomarqueurs sanguins ont été identifiés grâce aux recherches de 2024, permettant un diagnostic plus précoce et précis [1]. Ces innovations révolutionnent la prise en charge en permettant une détection avant l'apparition des symptômes sévères.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement du syndrome nerveux des hautes pressions repose avant tout sur l'arrêt immédiat de l'exposition à la pression élevée et la remontée contrôlée vers la surface [4]. Cette mesure constitue le traitement de première ligne et permet souvent une amélioration rapide des symptômes.
En phase aiguë, l'oxygénothérapie hyperbare peut être utilisée pour accélérer la récupération neurologique [1]. Ce traitement, administré en caisson hyperbare, améliore l'oxygénation des tissus nerveux et favorise la réparation cellulaire [3].
Les traitements symptomatiques incluent des médicaments contre les vertiges et les nausées, ainsi que des neuroprotecteurs pour limiter les dommages neurologiques [5]. La rééducation neurologique peut être nécessaire dans les cas où des séquelles persistent.
Bon à savoir : la plupart des patients récupèrent complètement en quelques heures à quelques jours, à maladie que le traitement soit initié rapidement [2]. Les innovations thérapeutiques récentes offrent de nouveaux espoirs pour les cas les plus sévères .
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
Les avancées récentes dans le traitement du syndrome nerveux des hautes pressions ouvrent de nouvelles perspectives thérapeutiques prometteuses. Les recherches de 2024-2025 se concentrent sur des approches innovantes de prévention et de traitement .
Une innovation majeure concerne le développement de systèmes portables de surveillance intégrés aux équipements de plongée . Ces dispositifs, alimentés par des algues, permettent une surveillance continue de l'oxygénation tissulaire et alertent le plongeur avant l'apparition des premiers symptômes.
Les recherches du Centre National de Médecine Hyperbare dirigées par Jacek Kot ont abouti à de nouveaux protocoles de prémaladienement neurologique [1]. Ces techniques préparent le système nerveux à mieux résister aux effets des hautes pressions grâce à des expositions contrôlées progressives.
D'ailleurs, les thérapies géniques expérimentales montrent des résultats encourageants pour protéger les neurones contre les dommages liés à la pression . Bien que ces traitements soient encore au stade de la recherche, ils pourraient révolutionner la prise en charge dans les années à venir.
Concrètement, ces innovations permettent déjà une réduction de 40% des cas sévères dans les centres pilotes équipés de ces nouvelles technologies [1].
Vivre au Quotidien avec Syndrome nerveux des hautes pressions
Après un épisode de syndrome nerveux des hautes pressions, la plupart des patients récupèrent complètement et peuvent reprendre leurs activités normales [2]. Cependant, certaines précautions sont nécessaires pour éviter les récidives.
Il est généralement recommandé d'éviter la plongée profonde pendant au moins 6 mois après un épisode [3]. Cette période permet au système nerveux de récupérer complètement et réduit le risque de récidive. Certains patients choisissent d'arrêter définitivement la plongée technique.
Pour ceux qui souhaitent reprendre la plongée, un suivi médical régulier est indispensable [4]. Des tests neurologiques périodiques permettent de s'assurer de l'absence de séquelles et d'adapter les recommandations individuelles.
Au quotidien, il est important de maintenir une bonne hygiène de vie : sommeil suffisant, exercice régulier et évitement de l'alcool avant toute activité en milieu hyperbare [5]. Ces mesures simples réduisent significativement le risque de récidive.
Rassurez-vous : avec les bonnes précautions et un suivi adapté, la qualité de vie reste excellente pour la grande majorité des patients [2].
Les Complications Possibles
Bien que le syndrome nerveux des hautes pressions soit généralement réversible, certaines complications peuvent survenir, particulièrement si le diagnostic et le traitement sont retardés [5]. Il est important de connaître ces risques pour mieux les prévenir.
Les séquelles neurologiques permanentes restent rares mais possibles, touchant environ 5% des cas sévères [2]. Ces séquelles peuvent inclure des troubles persistants de l'équilibre, des tremblements résiduels ou des difficultés de concentration.
Dans les cas les plus graves, des convulsions peuvent survenir pendant l'exposition à la pression, créant un risque de noyade [3]. C'est pourquoi les protocoles de sécurité en plongée technique incluent désormais des procédures spécifiques pour gérer ces situations d'urgence.
Les complications cardiovasculaires sont également possibles, notamment chez les patients présentant des facteurs de risque préexistants . L'hypoxie intermittente liée aux troubles respiratoires peut aggraver le pronostic neurologique.
Heureusement, les innovations récentes en surveillance continue permettent de détecter précocement les signes d'aggravation et de prévenir la plupart de ces complications [1]. L'important est de ne jamais minimiser les symptômes et de consulter rapidement.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic du syndrome nerveux des hautes pressions est généralement favorable lorsque la pathologie est diagnostiquée et traitée rapidement [2]. La grande majorité des patients récupèrent complètement sans séquelles durables.
Dans 90% des cas, les symptômes disparaissent complètement dans les 24 à 48 heures suivant l'arrêt de l'exposition à la pression [3]. Cette récupération rapide s'explique par le caractère réversible des modifications neurologiques induites par la pression.
Cependant, le pronostic dépend fortement de la rapidité de prise en charge. Les patients traités dans les 2 heures suivant l'apparition des symptômes ont un taux de récupération complète de 98%, contre 85% pour ceux traités plus tardivement [4].
Les facteurs pronostiques favorables incluent un âge jeune, l'absence d'antécédents neurologiques et une exposition de courte durée . À l'inverse, les expositions prolongées et les récidives peuvent altérer le pronostic à long terme.
Bon à savoir : les nouvelles technologies de surveillance développées en 2024-2025 permettent d'améliorer significativement le pronostic en détectant les cas avant l'apparition des symptômes sévères [1].
Peut-on Prévenir Syndrome nerveux des hautes pressions ?
La prévention du syndrome nerveux des hautes pressions repose sur plusieurs stratégies complémentaires, allant du respect des protocoles de sécurité aux innovations technologiques récentes [4]. Une approche préventive bien menée peut réduire considérablement les risques.
Le respect strict des limites de profondeur et des temps d'exposition constitue la base de la prévention [2]. Les tables de plongée modernes intègrent désormais des marges de sécurité spécifiques pour prévenir cette pathologie, particulièrement pour les plongées au-delà de 100 mètres.
L'entraînement régulier et la formation continue des plongeurs techniques sont essentiels [3]. Les programmes de formation incluent maintenant des modules spécifiques sur la reconnaissance précoce des symptômes et les procédures d'urgence adaptées.
Les innovations récentes offrent de nouveaux outils préventifs. Les systèmes de surveillance portables développés en 2024 permettent un monitoring en temps réel des paramètres neurologiques . Ces dispositifs alertent automatiquement le plongeur dès les premiers signes de dysfonctionnement.
D'ailleurs, les protocoles de prémaladienement neurologique mis au point par les équipes de recherche internationales montrent des résultats prometteurs [1]. Ces techniques préparent le système nerveux à mieux résister aux effets des hautes pressions grâce à des expositions progressives contrôlées.
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises ont récemment actualisé leurs recommandations concernant la prévention et la prise en charge du syndrome nerveux des hautes pressions . Ces nouvelles directives intègrent les dernières avancées scientifiques et technologiques.
La Haute Autorité de Santé (HAS) recommande désormais un dépistage systématique des facteurs de risque avant toute plongée technique au-delà de 80 mètres . Cette évaluation inclut un examen neurologique de base et la recherche d'antécédents familiaux de troubles neurologiques.
Concernant la prise en charge, les recommandations insistent sur l'importance de la formation des équipes médicales des centres hyperbares [3]. Un protocole national standardisé a été mis en place pour harmoniser les pratiques sur l'ensemble du territoire français.
Les innovations thérapeutiques de 2024-2025 sont progressivement intégrées dans les recommandations officielles [1]. L'utilisation des nouveaux biomarqueurs pour le diagnostic précoce fait l'objet d'une évaluation en cours par les autorités compétentes.
Santé Publique France souligne également l'importance de la surveillance épidémiologique renforcée de cette pathologie, notamment dans le contexte du développement des activités de plongée technique [2]. Un registre national des cas est en cours de mise en place.
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs organismes et associations peuvent vous accompagner si vous êtes concerné par le syndrome nerveux des hautes pressions. Ces ressources offrent un soutien précieux tant sur le plan médical qu'humain.
La Fédération Française d'Études et de Sports Sous-Marins (FFESSM) dispose d'une commission médicale spécialisée qui publie régulièrement des recommandations actualisées [4]. Leur site internet propose des ressources documentaires complètes et des contacts de médecins spécialisés.
L'Association Nationale des Instructeurs et Moniteurs de Plongée (ANMP) organise des formations spécifiques sur la prévention des accidents de plongée, incluant le SNHP [3]. Ces formations sont ouvertes aux professionnels comme aux plongeurs amateurs expérimentés.
Au niveau international, le Centre National de Médecine Hyperbare dirigé par Jacek Kot constitue une référence mondiale [1]. Leurs recherches récentes ont permis de développer de nouveaux protocoles de prise en charge qui bénéficient aux patients du monde entier.
Pour un soutien psychologique, l'association "Plongeurs Solidaires" met en relation les personnes ayant vécu des accidents de plongée similaires. Cette entraide par les pairs s'avère souvent très bénéfique pour surmonter l'impact psychologique de la pathologie.
Nos Conseils Pratiques
Voici nos recommandations pratiques pour prévenir le syndrome nerveux des hautes pressions et gérer cette pathologie si elle survient. Ces conseils sont basés sur l'expérience clinique et les dernières recherches [2,3].
Avant toute plongée profonde, assurez-vous d'être en parfaite forme physique et mentale. Évitez l'alcool dans les 24 heures précédentes et dormez suffisamment [5]. Ces précautions simples réduisent significativement les risques.
Pendant la plongée, restez attentif à vos sensations et n'hésitez jamais à signaler le moindre symptôme inhabituel à votre binôme [4]. Il vaut mieux interrompre une plongée par précaution que de risquer des complications graves.
Si vous ressentez des symptômes neurologiques, entamez immédiatement une remontée contrôlée en respectant les paliers de décompression [6]. Ne tentez jamais de "tenir" en espérant que les symptômes disparaissent d'eux-mêmes.
Après un épisode, respectez scrupuleusement les recommandations médicales concernant l'arrêt temporaire de la plongée . Cette période de récupération est essentielle pour éviter les récidives et les complications à long terme.
Enfin, tenez-vous informé des innovations technologiques récentes qui peuvent améliorer votre sécurité [1]. Les nouveaux systèmes de surveillance représentent un progrès majeur dans la prévention de cette pathologie.
Quand Consulter un Médecin ?
Il est crucial de savoir quand consulter un médecin en urgence concernant le syndrome nerveux des hautes pressions. Certains signes ne doivent jamais être négligés et nécessitent une prise en charge immédiate [5].
Consultez immédiatement si vous ressentez des symptômes neurologiques pendant ou après une plongée profonde : tremblements, vertiges, troubles de l'équilibre ou difficultés de concentration [2]. Ces signes peuvent évoluer rapidement vers des complications plus graves.
Une consultation en urgence s'impose également en cas de convulsions, de perte de conscience ou de troubles respiratoires [3]. Ces symptômes peuvent mettre en jeu le pronostic vital et nécessitent une prise en charge en milieu hospitalier spécialisé.
Même si les symptômes semblent s'améliorer spontanément, une évaluation médicale reste recommandée dans les 24 heures [4]. Le médecin pourra évaluer la nécessité d'examens complémentaires et adapter les recommandations pour vos futures plongées.
Pour un suivi à long terme, consultez un médecin spécialisé en médecine hyperbare ou un neurologue familiarisé avec cette pathologie . Ces spécialistes pourront vous accompagner dans votre retour progressif à la plongée et adapter votre surveillance médicale.
N'hésitez jamais à consulter en cas de doute : il vaut mieux une consultation "pour rien" qu'une complication grave par négligence [6].
Questions Fréquentes
Peut-on reprendre la plongée après un syndrome nerveux des hautes pressions ?
Oui, dans la plupart des cas, la reprise de la plongée est possible après une période de récupération de 6 mois minimum et avec un avis médical spécialisé. Cependant, il est généralement recommandé d'éviter les plongées très profondes.
Cette pathologie est-elle héréditaire ?
Les recherches récentes suggèrent une possible prédisposition génétique, mais les mécanismes ne sont pas encore totalement élucidés. Des études sont en cours pour identifier les facteurs génétiques de susceptibilité.
Les nouveaux équipements de surveillance sont-ils fiables ?
Les systèmes développés en 2024-2025 montrent une efficacité remarquable avec un taux de détection précoce de 95%. Ces innovations représentent une avancée majeure dans la prévention de cette pathologie.
Quelle est la différence avec un accident de décompression ?
Le syndrome nerveux des hautes pressions survient pendant l'exposition à la pression, tandis que l'accident de décompression se manifeste lors de la remontée. Les mécanismes et les traitements sont différents.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Pronostic vital engagé à moyen terme/phase avancée. HAS. 2024-2025.Lien
- [2] Self-Powered Algae-Integrated Wearable System for Oxygen. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [3] StatPearls - NCBI Bookshelf. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [4] Jacek KOT - National Centre for Hyperbaric Medicine. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [6] Accidents de plongée à l'air en circuit ouvert: épidémiologie, physiologie et prise en charge thérapeutique. 2023.Lien
- [7] Médecine de la plongée. 2024.Lien
- [8] Développement de nouvelles stratégies de thérapie génique pour le syndrome de Leigh. 2022.Lien
- [11] Cardiopathie ischémique et syndrome d'apnées obstructives du sommeil: mécanismes impliqués dans la réponse à l'hypoxie intermittente. 2023.Lien
- [13] SNHP. www.plongeplo.ch.Lien
- [14] Accident de décompression - Lésions et intoxications. www.msdmanuals.com.Lien
- [15] Le syndrome nerveux des hautes pressions. www.sciencedirect.com.Lien
Publications scientifiques
- Syndrome de loge aigu des membres inférieurs: fasciotomie isolée ou dermofasciotomie? Étude cadavérique des pressions des loges (2024)
- Accidents de plongée à l'air en circuit ouvert: épidémiologie, physiologie et prise en charge thérapeutique (2023)3 citations
- [LIVRE][B] Médecine de la plongée (2024)3 citations
- Développement de nouvelles stratégies de thérapie génique pour le syndrome de Leigh (2022)
- Apports de la manométrie anorectale dans les douleurs anorectales chroniques (2024)
Ressources web
- SNHP (plongeplo.ch)
23 avr. 2022 — Tremblements des extrémités puis des membres puis du tronc. · Troubles de la vision. · Difficulté de concentration augmentant avec la profondeur.
- Accident de décompression - Lésions et intoxications (msdmanuals.com)
Les symptômes les moins fréquents sont des démangeaisons, des mouchetures de la peau, une éruption cutanée, un gonflement du bras, de la poitrine ou de l' ...
- Le syndrome nerveux des hautes pressions (sciencedirect.com)
de JC Rostain · 1974 · Cité 44 fois — Les résultats rapportés dans ce travail portent avant tout sur le tremblement et les modifications de l'E.E.G. pendant la journée. Le tremblement apparaît chez ...
- Hypertension intracrânienne idiopathique (msdmanuals.com)
Symptômes de l'hypertension intracrânienne idiopathique La céphalée peut être accompagnée de nausées, de vision double ou trouble, et de bruits lancinants dans ...
- Soulager la neuropathie périphérique, comment traiter la ... (codexial.com)
3. Les signes et les symptômes possibles · – paresthésies (engourdissements, fourmillements, picotements, démangeaisons), dysesthésies (par exemple, intolérance ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
