Syndrome génitosurrénal : Symptômes, Diagnostic et Traitements 2025
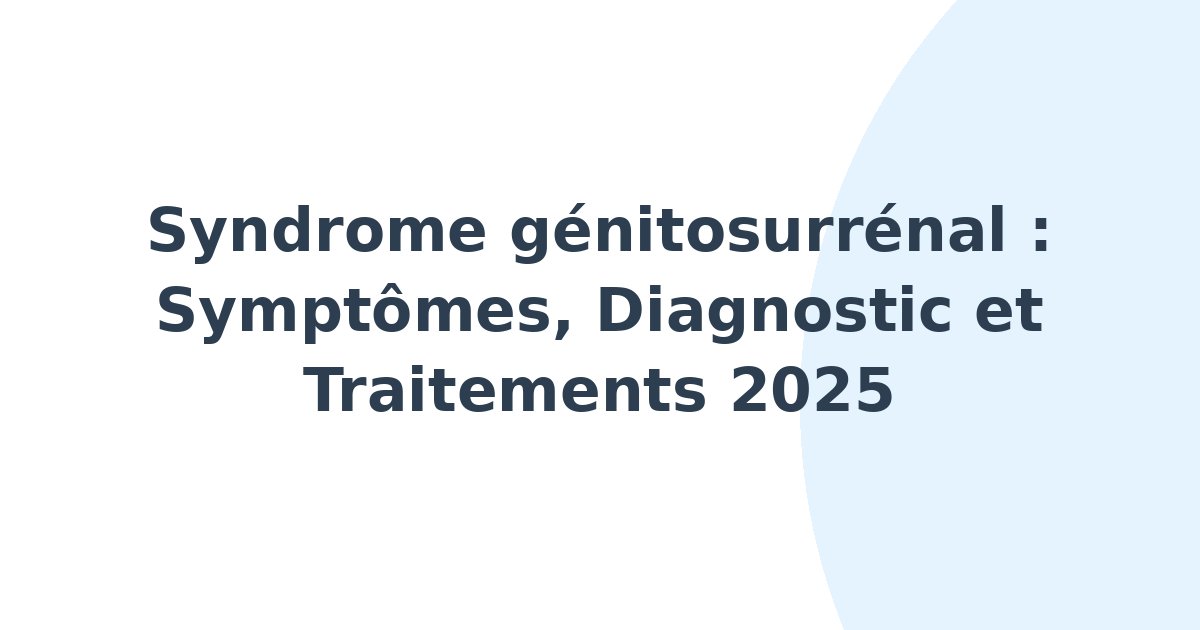
Le syndrome génitosurrénal, aussi appelé hyperplasie surrénale congénitale, touche environ 1 naissance sur 15 000 en France [2]. Cette pathologie hormonale complexe affecte la production de cortisol et d'aldostérone par les glandes surrénales. Bien que rare, elle nécessite une prise en charge spécialisée dès la naissance. Heureusement, les avancées thérapeutiques récentes, notamment le développement du crinecerfont [3], offrent de nouveaux espoirs aux patients et leurs familles.

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Syndrome génitosurrénal : Définition et Vue d'Ensemble
Le syndrome génitosurrénal représente un groupe de maladies génétiques rares qui affectent la production d'hormones par les glandes surrénales [2,6]. Ces petites glandes, situées au-dessus des reins, jouent un rôle crucial dans la régulation de nombreuses fonctions corporelles.
Concrètement, cette pathologie résulte d'un déficit enzymatique héréditaire qui perturbe la synthèse du cortisol et parfois de l'aldostérone [5,6]. En réponse à cette déficience, l'organisme produit des quantités excessives d'hormones androgènes, ce qui explique les manifestations cliniques caractéristiques.
Il existe plusieurs formes de cette maladie, mais la plus fréquente est le déficit en 21-hydroxylase, représentant environ 95% des cas [2]. D'ailleurs, cette forme peut se présenter sous trois variantes : classique avec perte de sel, classique simple virilisante, et non classique ou tardive.
L'important à retenir, c'est que malgré sa complexité apparente, cette pathologie se gère très bien aujourd'hui grâce aux traitements hormonaux substitutifs [3,5]. Les enfants atteints peuvent mener une vie normale avec un suivi médical approprié.
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, le syndrome génitosurrénal touche approximativement 1 naissance sur 15 000, soit environ 50 nouveaux cas par an [2]. Cette prévalence place notre pays dans la moyenne européenne, légèrement inférieure aux données scandinaves où l'incidence atteint 1/12 000 naissances.
Les données de Santé publique France révèlent une répartition équilibrée entre les sexes, contrairement à d'autres pathologies endocriniennes [2,6]. Cependant, le diagnostic est souvent plus précoce chez les filles en raison des signes de virilisation génitale externe plus évidents à la naissance.
Au niveau mondial, on observe des variations géographiques significatives. Les populations d'origine ashkénaze présentent une incidence plus élevée (1/3 500), tandis que certaines régions d'Afrique subsaharienne rapportent des taux inférieurs, probablement sous-estimés par manque de dépistage systématique [2].
Bon à savoir : depuis l'introduction du dépistage néonatal en France dans les années 1990, le diagnostic précoce a considérablement amélioré le pronostic. Aujourd'hui, plus de 95% des cas sont détectés avant l'âge de 3 mois [6].
L'évolution épidémiologique sur les 10 dernières années montre une stabilité de l'incidence, mais une amélioration notable de la prise en charge. Les projections pour 2025-2030 suggèrent que les nouvelles thérapies comme le crinecerfont pourraient transformer la qualité de vie des patients [3].
Les Causes et Facteurs de Risque
Le syndrome génitosurrénal résulte exclusivement de mutations génétiques héréditaires transmises selon un mode autosomique récessif [2,6]. Cela signifie que les deux parents doivent être porteurs du gène défaillant pour que leur enfant développe la maladie.
Dans 95% des cas, la mutation affecte le gène CYP21A2, responsable de la production de l'enzyme 21-hydroxylase [2]. Cette enzyme joue un rôle crucial dans la conversion des précurseurs hormonaux en cortisol et aldostérone. D'autres gènes peuvent être impliqués, notamment CYP11B1 (déficit en 11β-hydroxylase) et CYP17A1.
Contrairement à de nombreuses pathologies, il n'existe pas de facteurs de risque environnementaux ou comportementaux. L'âge des parents, leur mode de vie ou leur exposition à des toxiques n'influencent pas le risque de transmission [6].
Cependant, certains facteurs augmentent la probabilité statistique. La consanguinité multiplie par 25 le risque de naissance d'un enfant atteint. De même, les antécédents familiaux constituent le principal indicateur : si un couple a déjà eu un enfant atteint, le risque de récurrence est de 25% pour chaque grossesse ultérieure [2,6].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les manifestations du syndrome génitosurrénal varient considérablement selon la forme et l'âge du patient. Chez le nouveau-né, les signes peuvent être subtils ou au contraire très évidents [4,5].
Chez les filles, la virilisation génitale constitue souvent le premier signe d'alerte. Les organes génitaux externes présentent un aspect masculinisé à des degrés variables : hypertrophie clitoridienne, fusion labiale partielle ou complète. Ces anomalies sont généralement détectées dès la naissance lors de l'examen clinique [6].
Les garçons peuvent présenter une pseudo-puberté précoce avec développement musculaire excessif, croissance accélérée et maturation osseuse avancée. Paradoxalement, leurs organes génitaux peuvent paraître normaux ou même légèrement hypertrophiés [4,5].
Dans les formes avec perte de sel, les symptômes apparaissent généralement entre 7 et 21 jours de vie. Vous pourriez observer des vomissements, une déshydratation rapide, une perte de poids importante et une léthargie [5]. Ces signes constituent une urgence médicale absolue.
Chez l'enfant plus âgé et l'adulte, les symptômes incluent une croissance accélérée suivie d'un arrêt prématuré, une pilosité excessive, de l'acné sévère et des troubles de la fertilité [4,6]. Les femmes peuvent présenter des cycles menstruels irréguliers ou une aménorrhée.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic du syndrome génitosurrénal repose sur une approche méthodique combinant examens cliniques et analyses biologiques spécialisées [5,6]. En France, le dépistage néonatal systématique permet une détection précoce dans la majorité des cas.
La première étape consiste en un dosage de la 17-hydroxyprogestérone (17-OHP) sur papier buvard, réalisé entre le 3ème et 5ème jour de vie [6]. Un taux élevé nécessite une confirmation par dosage plasmatique et analyse des stéroïdes urinaires. Cette approche permet d'identifier 95% des formes classiques.
L'analyse génétique moléculaire confirme le diagnostic en identifiant les mutations responsables [2,6]. Elle permet également de déterminer le type exact de déficit enzymatique et d'orienter le conseil génétique familial. Les techniques de séquençage nouvelle génération ont révolutionné cette étape diagnostique.
Chez les patients plus âgés, le diagnostic peut nécessiter des tests de stimulation à l'ACTH pour révéler des déficits partiels [5]. Ces examens mesurent la réponse des glandes surrénales à une stimulation hormonale artificielle.
L'imagerie médicale, notamment l'échographie pelvienne et l'IRM, aide à évaluer l'anatomie génitale interne chez les filles présentant une virilisation [4,6]. Ces examens orientent les décisions chirurgicales éventuelles.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
La prise en charge du syndrome génitosurrénal repose principalement sur l'hormonothérapie substitutive, adaptée à chaque patient selon sa forme clinique [3,5]. L'objectif est de compenser les déficits hormonaux tout en contrôlant l'excès d'androgènes.
L'hydrocortisone constitue le traitement de référence pour remplacer le cortisol déficient [5]. Les doses sont soigneusement ajustées selon l'âge, le poids et la réponse biologique. Chez l'enfant, on privilégie des prises fractionnées pour mimer le rythme circadien naturel.
Dans les formes avec perte de sel, la fludrocortisone (Florinef®) compense le déficit en aldostérone [5,6]. Ce traitement prévient les crises de déshydratation et maintient l'équilibre électrolytique. Un apport sodé supplémentaire est souvent nécessaire chez le nourrisson.
Les situations de stress (fièvre, chirurgie, traumatisme) nécessitent une augmentation temporaire des doses de cortisol [5]. Cette adaptation, appelée "stress dosing", prévient l'insuffisance surrénale aiguë, complication potentiellement mortelle.
Certains patients bénéficient de traitements complémentaires : anti-androgènes pour contrôler la virilisation, hormone de croissance en cas de retard statural, ou thérapies psychologiques pour accompagner les questionnements identitaires [6].
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024 marque un tournant dans la prise en charge du syndrome génitosurrénal avec l'émergence de nouvelles approches thérapeutiques prometteuses [1,3]. Ces innovations visent à améliorer la qualité de vie des patients tout en réduisant les effets secondaires des traitements conventionnels.
Le crinecerfont, développé par Neurocrine Biosciences, représente l'avancée la plus significative [3]. Ce modulateur sélectif du récepteur CRF1 (corticotropin-releasing factor) permet de réduire la production excessive d'ACTH sans compromettre la fonction surrénalienne résiduelle. Les essais cliniques de phase III montrent des résultats encourageants.
D'ailleurs, cette molécule pourrait révolutionner le traitement en permettant une réduction des doses de glucocorticoïdes [3]. Cela diminuerait significativement les risques de retard de croissance, d'ostéoporose et de troubles métaboliques associés aux traitements actuels.
Parallèlement, les recherches sur la thérapie génique progressent rapidement [2]. Plusieurs équipes travaillent sur des vecteurs viraux capables de restaurer l'expression de l'enzyme déficiente directement dans les cellules surrénaliennes. Bien que ces approches restent expérimentales, elles ouvrent des perspectives de guérison définitive.
Les technologies de médecine personnalisée permettent désormais d'adapter finement les traitements selon le profil génétique de chaque patient [1,2]. Cette approche optimise l'efficacité thérapeutique tout en minimisant les effets indésirables.
Vivre au Quotidien avec Syndrome génitosurrénal
Vivre avec un syndrome génitosurrénal nécessite quelques adaptations, mais n'empêche pas de mener une vie épanouie [5,6]. L'essentiel réside dans une bonne compréhension de sa pathologie et un suivi médical régulier.
La gestion des traitements hormonaux devient rapidement une routine. Il est crucial de respecter scrupuleusement les horaires de prise et de ne jamais interrompre brutalement le traitement [5]. Beaucoup de patients utilisent des applications mobiles pour programmer leurs rappels médicamenteux.
En cas de maladie intercurrente, vous devez augmenter temporairement vos doses de cortisol [5,6]. Cette règle du "stress dosing" s'applique en cas de fièvre supérieure à 38°C, de vomissements, de diarrhée ou avant une intervention chirurgicale. Votre médecin vous fournira un protocole précis à suivre.
L'activité physique est non seulement possible mais recommandée [6]. Cependant, les sports intenses nécessitent une surveillance particulière de l'hydratation et parfois un ajustement des doses de fludrocortisone. La natation, la marche et le cyclisme sont particulièrement bénéfiques.
Sur le plan psychologique, certains patients traversent des périodes difficiles, notamment à l'adolescence. Les questions d'identité sexuelle et de fertilité peuvent générer de l'anxiété. Heureusement, un accompagnement psychologique spécialisé aide à surmonter ces défis [6].
Les Complications Possibles
Bien que généralement bien contrôlé, le syndrome génitosurrénal peut présenter certaines complications, particulièrement en cas de prise en charge inadéquate [4,5]. La connaissance de ces risques permet une prévention efficace.
L'insuffisance surrénale aiguë représente la complication la plus redoutable [5]. Elle survient lors d'un stress important (infection, chirurgie, traumatisme) si les doses de cortisol ne sont pas adaptées. Les signes d'alerte incluent vomissements, déshydratation sévère, hypotension et troubles de la conscience. Cette situation constitue une urgence vitale nécessitant une hospitalisation immédiate.
À long terme, un traitement mal équilibré peut entraîner des troubles de la croissance [4,6]. Un excès de glucocorticoïdes ralentit la croissance et retarde la puberté, tandis qu'un sous-dosage favorise une avance staturale précoce suivie d'un arrêt prématuré. Le suivi régulier de la courbe de croissance permet d'ajuster finement les traitements.
Les complications métaboliques incluent l'ostéoporose, le diabète et l'hypertension artérielle, particulièrement chez les patients recevant des doses élevées de corticoïdes [5,6]. Une surveillance biologique régulière et des mesures préventives (supplémentation calcique, activité physique) limitent ces risques.
Chez les femmes, les troubles de la fertilité peuvent compliquer les projets de grossesse [6]. Cependant, avec un suivi gynécologique spécialisé et un équilibrage optimal du traitement, la plupart peuvent concevoir naturellement.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic du syndrome génitosurrénal s'est considérablement amélioré ces dernières décennies grâce aux progrès diagnostiques et thérapeutiques [2,6]. Aujourd'hui, la plupart des patients peuvent espérer une espérance de vie normale avec une qualité de vie satisfaisante.
Chez les enfants diagnostiqués précocement et correctement traités, le développement psychomoteur est généralement normal [6]. Les capacités intellectuelles ne sont pas affectées par la maladie elle-même. Cependant, certains enfants peuvent présenter des difficultés d'apprentissage liées aux hospitalisations répétées ou aux effets secondaires des traitements.
La croissance finale dépend largement de la qualité de l'équilibrage thérapeutique [4,6]. Avec un suivi optimal, 80% des patients atteignent une taille adulte dans les limites de la normale. Les innovations récentes comme le crinecerfont pourraient encore améliorer ces résultats [3].
Concernant la fertilité, les données sont encourageantes. Chez les hommes, la fonction reproductive est généralement préservée avec un traitement adapté [6]. Chez les femmes, bien que des irrégularités menstruelles soient fréquentes, la plupart peuvent concevoir avec un accompagnement médical approprié.
L'aspect psychosocial mérite une attention particulière. Les questions d'identité sexuelle, notamment chez les filles ayant subi une chirurgie génitale, nécessitent un accompagnement spécialisé [6]. Heureusement, les approches multidisciplinaires actuelles permettent un développement harmonieux de la personnalité.
Peut-on Prévenir Syndrome génitosurrénal ?
Le syndrome génitosurrénal étant une maladie génétique héréditaire, il n'existe pas de prévention primaire au sens classique [2,6]. Cependant, plusieurs approches permettent de réduire les risques ou d'améliorer la prise en charge précoce.
Le conseil génétique constitue l'outil préventif principal pour les familles à risque [6]. Si vous avez des antécédents familiaux ou avez déjà eu un enfant atteint, une consultation génétique vous aidera à évaluer les risques de récurrence. Les généticiens peuvent proposer un dépistage des porteurs chez les apparentés.
Le diagnostic prénatal est possible dès 10-12 semaines de grossesse par biopsie de villosités choriales ou amniocentèse [2,6]. Cette approche permet aux couples à haut risque de connaître le statut génétique du fœtus. Cependant, cette démarche soulève des questions éthiques complexes que chaque famille doit considérer.
Plus récemment, le diagnostic préimplantatoire (DPI) offre une alternative aux couples ayant recours à la fécondation in vitro [2]. Cette technique permet de sélectionner les embryons non atteints avant l'implantation, évitant ainsi la transmission de la maladie.
En attendant, la prévention secondaire repose sur le dépistage néonatal systématique [6]. En France, ce programme national permet de diagnostiquer précocement la majorité des cas, améliorant considérablement le pronostic. L'objectif est d'initier le traitement avant l'apparition des complications.
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises ont établi des recommandations précises pour la prise en charge du syndrome génitosurrénal, régulièrement mises à jour selon les dernières données scientifiques [6]. Ces guidelines visent à harmoniser les pratiques et optimiser les résultats thérapeutiques.
La Haute Autorité de Santé (HAS) préconise un diagnostic dans les 48 heures suivant un dépistage néonatal positif [6]. Le protocole national de diagnostic et de soins (PNDS) détaille précisément les étapes diagnostiques, les examens complémentaires nécessaires et les critères d'orientation vers les centres spécialisés.
Concernant le traitement, les recommandations insistent sur l'importance d'un suivi multidisciplinaire [5,6]. L'équipe doit inclure un endocrinologue pédiatrique, un généticien, un psychologue et selon les cas, un chirurgien pédiatrique et un gynécologue. Cette approche globale garantit une prise en charge optimale de tous les aspects de la maladie.
Les centres de référence maladies rares (CRMR) jouent un rôle central dans l'organisation des soins [6]. En France, le réseau FIRENDO coordonne la prise en charge des maladies endocriniennes rares, incluant le syndrome génitosurrénal. Ces centres assurent l'expertise diagnostique, l'adaptation thérapeutique et la formation des professionnels.
Récemment, les autorités ont intégré les nouvelles thérapies comme le crinecerfont dans leurs évaluations [3]. L'objectif est de faciliter l'accès aux innovations tout en maintenant la sécurité des patients.
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs associations de patients accompagnent les familles touchées par le syndrome génitosurrénal en France [6]. Ces organisations offrent soutien, information et défense des droits des malades.
L'Association Française des Malades de l'Hyperplasie Congénitale des Surrénales (AFMHCS) constitue la référence nationale. Elle organise des rencontres annuelles, publie des guides d'information et facilite les échanges entre familles. Leur site internet propose des ressources documentaires actualisées et un forum de discussion.
Au niveau européen, l'European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE) développe des outils éducatifs destinés aux patients et familles [6]. Leurs brochures, traduites en français, expliquent simplement les aspects médicaux de la maladie.
Les réseaux sociaux jouent un rôle croissant dans l'entraide entre familles. Des groupes Facebook privés permettent de partager expériences et conseils pratiques. Cependant, il convient de vérifier la fiabilité des informations échangées avec votre équipe médicale.
Pour les aspects administratifs, la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) peut accorder des aides selon le retentissement de la maladie [6]. L'Allocation d'Éducation de l'Enfant Handicapé (AEEH) et la carte d'invalidité facilitent certaines démarches quotidiennes.
Nos Conseils Pratiques
Vivre avec un syndrome génitosurrénal nécessite quelques adaptations pratiques qui, une fois intégrées, facilitent grandement le quotidien [5,6]. Voici nos recommandations basées sur l'expérience des patients et familles.
Constituez une trousse d'urgence contenant une ampoule d'hydrocortisone injectable, une seringue et une notice explicative [5]. Gardez-la toujours à portée de main : domicile, voiture, lieu de travail. Formez votre entourage proche à son utilisation en cas d'urgence.
Établissez un carnet de suivi détaillé incluant les doses quotidiennes, les adaptations lors de stress, les résultats biologiques et les observations cliniques [6]. Cette documentation facilite les consultations médicales et permet un ajustement optimal des traitements.
Planifiez soigneusement vos voyages en emportant une réserve suffisante de médicaments et une ordonnance traduite si nécessaire [5]. Informez-vous sur les décalages horaires pour adapter les prises. Une assurance voyage spécialisée peut être utile.
Développez un réseau de soutien incluant famille, amis et professionnels de santé [6]. N'hésitez pas à expliquer votre pathologie à votre entourage : leur compréhension facilitera votre quotidien. Les groupes de patients offrent également un soutien précieux.
Maintenez une activité physique régulière adaptée à vos capacités [6]. Sport, marche, jardinage : l'important est de bouger quotidiennement. Cela améliore votre forme physique et votre moral.
Quand Consulter un Médecin ?
Certaines situations nécessitent une consultation médicale urgente chez les patients atteints de syndrome génitosurrénal [4,5]. La reconnaissance précoce de ces signes d'alerte peut prévenir des complications graves.
Consultez immédiatement en cas de vomissements répétés empêchant la prise des médicaments, de diarrhée profuse, de fièvre supérieure à 39°C ou de signes de déshydratation [5]. Ces symptômes peuvent déclencher une insuffisance surrénale aiguë, complication potentiellement mortelle.
Les signes neurologiques comme confusion, somnolence excessive, convulsions ou perte de conscience constituent également des urgences absolues [4,5]. N'attendez pas : appelez le SAMU (15) ou rendez-vous directement aux urgences.
Pour les consultations programmées, contactez votre endocrinologue si vous observez des changements inhabituels : modification de l'appétit, variations pondérales importantes, troubles du sommeil persistants ou signes de virilisation progressive [6].
Chez l'enfant, surveillez particulièrement la courbe de croissance [4,6]. Un ralentissement ou une accélération brutale de la croissance nécessite un ajustement thérapeutique. De même, l'apparition de signes pubertaires précoces (avant 8 ans chez la fille, 9 ans chez le garçon) doit motiver une consultation rapide.
N'hésitez jamais à contacter votre équipe médicale en cas de doute. Il vaut mieux une consultation "pour rien" qu'une complication évitable [5].
Questions Fréquentes
Mon enfant peut-il faire du sport avec un syndrome génitosurrénal ?Absolument ! L'activité physique est même recommandée [6]. Cependant, adaptez l'hydratation et surveillez les signes de fatigue excessive. Pour les sports intenses, discutez avec votre médecin d'un éventuel ajustement des doses de fludrocortisone.
Faut-il augmenter les médicaments en cas de stress émotionnel ?
Le stress physique (fièvre, chirurgie) nécessite effectivement une adaptation des doses [5]. Pour le stress émotionnel pur, ce n'est généralement pas nécessaire, mais discutez-en avec votre équipe médicale.
Cette maladie affecte-t-elle l'intelligence ?
Non, le syndrome génitosurrénal n'altère pas les capacités intellectuelles [6]. Votre enfant peut suivre une scolarité normale et réussir comme tous les autres.
Peut-on guérir définitivement de cette maladie ?
Actuellement, il n'existe pas de guérison définitive [2,3]. Cependant, les recherches en thérapie génique sont prometteuses et pourraient changer la donne dans les années à venir.
Les femmes atteintes peuvent-elles avoir des enfants ?
Oui, la plupart des femmes peuvent concevoir avec un suivi gynécologique adapté [6]. La grossesse nécessite un ajustement minutieux des traitements, mais elle reste tout à fait possible.
Combien coûte le traitement ?
En France, les médicaments sont intégralement remboursés dans le cadre de l'Affection de Longue Durée (ALD) [6]. Les consultations spécialisées et examens de suivi sont également pris en charge.
Questions Fréquentes
Mon enfant peut-il faire du sport avec un syndrome génitosurrénal ?
Absolument ! L'activité physique est même recommandée. Cependant, adaptez l'hydratation et surveillez les signes de fatigue excessive.
Cette maladie affecte-t-elle l'intelligence ?
Non, le syndrome génitosurrénal n'altère pas les capacités intellectuelles. Votre enfant peut suivre une scolarité normale.
Les femmes atteintes peuvent-elles avoir des enfants ?
Oui, la plupart des femmes peuvent concevoir avec un suivi gynécologique adapté et un ajustement des traitements.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Approval prospects for BioTissue's diabetic foot ulcer drug - Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [2] ADRENAL HYPERPLASIA, CONGENITAL, DUE - Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [3] Crinecerfont - Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [4] Symptômes du cancer de la glande surrénaleLien
- [5] Insuffisance surrénalienne - Troubles hormonauxLien
- [6] Dictionnaire médical de l'Académie de Médecine - Hyperplasie surrénale congénitaleLien
Ressources web
- Symptômes du cancer de la glande surrénale (cancer.ca)
Symptômes causés par une surproduction d'aldostérone · pression artérielle élevée; · faiblesse musculaire; · crampes musculaires; · soif accrue; · envies d'uriner ...
- Insuffisance surrénalienne - Troubles hormonaux et ... (msdmanuals.com)
La plupart des personnes perdent du poids, se déshydratent, manquent d'appétit et développent des douleurs musculaires, des nausées, des vomissements et des ...
- Dictionnaire médical de l'Académie de Médecine (academie-medecine.fr)
Syndrome provoqué soit par la décompensation d'une maladie d'Addison, soit par majoration d'un déficit en A.C.T.H.. Il est favorisé par un stress relevant d'une ...
- Troubles de la glande surrénale - Endocrinologie (chuv.ch)
il y a 5 jours — Une maladie des glandes surrénales peut se manifester par des signes d'excès hormonal, comme une virilisation chez la jeune fille (acné, ...
- Traitements du corticosurrénalome (cancer.ca)
On peut traiter le corticosurrénalome (CCS) au moyen de la chirurgie, de médicaments de soutien et de la chimiothérapie. On pourrait aussi avoir recours à ...

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
