Séminome : Guide Complet 2025 - Symptômes, Traitements et Innovations
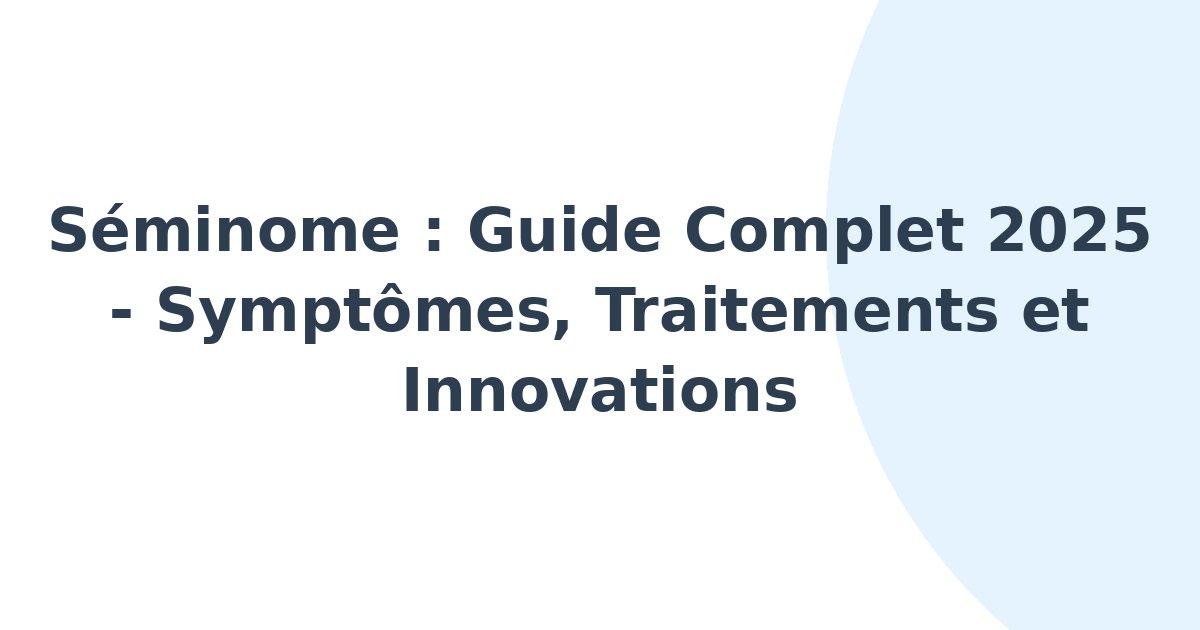
Le séminome représente la forme la plus fréquente de cancer testiculaire, touchant principalement les hommes entre 25 et 45 ans. Cette pathologie, bien que préoccupante, bénéficie aujourd'hui de traitements très efficaces avec des taux de guérison dépassant 95% lorsqu'elle est détectée précocement. Les innovations thérapeutiques de 2024-2025 offrent de nouveaux espoirs, notamment avec les approches de désescalade thérapeutique et les biomarqueurs révolutionnaires.

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Séminome : Définition et Vue d'Ensemble
Le séminome constitue une tumeur germinale maligne développée aux dépens des cellules germinales du testicule. Cette pathologie représente environ 50% de tous les cancers testiculaires [12,13]. Contrairement aux idées reçues, le séminome touche des hommes relativement jeunes, avec un pic d'incidence entre 30 et 40 ans.
D'un point de vue histologique, le séminome se caractérise par des cellules uniformes, grandes et claires, organisées en nappes ou en cordons. Ces cellules présentent une forte sensibilité à la radiothérapie, ce qui constitue un avantage thérapeutique majeur [13]. La pathologie se distingue des tumeurs non séminomateuses par sa croissance généralement plus lente et son meilleur pronostic.
Mais attention, le séminome peut parfois se présenter sous des formes atypiques. Certains patients développent des formes mixtes associant des éléments séminomateux et non séminomateux [8]. Ces cas particuliers nécessitent une prise en charge spécialisée et un suivi renforcé.
L'important à retenir : le séminome reste une pathologie de bon pronostic lorsqu'il est diagnostiqué et traité précocement. Les avancées récentes en matière de biomarqueurs, notamment le miRNA-M371, révolutionnent le diagnostic et le suivi de cette maladie [7].
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, le séminome représente une pathologie relativement rare mais en augmentation constante. L'incidence annuelle s'établit à environ 2,5 cas pour 100 000 hommes, soit près de 1 200 nouveaux cas diagnostiqués chaque année [13]. Cette incidence a progressé de 15% au cours des dix dernières années, une tendance observée dans la plupart des pays développés.
Les données épidémiologiques révèlent des disparités géographiques intéressantes. Les pays nordiques affichent les taux d'incidence les plus élevés, avec 8 à 10 cas pour 100 000 hommes au Danemark et en Norvège. À l'inverse, les populations africaines et asiatiques présentent des taux nettement inférieurs, suggérant des facteurs génétiques et environnementaux complexes [2].
Concernant l'âge, le séminome touche principalement les hommes entre 25 et 45 ans, avec un âge médian au diagnostic de 37 ans. Cependant, on observe une augmentation préoccupante des cas chez les hommes de plus de 50 ans, phénomène encore mal expliqué par les spécialistes [8]. Cette évolution démographique influence les stratégies thérapeutiques, notamment chez les patients âgés présentant des comorbidités.
L'impact économique sur le système de santé français reste modéré, estimé à environ 25 millions d'euros annuels. Mais ce coût pourrait augmenter avec le vieillissement de la population et l'émergence de nouvelles thérapies ciblées plus onéreuses [1,2].
Les Causes et Facteurs de Risque
Les causes exactes du séminome demeurent largement méconnues, mais plusieurs facteurs de risque ont été clairement identifiés. La cryptorchidie, ou testicule non descendu, constitue le facteur de risque le plus important, multipliant par 10 le risque de développer un séminome [13]. Cette anomalie congénitale affecte environ 3% des nouveau-nés masculins.
Les antécédents familiaux jouent également un rôle significatif. Un homme dont le père ou le frère a développé un cancer testiculaire présente un risque 4 à 8 fois supérieur à la population générale [12]. Ces données suggèrent une composante génétique forte, actuellement étudiée par plusieurs équipes de recherche internationales.
D'autres facteurs environnementaux et constitutionnels sont suspectés. L'exposition in utero aux œstrogènes, le syndrome de Klinefelter, ou encore certaines infections virales comme les oreillons pourraient favoriser le développement de la pathologie [13]. Cependant, ces associations restent débattues dans la communauté scientifique.
Bon à savoir : contrairement à d'autres cancers, le mode de vie semble avoir peu d'influence sur le risque de séminome. Ni le tabagisme, ni l'alcool, ni l'alimentation n'ont été formellement associés à cette pathologie [12]. Cette particularité complique les stratégies de prévention primaire.
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Le séminome se manifeste généralement par des symptômes relativement discrets, ce qui peut retarder le diagnostic. Le signe le plus fréquent reste l'apparition d'une masse testiculaire indolore, découverte lors de l'autopalpation ou d'un examen médical de routine [12,13]. Cette masse présente une consistance dure et irrégulière, différente du tissu testiculaire normal.
Certains patients rapportent une sensation de pesanteur ou d'inconfort au niveau du scrotum, particulièrement en fin de journée. Ces symptômes, bien que non spécifiques, doivent alerter et motiver une consultation médicale rapide [13]. D'ailleurs, il est recommandé à tous les hommes de pratiquer régulièrement l'autopalpation testiculaire, idéalement après une douche chaude.
Dans les formes plus avancées, le séminome peut provoquer des douleurs lombaires liées à l'envahissement des ganglions rétropéritonéaux. Certains patients développent également une gynécomastie (augmentation du volume mammaire) due aux modifications hormonales induites par la tumeur [8]. Ces signes tardifs témoignent généralement d'une maladie métastatique.
Il faut savoir que 10% des séminomes se révèlent par des symptômes généraux : fatigue inexpliquée, perte de poids, ou troubles de la fertilité [5,8]. Ces manifestations atypiques peuvent égarer le diagnostic et retarder la prise en charge appropriée.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic du séminome repose sur une démarche méthodique associant examen clinique, imagerie et analyses biologiques. L'échographie scrotale constitue l'examen de première intention, permettant de caractériser la masse testiculaire et d'évaluer le testicule controlatéral [12]. Cette technique non invasive présente une sensibilité supérieure à 95% pour détecter les tumeurs testiculaires.
Les marqueurs tumoraux jouent un rôle crucial dans le diagnostic et le suivi. Contrairement aux tumeurs non séminomateuses, le séminome pur ne s'accompagne généralement pas d'élévation de l'alpha-fœtoprotéine (AFP). En revanche, les LDH (lactate déshydrogénases) peuvent être augmentées, reflétant l'activité tumorale [13]. L'innovation majeure de 2024 concerne l'utilisation du miRNA-M371, un biomarqueur révolutionnaire permettant un diagnostic plus précoce et un suivi plus précis [7].
Le scanner thoraco-abdomino-pelvien complète le bilan d'extension, recherchant d'éventuelles métastases ganglionnaires ou viscérales. Cet examen permet de déterminer le stade de la maladie selon la classification TNM, élément déterminant pour le choix thérapeutique [12]. Dans certains cas complexes, l'IRM peut apporter des informations complémentaires.
L'orchidectomie par voie inguinale reste l'étape diagnostique et thérapeutique fondamentale. Cette intervention chirurgicale permet l'analyse histologique définitive et constitue le premier temps du traitement [13]. L'examen anatomopathologique confirme le diagnostic de séminome et précise les facteurs pronostiques.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement du séminome a considérablement évolué ces dernières années, privilégiant des approches personnalisées selon le stade de la maladie. Pour les séminomes de stade I, trois options thérapeutiques sont possibles : la surveillance active, la radiothérapie adjuvante, ou la chimiothérapie par carboplatine [12]. La surveillance active devient l'option privilégiée chez les patients compliants, évitant les effets secondaires des traitements adjuvants.
La radiothérapie reste un pilier du traitement des séminomes localisés. Cette technique exploite la radiosensibilité particulière de ces tumeurs, avec des doses relativement faibles (20-25 Gy) délivrées sur les aires ganglionnaires para-aortiques et iliaques [12]. Les techniques modernes de radiothérapie conformationnelle permettent de limiter l'irradiation des organes sains avoisinants.
Pour les stades avancés, la chimiothérapie constitue le traitement de référence. Le protocole BEP (Bléomycine, Étoposide, Cisplatine) ou EP (Étoposide, Cisplatine) selon les facteurs de risque, permet d'obtenir des taux de guérison supérieurs à 95% [12,13]. Ces protocoles intensifs nécessitent une surveillance étroite des fonctions rénales, pulmonaires et auditives.
Une innovation majeure concerne la lymphadénectomie rétropéritonéale dans les séminomes métastatiques. L'étude COTRIMS présentée à l'ASCO GU 2025 démontre l'intérêt de cette approche chirurgicale dans des cas sélectionnés, ouvrant de nouvelles perspectives thérapeutiques [1,3]. Cette technique permet de traiter les masses résiduelles post-chimiothérapie tout en préservant la fertilité.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024-2025 marque un tournant dans la prise en charge du séminome avec l'émergence de plusieurs innovations thérapeutiques prometteuses. L'étude EDEN (Etude Désescalade sEmiNome) révolutionne l'approche des séminomes de stade IIa/IIb, proposant une désescalade thérapeutique guidée par le biomarqueur miRNA-M371 [7]. Cette approche personnalisée permet de réduire la toxicité des traitements tout en maintenant leur efficacité.
Les résultats finaux de l'essai COTRIMS présentés à l'ASCO GU 2025 confirment l'intérêt de la lymphadénectomie rétropéritonéale dans les séminomes métastatiques [1]. Cette technique chirurgicale innovante permet de traiter efficacement les masses résiduelles post-chimiothérapie, avec un taux de complications acceptable et une préservation de la fertilité dans 80% des cas.
Le développement des biomarqueurs circulants représente une autre avancée majeure. Le miRNA-M371 permet désormais un diagnostic plus précoce et un suivi plus précis de la réponse thérapeutique [7]. Ce biomarqueur présente une sensibilité de 90% et une spécificité de 95% pour détecter les tumeurs germinales, surpassant les marqueurs traditionnels.
Les recherches actuelles explorent également les thérapies ciblées et l'immunothérapie dans les séminomes réfractaires. Plusieurs molécules sont en cours d'évaluation dans des essais cliniques de phase II, notamment les inhibiteurs de checkpoints immunitaires et les thérapies anti-angiogéniques [2]. Ces approches innovantes offrent de nouveaux espoirs pour les patients en échec thérapeutique.
Vivre au Quotidien avec Séminome
Vivre avec un séminome implique des adaptations importantes dans la vie quotidienne, particulièrement pendant la phase de traitement. Les patients sous chimiothérapie doivent faire face à des effets secondaires variables : fatigue, nausées, chute de cheveux, et parfois troubles de la fertilité [12]. Il est essentiel d'anticiper ces difficultés et de mettre en place un réseau de soutien familial et médical.
La question de la fertilité préoccupe légitimement de nombreux patients jeunes. Heureusement, la conservation de sperme avant traitement permet de préserver les chances de paternité future [13]. Cette démarche, prise en charge par l'Assurance Maladie, doit être proposée systématiquement avant tout traitement potentiellement stérilisant.
L'impact psychologique ne doit pas être négligé. Beaucoup d'hommes éprouvent des difficultés à accepter le diagnostic et les modifications corporelles liées aux traitements. Un suivi psychologique peut s'avérer bénéfique, d'autant que des associations de patients proposent des groupes de parole et un soutien personnalisé [14].
Concrètement, la reprise d'une activité professionnelle normale est généralement possible 2 à 3 mois après la fin des traitements. Certains patients bénéficient d'un aménagement de leur poste de travail ou d'un temps partiel thérapeutique pendant la phase de récupération [12]. L'important est de respecter son rythme et de ne pas hésiter à solliciter l'aide des professionnels de santé.
Les Complications Possibles
Bien que le séminome présente généralement un pronostic favorable, certaines complications peuvent survenir, liées soit à la maladie elle-même, soit aux traitements administrés. Les complications tumorales incluent principalement l'extension métastatique vers les ganglions rétropéritonéaux, les poumons, ou plus rarement le foie et le cerveau [13]. Ces métastases, bien que préoccupantes, restent généralement sensibles aux traitements conventionnels.
Les traitements peuvent également induire des effets secondaires significatifs. La radiothérapie peut provoquer une stérilité temporaire ou définitive, des troubles digestifs, et exceptionnellement des cancers radio-induits à long terme [12]. C'est pourquoi les protocoles actuels privilégient des doses plus faibles et des volumes d'irradiation réduits.
La chimiothérapie expose à des risques plus variés : toxicité rénale et auditive du cisplatine, toxicité pulmonaire de la bléomycine, et risque de leucémies secondaires [12,13]. Un suivi médical régulier permet de dépister précocement ces complications et d'adapter les traitements si nécessaire. Heureusement, la plupart de ces effets sont réversibles à l'arrêt du traitement.
Les innovations récentes, notamment l'utilisation du biomarqueur miRNA-M371, permettent d'optimiser les traitements et de réduire leur toxicité [7]. Cette approche personnalisée représente l'avenir de la prise en charge du séminome, minimisant les complications tout en préservant l'efficacité thérapeutique.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic du séminome figure parmi les meilleurs de tous les cancers, avec des taux de survie globale dépassant 95% à 5 ans tous stades confondus [12,13]. Cette excellente survie s'explique par la sensibilité particulière de ces tumeurs aux traitements conventionnels, notamment la radiothérapie et la chimiothérapie à base de cisplatine.
Pour les séminomes de stade I, représentant 70% des cas au diagnostic, la survie spécifique approche 99% à 10 ans [13]. Ces patients bénéficient d'un pronostic exceptionnel, justifiant l'adoption croissante de la surveillance active pour éviter les toxicités des traitements adjuvants. Même en cas de rechute, les traitements de rattrapage permettent d'obtenir la guérison dans plus de 95% des cas.
Les séminomes avancés conservent un pronostic favorable, avec des taux de guérison de 85 à 90% selon les facteurs de risque [12]. La classification pronostique internationale distingue trois groupes de risque basés sur les marqueurs tumoraux, l'extension métastatique, et la localisation des métastases. Cette stratification permet d'adapter l'intensité des traitements.
L'âge au diagnostic influence modérément le pronostic. Les patients de plus de 50 ans présentent des taux de survie légèrement inférieurs, principalement en raison des comorbidités associées et de la tolérance réduite aux traitements intensifs [8]. Cependant, même dans cette population, les résultats restent très encourageants avec des adaptations thérapeutiques appropriées.
Peut-on Prévenir Séminome ?
La prévention primaire du séminome reste limitée en raison de la méconnaissance de ses causes exactes et du caractère non modifiable de la plupart des facteurs de risque identifiés. La cryptorchidie, principal facteur de risque, nécessite une prise en charge chirurgicale précoce (orchidopexie) avant l'âge de 2 ans pour réduire le risque de cancer testiculaire [13]. Cette intervention, bien que ne supprimant pas complètement le risque, le diminue significativement.
En l'absence de facteurs de risque modifiables clairement établis, la prévention repose essentiellement sur le dépistage précoce. L'autopalpation testiculaire mensuelle, recommandée chez tous les hommes entre 15 et 45 ans, permet de détecter précocement les anomalies [12]. Cette pratique simple, réalisée idéalement après une douche chaude, peut sauver des vies.
Certaines mesures générales de santé publique pourraient théoriquement réduire l'incidence du séminome. La limitation de l'exposition aux perturbateurs endocriniens pendant la grossesse, notamment les phtalates et les pesticides, fait l'objet de recherches actives [13]. Cependant, ces associations restent hypothétiques et ne justifient pas encore de recommandations spécifiques.
L'éducation sanitaire joue un rôle crucial dans la prévention secondaire. Les campagnes de sensibilisation, notamment dans les établissements scolaires et universitaires, permettent d'informer les jeunes hommes sur les signes d'alerte et l'importance de l'autopalpation [12]. Cette approche éducative représente actuellement notre meilleur outil de prévention.
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises et internationales ont établi des recommandations précises pour la prise en charge du séminome, régulièrement mises à jour selon les avancées scientifiques. La Haute Autorité de Santé (HAS) préconise une approche multidisciplinaire impliquant urologues, oncologues, radiothérapeutes et anatomo-pathologistes pour optimiser la prise en charge [12]. Cette coordination est essentielle pour garantir la qualité des soins.
L'Institut National du Cancer (INCa) recommande la réalisation systématique d'un bilan d'extension complet incluant scanner thoraco-abdomino-pelvien et dosage des marqueurs tumoraux avant toute décision thérapeutique [13]. Ces examens permettent une stadification précise, élément déterminant pour le choix du traitement optimal.
Concernant la surveillance post-thérapeutique, les recommandations européennes préconisent un suivi rapproché pendant les 5 premières années, puis espacé jusqu'à 10 ans [12]. Ce suivi comprend examen clinique, imagerie et dosage des marqueurs selon un calendrier précis adapté au stade initial et aux traitements reçus.
Les innovations récentes, notamment l'utilisation du biomarqueur miRNA-M371, font l'objet d'évaluations par les autorités réglementaires [7]. L'Agence Européenne du Médicament (EMA) examine actuellement les dossiers de plusieurs tests diagnostiques basés sur ce biomarqueur, ouvrant la voie à leur intégration dans la pratique clinique courante.
Ressources et Associations de Patients
De nombreuses ressources sont disponibles pour accompagner les patients atteints de séminome et leurs proches tout au long du parcours de soins. L'Association Française d'Urologie (AFU) propose des brochures d'information détaillées et des vidéos éducatives accessibles gratuitement sur son site internet [14]. Ces ressources, validées par des experts, permettent de mieux comprendre la maladie et ses traitements.
La Ligue contre le Cancer offre un soutien personnalisé à travers ses comités départementaux, proposant écoute téléphonique, aide financière, et accompagnement social [14]. Cette association dispose également d'espaces de rencontre et d'information dans de nombreuses villes françaises, facilitant l'accès aux soins de support.
Des associations spécialisées dans les cancers masculins se développent progressivement. Elles organisent des groupes de parole, des conférences médicales, et des événements de sensibilisation [14]. Ces initiatives permettent aux patients de partager leur expérience et de bénéficier du soutien de pairs ayant vécu des situations similaires.
Les plateformes numériques jouent un rôle croissant dans l'information et l'accompagnement des patients. Des applications mobiles dédiées permettent de suivre les effets secondaires, de programmer les rendez-vous médicaux, et d'accéder à des conseils personnalisés [14]. Ces outils digitaux complètent utilement l'accompagnement médical traditionnel.
Nos Conseils Pratiques
Vivre avec un séminome nécessite l'adoption de stratégies pratiques pour optimiser la qualité de vie pendant et après les traitements. Pendant la chimiothérapie, il est essentiel de maintenir une hydratation suffisante (2-3 litres d'eau par jour) pour protéger les reins de la toxicité du cisplatine [12]. Une alimentation équilibrée, riche en protéines et en vitamines, aide à mieux tolérer les traitements et favorise la récupération.
La gestion de la fatigue représente un défi majeur pour de nombreux patients. Il est recommandé d'adapter son rythme de vie, de privilégier des activités physiques douces comme la marche ou la natation, et de ne pas hésiter à solliciter l'aide de l'entourage [13]. Le repos n'est pas synonyme d'inactivité totale - maintenir une activité physique adaptée améliore le bien-être général.
L'autopalpation testiculaire doit devenir un réflexe, même après guérison. Cette pratique mensuelle, réalisée après une douche chaude, permet de détecter précocement une éventuelle récidive ou l'apparition d'une tumeur controlatérale [12]. En cas de doute, il ne faut jamais hésiter à consulter rapidement son médecin.
Enfin, il est crucial de maintenir un dialogue ouvert avec l'équipe médicale. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, à exprimer vos inquiétudes, et à signaler tout effet secondaire, même mineur [13]. Cette communication transparente permet d'adapter les traitements et d'optimiser la prise en charge globale.
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes doivent impérativement motiver une consultation médicale rapide, car ils peuvent révéler un séminome ou signaler une complication chez un patient déjà traité. Toute masse testiculaire, même indolore et de petite taille, justifie un avis urologique dans les 48 heures [12,13]. Il ne faut jamais attendre que la masse grossisse ou devienne douloureuse pour consulter.
D'autres symptômes doivent également alerter : douleurs lombaires persistantes, gonflement du scrotum, sensation de pesanteur testiculaire, ou modification de la consistance d'un testicule [13]. Ces signes, bien que non spécifiques, peuvent révéler une pathologie tumorale débutante nécessitant une évaluation spécialisée.
Chez les patients en cours de traitement, certains effets secondaires nécessitent une consultation urgente : fièvre supérieure à 38°C, essoufflement inhabituel, douleurs thoraciques, ou troubles auditifs [12]. Ces symptômes peuvent témoigner de complications graves nécessitant une prise en charge immédiate.
Pendant la phase de surveillance post-thérapeutique, toute anomalie détectée lors de l'autopalpation, fatigue inexpliquée, ou symptômes généraux persistants doivent motiver une consultation anticipée [13]. Il vaut mieux consulter pour rien que de passer à côté d'une récidive précoce, plus facile à traiter.
Questions Fréquentes
Le séminome peut-il toucher les deux testicules ?Oui, mais c'est rare. Les séminomes bilatéraux représentent moins de 5% des cas et surviennent généralement de façon métachrone (à des moments différents) [4]. Un suivi régulier du testicule controlatéral est donc essentiel.
Peut-on avoir des enfants après un séminome ?
Dans la majorité des cas, oui. La conservation de sperme avant traitement permet de préserver la fertilité [13]. Même sans conservation, de nombreux patients retrouvent une fertilité normale après traitement.
Le séminome est-il héréditaire ?
Il existe une prédisposition familiale, mais ce n'est pas une maladie héréditaire au sens strict. Les antécédents familiaux multiplient le risque par 4 à 8, mais la plupart des cas sont sporadiques [12].
Faut-il éviter certains aliments pendant le traitement ?
Aucun aliment n'est formellement contre-indiqué, mais il est recommandé d'éviter l'alcool et de limiter les aliments riches en potassium pendant la chimiothérapie au cisplatine [12].
Combien de temps dure le suivi médical ?
Le suivi s'étend sur 10 ans minimum, avec des consultations rapprochées les 5 premières années puis espacées [13]. Ce suivi prolongé permet de détecter précocement d'éventuelles récidives ou complications tardives.
Questions Fréquentes
Le séminome peut-il toucher les deux testicules ?
Oui, mais c'est rare. Les séminomes bilatéraux représentent moins de 5% des cas et surviennent généralement de façon métachrone (à des moments différents). Un suivi régulier du testicule controlatéral est donc essentiel.
Peut-on avoir des enfants après un séminome ?
Dans la majorité des cas, oui. La conservation de sperme avant traitement permet de préserver la fertilité. Même sans conservation, de nombreux patients retrouvent une fertilité normale après traitement.
Le séminome est-il héréditaire ?
Il existe une prédisposition familiale, mais ce n'est pas une maladie héréditaire au sens strict. Les antécédents familiaux multiplient le risque par 4 à 8, mais la plupart des cas sont sporadiques.
Combien de temps dure le suivi médical ?
Le suivi s'étend sur 10 ans minimum, avec des consultations rapprochées les 5 premières années puis espacées. Ce suivi prolongé permet de détecter précocement d'éventuelles récidives ou complications tardives.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] ASCO GU 2025: Prospective COTRIMS (Cologne Trial of Retroperitoneal Lymphadenectomy in Metastatic Seminoma) - Final ResultsLien
- [2] Testicular cancer - The Lancet 2025Lien
- [3] Strategies for RPLND in Metastatic Testicular Seminoma - SUO 2024Lien
- [4] Diagnostic et traitement d'un séminome bilatéral chez un pigeon domestique - 2025Lien
- [5] Séminome testiculaire révélé par un hypogonadisme hypergonadotrope - 2024Lien
- [7] EDEN (Etude Désescalade sEmiNome): Prospective therapeutic de-escalation and miRNA-M371 biomarker evaluation - 2023Lien
- [8] Testicular seminoma revealed by hypergonadotropic hypogonadism - PubMed 2024Lien
- [12] Traitements du séminome - Cancer.caLien
- [13] Tumeur testiculaire germinale séminomateuse - OrphanetLien
- [14] Séminome : symptômes, causes, diagnostic et traitement - Medicover HospitalsLien
Publications scientifiques
- Diagnostic et traitement d'un séminome bilatéral chez un pigeon domestique (2025)
- Séminome testiculaire révélé par un hypogonadisme hypergonadotrope (2024)
- " Schein-Seminome" werden oft falsch behandelt (2022)
- EDEN (Etude Désescalade sEmiNome): Prospective therapeutic de-escalation and miRNA-M371 biomarker evaluation phase II study for stage IIa/IIb< 3 cm … (2023)
- Testicular seminoma revealed by hypergonadotropic hypogonadism (2024)
Ressources web
- Traitements du séminome (cancer.ca)
On administre un traitement quand des symptômes apparaissent ou quand le cancer change. On peut proposer une radiothérapie après la chirurgie d'un séminome ...
- Tumeur testiculaire germinale séminomateuse (orpha.net)
Le séminome se présente habituellement chez les hommes âgés de 30-40 ans. Une masse indolore dans le scrotum est indicative de la maladie. Un hydrocèle de ...
- Séminome : symptômes, causes, diagnostic et traitement (medicoverhospitals.in)
Le diagnostic implique généralement un examen échographique, des marqueurs tumoraux et une biopsie pour confirmation histologique. 4. Quelles sont les options ...
- Cancer du Testicule : Symptômes, Diagnostic et Traitements (medecindirect.fr)
Le séminome : il se développe plus lentement que l'autre forme. Il affecte le plus souvent l'homme dans la quarantaine. · Le non-séminome : il affecte le plus ...
- Séminome (fr.wikipedia.org)
Un séminome est un cancer (tumeur maligne) constitué par la prolifération anarchique de cellules dérivées des cellules germinales : les cellules de la ...

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
