Rectocolite Hémorragique : Guide Complet 2025 - Symptômes, Traitements
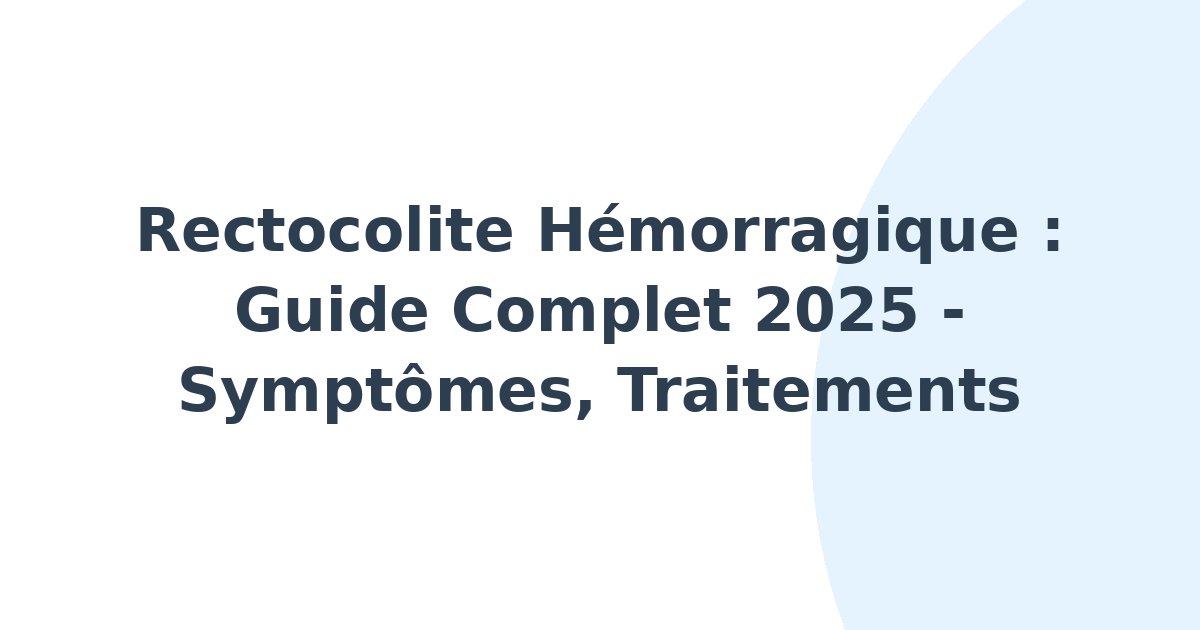
La rectocolite hémorragique est une maladie inflammatoire chronique qui touche le côlon et le rectum. En France, elle affecte environ 120 000 personnes selon les dernières données de Santé publique France [1]. Cette pathologie, bien que chronique, peut être efficacement prise en charge grâce aux avancées thérapeutiques récentes. Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur cette maladie : symptômes, diagnostic, traitements innovants et conseils pour mieux vivre au quotidien.

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Rectocolite Hémorragique : Définition et Vue d'Ensemble
La rectocolite hémorragique est une maladie inflammatoire chronique de l'intestin (MICI) qui affecte exclusivement le côlon et le rectum [1,15]. Contrairement à la maladie de Crohn, l'inflammation reste limitée à la muqueuse intestinale et progresse de manière continue depuis le rectum vers le côlon.
Cette pathologie se caractérise par des poussées inflammatoires alternant avec des périodes de rémission. L'inflammation débute toujours au niveau du rectum et peut s'étendre de façon continue vers le côlon ascendant [9]. Bon à savoir : chez certains patients, seul le rectum est touché, on parle alors de rectite.
La maladie évolue par cycles imprévisibles. Certaines personnes connaissent de longues périodes sans symptômes, tandis que d'autres font face à des poussées plus fréquentes. L'important à retenir, c'est que chaque patient a son propre rythme d'évolution [16].
Contrairement aux idées reçues, la rectocolite hémorragique n'est pas causée par le stress ou l'alimentation, même si ces facteurs peuvent influencer les symptômes. Il s'agit d'une véritable maladie auto-immune où le système immunitaire attaque par erreur les tissus sains de l'intestin [1,9].
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, la prévalence de la rectocolite hémorragique est estimée à 120 000 personnes, soit environ 1,8 pour 1000 habitants [1]. Cette pathologie touche légèrement plus les hommes que les femmes, avec un sex-ratio de 1,2:1 selon les données récentes de l'INSERM.
L'incidence annuelle française s'élève à 4,9 nouveaux cas pour 100 000 habitants, un chiffre en légère augmentation par rapport aux années 2010-2015 où elle était de 4,2/100 000 [9]. Cette progression s'explique en partie par l'amélioration du diagnostic et le vieillissement de la population.
Au niveau européen, la France se situe dans la moyenne haute. Les pays nordiques affichent des taux plus élevés : la Norvège atteint 15,6/100 000 habitants, tandis que les pays méditerranéens restent en dessous de 3/100 000 [2]. Cette variation géographique suggère l'influence de facteurs environnementaux et génétiques.
Concernant l'âge de diagnostic, deux pics sont observés : le premier entre 20-30 ans (60% des cas) et le second après 60 ans (25% des cas) [1,9]. Les formes pédiatriques représentent environ 15% des nouveaux diagnostics, avec une tendance à l'augmentation ces dernières années [13].
L'impact économique est considérable : le coût annuel moyen par patient s'élève à 8 500 euros, incluant hospitalisations, traitements et arrêts de travail. Au niveau national, cela représente plus d'un milliard d'euros par an pour l'Assurance Maladie [4].
Les Causes et Facteurs de Risque
Les causes exactes de la rectocolite hémorragique restent partiellement mystérieuses, mais les recherches récentes ont identifié plusieurs facteurs déterminants [15,16]. Il s'agit d'une maladie multifactorielle résultant de l'interaction entre prédisposition génétique, facteurs environnementaux et dysfonctionnement immunitaire.
La composante génétique est indéniable : avoir un parent au premier degré atteint multiplie le risque par 10 à 15 [9]. Plus de 200 gènes de susceptibilité ont été identifiés, notamment les gènes HLA-DRB1 et IL23R. Cependant, la génétique n'explique que 25% du risque total.
Parmi les facteurs environnementaux, le tabagisme présente un paradoxe intéressant. Contrairement à la maladie de Crohn, le tabac semble protéger contre la rectocolite hémorragique [1,15]. Les ex-fumeurs ont un risque 2 fois plus élevé que les fumeurs actuels, ce qui complique les recommandations de sevrage.
Le microbiote intestinal joue un rôle central dans le développement de la maladie. Les patients présentent une dysbiose caractérisée par une diminution des bactéries protectrices comme les Bifidobactéries et une augmentation des espèces pro-inflammatoires [12]. Cette découverte ouvre de nouvelles pistes thérapeutiques.
D'autres facteurs de risque incluent l'utilisation d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, certaines infections intestinales dans l'enfance, et paradoxalement, un niveau d'hygiène trop élevé pendant les premières années de vie (hypothèse hygiéniste) [16].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes de la rectocolite hémorragique varient selon l'étendue et la sévérité de l'inflammation [1]. Le signe le plus caractéristique reste la présence de sang dans les selles, observée chez 95% des patients lors des poussées. Ce saignement peut aller de quelques traces à des hémorragies importantes nécessitant une hospitalisation.
La diarrhée constitue le second symptôme majeur, avec des selles fréquentes (5 à 20 par jour) souvent mélangées de sang et de mucus [1,15]. Contrairement aux diarrhées infectieuses, elle persiste plusieurs semaines et s'accompagne de douleurs abdominales. Les patients décrivent souvent une urgence défécatoire, particulièrement gênante socialement.
Les douleurs abdominales siègent typiquement dans la fosse iliaque gauche et le flanc gauche, correspondant au trajet du côlon sigmoïde [16]. Ces crampes s'intensifient avant la défécation et peuvent irradier vers le dos. Certains patients ressentent également des ténesmes, sensation d'évacuation incomplète très inconfortable.
Lors des poussées sévères, des symptômes généraux apparaissent : fièvre modérée (38-38,5°C), fatigue intense, perte d'appétit et amaigrissement [1]. La fatigue est souvent sous-estimée mais représente un symptôme majeur impactant la qualité de vie. Elle résulte de l'inflammation chronique et de l'anémie fréquemment associée.
Bon à savoir : environ 10% des patients présentent des manifestations extra-intestinales touchant les articulations (arthrites), la peau (érythème noueux) ou les yeux (uvéite) [13,15]. Ces symptômes peuvent parfois précéder les troubles digestifs.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic de rectocolite hémorragique repose sur un faisceau d'arguments cliniques, biologiques et endoscopiques [9]. Il n'existe pas de test unique permettant d'affirmer le diagnostic, d'où l'importance d'une démarche méthodique et rigoureuse.
La première étape consiste en un interrogatoire approfondi explorant les symptômes, leur chronologie, les antécédents familiaux et la prise de médicaments. Le médecin recherche particulièrement les signes d'alarme : saignements importants, fièvre élevée, douleurs intenses ou amaigrissement rapide [1,9].
Les examens biologiques initiaux incluent une numération formule sanguine (recherche d'anémie), un bilan inflammatoire (CRP, VS), et un dosage de la calprotectine fécale. Cette dernière, marqueur d'inflammation intestinale, est élevée chez 90% des patients en poussée [15]. Des sérologies infectieuses éliminent les causes microbiennes.
La coloscopie reste l'examen de référence pour confirmer le diagnostic [9,16]. Elle visualise directement l'inflammation muqueuse, caractérisée par une perte du réseau vasculaire, un œdème, des ulcérations et une friabilité au contact. L'inflammation débute au rectum et s'étend de façon continue, contrairement à la maladie de Crohn où elle est discontinue.
Des biopsies sont systématiquement réalisées lors de la coloscopie. L'analyse histologique confirme l'inflammation chronique limitée à la muqueuse et élimine une dysplasie ou un cancer. En cas de contre-indication à la coloscopie, l'IRM ou le scanner peuvent apporter des informations utiles [8].
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement de la rectocolite hémorragique a considérablement évolué ces dernières années, offrant de meilleures perspectives aux patients [7,9]. L'objectif n'est plus seulement de contrôler les symptômes, mais d'obtenir une cicatrisation muqueuse complète pour prévenir les complications à long terme.
Les aminosalicylés (mésalazine) constituent le traitement de première ligne pour les formes légères à modérées [7,9]. Disponibles par voie orale et rectale, ils agissent directement sur l'inflammation intestinale avec peu d'effets secondaires. La posologie varie de 2 à 4 grammes par jour selon l'étendue de la maladie.
Pour les poussées modérées à sévères, les corticoïdes restent indispensables malgré leurs effets secondaires [9]. La prednisolone (0,5 à 1 mg/kg/jour) permet un contrôle rapide de l'inflammation. Cependant, ils ne doivent jamais être utilisés en traitement d'entretien en raison de leur toxicité à long terme.
Les immunosuppresseurs comme l'azathioprine ou le méthotrexate sont réservés aux formes cortico-dépendantes ou réfractaires [7]. Ils nécessitent une surveillance biologique régulière mais permettent de maintenir la rémission chez 60-70% des patients. L'effet thérapeutique n'apparaît qu'après 2-3 mois de traitement.
Les biothérapies représentent une révolution thérapeutique pour les formes sévères [2,7]. Les anti-TNF (infliximab, adalimumab) et les nouveaux agents comme le védolizumab ou l'ustékinumab offrent des taux de rémission de 40-60% chez les patients en échec des traitements conventionnels.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024-2025 marque un tournant dans la prise en charge de la rectocolite hémorragique avec l'émergence de nouvelles approches thérapeutiques prometteuses [2,3]. Les recherches se concentrent sur des cibles moléculaires plus spécifiques et des stratégies personnalisées.
Les inhibiteurs de JAK (Janus kinases) représentent la principale innovation récente [2,3]. Le tofacitinib, déjà approuvé, montre des résultats encourageants avec 60% de réponse clinique à 8 semaines. D'autres molécules de cette classe sont en développement avancé, promettant une efficacité supérieure avec moins d'effets secondaires.
La thérapie cellulaire fait l'objet d'essais cliniques prometteurs [3,4]. L'injection de cellules souches mésenchymateuses directement dans la muqueuse inflammée permet une régénération tissulaire. Les premiers résultats montrent une cicatrisation muqueuse chez 70% des patients traités, un taux jamais atteint auparavant.
L'approche par microbiote connaît également des avancées significatives [5,6]. La transplantation de microbiote fécal, initialement réservée aux infections à Clostridium difficile, montre des résultats encourageants dans la rectocolite hémorragique. Des probiotiques de nouvelle génération, sélectionnés spécifiquement pour cette pathologie, entrent en phase d'essais cliniques.
Les biomarqueurs prédictifs révolutionnent la médecine personnalisée [2,4]. Des tests génétiques permettent désormais de prédire la réponse aux différents traitements, évitant les échecs thérapeutiques et optimisant la prise en charge dès le diagnostic. Cette approche de précision devrait être généralisée d'ici 2026.
Vivre au Quotidien avec la Rectocolite Hémorragique
Vivre avec une rectocolite hémorragique nécessite des adaptations, mais n'empêche pas de mener une vie épanouie [1,15]. L'important est de bien connaître sa maladie et d'adopter des stratégies pour gérer les symptômes au quotidien.
L'alimentation joue un rôle crucial, même si aucun régime spécifique n'est universellement recommandé [15]. Pendant les poussées, il est conseillé d'éviter les aliments riches en fibres, les épices, l'alcool et les produits laitiers si une intolérance existe. En rémission, une alimentation équilibrée et variée est préférable.
La gestion du stress est fondamentale car il peut déclencher ou aggraver les poussées [1]. Des techniques de relaxation, la méditation, le yoga ou un suivi psychologique peuvent être bénéfiques. Beaucoup de patients trouvent dans l'activité physique adaptée un excellent moyen de réduire le stress et maintenir leur forme.
L'organisation professionnelle mérite une attention particulière. Il est important d'informer son employeur de sa pathologie pour bénéficier d'aménagements si nécessaire : horaires flexibles, accès facilité aux toilettes, télétravail pendant les poussées. La reconnaissance en affection longue durée (ALD) permet une prise en charge à 100%.
Les relations sociales peuvent être impactées par la maladie, notamment à cause de l'urgence défécatoire et de la fatigue. Il est essentiel de communiquer avec ses proches et de ne pas s'isoler. De nombreuses associations proposent des groupes de parole et des activités adaptées [14].
Les Complications Possibles
Bien que la plupart des patients vivent normalement avec leur rectocolite hémorragique, certaines complications peuvent survenir et nécessitent une surveillance attentive [8,10]. La connaissance de ces risques permet une prise en charge précoce et adaptée.
La colectasie aiguë représente l'urgence absolue [8,10]. Cette dilatation massive du côlon (diamètre > 6 cm) survient dans 5% des poussées sévères et engage le pronostic vital. Les signes d'alarme incluent une distension abdominale importante, des vomissements et une altération de l'état général. Une intervention chirurgicale en urgence est souvent nécessaire.
Le risque de cancer colorectal est multiplié par 2 à 3 chez les patients atteints depuis plus de 10 ans [9,16]. Ce risque justifie une surveillance endoscopique régulière : coloscopie tous les 1-2 ans après 10 ans d'évolution. Heureusement, les traitements modernes qui obtiennent une cicatrisation muqueuse réduisent significativement ce risque.
L'anémie touche 60% des patients, principalement due aux saignements chroniques [1]. Elle se manifeste par une fatigue intense, un essoufflement et une pâleur. Un traitement martial (fer) par voie orale ou intraveineuse est souvent nécessaire, parfois complété par des transfusions dans les cas sévères.
Les complications extra-intestinales concernent 25% des patients [13]. Les arthrites périphériques sont les plus fréquentes, touchant genoux, chevilles et poignets. Les atteintes oculaires (uvéite) et cutanées (érythème noueux, pyoderma gangrenosum) nécessitent une prise en charge spécialisée multidisciplinaire.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de la rectocolite hémorragique s'est considérablement amélioré ces dernières décennies grâce aux progrès thérapeutiques [7,9]. Aujourd'hui, la grande majorité des patients peut espérer une qualité de vie satisfaisante avec un traitement adapté.
L'évolution naturelle de la maladie varie considérablement d'un patient à l'autre [9,16]. Environ 50% des patients présentent une forme légère avec des poussées espacées et bien contrôlées par les traitements de première ligne. 30% ont une forme modérée nécessitant des traitements plus intensifs, et 20% une forme sévère requérant des biothérapies ou une chirurgie.
La rémission prolongée est possible chez la majorité des patients. Avec les traitements actuels, 70-80% des patients maintiennent une rémission clinique à 5 ans [7]. La cicatrisation muqueuse, objectif thérapeutique moderne, est obtenue chez 40-60% des patients traités par biothérapies, réduisant significativement le risque de complications.
Le recours à la chirurgie a diminué grâce aux nouveaux traitements [8,14]. Actuellement, 15-20% des patients nécessitent une colectomie au cours de leur vie, contre 30% dans les années 1990. La chirurgie, quand elle est nécessaire, offre d'excellents résultats avec des techniques préservant la continence.
L'espérance de vie des patients atteints de rectocolite hémorragique est identique à celle de la population générale [9]. Les décès directement liés à la maladie sont exceptionnels et concernent principalement les complications aiguës non traitées. La surveillance régulière et les traitements modernes permettent de prévenir efficacement ces situations.
Peut-on Prévenir la Rectocolite Hémorragique ?
La prévention primaire de la rectocolite hémorragique reste limitée car les causes exactes ne sont pas entièrement élucidées [15,16]. Cependant, certaines mesures peuvent réduire le risque de développer la maladie ou d'aggraver son évolution.
Concernant les facteurs modifiables, l'arrêt du tabac présente un paradoxe unique dans cette pathologie [1,15]. Contrairement à la maladie de Crohn, le tabagisme semble protéger contre la rectocolite hémorragique. Néanmoins, les risques cardiovasculaires et cancérologiques du tabac dépassent largement ce bénéfice hypothétique.
L'alimentation joue un rôle préventif potentiel [6]. Une alimentation riche en fibres, fruits et légumes, et pauvre en aliments ultra-transformés pourrait réduire le risque. Les acides gras oméga-3 présents dans les poissons gras montrent des propriétés anti-inflammatoires intéressantes dans les études épidémiologiques.
La prévention secondaire vise à éviter les poussées chez les patients déjà diagnostiqués [9]. L'observance thérapeutique est cruciale : l'arrêt intempestif des traitements d'entretien multiplie par 5 le risque de rechute. La gestion du stress, l'activité physique régulière et un sommeil de qualité contribuent également à maintenir la rémission.
La vaccination mérite une attention particulière chez les patients sous immunosuppresseurs [9]. Les vaccins inactivés sont recommandés et sûrs, tandis que les vaccins vivants sont contre-indiqués. Une mise à jour du calendrier vaccinal avant l'initiation des traitements immunosuppresseurs est essentielle.
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises ont publié des recommandations actualisées pour optimiser la prise en charge de la rectocolite hémorragique [9]. Ces guidelines, élaborées par la Société Nationale Française de Gastroentérologie, s'appuient sur les dernières données scientifiques et l'expérience clinique.
La Haute Autorité de Santé (HAS) recommande une approche thérapeutique stratifiée selon la sévérité [9]. Pour les formes légères, les aminosalicylés restent le traitement de première intention. Les formes modérées à sévères justifient un recours précoce aux immunosuppresseurs ou biothérapies pour éviter la cortico-dépendance.
Concernant la surveillance, les recommandations 2024 préconisent une coloscopie de contrôle 3-6 mois après le diagnostic pour évaluer la cicatrisation muqueuse [7,9]. Cette approche "treat-to-target" vise à adapter le traitement selon la réponse endoscopique, pas seulement clinique. La surveillance du cancer débute après 8-10 ans d'évolution.
L'Assurance Maladie a actualisé ses critères de prise en charge en ALD 30 [1]. Tous les patients avec rectocolite hémorragique confirmée peuvent bénéficier d'une exonération du ticket modérateur. Les biothérapies sont remboursées selon des protocoles stricts, nécessitant l'échec des traitements conventionnels.
Les recommandations insistent sur l'importance de la prise en charge multidisciplinaire [14]. L'intervention d'un psychologue, d'un diététicien et d'un pharmacien clinicien améliore significativement l'observance et la qualité de vie. Les centres experts MICI, labellisés par les autorités, garantissent cette approche globale.
Ressources et Associations de Patients
De nombreuses ressources sont disponibles pour accompagner les patients atteints de rectocolite hémorragique et leurs proches [14]. Ces structures offrent information, soutien et défense des droits des malades.
L'Association François Aupetit (AFA) est la principale association française dédiée aux MICI [14]. Elle propose des groupes de parole, des formations thérapeutiques, et milite pour l'amélioration de la prise en charge. Son site internet offre une mine d'informations actualisées et un forum d'échanges entre patients.
Les centres experts MICI sont répartis sur tout le territoire français [14]. Ces structures spécialisées garantissent une prise en charge optimale avec des équipes dédiées. Ils proposent également des programmes d'éducation thérapeutique pour mieux comprendre et gérer sa maladie au quotidien.
Le réseau social Carenity connecte plus de 10 000 patients français atteints de MICI. Cette plateforme permet d'échanger conseils, témoignages et questions avec d'autres personnes vivant la même situation. L'anonymat est préservé et la modération médicale garantit la qualité des informations.
Pour les aspects professionnels, l'Association de Gestion du Fonds pour l'Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées (AGEFIPH) peut accompagner les démarches d'aménagement de poste. Le service social de l'Assurance Maladie aide également dans les démarches administratives et l'accès aux droits.
Nos Conseils Pratiques
Vivre avec une rectocolite hémorragique nécessite quelques adaptations pratiques qui peuvent grandement améliorer votre qualité de vie [1,15]. Ces conseils, issus de l'expérience de milliers de patients, vous aideront au quotidien.
Pour gérer l'urgence défécatoire, planifiez vos sorties en repérant les toilettes disponibles. De nombreuses applications mobiles localisent les sanitaires publics. N'hésitez pas à demander une carte d'urgence toilettes à votre médecin : elle facilite l'accès aux sanitaires dans les commerces et transports.
Côté alimentation, tenez un carnet alimentaire pour identifier vos aliments déclencheurs personnels [15]. Pendant les poussées, privilégiez les aliments pauvres en fibres : riz blanc, pâtes, bananes mûres, compotes. En rémission, réintroduisez progressivement les fibres et variez votre alimentation.
Pour les voyages, emportez toujours une trousse de secours avec vos médicaments habituels plus une réserve. Informez-vous sur la couverture médicale de votre destination et souscrivez une assurance voyage adaptée. Certaines compagnies aériennes proposent des repas spéciaux pour les MICI.
Au travail, communiquez avec votre employeur sur vos besoins sans entrer dans les détails médicaux. Un certificat médical peut justifier des aménagements : bureau proche des toilettes, horaires flexibles, télétravail ponctuel. La médecine du travail peut vous accompagner dans ces démarches.
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes doivent vous alerter et justifier une consultation médicale rapide, voire urgente [1,10]. La connaissance de ces signaux d'alarme peut éviter des complications graves et optimiser votre prise en charge.
Consultez en urgence si vous présentez : des saignements abondants avec caillots, une fièvre élevée (>38,5°C), des douleurs abdominales intenses, des vomissements répétés ou une distension abdominale importante [10]. Ces symptômes peuvent signaler une colectasie aiguë ou une perforation, complications rares mais graves.
Une consultation rapide (24-48h) s'impose en cas de : recrudescence des symptômes malgré le traitement, apparition de nouveaux symptômes, fatigue intense inhabituelle, ou perte de poids rapide [1]. Ces signes peuvent indiquer une poussée débutante ou une complication naissante.
Pour le suivi régulier, respectez les rendez-vous programmés avec votre gastro-entérologue, même en période de rémission [9]. Ces consultations permettent d'adapter le traitement, de surveiller les effets secondaires et de planifier les examens de dépistage. N'hésitez pas à préparer vos questions à l'avance.
En cas de voyage à l'étranger, consultez avant le départ pour adapter votre traitement et obtenir les certificats nécessaires. Certains pays ont des restrictions sur l'importation de médicaments, particulièrement les biothérapies injectables. Une consultation de médecine des voyages peut être utile.
Questions Fréquentes
La rectocolite hémorragique est-elle héréditaire ?Il existe une prédisposition génétique : avoir un parent atteint multiplie le risque par 10-15 [9]. Cependant, la plupart des patients n'ont aucun antécédent familial. La génétique n'explique que 25% du risque total.
Peut-on guérir définitivement de la rectocolite hémorragique ?
Il n'existe pas de guérison au sens strict, mais des rémissions prolongées sont possibles [7]. Avec les traitements actuels, 70-80% des patients maintiennent une rémission à 5 ans. La chirurgie peut être curative mais implique l'ablation du côlon.
Puis-je avoir des enfants avec cette maladie ?
Absolument ! La fertilité n'est pas affectée chez la plupart des patients [15]. Certains médicaments nécessitent des adaptations pendant la grossesse, d'où l'importance d'une planification avec votre médecin. Les femmes enceintes en rémission ont généralement une grossesse normale.
Le stress peut-il déclencher une poussée ?
Le stress ne cause pas la maladie mais peut effectivement déclencher ou aggraver une poussée [1]. La gestion du stress par la relaxation, le sport ou un soutien psychologique fait partie intégrante du traitement.
Dois-je suivre un régime alimentaire particulier ?
Aucun régime spécifique n'est universellement recommandé [15]. Pendant les poussées, évitez les aliments riches en fibres et épicés. En rémission, une alimentation équilibrée et variée est préférable. Chaque patient doit identifier ses propres déclencheurs alimentaires.
Questions Fréquentes
La rectocolite hémorragique est-elle héréditaire ?
Il existe une prédisposition génétique : avoir un parent atteint multiplie le risque par 10-15. Cependant, la plupart des patients n'ont aucun antécédent familial. La génétique n'explique que 25% du risque total.
Peut-on guérir définitivement de la rectocolite hémorragique ?
Il n'existe pas de guérison au sens strict, mais des rémissions prolongées sont possibles. Avec les traitements actuels, 70-80% des patients maintiennent une rémission à 5 ans.
Puis-je avoir des enfants avec cette maladie ?
Absolument ! La fertilité n'est pas affectée chez la plupart des patients. Certains médicaments nécessitent des adaptations pendant la grossesse, d'où l'importance d'une planification avec votre médecin.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Les symptômes de la rectocolite hémorragique. www.ameli.fr.Lien
- [2] JFHOD2025-Livre des résumés.pdf. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [3] POST U. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [4] Communiqués de presse. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [7] G Le Cosquer, C Gilletta - La Presse Médicale Formation. Traitement de la rectocolite hémorragique en 2024. 2025.Lien
- [8] O Lelièvre, S Benoist. Indications, modalités et résultats du traitement chirurgical de la rectocolite hémorragique en 2024. 2024.Lien
- [9] A Amiot, S Viennot. Recommandations de pratique pour le diagnostic et la prise en charge de la rectocolite hémorragique (version courte). 2022.Lien
- [15] Rectocolite hémorragique - symptômes, causes, ... - VIDAL. www.vidal.fr.Lien
Publications scientifiques
- Traitement de la rectocolite hémorragique en 2024 (2025)[PDF]
- Indications, modalités et résultats du traitement chirurgical de la rectocolite hémorragique en 2024 (2024)
- Recommandations de pratique pour le diagnostic et la prise en charge de la rectocolite hémorragique (version courte) (2022)14 citations[PDF]
- Une rectocolite hémorragique particulièrement «rebelle»… (2024)
- L'AMIBIASE AU COURS DE LA RECTOCOLITE ULCERO HEMORRAGIQUE REVUE DE LA LITTERATURE (2022)
Ressources web
- Les symptômes de la rectocolite hémorragique (ameli.fr)
La rectocolite hémorragique se manifeste par des rectorragies, des besoins urgents d'aller à la selle, des douleurs abdominales et une diarrhée.
- Rectocolite hémorragique - symptômes, causes, ... - VIDAL (vidal.fr)
14 sept. 2023 — La rectocolite hémorragique est une maladie inflammatoire chronique du gros intestin et du rectum. Elle provoque une inflammation, des ulcères ...
- Rectocolite hémorragique - Troubles digestifs - Manuels ... (msdmanuals.com)
Les symptômes typiques pendant une poussée incluent des crampes abdominales, un besoin impérieux d'évacuer et des diarrhées (généralement sanglantes). Le ...
- Rectocolite hémorragique : définition, causes, traitements (elsan.care)
Elle est caractérisée par des saignements rectaux, des selles fréquentes et souvent accompagnées de sang, ainsi que des douleurs abdominales.
- La rectocolite hémorragique (snfcp.org)
Comment se manifeste la RCH ? Les symptômes sont d'abord digestifs : diarrhée, sang dans les selles, besoins anormalement fréquents de se présenter aux ...

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
