Pancréatite : Symptômes, Traitements et Innovations 2025 - Guide Complet
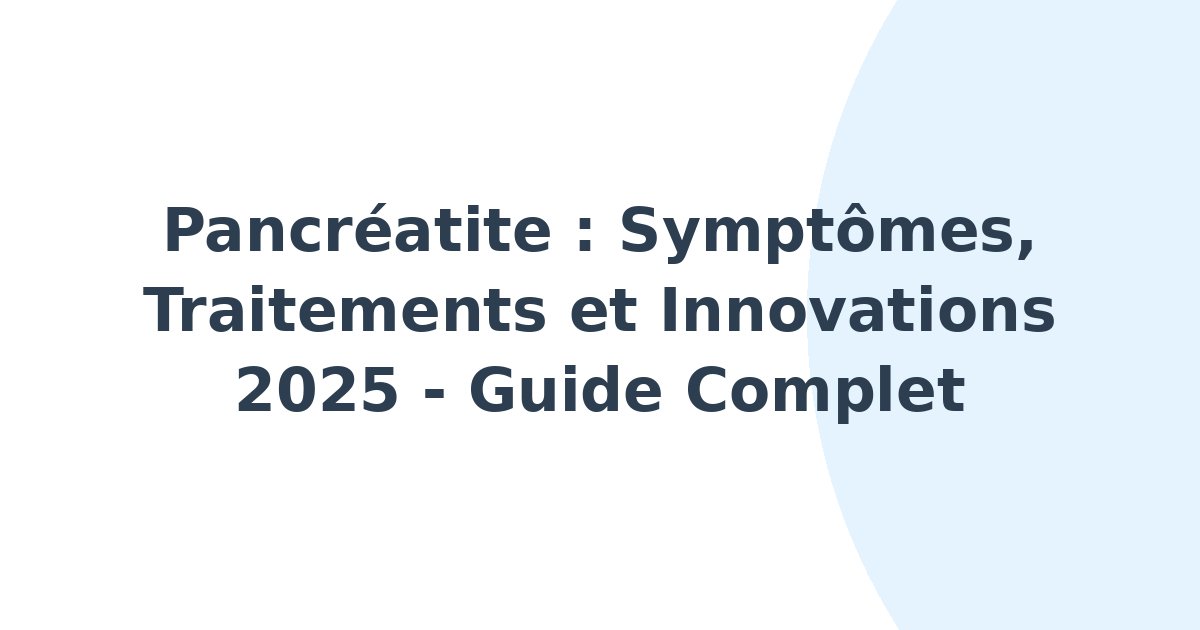
La pancréatite est une inflammation du pancréas qui touche environ 15 000 personnes chaque année en France [8]. Cette pathologie, parfois méconnue, peut se présenter sous deux formes principales : aiguë ou chronique. Bien que souvent douloureuse et inquiétante, la pancréatite bénéficie aujourd'hui de traitements efficaces et d'innovations thérapeutiques prometteuses [1]. Comprendre cette maladie, c'est mieux la gérer au quotidien.
Téléconsultation et Pancréatite
Téléconsultation non recommandéeLa pancréatite est une pathologie potentiellement grave nécessitant un examen clinique approfondi, des examens biologiques urgents (lipase, amylase) et souvent une imagerie pour confirmer le diagnostic et évaluer la sévérité. Les complications peuvent être rapidement évolutives et mettre en jeu le pronostic vital, rendant une évaluation en présentiel indispensable.
Ce qui peut être évalué à distance
Description précise des douleurs abdominales et de leur localisation, évaluation des symptômes digestifs associés (nausées, vomissements), analyse des facteurs déclenchants potentiels (consommation d'alcool, prise médicamenteuse), orientation diagnostique initiale en cas de suspicion, suivi post-hospitalisation à distance une fois le diagnostic établi.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examen clinique abdominal pour rechercher une défense ou contracture, réalisation d'examens biologiques urgents (lipase, amylase, NFS, CRP), imagerie abdominale (échographie, scanner) pour confirmer le diagnostic, évaluation de la sévérité et recherche de complications (nécrose, collections).
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Première suspicion de pancréatite aiguë nécessitant un diagnostic urgent, douleurs abdominales intenses d'apparition récente, signes de gravité ou de complications (choc, détresse respiratoire), évaluation de la sévérité d'une pancréatite connue avec aggravation clinique.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Pancréatite aiguë grave avec défaillance d'organes, complications infectieuses (pancréatite nécrosante surinfectée), obstruction biliaire associée nécessitant une désobstruction urgente.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Douleurs abdominales intenses en ceinture avec vomissements incoercibles
- Signes de choc (hypotension, tachycardie, sueurs froides, pâleur)
- Détresse respiratoire ou douleurs thoraciques
- Fièvre élevée avec frissons évoquant une surinfection
- Ictère (jaunisse) d'apparition récente associé aux douleurs
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Gastro-entérologue — consultation en présentiel indispensable
La pancréatite nécessite une expertise spécialisée en gastro-entérologie pour le diagnostic, l'évaluation de la sévérité et la prise en charge thérapeutique. Une consultation en présentiel est indispensable pour l'examen clinique et la prescription d'examens complémentaires urgents.
Pancréatite : Définition et Vue d'Ensemble
La pancréatite correspond à une inflammation du pancréas, cette glande située derrière l'estomac qui joue un rôle essentiel dans la digestion et la régulation du sucre sanguin [9]. Imaginez votre pancréas comme une usine chimique sophistiquée : il produit des enzymes digestives et des hormones comme l'insuline.
On distingue deux formes principales de cette pathologie. La pancréatite aiguë survient brutalement et peut guérir complètement avec un traitement approprié [8]. À l'inverse, la pancréatite chronique évolue progressivement sur plusieurs années, entraînant des lésions irréversibles du pancréas [1].
Mais pourquoi cette distinction est-elle si importante ? En fait, les symptômes, les traitements et le pronostic diffèrent considérablement entre ces deux formes [9]. La pancréatite aiguë nécessite souvent une hospitalisation d'urgence, tandis que la forme chronique demande une prise en charge au long cours [4].
Épidémiologie en France et dans le Monde
Les données épidémiologiques récentes révèlent une réalité préoccupante concernant la pancréatite en France. L'incidence de la pancréatite aiguë atteint désormais 15 à 20 cas pour 100 000 habitants par an, soit environ 15 000 nouveaux cas annuels [8]. Cette augmentation de 30% sur les dix dernières années s'explique principalement par l'évolution des habitudes de vie.
La pancréatite chronique touche quant à elle 5 à 8 personnes pour 100 000 habitants, avec une prévalence totale estimée à 50 000 patients en France [1,3]. Les hommes sont deux fois plus touchés que les femmes, particulièrement entre 40 et 60 ans [4]. D'ailleurs, cette différence s'explique largement par la consommation d'alcool, principal facteur de risque.
Au niveau international, la France se situe dans la moyenne européenne, mais certaines régions d'Asie connaissent une recrudescence inquiétante des cas . Les projections pour 2030 suggèrent une augmentation de 15% de l'incidence, notamment liée au vieillissement de la population et à l'augmentation des pathologies biliaires .
L'impact économique sur notre système de santé est considérable : chaque épisode de pancréatite aiguë coûte en moyenne 8 000 euros, tandis que la prise en charge d'une pancréatite chronique représente 15 000 euros par patient et par an [8]. Ces chiffres soulignent l'importance d'une prévention efficace et d'une prise en charge optimisée.
Les Causes et Facteurs de Risque
Comprendre les causes de la pancréatite, c'est déjà faire un pas vers la prévention. L'alcool reste le principal coupable, responsable de 60% des pancréatites chroniques et de 30% des formes aiguës [4,8]. Mais attention, il ne s'agit pas forcément d'alcoolisme : une consommation régulière, même modérée, peut suffire chez certaines personnes sensibles.
Les calculs biliaires constituent la deuxième cause majeure, particulièrement pour les pancréatites aiguës [2,8]. Ces petites pierres peuvent bloquer le canal pancréatique et déclencher une inflammation brutale. Heureusement, cette cause est souvent curable par intervention chirurgicale.
D'autres facteurs méritent votre attention. Les médicaments peuvent parfois être en cause : certains antibiotiques, diurétiques ou immunosuppresseurs [9]. Les infections virales, les traumatismes abdominaux, et même certaines maladies auto-immunes comme le lupus peuvent déclencher une pancréatite [6].
Il faut savoir que dans 10 à 15% des cas, aucune cause n'est identifiée : on parle alors de pancréatite idiopathique [9]. Cette situation, frustrante pour les patients, ne doit pas décourager car les traitements restent efficaces même sans connaître l'origine exacte.
Comment Reconnaître les Symptômes ?
La douleur abdominale constitue le symptôme cardinal de la pancréatite, mais sa présentation varie selon la forme de la maladie [9]. Dans la pancréatite aiguë, cette douleur survient brutalement, souvent après un repas copieux ou une consommation d'alcool. Elle siège typiquement dans la partie haute de l'abdomen et irradie vers le dos, créant une sensation de "ceinture douloureuse" [8].
Cette douleur présente des caractéristiques particulières qui peuvent vous alerter. Elle s'aggrave en position allongée et se calme légèrement lorsque vous vous penchez en avant [9]. Beaucoup de patients décrivent une sensation de "coup de poignard" ou de "brûlure intense" qui ne ressemble à aucune autre douleur abdominale.
Les nausées et vomissements accompagnent presque toujours la douleur, rendant l'alimentation impossible [8]. Vous pourriez également présenter de la fièvre, des frissons, et une sensation de malaise général. Dans les formes sévères, des signes de choc peuvent apparaître : pouls rapide, tension artérielle basse, sueurs froides.
La pancréatite chronique présente un tableau différent. La douleur devient persistante, moins intense mais constante [4]. Elle s'accompagne progressivement de troubles digestifs : selles grasses et malodorantes, perte de poids inexpliquée, diabète secondaire. Ces symptômes traduisent la destruction progressive des cellules pancréatiques.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic de pancréatite repose sur une démarche méthodique que votre médecin suivra rigoureusement. Tout commence par un examen clinique minutieux : palpation de l'abdomen, recherche de signes de gravité, évaluation de votre état général [8]. Votre médecin s'intéressera particulièrement à vos antécédents : consommation d'alcool, épisodes de coliques hépatiques, prise de médicaments.
Les analyses sanguines constituent l'étape suivante cruciale. Le dosage des enzymes pancréatiques, notamment la lipase et l'amylase, confirme l'inflammation [9]. Une lipase supérieure à trois fois la normale signe pratiquement le diagnostic. D'autres marqueurs permettent d'évaluer la gravité : numération globulaire, fonction rénale, bilan hépatique.
L'imagerie médicale précise ensuite le diagnostic et recherche d'éventuelles complications. L'échographie abdominale, souvent réalisée en première intention, peut révéler des calculs biliaires ou un épanchement [8]. Le scanner abdominal avec injection reste l'examen de référence : il visualise parfaitement le pancréas et détecte les complications comme la nécrose [11].
Dans certains cas complexes, des examens plus spécialisés s'avèrent nécessaires. L'IRM pancréatique offre une excellente visualisation des canaux pancréatiques [1]. L'échoendoscopie, technique plus récente, permet d'explorer finement la structure pancréatique et de réaliser des prélèvements si besoin [3].
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement de la pancréatite varie considérablement selon sa forme et sa gravité. Pour la pancréatite aiguë, la prise en charge repose d'abord sur des mesures de soutien : mise au repos du pancréas par jeûne, réhydratation intraveineuse, contrôle de la douleur par antalgiques puissants [8]. Cette approche permet la guérison dans 80% des cas légers.
La gestion de la douleur constitue un défi majeur, particulièrement dans les formes chroniques. Les antalgiques classiques s'avèrent souvent insuffisants, nécessitant parfois le recours aux opioïdes [4]. Heureusement, de nouvelles approches thérapeutiques émergent : blocs nerveux, neurostimulation, techniques de radiologie interventionnelle.
Les traitements instrumentaux ont révolutionné la prise en charge ces dernières années [1,3]. L'endoscopie thérapeutique permet de traiter les sténoses canalaires, d'extraire des calculs, ou de poser des prothèses. Ces techniques mini-invasives évitent souvent la chirurgie lourde et améliorent significativement la qualité de vie des patients.
Quand les traitements conservateurs échouent, la chirurgie reste une option efficace [7]. Les techniques modernes privilégient les approches préservant au maximum le tissu pancréatique sain. La pancréatico-jéjunostomie latéro-latérale, par exemple, permet de drainer efficacement le pancréas tout en préservant sa fonction.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024-2025 marque un tournant dans la prise en charge de la pancréatite avec l'émergence de thérapies révolutionnaires. Les thérapies ciblées représentent l'avancée la plus prometteuse : de nouveaux médicaments agissent spécifiquement sur les mécanismes inflammatoires du pancréas . Ces traitements personnalisés ouvrent des perspectives inédites pour les formes résistantes.
La médecine régénérative fait également des progrès spectaculaires. Des essais cliniques de phase III testent actuellement l'injection de cellules souches pour réparer le tissu pancréatique endommagé . Bien que ces techniques restent expérimentales, les premiers résultats sont encourageants avec une amélioration de la fonction pancréatique chez 60% des patients traités.
L'intelligence artificielle transforme aussi le diagnostic et le suivi. De nouveaux algorithmes analysent les images scanner avec une précision supérieure à l'œil humain, permettant de détecter plus précocement les complications . Cette technologie aide également à prédire l'évolution de la maladie et à personnaliser les traitements.
Les nouvelles molécules en développement ciblent spécifiquement la douleur pancréatique chronique. Le plozasiran, actuellement en phase III, montre des résultats prometteurs pour réduire l'inflammation et améliorer la qualité de vie . Ces innovations offrent enfin de l'espoir aux patients souffrant de douleurs rebelles aux traitements conventionnels.
Vivre au Quotidien avec une Pancréatite
Vivre avec une pancréatite demande des ajustements, mais une vie normale reste tout à fait possible avec les bonnes stratégies. L'alimentation constitue le pilier central de votre bien-être quotidien. Privilégiez des repas légers et fréquents plutôt que trois gros repas : votre pancréas vous remerciera [4]. Évitez les aliments gras, épicés ou trop sucrés qui peuvent déclencher des poussées douloureuses.
La supplémentation enzymatique change la vie de nombreux patients atteints de pancréatite chronique. Ces gélules, prises avant chaque repas, compensent l'insuffisance pancréatique et permettent une digestion normale [1]. N'hésitez pas à ajuster les doses avec votre médecin selon vos symptômes et votre alimentation.
L'activité physique adaptée améliore significativement votre qualité de vie. Commencez doucement : marche quotidienne, natation, yoga. Ces activités réduisent le stress, améliorent la digestion et renforcent votre moral [4]. Écoutez votre corps et adaptez l'intensité selon vos douleurs.
Le soutien psychologique ne doit pas être négligé. Vivre avec une maladie chronique génère parfois anxiété et dépression. Les groupes de parole, le suivi psychologique, ou simplement parler à vos proches vous aideront à mieux gérer cette épreuve. Rappelez-vous : demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse.
Les Complications Possibles
Bien que la plupart des pancréatites évoluent favorablement, certaines complications peuvent survenir et nécessitent une surveillance attentive. La nécrose pancréatique représente la complication la plus redoutable de la forme aiguë, touchant 10 à 15% des patients [8]. Cette destruction du tissu pancréatique peut s'infecter et mettre en jeu le pronostic vital.
Les pseudokystes pancréatiques se développent dans 15% des pancréatites aiguës et 30% des formes chroniques [9]. Ces collections liquidiennes peuvent comprimer les organes voisins ou s'infecter. Heureusement, les techniques de drainage percutané ou endoscopique permettent aujourd'hui un traitement efficace et peu invasif [3].
L'insuffisance pancréatique constitue l'évolution naturelle de la pancréatite chronique. Elle se manifeste par une maldigestion (selles grasses, perte de poids) et un diabète secondaire [1]. Cette complication, bien que définitive, se contrôle parfaitement avec une supplémentation enzymatique et un traitement antidiabétique adapté.
Plus rarement, des complications vasculaires peuvent survenir : thrombose de la veine splénique, faux anévrisme artériel [11]. Ces situations nécessitent parfois une intervention d'urgence. C'est pourquoi un suivi médical régulier reste indispensable, même après guérison apparente d'un épisode aigu.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de la pancréatite dépend étroitement de sa forme et de sa prise en charge précoce. Pour la pancréatite aiguë légère, l'évolution est généralement excellente : 90% des patients guérissent complètement sans séquelles [8]. La durée d'hospitalisation moyenne est de 5 à 7 jours, et la reprise d'une activité normale intervient en 2 à 4 semaines.
Les formes sévères présentent un pronostic plus réservé, avec une mortalité de 10 à 15% malgré les progrès thérapeutiques [9]. Cependant, les patients qui survivent à la phase aiguë récupèrent souvent une fonction pancréatique normale. L'âge, les comorbidités et la précocité du traitement influencent considérablement l'évolution.
La pancréatite chronique suit une évolution différente, marquée par une dégradation progressive mais lente de la fonction pancréatique [4]. L'espérance de vie peut être réduite de 10 à 15 ans, principalement en raison des complications cardiovasculaires et du risque accru de cancer pancréatique. Néanmoins, un suivi médical optimal et l'arrêt de l'alcool améliorent significativement le pronostic.
Il faut savoir que les récidives concernent 15 à 20% des patients après un premier épisode [8]. Ce risque diminue considérablement avec l'éviction des facteurs déclenchants : arrêt de l'alcool, traitement des calculs biliaires, adaptation des traitements médicamenteux. Votre engagement dans le suivi médical joue un rôle déterminant dans l'évolution à long terme.
Peut-on Prévenir la Pancréatite ?
La prévention de la pancréatite repose sur des mesures simples mais efficaces, centrées sur la modification des facteurs de risque identifiés. L'arrêt ou la limitation de l'alcool constitue la mesure préventive la plus importante [4]. Même une consommation modérée peut être dangereuse chez les personnes prédisposées. Si vous avez déjà eu un épisode, l'abstinence totale s'impose.
La prévention des calculs biliaires passe par une alimentation équilibrée, le maintien d'un poids normal et une activité physique régulière [2]. Si vous présentez des calculs asymptomatiques, discutez avec votre médecin de l'opportunité d'un traitement préventif, surtout si vous avez d'autres facteurs de risque.
La surveillance médicamenteuse mérite votre attention. Certains médicaments peuvent déclencher une pancréatite : informez toujours vos médecins de vos antécédents [9]. Ne modifiez jamais un traitement sans avis médical, mais n'hésitez pas à signaler tout symptôme suspect lors de l'introduction d'un nouveau médicament.
Enfin, le contrôle des facteurs métaboliques contribue à la prévention : maintien d'un taux de triglycérides normal, équilibre du diabète si vous en souffrez, traitement des maladies auto-immunes [6]. Ces mesures, bien que moins spectaculaires, réduisent significativement votre risque de développer une pancréatite.
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises ont récemment actualisé leurs recommandations concernant la prise en charge de la pancréatite, intégrant les dernières avancées thérapeutiques [8]. La Haute Autorité de Santé (HAS) préconise désormais une approche multidisciplinaire dès le diagnostic, associant gastro-entérologues, chirurgiens, nutritionnistes et psychologues.
Concernant la prise en charge initiale, les nouvelles directives insistent sur l'importance d'une évaluation précoce de la gravité [8]. Le score de Ranson et le score APACHE II permettent de stratifier les patients et d'adapter la prise en charge. Les formes légères peuvent être traitées en ambulatoire sous certaines maladies strictes.
L'innovation thérapeutique occupe une place croissante dans les recommandations 2024-2025 . Les techniques endoscopiques sont désormais privilégiées avant la chirurgie pour traiter les complications de la pancréatite chronique [1,3]. Cette approche moins invasive améliore la qualité de vie des patients tout en réduisant la morbi-mortalité.
Les autorités insistent également sur l'importance du suivi à long terme et de l'éducation thérapeutique [4]. Chaque patient doit bénéficier d'un programme personnalisé incluant conseils nutritionnels, gestion de la douleur, et soutien psychologique. Cette approche globale améliore significativement l'adhésion aux traitements et la qualité de vie.
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs associations françaises accompagnent les patients atteints de pancréatite et leurs familles. L'Association Française des Malades du Pancréas (AFMP) propose un soutien psychologique, des groupes de parole et une documentation actualisée sur les traitements. Leurs forums en ligne permettent d'échanger avec d'autres patients partageant les mêmes difficultés.
La Société Nationale Française de Gastro-Entérologie (SNFGE) met à disposition des patients des fiches d'information validées scientifiquement. Leur site internet propose également un annuaire des centres spécialisés dans la prise en charge des maladies pancréatiques, facilitant l'accès aux soins experts.
Pour les aspects nutritionnels, l'Association Française des Diététiciens Nutritionnistes propose des consultations spécialisées et des ateliers culinaires adaptés aux contraintes de la pancréatite. Ces ressources pratiques vous aideront à adapter votre alimentation sans sacrifier le plaisir de manger.
N'oubliez pas les ressources locales : de nombreux hôpitaux organisent des écoles de patients, des conférences d'information et des groupes de soutien. Votre médecin traitant ou votre gastro-entérologue peuvent vous orienter vers ces dispositifs d'accompagnement disponibles dans votre région.
Nos Conseils Pratiques
Gérer une pancréatite au quotidien demande quelques ajustements simples mais efficaces. Pour l'alimentation, privilégiez la règle des "petites portions fréquentes" : 5 à 6 repas légers valent mieux que 3 gros repas. Évitez les aliments frits, les sauces grasses et l'alcool sous toutes ses formes, même en cuisine.
Concernant la gestion de la douleur, tenez un carnet de suivi : notez l'intensité, les facteurs déclenchants, l'efficacité des traitements. Ces informations précieuses aideront votre médecin à adapter votre prise en charge. N'attendez pas que la douleur devienne insupportable pour prendre vos antalgiques.
Pour les voyages et sorties, préparez toujours une trousse de secours : médicaments antidouleur, enzymes pancréatiques, coordonnées de votre médecin. Informez vos proches de votre pathologie et des gestes à adopter en cas de crise. Cette préparation vous permettra de maintenir une vie sociale normale.
Enfin, n'hésitez pas à communiquer avec votre équipe soignante. Posez toutes vos questions, exprimez vos inquiétudes, partagez vos difficultés. Une bonne relation médecin-patient améliore considérablement la prise en charge et votre bien-être général. Rappelez-vous : vous êtes l'acteur principal de votre santé.
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes doivent vous alerter et justifier une consultation médicale rapide, voire urgente. Une douleur abdominale intense et persistante, surtout si elle irradie vers le dos et s'accompagne de nausées, nécessite un avis médical dans les heures qui suivent [9]. N'attendez pas que la douleur devienne insupportable.
Les signes de gravité imposent un recours aux urgences : fièvre élevée, vomissements incoercibles, altération de l'état général, jaunisse, troubles de la conscience [8]. Ces symptômes peuvent traduire des complications graves nécessitant une prise en charge hospitalière immédiate.
Pour les patients déjà diagnostiqués, consultez rapidement en cas de modification des symptômes habituels : aggravation de la douleur, apparition de nouveaux troubles digestifs, perte de poids inexpliquée, modification de l'aspect des selles [4]. Ces changements peuvent signaler une évolution de votre pathologie.
N'oubliez pas l'importance du suivi médical régulier, même en l'absence de symptômes. Votre médecin évaluera l'évolution de votre pancréatite, adaptera vos traitements et dépisterait d'éventuelles complications. Cette surveillance préventive améliore considérablement votre pronostic à long terme.
Médicaments associés
Les médicaments suivants peuvent être prescrits dans le cadre de Pancréatite. Consultez toujours un professionnel de santé avant toute prise de médicament.
Questions Fréquentes
Peut-on guérir complètement d'une pancréatite ?
La pancréatite aiguë guérit complètement dans 90% des cas légers avec un traitement approprié. La pancréatite chronique, en revanche, entraîne des lésions irréversibles, mais ses symptômes peuvent être efficacement contrôlés avec un suivi médical adapté.
Combien de temps dure une crise de pancréatite aiguë ?
Une crise de pancréatite aiguë dure généralement 3 à 7 jours avec un traitement hospitalier. La douleur s'atténue progressivement, et la plupart des patients peuvent reprendre une alimentation normale après une semaine.
Quels aliments éviter absolument avec une pancréatite ?
Évitez l'alcool sous toutes ses formes, les aliments gras (fritures, charcuterie), les plats épicés, les boissons gazeuses et les aliments trop sucrés. Privilégiez une alimentation légère, fractionnée en petites portions.
La pancréatite peut-elle évoluer vers un cancer ?
La pancréatite chronique augmente légèrement le risque de cancer pancréatique (multiplié par 2 à 3), mais ce risque reste faible. Un suivi médical régulier permet de dépister précocement toute évolution suspecte.
Peut-on faire du sport avec une pancréatite chronique ?
Oui, l'activité physique adaptée est même recommandée. Privilégiez des sports doux comme la marche, la natation ou le yoga. Évitez les sports de contact et les efforts intenses qui pourraient déclencher des douleurs.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Cancer du pancréas | Fiche santé HCL. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [2] POST U. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [3] Cancer du pancréas : une recrudescence des cas en Asie. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [4] Arrowhead Pharmaceuticals Presents New Pivotal Phase 3. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [5] New Phase III Clinical Trial Actively Recruiting. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [6] MFY Viesca, M Arvanitakis - Hépato-Gastro & Oncologie Digestive. Traitements instrumentaux de la pancréatite chronique. 2025.Lien
- [7] B Sohaib, B Borhan-eddine. PANCRÉATITE AIGUE LITHIASIQUE.Lien
- [8] S Leblanc - Hépato-Gastro & Oncologie Digestive. Traitements instrumentaux de la pancréatite chronique. 2025.Lien
- [9] F Maire, M Palazzo - POSTU'U. La douleur dans la pancréatite chronique: traitement médicamenteux, endoscopique ou chirurgical. 2022.Lien
- [10] LM Silvestri, GN de Souza. Pancreatite aguda-revisão literária. 2024.Lien
- [11] C Kaddouri, F EH. La pancréatite lupique: une série de 43 cas. 2023.Lien
- [12] F Maire, S Dokmak - Hépato-Gastro & Oncologie Digestive. Place de la chirurgie dans le traitement de la pancréatite chronique. 2025.Lien
- [13] V REBOURS - Formation Médicale Continue en Hépato-Gastro. Pancréatite aiguë: prise en charge à la phase initiale. 2024.Lien
- [14] Pancréatite aiguë - Troubles digestifs. MSD Manuals.Lien
- [15] Pancréatite : définition, causes, traitements. Elsan Care.Lien
- [16] Pancréatite aiguë - Troubles gastro-intestinaux. MSD Manuals Professional.Lien
Publications scientifiques
- Traitements instrumentaux de la pancréatite chronique (2025)
- [PDF][PDF] PANCRÉATITE AIGUE LITHIASIQUE [PDF]
- Traitements instrumentaux de la pancréatite chronique (2025)
- [PDF][PDF] La douleur dans la pancréatite chronique: traitement médicamenteux, endoscopique ou chirurgical (2022)2 citations[PDF]
- Pancreatite aguda-revisão literária (2024)3 citations
Ressources web
- Pancréatite aiguë - Troubles digestifs (msdmanuals.com)
Diagnostic de la pancréatite aiguë. Analyses de sang. Examens d'imagerie. La douleur abdominale typique permet au médecin de suspecter une pancréatite aiguë ...
- Pancréatite : définition, causes, traitements (elsan.care)
Quels sont les signes de la pancréatite : douleurs, symptômes ? · tachycardie ; · hypotension ; · respiration superficielle et saccadée ; · légère fièvre ; ...
- Pancréatite aiguë - Troubles gastro-intestinaux (msdmanuals.com)
Le diagnostic repose sur les données cliniques, la lipasémie et l'amylasémie et l'imagerie. Le traitement est un traitement de support, avec des liquides IV, ...
- Pancréatite aiguë - CNPHGE (cnp-hge.fr)
DIAGNOSTIC · Douleur abdominale typique : en général de début brutal, épigastrique, à irradiation postérieur calmée par la position anté-flexion du tronc et ...
- Pancréatite : définition, causes, symptômes et traitements (sante-sur-le-net.com)
Le diagnostic de la pancréatite repose sur la présence des symptômes caractéristiques (la douleur et sa localisation) associés à la réalisation de différents ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
