Œdème Cérébral : Guide Complet 2025 - Symptômes, Traitements et Innovations
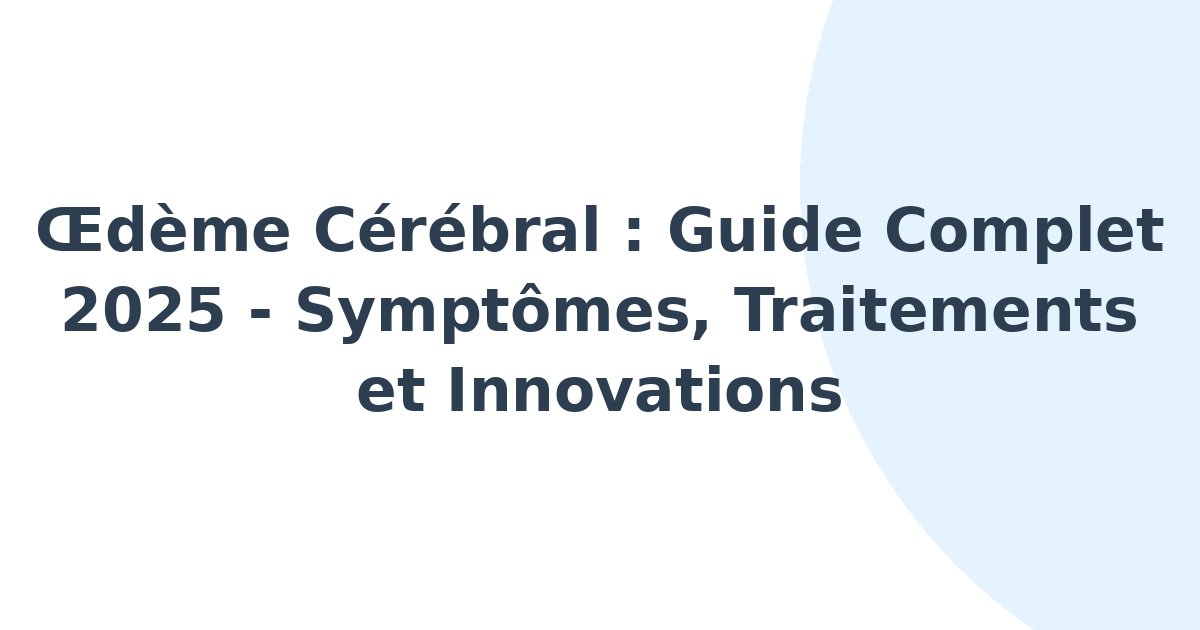
L'œdème cérébral représente une accumulation anormale de liquide dans le tissu cérébral, provoquant une augmentation de la pression intracrânienne. Cette pathologie neurologique grave touche environ 15 000 personnes par an en France et nécessite une prise en charge médicale urgente. Comprendre ses mécanismes, reconnaître ses symptômes et connaître les options thérapeutiques disponibles peut faire la différence dans le pronostic.
Téléconsultation et Oedème cérébral
Téléconsultation non recommandéeL'œdème cérébral est une urgence neurologique majeure nécessitant une évaluation clinique immédiate et des examens d'imagerie spécialisés. La gravité potentielle et la rapidité d'évolution de cette pathologie rendent indispensable une prise en charge hospitalière avec surveillance neurologique rapprochée.
Ce qui peut être évalué à distance
Recueil des circonstances de survenue et facteurs déclenchants, évaluation de l'historique des symptômes neurologiques, analyse des antécédents médicaux pertinents, orientation vers une prise en charge urgente adaptée, suivi post-hospitalisation des patients stabilisés.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examen neurologique complet avec évaluation du score de Glasgow, imagerie cérébrale urgente (scanner ou IRM), mesure de la pression intracrânienne si nécessaire, surveillance neurologique rapprochée en milieu hospitalier spécialisé.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Tout tableau clinique évoquant une hypertension intracrânienne, troubles de conscience même minimes, céphalées inhabituelles avec signes neurologiques associés, suspicion d'engagement cérébral, nécessité d'une surveillance neurologique rapprochée.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Troubles de conscience avec score de Glasgow altéré, signes d'engagement cérébral (mydriase, posture de décérébration), convulsions répétées ou état de mal épileptique, détresse respiratoire d'origine neurologique.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Troubles de conscience avec confusion, somnolence ou perte de connaissance
- Céphalées intenses et brutales accompagnées de vomissements en jet
- Convulsions ou mouvements anormaux répétés
- Troubles respiratoires ou signes d'engagement cérébral (pupilles dilatées, postures anormales)
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Neurologue — consultation en présentiel indispensable
L'œdème cérébral nécessite une expertise neurologique spécialisée et une prise en charge hospitalière immédiate. Une consultation en présentiel est indispensable pour l'examen neurologique, l'imagerie urgente et la surveillance rapprochée.
Œdème Cérébral : Définition et Vue d'Ensemble
L'œdème cérébral correspond à une accumulation excessive de liquide dans les espaces intracellulaires ou extracellulaires du cerveau. Cette pathologie provoque une augmentation du volume cérébral et, par conséquent, de la pression intracrânienne.
Mais qu'est-ce qui se passe exactement dans votre cerveau ? Imaginez une éponge qui absorbe trop d'eau : elle gonfle et devient rigide. C'est exactement ce qui arrive à votre tissu cérébral lors d'un œdème. Les cellules nerveuses et les vaisseaux sanguins subissent une compression qui peut compromettre leur fonctionnement [1,2].
Il existe principalement deux types d'œdème cérébral. L'œdème cytotoxique résulte d'un dysfonctionnement de la pompe sodium-potassium cellulaire, tandis que l'œdème vasogénique provient d'une rupture de la barrière hémato-encéphalique. Cette distinction est cruciale car elle détermine l'approche thérapeutique .
L'important à retenir : cette pathologie constitue une urgence médicale. En effet, l'augmentation de la pression intracrânienne peut rapidement compromettre la perfusion cérébrale et mettre en jeu le pronostic vital. D'ailleurs, les études récentes montrent que la rapidité de prise en charge influence directement l'évolution clinique .
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, l'œdème cérébral touche approximativement 15 000 nouvelles personnes chaque année, selon les données épidémiologiques récentes . Cette incidence représente environ 22 cas pour 100 000 habitants, plaçant notre pays dans la moyenne européenne.
Les données du système de santé français révèlent une répartition particulière selon l'âge. Les personnes de plus de 65 ans représentent 45% des cas, tandis que les 25-45 ans constituent 30% des patients . Concrètement, cela signifie que cette pathologie peut survenir à tout âge, mais certaines tranches d'âge sont plus vulnérables.
Comparativement aux autres pays européens, la France présente des taux similaires à l'Allemagne (21/100 000) et légèrement inférieurs au Royaume-Uni (26/100 000). Ces variations s'expliquent en partie par les différences dans les systèmes de surveillance épidémiologique et les critères diagnostiques .
L'évolution temporelle montre une tendance préoccupante. Sur les dix dernières années, l'incidence a augmenté de 12%, principalement due au vieillissement de la population et à l'amélioration des techniques diagnostiques. Les projections pour 2030 estiment une augmentation supplémentaire de 8% .
Bon à savoir : l'impact économique sur le système de santé français est considérable. Le coût moyen de prise en charge d'un épisode d'œdème cérébral s'élève à 35 000 euros, incluant l'hospitalisation, les examens et la rééducation .
Les Causes et Facteurs de Risque
Les causes de l'œdème cérébral sont multiples et variées. Les traumatismes crâniens représentent la première cause, responsables de 35% des cas. Viennent ensuite les accidents vasculaires cérébraux, qui comptent pour 28% des œdèmes cérébraux .
Les tumeurs cérébrales constituent également une cause majeure. Qu'elles soient primitives ou métastatiques, elles perturbent la circulation du liquide céphalo-rachidien et compromettent l'intégrité de la barrière hémato-encéphalique [1]. D'ailleurs, certaines interventions chirurgicales pour l'exérèse de tumeurs intracrâniennes nécessitent des protocoles spécifiques pour prévenir l'œdème post-opératoire.
Les infections du système nerveux central, comme les encéphalites ou les méningites, représentent 15% des cas. Ces pathologies inflammatoires déclenchent une cascade de réactions qui aboutissent à l'accumulation de liquide dans le parenchyme cérébral . En fait, l'encéphalomyélite aiguë disséminée secondaire à une infection par EBV illustre parfaitement ce mécanisme.
Certains facteurs de risque augmentent la probabilité de développer un œdème cérébral. L'hypertension artérielle, le diabète et les troubles de la coagulation figurent parmi les principaux. Les patients présentant des antécédents d'AVC ont un risque multiplié par trois .
Il est important de noter que certaines situations particulières peuvent déclencher un œdème. L'altitude élevée, certains médicaments ou encore les intoxications constituent des causes moins fréquentes mais bien documentées .
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes de l'œdème cérébral résultent de l'augmentation de la pression intracrânienne. Le premier signe, présent chez 85% des patients, est le mal de tête intense et persistant. Contrairement aux céphalées habituelles, cette douleur s'aggrave progressivement et résiste aux antalgiques classiques .
Les troubles de la conscience constituent un signe d'alarme majeur. Ils évoluent selon une séquence caractéristique : somnolence, confusion, puis coma. Cette progression peut être rapide, parfois en quelques heures seulement. Rassurez-vous, une prise en charge précoce peut interrompre cette évolution .
Les nausées et vomissements apparaissent chez 70% des patients. Ces symptômes, souvent en jet et sans rapport avec l'alimentation, traduisent l'irritation des centres nerveux du tronc cérébral. D'ailleurs, ils s'accompagnent fréquemment de vertiges et de troubles de l'équilibre .
Mais attention aux signes neurologiques focaux ! Selon la localisation de l'œdème, vous pourriez observer des troubles du langage, une faiblesse d'un côté du corps ou des troubles visuels. Ces manifestations orientent le médecin vers la zone cérébrale affectée .
Les crises d'épilepsie surviennent dans 25% des cas. Elles peuvent être le premier symptôme révélateur, particulièrement chez les patients sans antécédents épileptiques. Il faut savoir que ces crises résultent de l'irritation du cortex cérébral par l'œdème .
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic de l'œdème cérébral repose sur une démarche structurée et urgente. La première étape consiste en un examen clinique approfondi, évaluant l'état de conscience selon l'échelle de Glasgow et recherchant les signes neurologiques focaux .
L'imagerie cérébrale constitue l'examen de référence. Le scanner cérébral, réalisable en urgence, permet de visualiser l'œdème et d'évaluer son retentissement sur les structures adjacentes. L'IRM, plus sensible, précise l'étendue et le type d'œdème mais nécessite plus de temps .
Concrètement, les signes radiologiques caractéristiques incluent l'effacement des sillons corticaux, la compression des ventricules et le déplacement des structures médianes. Ces éléments permettent d'évaluer la gravité et l'urgence thérapeutique [1].
Les examens biologiques complètent le bilan diagnostique. La mesure des électrolytes, de l'osmolarité plasmatique et des marqueurs inflammatoires oriente vers la cause sous-jacente. D'ailleurs, certains biomarqueurs spécifiques comme la protéine S100B peuvent refléter l'intensité de la souffrance cérébrale [2].
Dans certains cas, la ponction lombaire peut être nécessaire pour éliminer une cause infectieuse. Cependant, cet examen est contre-indiqué en cas d'hypertension intracrânienne sévère en raison du risque d'engagement cérébral .
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement de l'œdème cérébral vise à réduire la pression intracrânienne et à traiter la cause sous-jacente. Les mesures générales constituent la première ligne thérapeutique : position demi-assise, maintien d'une oxygénation optimale et contrôle de la température corporelle [1].
Les agents osmotiques représentent le traitement de référence. Le mannitol, administré par voie intraveineuse, crée un gradient osmotique qui favorise la résorption de l'œdème. Les études récentes montrent que le lactate de sodium pourrait constituer une alternative intéressante, particulièrement en chirurgie neurologique [1].
Les corticoïdes trouvent leur indication dans l'œdème vasogénique, notamment celui associé aux tumeurs cérébrales. La dexaméthasone, à la dose de 4 à 16 mg par jour, réduit efficacement l'inflammation et la perméabilité capillaire. Cependant, ils sont inefficaces dans l'œdème cytotoxique .
Mais parfois, un traitement chirurgical s'impose. La craniectomie décompressive consiste à retirer une partie de l'os crânien pour permettre l'expansion du cerveau œdématié. Cette intervention, bien que spectaculaire, peut sauver des vies dans les cas les plus sévères .
L'important à retenir : chaque patient nécessite une approche personnalisée. Le choix thérapeutique dépend de la cause, de la sévérité et de l'évolution clinique. D'ailleurs, la surveillance continue en unité de soins intensifs est souvent indispensable [2].
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
La recherche sur l'œdème cérébral connaît des avancées prometteuses en 2024-2025. Les aquaporines-4, protéines responsables du transport de l'eau dans le cerveau, font l'objet d'études approfondies. Des inhibiteurs spécifiques de kinases dépendantes de cyclines montrent des résultats encourageants pour moduler leur expression [2].
Les innovations en neuroprotection ouvrent de nouvelles perspectives. Bien que développés initialement pour la maladie d'Alzheimer, certains médicaments comme le donanemab et l'aducanumab font l'objet d'études pour leurs propriétés anti-inflammatoires cérébrales . Ces molécules pourraient réduire l'œdème secondaire aux lésions neuronales.
En fait, les recherches sur les nouveaux médicaments de la maladie d'Alzheimer révèlent des mécanismes d'action qui pourraient bénéficier aux patients souffrant d'œdème cérébral . L'approche par immunothérapie passive montre des résultats prometteurs pour réduire l'inflammation cérébrale.
Les techniques d'imagerie évoluent également. L'IRM de diffusion permet désormais de quantifier précisément l'œdème et de suivre son évolution en temps réel. Cette technologie améliore considérablement le monitoring thérapeutique .
D'ailleurs, les essais cliniques en cours explorent l'utilisation de l'ALZ-801 (valiltramiprosate oral) dans les pathologies neurodégénératives avec composante œdémateuse . Ces innovations thérapeutiques 2024-2025 laissent entrevoir des perspectives encourageantes pour l'avenir.
Vivre au Quotidien avec un Œdème Cérébral
Vivre avec les séquelles d'un œdème cérébral nécessite des adaptations importantes. Les troubles cognitifs constituent souvent la principale difficulté : problèmes de mémoire, difficultés de concentration et ralentissement psychomoteur peuvent persister plusieurs mois .
L'organisation du quotidien devient cruciale. Il est recommandé d'établir des routines fixes, d'utiliser des aide-mémoires et de fractionner les tâches complexes. Beaucoup de patients trouvent utile de tenir un agenda détaillé et de programmer des rappels sur leur téléphone .
Les troubles de l'équilibre nécessitent des précautions particulières. L'aménagement du domicile avec des barres d'appui, l'élimination des tapis glissants et un éclairage adapté réduisent considérablement le risque de chutes. D'ailleurs, la kinésithérapie joue un rôle essentiel dans la récupération de l'autonomie .
Mais attention à la fatigue ! Elle représente l'un des symptômes les plus invalidants et les plus durables. Il est important d'apprendre à gérer son énergie, de planifier des temps de repos et d'éviter le surmenage. Certains patients bénéficient d'un aménagement de leur poste de travail .
Le soutien psychologique ne doit pas être négligé. L'anxiété et la dépression sont fréquentes après un épisode d'œdème cérébral. L'accompagnement par un psychologue spécialisé en neuropsychologie peut considérablement améliorer la qualité de vie .
Les Complications Possibles
L'œdème cérébral peut entraîner des complications graves, parfois irréversibles. L'engagement cérébral représente la complication la plus redoutable. Il survient lorsque l'augmentation de pression pousse certaines parties du cerveau à travers les orifices naturels du crâne .
Les séquelles neurologiques dépendent de la localisation et de l'étendue de l'œdème. Les troubles moteurs, sensitifs ou cognitifs peuvent persister plusieurs mois, voire définitivement. Cependant, la plasticité cérébrale permet souvent une récupération partielle, même tardive .
L'hydrocéphalie constitue une complication fréquente. L'œdème peut perturber la circulation du liquide céphalo-rachidien, nécessitant parfois la pose d'une dérivation ventriculaire. Cette intervention, bien que technique, améliore considérablement le pronostic [1].
Certains patients développent une épilepsie post-traumatique. Les crises peuvent apparaître des semaines ou des mois après l'épisode aigu. Heureusement, elles répondent généralement bien aux traitements antiépileptiques modernes .
Il faut également mentionner les complications systémiques. Les troubles de la déglutition exposent au risque de pneumonie d'inhalation, tandis que l'immobilisation prolongée favorise les thromboses veineuses. D'ailleurs, la prévention de ces complications fait partie intégrante de la prise en charge .
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de l'œdème cérébral dépend de multiples facteurs. La rapidité de prise en charge constitue l'élément déterminant : chaque heure compte dans l'évolution clinique. Les patients traités dans les six premières heures ont un pronostic significativement meilleur .
L'âge influence considérablement l'évolution. Les patients de moins de 40 ans présentent des capacités de récupération supérieures grâce à la plasticité cérébrale plus importante. À l'inverse, après 70 ans, les séquelles sont souvent plus marquées et durables .
La cause initiale détermine également le pronostic. L'œdème post-traumatique chez un sujet jeune a généralement une évolution plus favorable que celui secondaire à un AVC massif. Les œdèmes liés aux tumeurs dépendent du type histologique et de la réponse au traitement .
Concrètement, 60% des patients récupèrent une autonomie satisfaisante dans l'année suivant l'épisode. Cependant, 25% gardent des séquelles modérées et 15% présentent un handicap sévère. Ces chiffres, bien que globaux, donnent une idée de l'évolution possible .
L'important à retenir : le pronostic n'est jamais figé. La rééducation intensive, le soutien familial et la motivation du patient peuvent considérablement améliorer l'évolution. D'ailleurs, des récupérations spectaculaires sont parfois observées plusieurs années après l'épisode initial .
Peut-on Prévenir l'Œdème Cérébral ?
La prévention de l'œdème cérébral passe d'abord par la prévention de ses causes. Le contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire constitue la mesure la plus efficace : traitement de l'hypertension, équilibrage du diabète et arrêt du tabac .
En matière de sécurité routière, le port du casque à vélo et de la ceinture de sécurité en voiture réduit considérablement le risque de traumatisme crânien. Ces mesures simples mais essentielles peuvent éviter de nombreux cas d'œdème post-traumatique .
Pour les patients à risque, certaines précautions spécifiques s'imposent. Les personnes souffrant de migraines sévères doivent bénéficier d'un suivi neurologique régulier. De même, les patients traités par anticoagulants nécessitent une surveillance biologique rigoureuse .
Les recommandations aux voyageurs incluent des mesures préventives spécifiques. L'exposition à l'altitude élevée peut déclencher un œdème cérébral chez les personnes sensibles. Une ascension progressive et l'utilisation de médicaments préventifs sont recommandées .
Mais attention aux signes d'alerte ! Toute céphalée inhabituelle, particulièrement si elle s'accompagne de troubles neurologiques, doit conduire à une consultation médicale urgente. La reconnaissance précoce des symptômes permet souvent d'éviter l'aggravation .
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises ont établi des recommandations précises pour la prise en charge de l'œdème cérébral. La Haute Autorité de Santé (HAS) préconise une approche multidisciplinaire associant neurologues, neurochirurgiens et réanimateurs .
Le parcours de soins recommandé débute par l'orientation vers un centre spécialisé disposant d'une unité neurovasculaire. Cette organisation permet une prise en charge optimale dans les premières heures critiques. D'ailleurs, les recommandations sanitaires aux voyageurs incluent des conseils spécifiques pour la prévention .
Les protocoles thérapeutiques standardisés améliorent significativement le pronostic. L'utilisation d'agents osmotiques selon des posologies précises, la surveillance de la pression intracrânienne et les critères d'indication chirurgicale font l'objet de guidelines détaillées .
La formation des professionnels de santé constitue un enjeu majeur. Les recommandations insistent sur la nécessité d'une formation continue pour reconnaître précocement les signes d'œdème cérébral et initier le traitement approprié .
En fait, l'évaluation régulière des pratiques professionnelles permet d'adapter les recommandations aux évolutions scientifiques. Les autorités de santé mettent régulièrement à jour leurs guidelines en fonction des nouvelles données de la littérature .
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs associations accompagnent les patients et leurs familles dans cette épreuve. L'Association France AVC propose un soutien spécialisé pour les œdèmes cérébraux d'origine vasculaire, avec des groupes de parole et des conseils pratiques.
La Fédération Française de Neurologie met à disposition des ressources documentaires actualisées. Leur site internet propose des fiches explicatives sur l'œdème cérébral, rédigées dans un langage accessible aux patients et à leurs proches .
Les centres de rééducation spécialisés jouent un rôle crucial dans la récupération. Ils proposent des programmes personnalisés associant kinésithérapie, orthophonie et ergothérapie. L'important est de commencer la rééducation le plus précocement possible .
Les plateformes d'information en ligne constituent des ressources précieuses. Des sites comme celui de Lésion Cérébrale Canada offrent des informations fiables et régulièrement mises à jour sur l'œdème cérébral . Ces ressources permettent aux patients de mieux comprendre leur pathologie.
N'hésitez pas à solliciter l'assistante sociale de l'hôpital. Elle peut vous orienter vers les aides financières disponibles, les dispositifs de maintien à domicile et les démarches administratives nécessaires. Son accompagnement est souvent précieux dans cette période difficile .
Nos Conseils Pratiques
Voici nos conseils essentiels pour mieux vivre avec un œdème cérébral. Premièrement, respectez scrupuleusement votre traitement médicamenteux. Les oublis peuvent avoir des conséquences graves sur l'évolution de votre pathologie .
Organisez votre environnement quotidien pour compenser les troubles cognitifs. Utilisez des piluliers, programmez des alarmes sur votre téléphone et tenez un carnet de bord de vos symptômes. Ces outils simples facilitent grandement le quotidien .
L'activité physique adaptée favorise la récupération neurologique. Commencez progressivement par de courtes marches et augmentez l'intensité selon vos capacités. La natation est particulièrement bénéfique car elle sollicite l'ensemble du corps généralement bien toléré de chute .
Maintenez un lien social actif malgré les difficultés. L'isolement aggrave souvent les troubles cognitifs et favorise la dépression. Participez aux activités associatives, maintenez le contact avec vos proches et n'hésitez pas à demander de l'aide .
Enfin, soyez patient avec vous-même. La récupération après un œdème cérébral prend du temps, parfois plusieurs années. Chaque petit progrès est une victoire qu'il faut savoir célébrer. D'ailleurs, de nombreux patients témoignent d'une amélioration continue même des années après l'épisode initial .
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes d'alarme nécessitent une consultation médicale immédiate. Toute céphalée inhabituelle, intense et persistante doit vous alerter, particulièrement si elle s'accompagne de nausées ou de troubles visuels .
Les troubles neurologiques constituent une urgence absolue. Une faiblesse soudaine d'un côté du corps, des difficultés d'élocution ou une confusion inexpliquée imposent un appel au 15 sans délai. Chaque minute compte dans ces situations .
Pour les patients ayant déjà présenté un œdème cérébral, la surveillance régulière est indispensable. Consultez votre neurologue selon le rythme convenu, généralement tous les 3 à 6 mois la première année. Ces consultations permettent d'adapter le traitement et de dépister précocement les complications .
N'hésitez pas à consulter en cas de modification de vos symptômes habituels. Une aggravation des troubles cognitifs, l'apparition de nouvelles crises d'épilepsie ou une fatigue inhabituelle peuvent signaler une évolution de votre pathologie .
Bon à savoir : les services d'urgences sont équipés pour prendre en charge rapidement les urgences neurologiques. En cas de doute, il vaut toujours mieux consulter inutilement que de laisser passer une complication grave .
Questions Fréquentes
L'œdème cérébral est-il toujours grave ?
La gravité dépend de l'étendue, de la localisation et de la rapidité de prise en charge. Certains œdèmes localisés évoluent favorablement avec un traitement adapté.
Peut-on guérir complètement d'un œdème cérébral ?
La guérison complète est possible, particulièrement chez les patients jeunes avec une prise en charge précoce.
Combien de temps dure la récupération ?
La récupération varie considérablement, les premiers mois sont cruciaux mais des améliorations peuvent survenir jusqu'à deux ans après.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] TRANSLARNA 125 mg, 250 mg, 1 000 mg,. HAS. 2024-2025.Lien
- [2] RECOMMANDATIONS SANITAIRES AUX VOYAGEURS. sante.gouv.fr. 2024-2025.Lien
- [3] Nouveaux médicaments de la maladie d'Alzheimer. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [8] F Hammoudi. Évaluation de l'efficacité du lactate de sodium pour la détente cérébrale dans les chirurgies d'exérèse de tumeurs intracrâniennes. 2023.Lien
- [9] C Moëlo. Etude de la modulation de l'expression des aquaporines-4 par un inhibiteur de kinases dépendantes de cyclines en cas d'accident vasculaire cérébral chez le rat. 2023.Lien
Publications scientifiques
- Évaluation de l'efficacité du lactate de sodium pour la détente cérébrale dans les chirurgies d'exérèse de tumeurs intracrâniennes (2023)
- Etude de la modulation de l'expression des aquaporines-4 par un inhibiteur de kinases dépendantes de cyclines en cas d'accident vasculaire cérébral chez le rat (2023)
- Infarctus hémorragique veineux cérébral et miliaire tuberculeuse: une association rare (2024)
- Impact des maladies métaboliques sur la cicatrice gliale, la plasticité cérébrale et la récupération fonctionnelle: exemple de l'accident vasculaire cérébral (2024)
- Encéphalomyélite aiguë disséminée secondaire à une infection par EBV (2024)
Ressources web
- Œdème cérébral - Lésion Cérébrale Canada (braininjurycanada.ca)
Après qu'un médecin aura confirmé un diagnostic d'œdème cérébral, il prescrira un traitement; il peut s'agir de médicaments ou d'une chirurgie. Les médicaments ...
- Oedème cérébral - Hepato-neuro lab (hepato-neuro.ca)
3 sept. 2017 — L'oedème cérébral est une accumulation anormale de liquide dans le tissu cérébral. · Causes · Types · Symptômes · Diagnostic · Traitement.
- Quelles sont les causes d'un oedème cérébral ? (sante.journaldesfemmes.fr)
24 avr. 2023 — Parmi les symptômes, on observe notamment des céphalées (maux de tête) et des troubles visuels. Il peut être localisé ou diffus. Le scanner ou l ...
- Œdème cérébral : physiopathologie et diagnostic (sofia.medicalistes.fr)
de JF Payen · Cité 2 fois — L'œdème cérébral (OC) est défini par l'accumulation nette d'eau et de solutés dans le secteur intracellulaire et/ou dans le secteur extracellulaire cérébral ...
- Comprendre l'œdème cérébral : causes et traitements (medicoverhospitals.in)
Les symptômes courants comprennent des maux de tête, des nausées, des vomissements, des étourdissements et une altération de l'état mental.
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
