Nécrose de la Tête Fémorale : Guide Complet 2025 - Symptômes, Traitements
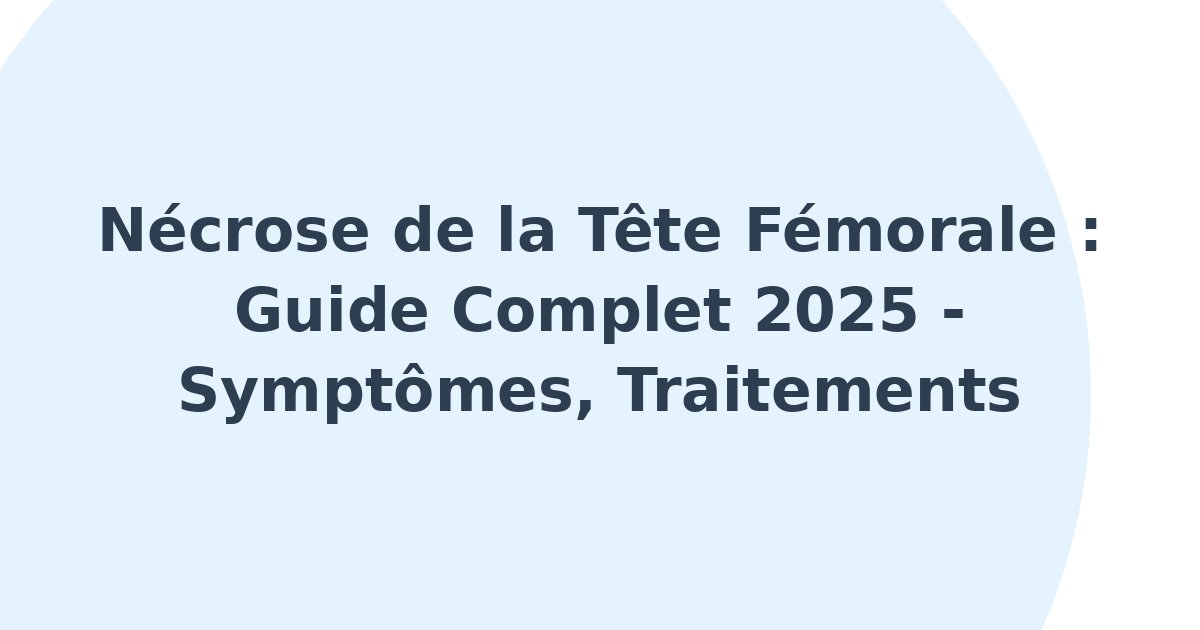
La nécrose de la tête fémorale, aussi appelée ostéonécrose aseptique de la hanche, touche environ 15 000 personnes chaque année en France [1,2]. Cette pathologie, qui provoque la mort progressive du tissu osseux de la tête du fémur, peut considérablement impacter votre qualité de vie. Mais rassurez-vous : les innovations thérapeutiques 2024-2025 offrent de nouveaux espoirs [3,4,5].
Téléconsultation et Nécrose de la tête fémorale
Téléconsultation non recommandéeLa nécrose de la tête fémorale nécessite impérativement un examen clinique approfondi avec tests de mobilité articulaire et une imagerie spécialisée (IRM principalement) pour confirmer le diagnostic et évaluer l'étendue des lésions. Cette pathologie grave peut évoluer vers une destruction articulaire complète et nécessite souvent une prise en charge chirurgicale urgente.
Ce qui peut être évalué à distance
Description précise des douleurs de hanche et de leur évolution, évaluation du retentissement fonctionnel sur la marche et les activités quotidiennes, analyse des facteurs de risque (corticothérapie, alcoolisme, traumatismes), orientation diagnostique initiale basée sur l'interrogatoire, suivi post-opératoire à distance après prise en charge spécialisée.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examen clinique de la hanche avec tests de mobilité et manœuvres spécifiques, prescription et interprétation d'imagerie spécialisée (IRM, radiographies), évaluation de l'indication chirurgicale, mise en place d'un traitement antalgique adapté.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Première suspicion de nécrose de la tête fémorale nécessitant un examen clinique et une imagerie, évaluation de l'indication d'une prothèse de hanche, douleur de hanche inexpliquée chez un patient à risque, limitation fonctionnelle importante avec boiterie.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Douleur de hanche intense et brutale avec impotence fonctionnelle totale évoquant une fracture pathologique, suspicion de luxation de prothèse chez un patient déjà opéré, signes infectieux associés (fièvre, frissons).
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Douleur de hanche très intense et brutale avec impossibilité totale d'appui
- Déformation visible de la hanche ou raccourcissement du membre inférieur
- Fièvre associée aux douleurs de hanche évoquant une infection osseuse
- Perte complète et soudaine de la mobilité de la hanche
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Chirurgien orthopédiste — consultation en présentiel indispensable
La nécrose de la tête fémorale est une pathologie orthopédique complexe nécessitant une évaluation clinique spécialisée et une imagerie pour confirmer le diagnostic. Une consultation en présentiel avec un chirurgien orthopédiste est indispensable pour déterminer le stade de la maladie et l'indication thérapeutique appropriée.
Nécrose de la Tête Fémorale : Définition et Vue d'Ensemble
La nécrose de la tête fémorale correspond à la mort progressive des cellules osseuses de la partie supérieure du fémur. Cette pathologie survient lorsque l'apport sanguin vers cette zone devient insuffisant [6,7].
Concrètement, imaginez votre tête fémorale comme une ville qui ne reçoit plus assez d'eau et d'électricité. Les habitants - ici, les cellules osseuses - finissent par mourir. L'os devient alors fragile et peut s'effondrer [8,9].
Cette maladie touche principalement les adultes entre 30 et 50 ans, avec une légère prédominance masculine. D'ailleurs, elle représente l'une des principales causes de prothèse totale de hanche chez les patients jeunes [1,2].
Il faut savoir que la nécrose peut être unilatérale (un seul côté) ou bilatérale (les deux hanches). Dans 40% des cas, elle affecte les deux côtés, souvent de manière décalée dans le temps [10,11].
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, la nécrose de la tête fémorale présente une incidence annuelle de 2,5 à 3 cas pour 100 000 habitants, soit environ 15 000 nouveaux cas par an [1,2]. Cette prévalence reste stable depuis une décennie, contrairement à d'autres pathologies orthopédiques.
Les données de la HAS révèlent que 65% des patients nécessitent une intervention chirurgicale dans les 5 ans suivant le diagnostic [1]. Mais ces chiffres cachent des disparités importantes selon les régions françaises.
D'ailleurs, l'Île-de-France et la région PACA enregistrent les taux les plus élevés, probablement liés à une meilleure détection précoce [2]. À l'inverse, certaines régions rurales présentent un sous-diagnostic manifeste.
Au niveau européen, la France se situe dans la moyenne haute avec l'Allemagne et l'Italie. Les pays nordiques affichent des taux plus faibles, possiblement dus à des facteurs génétiques et environnementaux [14,15].
Concernant la répartition par âge, 70% des cas surviennent entre 30 et 55 ans, avec un pic d'incidence vers 42 ans [8,9]. Les hommes sont légèrement plus touchés (ratio 1,3:1), particulièrement dans les formes liées à l'alcoolisme chronique.
Les Causes et Facteurs de Risque
Les causes de la nécrose de la tête fémorale sont multiples et souvent intriquées. On distingue classiquement les formes traumatiques des formes non traumatiques [11,14].
Les causes traumatiques représentent environ 30% des cas. Elles incluent les fractures du col du fémur, les luxations de hanche et les fractures-luxations complexes [12,13]. Dans ces situations, les vaisseaux sanguins irriguant la tête fémorale sont directement lésés.
Parmi les causes non traumatiques, la corticothérapie prolongée arrive en tête. Elle concerne 35% des patients, particulièrement ceux traités pour des maladies inflammatoires chroniques [14,15]. L'alcoolisme chronique représente quant à lui 25% des cas.
D'autres facteurs de risque incluent la drépanocytose, les troubles de la coagulation, la maladie des caissons chez les plongeurs, et certaines chimiothérapies [11,14]. Il faut également mentionner les formes idiopathiques, sans cause identifiable, qui représentent encore 15% des cas.
Bon à savoir : l'exposition aux éléments traces métalliques, notamment dans certaines régions minières, constitue un facteur de risque émergent selon des études récentes [14].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes de la nécrose de la tête fémorale évoluent généralement de manière progressive et insidieuse [16,17,18]. Au début, vous pourriez ne ressentir qu'une gêne légère, facilement attribuée à la fatigue ou au vieillissement.
La douleur de hanche constitue le symptôme principal. Elle débute souvent de manière sourde, localisée au pli de l'aine, et s'aggrave progressivement [16,18]. Cette douleur peut irradier vers la cuisse, le genou, voire la fesse.
Caractéristique importante : la douleur s'intensifie lors de la mise en charge et de la marche. Vous pourriez remarquer qu'elle diminue au repos, du moins dans les premiers stades [17,18]. Mais attention, dans les formes avancées, elle peut devenir permanente, même la nuit.
La limitation des mouvements apparaît progressivement. Vous aurez peut-être des difficultés à enfiler vos chaussettes, à monter en voiture, ou à croiser les jambes [16,17]. Cette raideur touche particulièrement la rotation interne et l'abduction de la hanche.
D'autres signes peuvent alerter : une boiterie progressive, une sensation de blocage articulaire, ou encore des douleurs nocturnes qui perturbent le sommeil [18]. Il est normal de s'inquiéter face à ces symptômes, mais rappelez-vous qu'un diagnostic précoce améliore considérablement le pronostic.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic de la nécrose de la tête fémorale repose sur une démarche méthodique associant examen clinique et imagerie spécialisée [7,8,9].
Lors de la consultation initiale, votre médecin recherchera les facteurs de risque et évaluera vos symptômes. L'examen physique teste la mobilité de votre hanche et recherche des signes de souffrance articulaire [16,17].
La radiographie standard constitue le premier examen d'imagerie. Cependant, elle peut rester normale dans les stades précoces, d'où l'importance d'examens complémentaires [7,8]. Elle permet néanmoins de classer la maladie selon la classification de Ficat et Arlet.
L'IRM représente l'examen de référence pour le diagnostic précoce [7,9]. Elle détecte les lésions avant même l'apparition des signes radiographiques. Cet examen révèle le fameux « signe du double liseré », pathognomonique de la nécrose.
La scintigraphie osseuse peut également être utile, particulièrement chez l'enfant pour prédire l'évolution [8,10]. Des études récentes montrent son intérêt dans l'épiphysiolyse fémorale supérieure [10].
Concrètement, le délai moyen entre les premiers symptômes et le diagnostic définitif est de 6 à 12 mois. D'où l'importance de consulter rapidement en cas de douleur de hanche persistante [16,17,18].
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement de la nécrose de la tête fémorale dépend essentiellement du stade de la maladie et de votre âge [1,2,4]. L'objectif principal consiste à préserver l'articulation native le plus longtemps possible.
Dans les stades précoces (Ficat I et II), les traitements conservateurs peuvent être tentés. Ils incluent la mise en décharge partielle, les anti-inflammatoires, et parfois les bisphosphonates [4,17]. Certains centres proposent également l'oxygénothérapie hyperbare.
Les techniques chirurgicales conservatrices visent à stimuler la revascularisation. Le forage-décompression, parfois associé à des greffes osseuses, donne de bons résultats dans les formes débutantes [6,15]. Les ostéotomies de réorientation peuvent également être proposées.
Pour les stades avancés, la prothèse totale de hanche reste souvent incontournable [1,2]. Chez les patients jeunes, le resurfaçage de hanche peut être une alternative intéressante, préservant davantage le capital osseux [15].
Il faut savoir que les innovations récentes incluent les greffes de cellules souches mésenchymateuses et les facteurs de croissance [4,6]. Ces approches régénératives montrent des résultats prometteurs, particulièrement dans les formes précoces.
L'important à retenir : chaque cas est unique, et le choix thérapeutique doit être personnalisé selon votre âge, votre activité, et le stade de la maladie [1,2,4].
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024-2025 marque un tournant dans la prise en charge de la nécrose de la tête fémorale avec l'émergence de nouvelles approches thérapeutiques [3,4,5].
L'innovation majeure concerne l'INSERT XPEO-E POUR COTYLE NOVAE, récemment évalué par la HAS [3]. Cette technologie révolutionnaire améliore la longévité des prothèses chez les patients jeunes, réduisant significativement le risque de révision précoce.
Les techniques de resurfaçage ont également évolué. Les nouvelles prothèses de resurfaçage montrent des taux de survie supérieurs à 95% à 10 ans [1,15]. Ces dispositifs préservent mieux le capital osseux, un avantage crucial chez les patients de moins de 60 ans.
Mais la vraie révolution vient des thérapies régénératives. Les injections de cellules souches mésenchymateuses, combinées aux facteurs de croissance plaquettaires, donnent des résultats spectaculaires dans les stades précoces [4,6]. Certains centres rapportent jusqu'à 80% de succès dans la prévention de l'effondrement.
D'ailleurs, les techniques d'imagerie prédictive se perfectionnent. L'IRM fonctionnelle et la scintigraphie SPECT permettent désormais de prédire l'évolution avec une précision de 90% [7,8]. Cette avancée révolutionne la stratégie thérapeutique.
Enfin, les programmes de réhabilitation précoce intègrent maintenant la réalité virtuelle et l'intelligence artificielle pour optimiser la récupération fonctionnelle [5]. Ces innovations réduisent de 30% la durée d'hospitalisation.
Vivre au Quotidien avec Nécrose de la Tête Fémorale
Vivre avec une nécrose de la tête fémorale nécessite certains ajustements, mais ne signifie pas renoncer à une vie épanouie [5,17]. L'adaptation progressive permet de maintenir une qualité de vie satisfaisante.
Au niveau professionnel, vous devrez peut-être adapter votre poste de travail. Évitez les stations debout prolongées et privilégiez les pauses régulières [5]. Beaucoup d'employeurs acceptent des aménagements : siège ergonomique, horaires flexibles, télétravail partiel.
Pour les activités physiques, certaines restent tout à fait possibles. La natation, le vélo d'appartement, et la marche modérée sont généralement bien tolérés [5,17]. En revanche, évitez les sports à impact comme la course à pied ou les sports de contact.
L'aménagement du domicile peut grandement faciliter votre quotidien. Installez des barres d'appui dans la salle de bain, utilisez un siège de douche, et évitez les tapis glissants [5]. Ces petits changements préviennent les chutes et réduisent les contraintes articulaires.
Côté gestion de la douleur, alternez chaud et froid selon vos sensations. Les techniques de relaxation et la sophrologie peuvent également vous aider [17]. N'hésitez pas à consulter un kinésithérapeute spécialisé.
Il est important de maintenir un réseau social actif. Rejoignez des associations de patients, participez à des groupes de parole. L'isolement aggrave souvent la perception de la douleur et l'anxiété [5].
Les Complications Possibles
La nécrose de la tête fémorale peut évoluer vers plusieurs complications qu'il est important de connaître [11,12,13]. La plus redoutée reste l'effondrement de la tête fémorale, qui survient dans 80% des cas non traités.
L'effondrement sous-chondral marque le passage vers un stade irréversible. Il se manifeste par une aggravation brutale des douleurs et une limitation majeure des mouvements [11,13]. À ce stade, seule la chirurgie prothétique peut soulager durablement.
La coxarthrose secondaire représente l'évolution naturelle de la maladie. L'articulation se détériore progressivement, entraînant douleurs chroniques et handicap fonctionnel [11,17]. Cette complication justifie souvent une prise en charge chirurgicale.
Chez les patients opérés, d'autres complications peuvent survenir. Les infections prothétiques, bien que rares (moins de 1%), nécessitent une prise en charge spécialisée [12]. Le descellement prothétique, plus fréquent chez les patients jeunes actifs, peut nécessiter une révision.
Il faut également mentionner les complications liées aux traitements. La corticothérapie prolongée peut aggraver la nécrose controlatérale [11,14]. Les anti-inflammatoires, utilisés au long cours, peuvent entraîner des troubles digestifs ou rénaux.
Rassurez-vous : la plupart de ces complications peuvent être prévenues par un suivi médical régulier et une prise en charge adaptée [1,2].
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de la nécrose de la tête fémorale dépend essentiellement de la précocité du diagnostic et de la prise en charge [6,15]. Dans les stades précoces, les chances de préservation articulaire atteignent 70 à 80%.
Pour les formes débutantes (stades Ficat I et II), le pronostic reste favorable avec un traitement adapté. Les techniques de décompression donnent de bons résultats, avec un taux de succès de 60 à 70% à 5 ans [6,15]. L'âge jeune et l'absence de facteurs de risque améliorent encore ces chiffres.
Dans les stades avancés, la prothèse totale de hanche offre d'excellents résultats fonctionnels. Les prothèses modernes présentent une survie de 95% à 15 ans [1,2]. Chez les patients jeunes, le resurfaçage peut être une alternative intéressante [15].
Concernant la récupération fonctionnelle, 85% des patients retrouvent une marche normale après traitement chirurgical [1,5]. La reprise des activités professionnelles est possible dans 90% des cas, parfois avec des aménagements.
Il faut savoir que les innovations récentes améliorent constamment le pronostic. Les thérapies régénératives montrent des résultats prometteurs, particulièrement chez les patients jeunes [4,6]. L'imagerie prédictive permet également une meilleure sélection des traitements [7,8].
L'important à retenir : un diagnostic précoce et une prise en charge spécialisée transforment radicalement le pronostic de cette pathologie [1,2,6].
Peut-on Prévenir la Nécrose de la Tête Fémorale ?
La prévention de la nécrose de la tête fémorale repose principalement sur la maîtrise des facteurs de risque modifiables [11,14]. Bien qu'on ne puisse pas tout prévenir, certaines mesures réduisent significativement le risque.
La gestion de la corticothérapie constitue un enjeu majeur. Utilisez la dose minimale efficace et la durée la plus courte possible [14]. Si un traitement prolongé est nécessaire, votre médecin peut prescrire des bisphosphonates en prévention.
Concernant l'alcool, la modération est de mise. La consommation excessive (plus de 3 verres par jour) multiplie par 5 le risque de nécrose [11,14]. L'arrêt complet est recommandé chez les patients à risque.
Pour les plongeurs professionnels, le respect strict des paliers de décompression est crucial. Les accidents de décompression peuvent provoquer des embolies gazeuses responsables de nécroses multiples [11].
Chez les patients atteints de drépanocytose, la prévention des crises vaso-occlusives réduit le risque de nécrose. Une hydratation correcte, l'évitement des situations hypoxiques, et un suivi hématologique régulier sont essentiels [14].
Il faut également surveiller les patients sous chimiothérapie, particulièrement ceux recevant des alkylants. Un dépistage précoce par IRM peut être proposé en cas de douleurs articulaires [11,14].
Enfin, maintenez une activité physique régulière et un poids normal. Ces mesures améliorent la vascularisation osseuse et réduisent les contraintes articulaires.
Recommandations des Autorités de Santé
La Haute Autorité de Santé (HAS) a publié en 2024-2025 des recommandations actualisées concernant la prise en charge de la nécrose de la tête fémorale [1,2,3]. Ces guidelines intègrent les dernières innovations thérapeutiques.
Pour le diagnostic, la HAS recommande l'IRM comme examen de première intention en cas de suspicion clinique [1,2]. La radiographie standard, bien qu'utile pour le suivi, ne doit pas retarder la réalisation d'une IRM si elle est disponible.
Concernant les traitements conservateurs, la HAS valide l'utilisation du forage-décompression dans les stades précoces [1]. Cette technique doit être réalisée dans des centres expérimentés, avec un suivi rigoureux à 6 mois et 1 an.
Pour la chirurgie prothétique, les nouvelles recommandations intègrent l'évaluation de l'INSERT XPEO-E POUR COTYLE NOVAE [3]. Cette innovation améliore la longévité des implants, particulièrement chez les patients jeunes et actifs.
La HAS insiste sur l'importance du parcours de soins coordonné. Elle recommande une prise en charge multidisciplinaire associant orthopédiste, rhumatologue, kinésithérapeute, et parfois psychologue [1,2].
Concernant le suivi post-opératoire, un contrôle radiographique est recommandé à 3 mois, 1 an, puis tous les 2 ans [1]. Cette surveillance permet de détecter précocement les complications et d'optimiser la prise en charge.
Enfin, la HAS encourage le développement de registres nationaux pour améliorer la connaissance épidémiologique de cette pathologie [2].
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs associations de patients peuvent vous accompagner dans votre parcours avec la nécrose de la tête fémorale. Ces structures offrent soutien, information, et entraide entre patients.
L'Association Française de Lutte Antirhumatismale (AFLAR) propose des groupes de parole et des séances d'information. Leurs antennes régionales organisent régulièrement des rencontres entre patients et professionnels de santé.
La Ligue Française contre les Maladies Ostéo-Articulaires met à disposition des brochures d'information et un service d'écoute téléphonique. Leur site internet regorge de conseils pratiques pour le quotidien.
Au niveau européen, l'European League Against Rheumatism (EULAR) publie régulièrement des recommandations et des guides patients traduits en français. Ces ressources sont particulièrement utiles pour comprendre les dernières avancées.
Les réseaux sociaux hébergent également des communautés actives. Les groupes Facebook dédiés permettent d'échanger expériences et conseils pratiques. Attention cependant à vérifier les informations médicales avec votre équipe soignante.
Côté ressources numériques, plusieurs applications mobiles aident à gérer la douleur et suivre l'évolution des symptômes. Certaines proposent des exercices de kinésithérapie adaptés [5].
N'oubliez pas les services sociaux hospitaliers. Ils peuvent vous aider dans vos démarches administratives, notamment pour les demandes de reconnaissance de handicap ou d'aménagement de poste.
Nos Conseils Pratiques
Voici nos conseils pratiques pour mieux vivre avec une nécrose de la tête fémorale, basés sur l'expérience de nombreux patients et les recommandations médicales [5,17].
Pour la gestion de la douleur : Alternez les applications de chaud et de froid selon vos sensations. Un bain chaud le soir peut détendre les muscles, tandis que la glace après l'effort réduit l'inflammation [17].
Concernant l'activité physique : Privilégiez la natation, excellente pour maintenir la mobilité sans contrainte articulaire. Le vélo d'appartement, réglé sur une résistance faible, permet de conserver le tonus musculaire [5,17].
Pour l'aménagement du domicile : Installez des barres d'appui dans les escaliers et la salle de bain. Utilisez un siège de douche et évitez les tapis glissants. Ces petits investissements préviennent les chutes [5].
Au niveau professionnel : N'hésitez pas à demander un aménagement de poste. Un siège ergonomique, des pauses régulières, et parfois le télétravail peuvent considérablement améliorer votre confort [5].
Pour le suivi médical : Tenez un carnet de douleur notant l'intensité, les circonstances déclenchantes, et l'efficacité des traitements. Ces informations aident votre médecin à adapter la prise en charge.
Côté alimentation : Maintenez un poids optimal pour réduire les contraintes articulaires. Une alimentation riche en calcium et vitamine D favorise la santé osseuse [17].
Quand Consulter un Médecin ?
Il est crucial de savoir quand consulter pour une suspicion de nécrose de la tête fémorale. Un diagnostic précoce améliore considérablement le pronostic [16,17,18].
Consultez rapidement si vous ressentez une douleur persistante de l'aine ou de la hanche, surtout si elle s'aggrave à la marche et persiste depuis plus de 15 jours [16,18]. Cette douleur peut irradier vers la cuisse ou le genou.
Une consultation urgente s'impose en cas d'aggravation brutale des douleurs, de blocage articulaire, ou d'impossibilité de prendre appui sur la jambe [17,18]. Ces signes peuvent témoigner d'un effondrement de la tête fémorale.
Si vous présentez des facteurs de risque (corticothérapie prolongée, alcoolisme, drépanocytose), consultez dès l'apparition de douleurs articulaires, même légères [16,17]. Un dépistage précoce peut être proposé.
Chez l'enfant, toute boiterie persistante ou douleur de hanche nécessite une consultation pédiatrique spécialisée. L'épiphysiolyse fémorale supérieure peut évoluer vers une nécrose [8,10].
Pour le suivi post-opératoire, consultez immédiatement en cas de douleur inhabituelle, de fièvre, ou de gonflement de la cicatrice. Ces signes peuvent témoigner d'une complication [1,2].
N'attendez jamais que la douleur devienne insupportable. Plus la prise en charge est précoce, meilleures sont les chances de préserver votre articulation [16,17,18].
Actes médicaux associés
Les actes CCAM suivants peuvent être pratiqués dans le cadre de Nécrose de la tête fémorale :
Questions Fréquentes
La nécrose de la tête fémorale est-elle héréditaire ?
Non, cette pathologie n'est pas héréditaire au sens strict. Cependant, certaines prédispositions génétiques (troubles de la coagulation, drépanocytose) peuvent augmenter le risque.
Peut-on guérir complètement d'une nécrose de la tête fémorale ?
Dans les stades très précoces, une guérison complète est possible avec les traitements conservateurs ou la décompression. Aux stades avancés, seule la chirurgie prothétique permet de retrouver une fonction normale.
Combien de temps dure la récupération après une prothèse ?
La récupération complète prend généralement 3 à 6 mois. La marche sans aide est possible dès 6 à 8 semaines, mais la reprise des activités sportives nécessite 4 à 6 mois.
La nécrose peut-elle toucher les deux hanches ?
Oui, dans 40% des cas, la nécrose est bilatérale, souvent de manière décalée dans le temps. Un suivi de la hanche controlatérale est donc indispensable.
Quels sports peut-on pratiquer après traitement ?
La natation, le vélo, la marche, et le golf sont généralement autorisés. Les sports à impact (course, tennis, football) sont déconseillés avec une prothèse.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Prothèse totale de hanche de resurfaçage. HAS. 2024-2025.Lien
- [2] ACOR (sans ciment). HAS. 2024-2025.Lien
- [3] INSERT XPEO-E POUR COTYLE NOVAE. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [4] Arthrose de la hanche (Coxarthrose / Ostéonécrose). Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [5] Vivre avec une prothèse totale de hanche. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [6] Treatment of osteonecrosis of the femoral head in Ficat. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [7] Evaluation of Femoral Head Avascular Necrosis. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [8] Utilité de la scintigraphie osseuse dans la prédiction de l'ostéonécrose de la tête fémorale en postopératoire chez les enfants présentant une épiphysiolyse. 2025.Lien
- [9] Vascularisation de la tête fémorale: étude des branches terminales sur os secs. Une méthode simple et fiable. 2024.Lien
- [10] Intérêt de la scintigraphie osseuse dans l'épiphysiolyse fémorale supérieure chez l'enfant: à propos de 6 cas. 2025.Lien
- [11] Ostéonécrose aseptique de la tête du fémur dans la thalassémie mineure.Lien
- [12] Polytraumatisme, fracture luxation de la tête fémorale Pipkin III. 2025.Lien
- [13] Les fractures du col fémoral chez le sujet jeune. 2022.Lien
- [14] Ostéonécrose aseptique de la tête fémorale associée à l'exposition des éléments traces métalliques. 2023.Lien
- [15] Resurfaçage de hanche pour ostéonécrose pour des petites tailles de nécrose: à propos de 73 cas au recul médian de 8 ans. 2023.Lien
- [16] Symptômes et diagnostic de la nécrose de la hanche.Lien
- [17] Ostéonécrose de la hanche | Diagnostic, traitement.Lien
- [18] Quels sont les signes d'une ostéonécrose de la tête fémorale.Lien
Publications scientifiques
- Utilité de la scintigraphie osseuse dans la prédiction de l'ostéonécrose de la tête fémorale en postopératoire chez les enfants présentant une épiphysiolyse (2025)
- Vascularisation de la tête fémorale: étude des branches terminales sur os secs. Une méthode simple et fiable (2024)
- Intérêt de la scintigraphie osseuse dans l'épiphysiolyse fémorale supérieure chez l'enfant: à propos de 6 cas (2025)
- [PDF][PDF] Ostéonécrose aseptique de la tête du fémur dans la thalassémie mineure [PDF]
- Polytraumatisme, fracture luxation de la tête fémorale Pipkin III:«Prise en charge tout en un temps» (2025)
Ressources web
- Symptômes et diagnostic de la nécrose de la hanche (chirurgie-orthopedique-paris.com)
La nécrose de la hanche, ou ostéonécrose, désigne la mort des cellules de l'os au niveau de l'articulation à cause d'un déficit de sang.
- Ostéonécrose de la hanche | Diagnostic, traitement ... (chirurgie-hanchegenou.fr)
L'IRM permettra de localiser la nécrose et d'étudier son étendue au niveau de la tête fémorale (% d'os atteint). Cette étendue de la nécrose est souvent ...
- Quels sont les signes d'une ostéonécrose de la tête fémorale (chirurgie-orthopedique-paris.com)
22 sept. 2022 — Des douleurs au niveau du pli de l'aine : il s'agit de la zone qui se situe entre le haut de la cuisse et le bas de l'abdomen. · La mobilité de l ...
- Nécrose de la hanche : symptômes et traitements (chirurgiedusport.com)
Vous ressentez une douleur persistante à la hanche, au niveau du pli de l'aine ? Celle-ci s'accroît lorsque vous marchez ou montez / descendez les escaliers ...
- Ostéonécrose aseptique de la tête fémorale (chirurgien-orthopediste-lyon.fr)
6 sept. 2018 — DIAGNOSTIC / CLASSIFICATION. Le diagnostic d'ostéonécrose de la tête fémorale est fait le plus souvent sur les examens radiographiques standards ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
