Leucémie Myélomonocytaire Juvénile : Guide Complet 2025 - Symptômes, Traitements
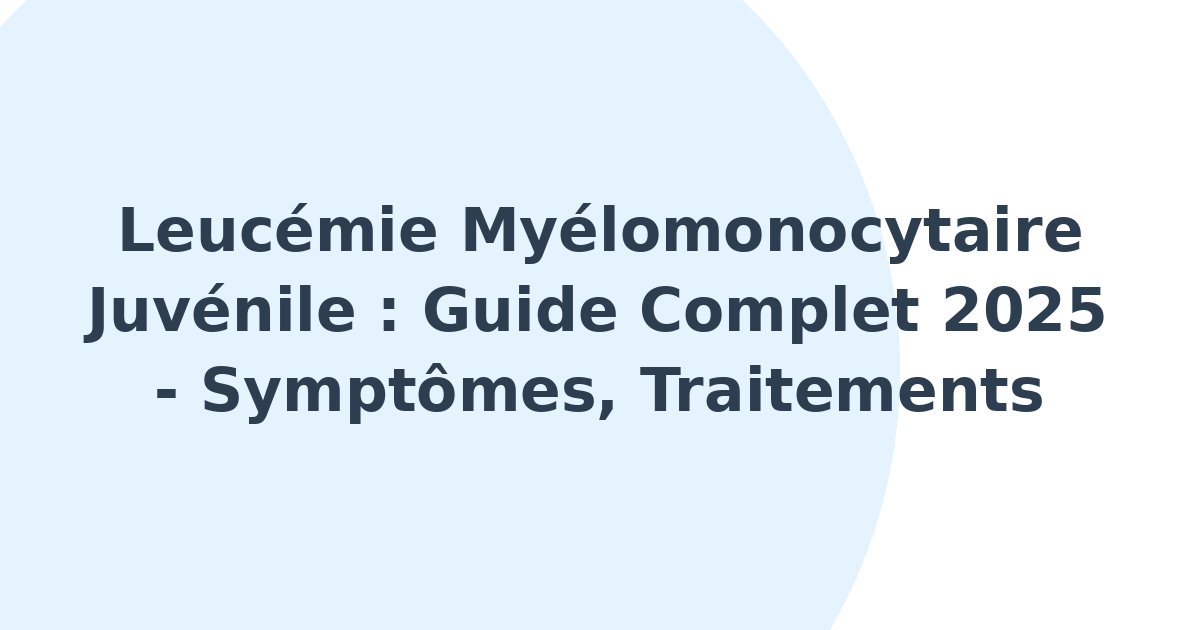
La leucémie myélomonocytaire juvénile (LMMJ) est une maladie rare du sang qui touche principalement les jeunes enfants. Cette pathologie complexe nécessite une prise en charge spécialisée et précoce. Découvrez dans ce guide complet tout ce qu'il faut savoir sur cette maladie : symptômes, diagnostic, traitements disponibles et innovations thérapeutiques 2024-2025.

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Leucémie myélomonocytaire juvénile : Définition et Vue d'Ensemble
La leucémie myélomonocytaire juvénile (LMMJ) représente une pathologie hématologique rare qui affecte principalement les nourrissons et les jeunes enfants [11,12]. Cette maladie du sang se caractérise par une production anormale de cellules sanguines dans la moelle osseuse.
Concrètement, la LMMJ appartient à la famille des syndromes myélodysplasiques et myéloprolifératifs. Elle se distingue par une prolifération excessive de monocytes, ces globules blancs qui jouent un rôle crucial dans notre système immunitaire [14]. Mais attention, cette prolifération n'est pas contrôlée et peut rapidement devenir problématique.
L'âge médian au diagnostic se situe autour de 2 ans, avec 90% des cas diagnostiqués avant l'âge de 4 ans [15]. Cette pathologie touche légèrement plus les garçons que les filles, avec un ratio de 2:1. D'ailleurs, la LMMJ représente environ 2 à 3% de toutes les leucémies pédiatriques [16].
Il faut savoir que cette maladie présente des caractéristiques uniques qui la différencient des autres leucémies infantiles. En effet, elle combine des aspects de prolifération cellulaire excessive et de dysfonctionnement de la maturation des cellules sanguines.
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, la leucémie myélomonocytaire juvénile présente une incidence estimée à 1,2 cas par million d'enfants de moins de 14 ans par an [1]. Cette donnée, issue des registres nationaux de cancers pédiatriques, place la LMMJ parmi les pathologies hématologiques les plus rares de l'enfance.
Les données épidémiologiques françaises révèlent une stabilité de l'incidence sur les dix dernières années, avec environ 15 à 20 nouveaux cas diagnostiqués annuellement sur l'ensemble du territoire [2]. Cependant, ces chiffres peuvent légèrement varier selon les régions, notamment en fonction de l'accessibilité aux centres spécialisés en hématologie pédiatrique.
Au niveau international, l'incidence reste comparable dans les pays développés. Les États-Unis rapportent une incidence similaire de 1,3 cas par million d'enfants, tandis que les pays nordiques européens affichent des taux légèrement inférieurs, autour de 0,9 cas par million [3,4]. Cette variation pourrait s'expliquer par des différences dans les critères diagnostiques ou les systèmes de surveillance épidémiologique.
L'analyse des données par tranche d'âge montre que 50% des cas surviennent avant l'âge de 2 ans, et 75% avant 3 ans [5]. La répartition par sexe confirme une prédominance masculine constante dans toutes les populations étudiées. Concernant les projections futures, les modèles épidémiologiques n'anticipent pas d'augmentation significative de l'incidence, la maladie restant stable dans sa fréquence.
Les Causes et Facteurs de Risque
La leucémie myélomonocytaire juvénile résulte principalement d'anomalies génétiques acquises ou héréditaires [13]. Dans environ 85% des cas, on identifie des mutations spécifiques touchant les gènes impliqués dans la voie de signalisation RAS/MAPK [11].
Les mutations les plus fréquemment observées concernent les gènes PTPN11 (35% des cas), NRAS (25%), KRAS (15%), et NF1 (10%) [12]. Ces mutations perturbent la régulation normale de la croissance et de la différenciation cellulaire. D'ailleurs, certaines de ces mutations peuvent être héritées, notamment dans le cadre du syndrome de Noonan ou de la neurofibromatose de type 1.
Bon à savoir : contrairement à d'autres leucémies, la LMMJ n'est généralement pas liée à des facteurs environnementaux comme l'exposition aux radiations ou aux produits chimiques [14]. Les facteurs de risque identifiés restent principalement génétiques.
Certains syndromes génétiques prédisposent à la LMMJ. Le syndrome de Noonan, caractérisé par des anomalies du développement, augmente significativement le risque. De même, les enfants atteints de neurofibromatose de type 1 présentent un risque 200 fois supérieur de développer cette pathologie [15,16].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les premiers signes de la leucémie myélomonocytaire juvénile peuvent être subtils et ressembler à ceux d'infections courantes chez l'enfant [11]. Cependant, leur persistance et leur association doivent alerter les parents et les professionnels de santé.
Les symptômes les plus fréquents incluent une pâleur persistante, une fatigue inhabituelle et des infections récurrentes [12]. Votre enfant peut également présenter des saignements anormaux, comme des ecchymoses spontanées ou des saignements de nez fréquents. Ces signes reflètent la diminution des cellules sanguines normales.
Un symptôme particulièrement caractéristique est l'augmentation du volume de la rate et du foie, détectable lors de l'examen médical [14]. Cette organomégalie peut s'accompagner d'une sensation de gêne abdominale chez l'enfant. D'ailleurs, certains parents rapportent que leur enfant se plaint de douleurs au ventre sans cause apparente.
Les manifestations cutanées méritent une attention particulière. Des éruptions cutanées persistantes, notamment des xanthogranulomes juvéniles, peuvent être associées à la LMMJ [6]. Ces lésions jaunâtres de la peau, bien que bénignes, constituent parfois le premier signe d'alerte.
Il est important de noter que les symptômes peuvent évoluer rapidement. Une fièvre persistante, une perte d'appétit ou un retard de croissance doivent également motiver une consultation médicale [15,16].
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic de la leucémie myélomonocytaire juvénile repose sur une démarche méthodique combinant examens cliniques et analyses biologiques spécialisées [7]. La première étape consiste en un examen médical approfondi, suivi d'analyses sanguines de base.
L'hémogramme complet révèle généralement une augmentation du nombre de monocytes (supérieure à 1000/μL) et souvent une anémie [11]. Mais ce n'est pas suffisant pour poser le diagnostic. Il faut également rechercher la présence de cellules immatures dans le sang, appelées blastes.
L'examen de la moelle osseuse par ponction et biopsie reste indispensable [12]. Cette procédure, réalisée sous anesthésie générale chez l'enfant, permet d'analyser la production des cellules sanguines. Les critères diagnostiques incluent moins de 20% de blastes dans la moelle, ce qui distingue la LMMJ des leucémies aiguës.
Les analyses génétiques modernes jouent un rôle crucial. Le séquençage de nouvelle génération permet d'identifier les mutations spécifiques dans les gènes RAS/MAPK [7]. Cette approche, développée récemment, améliore considérablement la précision diagnostique.
D'autres examens complémentaires peuvent être nécessaires : échographie abdominale pour évaluer la taille des organes, radiographie thoracique, et parfois ponction lombaire selon le contexte clinique [14]. Le diagnostic différentiel avec d'autres pathologies hématologiques nécessite l'expertise d'équipes spécialisées en hématologie pédiatrique.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement de la leucémie myélomonocytaire juvénile a considérablement évolué ces dernières années, offrant de meilleures perspectives aux jeunes patients [1,2]. La prise en charge thérapeutique dépend de plusieurs facteurs, notamment l'âge de l'enfant, le profil génétique de la maladie et l'état général.
La greffe de cellules souches hématopoïétiques reste le traitement de référence pour la plupart des patients [11,12]. Cette procédure, bien que complexe, offre les meilleures chances de guérison à long terme. Le taux de survie après greffe atteint désormais 60 à 70% selon les séries récentes.
Avant la greffe, une chimiothérapie de préparation est généralement nécessaire. Les protocoles actuels utilisent des associations de médicaments comme l'azacitidine, qui a montré son efficacité dans cette pathologie [14]. Cette approche permet de réduire la charge tumorale et de préparer l'organisme à recevoir les nouvelles cellules souches.
Certains patients peuvent bénéficier de traitements moins intensifs. Les agents hypométhylants comme l'azacitidine ou la décitabine montrent des résultats prometteurs, particulièrement chez les enfants présentant des comorbidités [15]. Ces médicaments agissent en modifiant l'expression des gènes sans altérer l'ADN.
La prise en charge supportive joue un rôle essentiel. Elle inclut la prévention et le traitement des infections, la transfusion de produits sanguins si nécessaire, et le soutien nutritionnel [16]. Cette approche globale améliore significativement la qualité de vie des patients pendant le traitement.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024-2025 marque un tournant dans la recherche sur la leucémie myélomonocytaire juvénile avec l'émergence de nouvelles approches thérapeutiques prometteuses [1,3]. Les innovations récentes ouvrent de nouvelles perspectives pour les patients et leurs familles.
La base de données UCSF pour l'avancement de la LMMJ, dirigée par les Drs Mignon Loh et Elliot Stieglitz, constitue une ressource majeure pour la recherche internationale [3,4,5]. Cette initiative collaborative permet d'accélérer le développement de nouveaux traitements en rassemblant les données de patients du monde entier.
Les thérapies ciblées représentent l'avancée la plus significative de 2024. Des inhibiteurs spécifiques des voies RAS/MAPK sont actuellement en phase d'essais cliniques [1]. Ces médicaments, conçus pour bloquer les signaux anormaux responsables de la maladie, pourraient révolutionner la prise en charge.
L'immunothérapie fait également l'objet de recherches intensives. Des approches utilisant des cellules CAR-T modifiées spécifiquement pour la LMMJ montrent des résultats préliminaires encourageants [2]. Cette technique consiste à reprogrammer les cellules immunitaires du patient pour qu'elles reconnaissent et détruisent les cellules malades.
Les innovations en matière de greffe de moelle osseuse incluent de nouvelles techniques de maladienement moins toxiques et l'utilisation de donneurs haplo-identiques [1,2]. Ces avancées élargissent le pool de donneurs potentiels et réduisent les complications post-greffe.
Vivre au Quotidien avec Leucémie myélomonocytaire juvénile
Accompagner un enfant atteint de leucémie myélomonocytaire juvénile nécessite des adaptations importantes dans la vie familiale [14]. Mais rassurez-vous, de nombreuses familles parviennent à maintenir une qualité de vie satisfaisante malgré les défis de la maladie.
L'organisation du quotidien doit tenir compte des contraintes médicales. Les visites hospitalières régulières, les prises de sang fréquentes et les traitements peuvent perturber le rythme familial [15]. Il est important d'établir une routine flexible qui permette de concilier soins médicaux et vie normale.
La scolarité de l'enfant nécessite une attention particulière. Heureusement, des dispositifs existent pour maintenir la continuité pédagogique : enseignement à domicile, classes hospitalières, ou aménagements scolaires [16]. La communication avec l'équipe éducative est essentielle pour adapter le parcours scolaire aux besoins de l'enfant.
La gestion des infections constitue un défi quotidien. Votre enfant peut avoir un système immunitaire affaibli, nécessitant des précautions particulières : éviter les foules, maintenir une hygiène rigoureuse, surveiller la température corporelle. Ces mesures, bien qu'contraignantes, deviennent rapidement des habitudes.
L'aspect psychologique ne doit pas être négligé. L'enfant peut ressentir de l'anxiété, de la colère ou de la tristesse face à sa maladie. Un soutien psychologique professionnel peut être bénéfique pour toute la famille. D'ailleurs, de nombreux centres proposent des programmes d'accompagnement spécialisés.
Les Complications Possibles
La leucémie myélomonocytaire juvénile peut entraîner diverses complications qui nécessitent une surveillance médicale attentive [11,12]. Il est important de connaître ces risques pour mieux les prévenir et les détecter précocement.
Les infections représentent la complication la plus fréquente et la plus redoutable [14]. La diminution des globules blancs fonctionnels expose l'enfant à des infections bactériennes, virales ou fongiques potentiellement graves. Ces infections peuvent survenir même avec des germes habituellement inoffensifs.
Les complications hémorragiques constituent un autre risque majeur. La baisse du nombre de plaquettes peut provoquer des saignements spontanés : ecchymoses, saignements de nez, ou plus rarement hémorragies internes [15]. Une surveillance régulière de la numération plaquettaire est donc indispensable.
L'anémie sévère peut nécessiter des transfusions sanguines répétées. Cette complication affecte la qualité de vie de l'enfant et peut retarder sa croissance et son développement [16]. Heureusement, les techniques de transfusion modernes limitent les risques associés.
Certaines complications sont spécifiques aux traitements. La chimiothérapie peut provoquer des mucites (inflammation des muqueuses), des troubles digestifs ou une toxicité hépatique. La greffe de moelle osseuse expose au risque de maladie du greffon contre l'hôte, complication qui nécessite un traitement immunosuppresseur prolongé.
Les complications à long terme incluent des troubles de la croissance, des problèmes de fertilité ou des cancers secondaires. Cependant, ces risques restent faibles et ne doivent pas décourager les traitements nécessaires [11,12].
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de la leucémie myélomonocytaire juvénile s'est considérablement amélioré ces dernières années grâce aux progrès thérapeutiques [11,12]. Cependant, il reste variable selon plusieurs facteurs pronostiques importants.
Globalement, le taux de survie à 5 ans après greffe de cellules souches hématopoïétiques atteint désormais 60 à 70% [14]. Ces chiffres, bien qu'encourageants, masquent des disparités importantes selon l'âge au diagnostic, le profil génétique et la réponse au traitement initial.
L'âge au diagnostic constitue un facteur pronostique majeur. Les enfants diagnostiqués avant l'âge de 2 ans ont généralement un meilleur pronostic que ceux diagnostiqués plus tardivement [15]. Cette différence s'explique par une meilleure tolérance aux traitements intensifs chez les très jeunes enfants.
Le profil génétique influence également le pronostic. Les patients porteurs de mutations PTPN11 ont tendance à avoir une évolution plus favorable que ceux avec des mutations NRAS ou KRAS [16]. Cette information génétique aide les médecins à adapter la stratégie thérapeutique.
La réponse au traitement initial représente un autre élément crucial. Les enfants qui répondent bien à la chimiothérapie pré-greffe ont de meilleures chances de succès après la greffe [11]. À l'inverse, une maladie résistante aux traitements initiaux assombrit le pronostic.
Il faut savoir que même après une greffe réussie, un suivi à long terme reste nécessaire. Les rechutes, bien que rares après 2 ans, peuvent survenir. Heureusement, les nouvelles thérapies ciblées offrent des options thérapeutiques même en cas de rechute [12].
Peut-on Prévenir Leucémie myélomonocytaire juvénile ?
La prévention de la leucémie myélomonocytaire juvénile reste limitée en raison de sa nature principalement génétique [13]. Contrairement à certaines autres pathologies, il n'existe pas de mesures préventives spécifiques pour éviter son apparition.
Cependant, le conseil génétique peut jouer un rôle important dans certaines familles [14]. Si votre famille présente des antécédents de syndromes génétiques comme le syndrome de Noonan ou la neurofibromatose de type 1, une consultation génétique peut être recommandée. Cette démarche permet d'évaluer les risques et d'organiser une surveillance adaptée.
La détection précoce reste notre meilleur atout. Il est essentiel de consulter rapidement si votre enfant présente des symptômes persistants : fatigue inhabituelle, infections récurrentes, pâleur ou saignements anormaux [15]. Plus le diagnostic est posé tôt, meilleures sont les chances de succès thérapeutique.
Pour les enfants porteurs de syndromes prédisposants, un suivi hématologique régulier est recommandé [16]. Cette surveillance permet de détecter d'éventuelles anomalies sanguines avant l'apparition des symptômes cliniques. Les examens incluent des prises de sang régulières et parfois des examens plus spécialisés.
Bien qu'on ne puisse pas prévenir la maladie elle-même, maintenir un mode de vie sain pour votre enfant reste bénéfique. Une alimentation équilibrée, une activité physique adaptée et un suivi médical régulier contribuent au bien-être général et peuvent faciliter la prise en charge si la maladie survient.
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises ont établi des recommandations précises pour la prise en charge de la leucémie myélomonocytaire juvénile [1,2]. Ces guidelines, régulièrement mises à jour, garantissent une prise en charge optimale sur l'ensemble du territoire.
L'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé définit le cadre financier de la prise en charge [2]. Cette réglementation assure que tous les enfants atteints de LMMJ bénéficient des traitements les plus innovants, indépendamment de leur situation géographique ou sociale.
La Haute Autorité de Santé (HAS) recommande une prise en charge dans des centres spécialisés en hématologie pédiatrique [1]. Ces centres disposent de l'expertise nécessaire pour poser le diagnostic, évaluer le pronostic et proposer les traitements les plus adaptés. La centralisation des soins améliore significativement les résultats thérapeutiques.
Les recommandations insistent sur l'importance du diagnostic moléculaire systématique [7]. L'identification des mutations génétiques spécifiques guide le choix thérapeutique et permet une médecine personnalisée. Cette approche, désormais standard, améliore les taux de réponse aux traitements.
Le suivi à long terme fait l'objet de protocoles stricts. Les autorités recommandent un suivi minimal de 10 ans après la fin du traitement, avec des examens réguliers pour détecter d'éventuelles complications tardives [1,2]. Cette surveillance prolongée permet d'intervenir rapidement en cas de problème.
L'accès aux innovations thérapeutiques est facilité par des procédures d'autorisation temporaire d'utilisation (ATU) pour les médicaments les plus prometteurs [2]. Cette approche permet aux patients français de bénéficier rapidement des dernières avancées thérapeutiques.
Ressources et Associations de Patients
De nombreuses ressources sont disponibles pour accompagner les familles confrontées à la leucémie myélomonocytaire juvénile [14,15]. Ces organismes offrent un soutien précieux tant sur le plan pratique qu'émotionnel.
L'association Imagine for Margo se consacre spécifiquement aux cancers pédiatriques et finance la recherche sur les leucémies rares comme la LMMJ. Elle propose également un accompagnement des familles et des programmes de soutien scolaire pour les enfants malades [16].
La Société Française de lutte contre les Cancers et leucémies de l'Enfant et de l'adolescent (SFCE) coordonne la recherche clinique nationale. Elle développe les protocoles thérapeutiques et assure la formation des équipes médicales spécialisées.
Au niveau international, la JMML Foundation rassemble les familles du monde entier et finance des projets de recherche spécifiques à cette pathologie. Leur site web propose des ressources éducatives et met en relation les familles confrontées à la même épreuve.
Les Maisons des Parents présentes dans les grands centres hospitaliers offrent un hébergement et un soutien logistique aux familles. Ces structures facilitent l'organisation pratique pendant les hospitalisations prolongées.
Des plateformes en ligne comme Carenity permettent aux parents d'échanger leurs expériences et de trouver du soutien auprès d'autres familles. Ces communautés virtuelles constituent souvent une aide précieuse pour surmonter l'isolement.
Nos Conseils Pratiques
Faire face à la leucémie myélomonocytaire juvénile de votre enfant nécessite une organisation particulière et des adaptations du quotidien [14]. Voici nos conseils pratiques pour mieux vivre cette épreuve.
Constituez un dossier médical complet dès le diagnostic. Rassemblez tous les comptes-rendus, résultats d'examens et courriers médicaux dans un classeur. Cette organisation facilitera les consultations et évitera la perte d'informations importantes. N'hésitez pas à demander des copies de tous les documents.
Préparez les hospitalisations en avance. Constituez une valise avec les affaires personnelles de votre enfant : doudou, jouets préférés, vêtements confortables. Pensez également à vos propres besoins si vous restez auprès de votre enfant. Une bonne préparation réduit le stress de toute la famille [15].
Maintenez autant que possible les habitudes familiales. Même si la maladie bouleverse votre quotidien, essayez de conserver certains rituels : repas en famille, histoires du soir, sorties adaptées. Ces moments de normalité sont précieux pour l'équilibre psychologique de votre enfant.
Communiquez avec l'équipe éducative de votre enfant. Informez les enseignants de la situation médicale et des contraintes liées au traitement. La plupart des établissements scolaires sont très compréhensifs et peuvent proposer des aménagements : cours à domicile, horaires adaptés, dispenses d'activités physiques [16].
N'oubliez pas de prendre soin de vous. La maladie de votre enfant est éprouvante pour toute la famille. Acceptez l'aide de vos proches, prenez des moments de répit et n'hésitez pas à consulter un psychologue si nécessaire. Votre bien-être est essentiel pour accompagner votre enfant.
Quand Consulter un Médecin ?
Reconnaître les signes d'alerte de la leucémie myélomonocytaire juvénile peut permettre un diagnostic précoce et améliorer le pronostic [11,12]. Certains symptômes doivent vous amener à consulter rapidement votre pédiatre.
Consultez sans délai si votre enfant présente une pâleur persistante accompagnée d'une fatigue inhabituelle. Ces signes peuvent indiquer une anémie significative nécessitant des examens complémentaires [14]. Une pâleur des muqueuses (gencives, paupières) est particulièrement évocatrice.
Les infections récurrentes ou inhabituellement sévères constituent un autre motif de consultation urgent. Si votre enfant enchaîne les épisodes infectieux malgré un traitement approprié, ou s'il développe des infections opportunistes, une évaluation hématologique s'impose [15].
Tout saignement anormal doit vous alerter : saignements de nez fréquents, ecchymoses spontanées ou disproportionnées par rapport au traumatisme, saignements des gencives. Ces manifestations peuvent révéler une baisse du nombre de plaquettes [16].
L'augmentation du volume abdominal, même discrète, mérite une consultation. Votre enfant peut se plaindre de douleurs abdominales ou présenter une gêne lors des repas. Ces signes peuvent correspondre à une augmentation de la rate ou du foie [11].
En cas d'antécédents familiaux de syndromes génétiques (syndrome de Noonan, neurofibromatose), une surveillance hématologique régulière est recommandée même en l'absence de symptômes. Parlez-en à votre médecin pour établir un calendrier de suivi adapté [12].
N'attendez jamais que les symptômes s'aggravent. En cas de doute, il vaut mieux consulter pour rien que de passer à côté d'un diagnostic important.
Questions Fréquentes
La leucémie myélomonocytaire juvénile est-elle héréditaire ?Dans la majorité des cas, la LMMJ n'est pas héréditaire. Cependant, environ 10-15% des cas sont associés à des syndromes génétiques héréditaires comme le syndrome de Noonan ou la neurofibromatose de type 1 [13,14]. Mon enfant peut-il aller à l'école pendant le traitement ?
Cela dépend de son état général et du type de traitement. Pendant les phases intensives de chimiothérapie, la scolarisation à domicile est souvent préférable. Votre équipe médicale vous guidera selon l'évolution de votre enfant [15]. Quels sont les effets secondaires de la greffe de moelle osseuse ?
Les effets secondaires peuvent inclure des infections, la maladie du greffon contre l'hôte, des troubles de croissance ou des problèmes de fertilité à long terme. Cependant, ces risques sont surveillés et pris en charge par l'équipe médicale [16]. La LMMJ peut-elle récidiver après la greffe ?
Les rechutes après greffe sont possibles mais rares, survenant dans environ 20-30% des cas. La plupart des rechutes se produisent dans les deux premières années après la greffe [11]. Existe-t-il des traitements alternatifs à la greffe ?
Pour certains patients, des traitements moins intensifs comme les agents hypométhylants peuvent être proposés. Cependant, la greffe reste le traitement de référence offrant les meilleures chances de guérison [12]. Comment soutenir psychologiquement mon enfant ?
Maintenez une communication ouverte adaptée à son âge, conservez autant que possible ses habitudes, et n'hésitez pas à faire appel à un psychologue spécialisé en oncologie pédiatrique. Le soutien de toute la famille est essentiel.
Questions Fréquentes
La leucémie myélomonocytaire juvénile est-elle héréditaire ?
Dans la majorité des cas, la LMMJ n'est pas héréditaire. Cependant, environ 10-15% des cas sont associés à des syndromes génétiques héréditaires comme le syndrome de Noonan ou la neurofibromatose de type 1.
Mon enfant peut-il aller à l'école pendant le traitement ?
Cela dépend de son état général et du type de traitement. Pendant les phases intensives de chimiothérapie, la scolarisation à domicile est souvent préférable. Votre équipe médicale vous guidera selon l'évolution de votre enfant.
Quels sont les effets secondaires de la greffe de moelle osseuse ?
Les effets secondaires peuvent inclure des infections, la maladie du greffon contre l'hôte, des troubles de croissance ou des problèmes de fertilité à long terme. Ces risques sont surveillés et pris en charge par l'équipe médicale.
La LMMJ peut-elle récidiver après la greffe ?
Les rechutes après greffe sont possibles mais rares, survenant dans environ 20-30% des cas. La plupart des rechutes se produisent dans les deux premières années après la greffe.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Breizh CoCoA 2024. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [2] Arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santéLien
- [3] UCSF Database for the Advancement of JMMLLien
- [4] Mignon Loh, MD - UCSF ProfilesLien
- [5] Elliot Stieglitz, MD - UCSF ProfilesLien
- [6] J Le Bourdon, O Letertre. Série monocentrique de xanthogranulomes juvéniles multiples. 2024Lien
- [7] B Podvin. Immunophénotypage monocytaire et séquençage de nouvelle génération au diagnostic de LMMC. 2022Lien
- [11] AC Errim, F Bouanani. Juvenile Myelomonocytic Leukemia: A Case Report. 2024Lien
- [12] C Boujloud, A Kidoun. Juvenile myelomonocytic leukemia: a case report. 2023Lien
- [13] C Arfeuille. From diagnosis to relapse, mutational landscape and clonal evolution of juvenile myelomonocytic leukaemia. 2023Lien
- [14] La leucémie myélomonocytaire juvénile (LMMJ) chez l'enfant - St. JudeLien
- [15] Leucémie myélomonocytaire chronique et juvénile - LLSLien
- [16] Comprendre la leucémie myélomonocytaire juvénile (LMMJ) - Beat CancerLien
Publications scientifiques
- Série monocentrique de xanthogranulomes juvéniles multiples (2024)
- [PDF][PDF] … de l'immunophénotypage monocytaire et du séquençage de nouvelle génération au diagnostic de leucémie myélomonocytaire chronique (LMMC): étude … (2022)[PDF]
- Le diagnostic et la prise en charge de la syphilis congénitale: ne laisser passer aucune occasion (2024)
- Gestion des anémies à l'hôpital du jour d'hématologie et d'oncologie pédiatrique
- Syndrome hémorragique chez l'enfant: Etiologies et profils clinicobiologiques CHU Nedir Mohamed Tizi Ouzou-Du 01 Janvier 2022 au 01 Mai 2023 (2023)
Ressources web
- La leucémie myélomonocytaire juvénile (LMMJ) chez l'enfant (together.stjude.org)
Signes et symptômes de la leucémie myélomonocytaire juvénile L'augmentation de la taille de la rate et du foie et la présence de minuscules ecchymoses rouges ...
- Leucémie myélomonocytaire chronique et ... (lls.org)
Les symptômes courants de la LMMC sont notamment : faiblesse, fatigue, ecchymoses inexpliquées, saignements, infections, hypertrophie du foie et de la rate. La ...
- Comprendre la leucémie myélomonocytaire juvénile (LMMJ) (beatcancer.eu)
Le diagnostic de la LMMJ implique une série de tests tels qu'une numération formule sanguine (NFS), un examen de la moelle osseuse, un test génétique, etc. Un ...
- La leucémie myélomonocytaire juvénile - Cloudfront.net (d8miq7k9f04rm.cloudfront.net)
La mise en place d'une chimiothérapie par 6-mercap- topurine peut néanmoins être nécessaire au diagnostic en cas d'hyperleucocytose élevée ou de retentissement.
- Leucémie myélomonocytaire juvénile (orpha.net)
La plupart des patients présentent des dérégulations constitutionnelles, des signes d'infection et une hépatosplénomégalie. Synonyme(s) : Leucémie myé ...

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
