Leucémie Myéloïde en Phase Accélérée : Guide Complet 2025 | Symptômes, Traitements
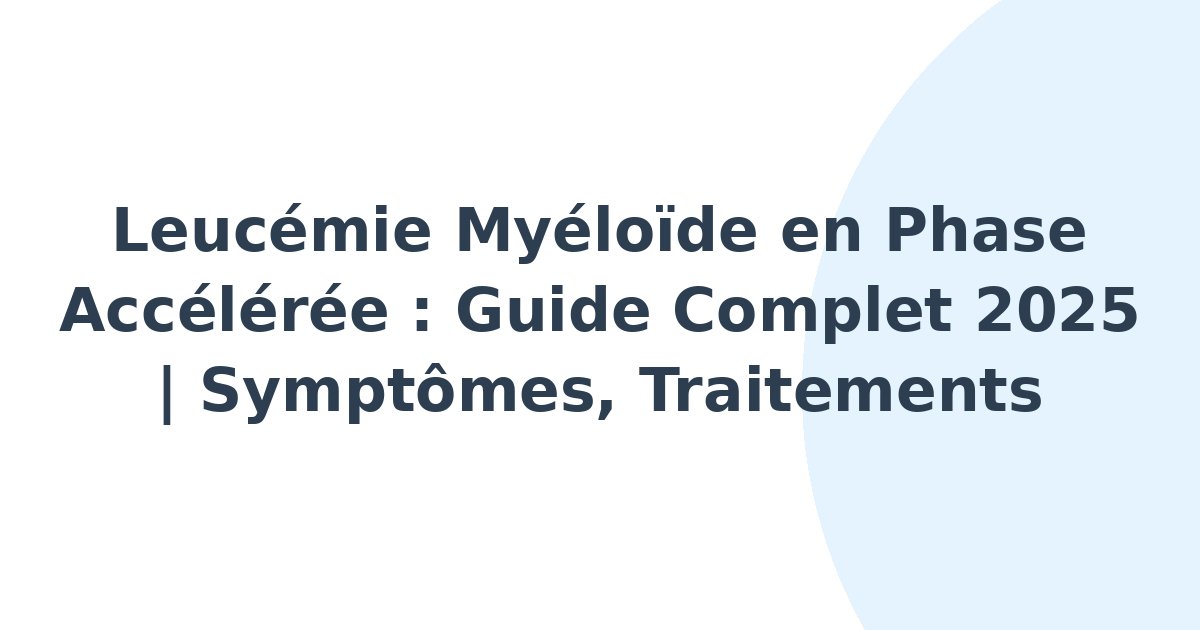
La leucémie myéloïde en phase accélérée représente une étape critique dans l'évolution de la leucémie myéloïde chronique. Cette pathologie hématologique complexe nécessite une prise en charge spécialisée et adaptée. Découvrez dans ce guide complet tout ce qu'il faut savoir sur cette maladie : de ses manifestations cliniques aux dernières innovations thérapeutiques 2025.

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Leucémie myéloïde en phase accélérée : Définition et Vue d'Ensemble
La leucémie myéloïde en phase accélérée constitue une forme intermédiaire entre la phase chronique et la phase blastique de la leucémie myéloïde chronique (LMC). Cette pathologie se caractérise par une accélération de la production de cellules sanguines anormales dans la moelle osseuse [13].
Concrètement, votre moelle osseuse produit de manière excessive des globules blancs immatures qui ne fonctionnent pas correctement. Ces cellules, appelées blastes, envahissent progressivement votre circulation sanguine et vos organes. La phase accélérée se définit par la présence de 10 à 19% de blastes dans le sang ou la moelle osseuse [14].
Mais qu'est-ce qui distingue vraiment cette phase ? D'abord, elle marque une résistance croissante aux traitements habituels de la phase chronique. Ensuite, les symptômes deviennent plus marqués et plus gênants au quotidien. L'important à retenir : cette phase nécessite une adaptation rapide de votre traitement [5,8].
La transformation vers cette phase peut survenir après plusieurs années de maladie chronique stable. Environ 15 à 20% des patients en phase chronique évoluent vers cette phase accélérée, généralement entre 3 et 5 ans après le diagnostic initial [11]. Heureusement, les nouveaux traitements permettent aujourd'hui de mieux contrôler cette évolution.
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, la leucémie myéloïde chronique touche environ 600 à 800 nouveaux patients chaque année, selon les données de Santé Publique France. Parmi ces cas, 15 à 20% évolueront vers la phase accélérée au cours de leur suivi [6].
L'âge médian au diagnostic de la phase accélérée se situe autour de 55-60 ans, avec une légère prédominance masculine (ratio 1,3:1). Cette pathologie représente donc un enjeu de santé publique non négligeable, d'autant que l'incidence globale de la LMC tend à augmenter avec le vieillissement de la population [1].
Au niveau international, les données montrent des variations géographiques intéressantes. En Europe, l'incidence annuelle de la LMC varie de 1 à 2 cas pour 100 000 habitants. Les pays nordiques rapportent des taux légèrement supérieurs, possiblement liés à de meilleurs systèmes de détection précoce [6,12].
D'ailleurs, l'évolution vers la phase accélérée a considérablement diminué depuis l'introduction de l'imatinib en 2001. Avant cette révolution thérapeutique, près de 80% des patients évoluaient vers cette phase dans les 10 ans. Aujourd'hui, ce pourcentage est tombé à moins de 5% grâce aux inhibiteurs de tyrosine kinase [8,9].
Les Causes et Facteurs de Risque
La cause principale de la leucémie myéloïde en phase accélérée reste l'évolution naturelle de la leucémie myéloïde chronique. Cette progression résulte de l'accumulation d'anomalies génétiques supplémentaires dans les cellules déjà porteuses du chromosome Philadelphie [7,12].
Plusieurs facteurs peuvent accélérer cette transformation. L'âge avancé au diagnostic initial constitue un facteur de risque majeur. Les patients diagnostiqués après 60 ans présentent un risque plus élevé d'évolution rapide vers la phase accélérée [6]. De même, un taux de blastes élevé dès le diagnostic initial peut prédire une évolution moins favorable.
Mais attention, la résistance ou l'intolérance aux traitements de première ligne représente également un facteur déterminant. Lorsque l'imatinib ne parvient plus à contrôler efficacement la maladie, le risque de progression augmente significativement [5,8]. C'est pourquoi votre médecin surveille régulièrement votre réponse au traitement.
Il faut savoir que certaines mutations génétiques additionnelles favorisent cette évolution. Les mutations des gènes p53, RB ou encore les anomalies chromosomiques complexes constituent des signaux d'alarme pour votre équipe médicale [11,12]. Heureusement, les techniques de biologie moléculaire permettent aujourd'hui de détecter précocement ces changements.
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes de la phase accélérée sont souvent plus marqués que ceux de la phase chronique. Vous pourriez d'abord remarquer une fatigue inhabituelle qui ne s'améliore pas avec le repos. Cette asthénie résulte de l'anémie causée par l'envahissement de la moelle osseuse par les cellules anormales [14].
La fièvre constitue un autre signe d'alarme fréquent. Elle peut survenir sans infection apparente et témoigne de l'activité accrue de la maladie. Parallèlement, vous pourriez observer des sueurs nocturnes importantes, parfois accompagnées d'une perte de poids inexpliquée [13,14].
D'un point de vue physique, l'augmentation du volume de la rate (splénomégalie) devient souvent plus perceptible. Vous pourriez ressentir une gêne ou une douleur dans la partie gauche de votre abdomen, surtout après les repas. Cette sensation de plénitude précoce peut également affecter votre appétit [15].
Les troubles de la coagulation représentent une manifestation particulièrement préoccupante. Des saignements spontanés, des ecchymoses faciles ou des pétéchies (petites taches rouges sur la peau) peuvent apparaître. Ces signes résultent de la diminution du nombre de plaquettes fonctionnelles [10,14]. Il est crucial de signaler rapidement ces symptômes à votre équipe médicale.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic de la phase accélérée repose sur des critères précis établis par l'Organisation Mondiale de la Santé. Votre médecin recherchera d'abord la présence de 10 à 19% de blastes dans votre sang périphérique ou votre moelle osseuse [13].
L'examen de la moelle osseuse constitue l'étape diagnostique centrale. Cette procédure, réalisée sous anesthésie locale, permet d'analyser précisément la composition cellulaire et de détecter d'éventuelles anomalies chromosomiques supplémentaires. Rassurez-vous, cet examen est généralement bien toléré [7,12].
Les analyses de biologie moléculaire jouent un rôle croissant dans le diagnostic. La recherche de mutations additionnelles, comme celles touchant les gènes ABL1, permet d'adapter au mieux votre traitement. Ces techniques sophistiquées aident également à prédire la réponse aux différentes thérapies disponibles [7,12].
Parallèlement, votre équipe médicale évaluera votre état général et recherchera d'éventuelles complications. Des examens d'imagerie peuvent être nécessaires pour évaluer l'atteinte des différents organes, notamment la rate et le foie. Cette approche globale permet d'établir un plan de traitement personnalisé [11,13].
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement de la leucémie myéloïde en phase accélérée a considérablement évolué ces dernières années. Les inhibiteurs de tyrosine kinase de deuxième génération constituent aujourd'hui le traitement de référence. Le dasatinib, le nilotinib et le bosutinib ont révolutionné la prise en charge de cette pathologie [5,8].
Lorsque l'imatinib ne suffit plus, votre médecin vous proposera probablement l'un de ces traitements plus puissants. Le choix dépendra de votre profil de mutations, de vos antécédents médicaux et de votre tolérance. Par exemple, le dasatinib est souvent privilégié en cas de mutation T315I, tandis que le nilotinib convient mieux aux patients avec des antécédents cardiovasculaires [5,6].
Le ponatinib représente une option thérapeutique particulièrement intéressante pour les formes résistantes. Cependant, ce médicament nécessite une surveillance cardiovasculaire renforcée en raison de ses effets secondaires potentiels. Les recommandations 2022 du groupe Fi-LMC précisent les modalités de cette surveillance [5].
Dans certains cas, la greffe de moelle osseuse peut être envisagée, particulièrement chez les patients jeunes avec un donneur compatible. Cette option thérapeutique reste le seul traitement potentiellement curatif, mais elle comporte des risques significatifs qui doivent être soigneusement évalués [8,11].
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024-2025 marque une période d'innovations remarquables dans le traitement des leucémies myéloïdes. Les recherches sur les vésicules extracellulaires (EVs) ouvrent de nouvelles perspectives thérapeutiques prometteuses. Ces structures naturelles pourraient servir de vecteurs pour délivrer des traitements ciblés directement aux cellules cancéreuses [3].
Le développement du tacrolimus monohydrate (FK506) représente une autre avancée significative. Cette molécule, initialement utilisée en transplantation, montre des résultats encourageants dans la modulation de la réponse immunitaire contre les cellules leucémiques. Les premiers essais cliniques suggèrent une amélioration de la tolérance aux traitements conventionnels [2].
Les technologies de suivi médical connecté révolutionnent également la prise en charge. Le MedTech-Tracker 2025 recense plus de 150 dispositifs innovants pour le monitoring des patients hématologiques. Ces outils permettent un suivi en temps réel des paramètres biologiques et une adaptation plus rapide des traitements [4].
D'ailleurs, les thérapies cellulaires CAR-T font l'objet de recherches intensives pour les leucémies myéloïdes résistantes. Bien que ces approches soient encore expérimentales, les résultats préliminaires sont encourageants et pourraient changer la donne dans les années à venir [3,4].
Vivre au Quotidien avec la Leucémie Myéloïde en Phase Accélérée
Vivre avec une leucémie myéloïde en phase accélérée nécessite des ajustements importants dans votre quotidien. La gestion de la fatigue constitue souvent le défi principal. Il est normal de ressentir une baisse d'énergie significative, et il faut apprendre à respecter les signaux de votre corps [6].
L'organisation de vos activités devient cruciale. Privilégiez les tâches importantes aux moments où vous vous sentez le mieux, généralement le matin. N'hésitez pas à déléguer certaines responsabilités et à accepter l'aide de vos proches. Cette maladie n'est pas un combat que vous devez mener seul.
Sur le plan professionnel, une adaptation de votre poste peut s'avérer nécessaire. Le télétravail, l'aménagement des horaires ou la réduction temporaire du temps de travail sont autant d'options à discuter avec votre employeur et votre médecin du travail. La reconnaissance en affection de longue durée facilite ces démarches [1].
L'alimentation joue également un rôle important dans votre bien-être. Privilégiez une alimentation équilibrée, riche en fruits et légumes, tout en respectant les éventuelles restrictions liées à votre traitement. Certains aliments peuvent interagir avec vos médicaments, d'où l'importance de suivre les conseils de votre équipe soignante [6,10].
Les Complications Possibles
La leucémie myéloïde en phase accélérée peut entraîner plusieurs complications qu'il est important de connaître. La transformation blastique représente l'évolution la plus redoutée. Cette progression vers la phase aiguë survient chez 10 à 15% des patients en phase accélérée et nécessite une prise en charge urgente [11].
Les complications infectieuses constituent un risque majeur en raison de la diminution des défenses immunitaires. Votre organisme devient plus vulnérable aux infections bactériennes, virales ou fongiques. Il est donc crucial de signaler rapidement tout épisode fébrile à votre équipe médicale [13,15].
Les troubles de la coagulation peuvent également survenir. La thrombopénie (diminution des plaquettes) expose à un risque hémorragique, tandis que l'hyperleucocytose peut paradoxalement favoriser les thromboses. Cette dualité nécessite une surveillance biologique régulière [10,14].
D'autres complications peuvent affecter différents organes. L'atteinte cardiaque, bien que rare, peut survenir en cas d'hyperleucocytose importante. De même, l'infiltration leucémique du système nerveux central, quoique exceptionnelle, doit être recherchée en cas de symptômes neurologiques [5,13]. Heureusement, la plupart de ces complications peuvent être prévenues ou traitées efficacement si elles sont détectées précocement.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de la leucémie myéloïde en phase accélérée s'est considérablement amélioré avec l'avènement des inhibiteurs de tyrosine kinase de nouvelle génération. Aujourd'hui, la survie globale à 5 ans dépasse 70% chez les patients traités par ces molécules [6,8].
Plusieurs facteurs influencent votre pronostic individuel. L'âge au diagnostic reste un élément déterminant : les patients de moins de 60 ans présentent généralement une évolution plus favorable. De même, la réponse précoce au traitement constitue un facteur prédictif majeur de l'évolution à long terme [6].
Les scores pronostiques permettent d'affiner l'évaluation de votre situation. Le score de Sokal, adapté à la phase accélérée, prend en compte votre âge, la taille de votre rate, le pourcentage de blastes et votre numération plaquettaire. Ces outils aident votre médecin à personnaliser votre prise en charge [8,11].
Il faut savoir que la qualité de vie peut être préservée chez la majorité des patients. Les études récentes montrent que plus de 80% des patients en phase accélérée maintiennent une activité professionnelle et sociale satisfaisante sous traitement adapté. Cette donnée rassurante témoigne des progrès thérapeutiques accomplis [6,8].
Peut-on Prévenir la Leucémie Myéloïde en Phase Accélérée ?
La prévention de l'évolution vers la phase accélérée repose principalement sur une prise en charge optimale de la phase chronique. Le respect scrupuleux de votre traitement par inhibiteurs de tyrosine kinase constitue la mesure préventive la plus efficace [8,9].
Le suivi régulier de votre réponse moléculaire permet de détecter précocement les signes de résistance. Votre médecin surveillera l'évolution du taux de transcrits BCR-ABL par PCR quantitative. Une augmentation de ce marqueur peut signaler la nécessité d'adapter votre traitement avant l'évolution vers la phase accélérée [7,12].
L'observance thérapeutique joue un rôle crucial dans cette prévention. Des études montrent que les patients qui prennent moins de 90% de leur traitement présentent un risque significativement plus élevé de progression. Il est donc essentiel de discuter avec votre équipe médicale de toute difficulté à suivre votre traitement [8].
Certains facteurs de mode de vie peuvent également influencer l'évolution de votre maladie. Bien qu'aucune mesure diététique spécifique ne soit prouvée, maintenir une activité physique adaptée et éviter le tabac contribuent à votre bien-être général et peuvent favoriser une meilleure réponse aux traitements [6,9].
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités de santé françaises ont établi des recommandations précises pour la prise en charge de la leucémie myéloïde en phase accélérée. La Haute Autorité de Santé (HAS) préconise une approche multidisciplinaire impliquant hématologues, pharmaciens cliniciens et équipes paramédicales spécialisées [1].
Le suivi biologique doit être renforcé par rapport à la phase chronique. Les recommandations prévoient un hémogramme hebdomadaire pendant les premiers mois de traitement, puis mensuel une fois la stabilité obtenue. La surveillance de la réponse moléculaire reste trimestrielle, conformément aux standards internationaux [1,5].
Concernant les inhibiteurs de tyrosine kinase de deuxième génération, les recommandations 2022 du groupe Fi-LMC précisent les modalités de surveillance cardiovasculaire sous ponatinib. Un électrocardiogramme et un échocardiogramme sont requis avant l'initiation, puis tous les 3 mois pendant la première année [5].
L'Institut National du Cancer (INCa) insiste sur l'importance de l'information du patient et de son entourage. Des consultations d'annonce spécifiques doivent être organisées, avec remise de documents d'information adaptés. L'accès aux soins de support (psycho-oncologie, diététique, kinésithérapie) doit être facilité [1,4].
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs associations françaises accompagnent les patients atteints de leucémie myéloïde chronique et leurs familles. L'Association Laurette Fugain constitue une ressource majeure, proposant soutien psychologique, aide financière et information médicale actualisée.
France Lymphome Espoir offre également un accompagnement spécialisé pour les hémopathies malignes. Cette association organise régulièrement des rencontres entre patients, des conférences médicales grand public et des groupes de parole. Leur site internet propose une documentation riche et régulièrement mise à jour [4].
Au niveau local, de nombreux centres hospitaliers universitaires disposent de consultations dédiées aux leucémies myéloïdes. Ces consultations spécialisées permettent un suivi personnalisé et l'accès aux dernières innovations thérapeutiques. N'hésitez pas à demander à votre médecin traitant une orientation vers l'un de ces centres [1].
Les plateformes numériques se développent également. Le site Mon Réseau Cancer Hématologie propose des forums d'échanges modérés par des professionnels de santé, des webinaires éducatifs et des outils de suivi personnalisés. Ces ressources digitales complètent utilement l'accompagnement traditionnel [4].
Nos Conseils Pratiques
Gérer une leucémie myéloïde en phase accélérée au quotidien nécessite quelques ajustements pratiques. Tout d'abord, organisez votre prise médicamenteuse avec rigueur. Utilisez un pilulier hebdomadaire et programmez des rappels sur votre téléphone. Cette organisation simple mais efficace améliore significativement l'observance [8].
Tenez un carnet de suivi de vos symptômes et de votre état général. Notez votre niveau de fatigue, d'éventuels saignements, votre température si elle dépasse 38°C. Ces informations précieuses aideront votre équipe médicale à adapter votre prise en charge lors des consultations.
Préparez soigneusement vos consultations médicales. Listez vos questions à l'avance, apportez tous vos résultats d'examens et n'hésitez pas à vous faire accompagner. La présence d'un proche peut vous aider à mieux retenir les informations importantes et à poser les bonnes questions [1].
Maintenez une activité physique adaptée à vos capacités. La marche quotidienne, même de courte durée, contribue à lutter contre la fatigue et améliore votre moral. Évitez les sports de contact qui pourraient provoquer des traumatismes en cas de thrombopénie [6,10].
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes doivent vous amener à consulter rapidement votre médecin ou à contacter votre équipe d'hématologie. La fièvre supérieure à 38°C constitue un motif de consultation urgente, même en l'absence d'autres symptômes. Votre système immunitaire affaibli nécessite une prise en charge précoce de toute infection [13,15].
Les saignements anormaux représentent également un signal d'alarme. Qu'il s'agisse de saignements de nez répétés, de gencives qui saignent spontanément, ou d'ecchymoses importantes après des chocs minimes, ces manifestations peuvent témoigner d'une chute du taux de plaquettes [10,14].
Une aggravation brutale de votre état général doit vous alerter. Si votre fatigue devient soudainement plus intense, si vous ressentez des essoufflements inhabituels ou des douleurs abdominales importantes, n'attendez pas votre prochaine consultation programmée [14,15].
En cas de doute, privilégiez toujours la prudence. Votre équipe médicale préfère être contactée pour une fausse alerte plutôt que de passer à côté d'une complication. La plupart des services d'hématologie disposent d'une ligne téléphonique dédiée aux patients, accessible 24h/24 [1,13].
Questions Fréquentes
Puis-je continuer à travailler avec une leucémie myéloïde en phase accélérée ?Oui, dans la plupart des cas. Environ 70% des patients maintiennent une activité professionnelle, souvent avec des aménagements d'horaires ou de poste. La reconnaissance en ALD facilite ces adaptations [6].
Les traitements actuels permettent-ils une guérison ?
Les inhibiteurs de tyrosine kinase permettent un contrôle excellent de la maladie, mais ne constituent pas une guérison au sens strict. Seule la greffe de moelle osseuse offre une possibilité de guérison définitive [8,11].
Quels sont les effets secondaires les plus fréquents des traitements ?
Les effets secondaires varient selon le médicament utilisé. Diarrhées, nausées, crampes musculaires et éruptions cutanées sont les plus courants. La plupart sont gérables avec un traitement symptomatique [5,8].
Puis-je avoir des enfants pendant le traitement ?
Cette question nécessite une discussion approfondie avec votre équipe médicale. Certains traitements peuvent affecter la fertilité, et des mesures contraceptives sont généralement recommandées pendant le traitement [1].
Comment savoir si mon traitement fonctionne ?
Votre médecin surveille régulièrement votre réponse par des analyses de sang et de moelle osseuse. La diminution du taux de transcrits BCR-ABL témoigne de l'efficacité du traitement [7,12].
Questions Fréquentes
Puis-je continuer à travailler avec une leucémie myéloïde en phase accélérée ?
Oui, dans la plupart des cas. Environ 70% des patients maintiennent une activité professionnelle, souvent avec des aménagements d'horaires ou de poste. La reconnaissance en ALD facilite ces adaptations.
Les traitements actuels permettent-ils une guérison ?
Les inhibiteurs de tyrosine kinase permettent un contrôle excellent de la maladie, mais ne constituent pas une guérison au sens strict. Seule la greffe de moelle osseuse offre une possibilité de guérison définitive.
Quels sont les effets secondaires les plus fréquents des traitements ?
Les effets secondaires varient selon le médicament utilisé. Diarrhées, nausées, crampes musculaires et éruptions cutanées sont les plus courants. La plupart sont gérables avec un traitement symptomatique.
Comment savoir si mon traitement fonctionne ?
Votre médecin surveille régulièrement votre réponse par des analyses de sang et de moelle osseuse. La diminution du taux de transcrits BCR-ABL témoigne de l'efficacité du traitement.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Purpura thrombopénique immunologique de l'adulte - PNDS. HAS. 2024-2025.Lien
- [2] Tacrolimus monohydrate (Synonyms: FK506). Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [3] EVs enhance breast tumor growth. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [4] Conditions and Diseases - MedTech-Tracker. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [5] Recommandations 2022 du groupe Fi-LMC pour la gestion du risque d'événements cardiovasculaires sous ponatinib dans la leucémie myéloïde chronique.Lien
- [6] Caractéristiques cliniques, facteurs pronostiques et évolution de la leucémie myéloïde chronique (LMC) traitée par l'imatinib mésylate (GLIVEC®) au Mali.Lien
- [7] Application de la Biologie moléculaire dans la Leucémie Myéloïde Chronique.Lien
- [8] Leucémie myéloïde chronique: vingt ans d'analyses ciblées sur l'imatinib.Lien
- [9] Le rôle passé, présent et l'éventuel regain d'intérêt de l'interféron dans le traitement de la leucémie myéloïde chronique.Lien
- [10] Leucémie myéloide chronique et thrombopénie Immunologique iatrogène sous Imatinib Mesylate.Lien
- [11] Transformation d'une leucémie myéloïde chronique (LMC) en Leucémie aigue mégacaryoblastique: A propos d'un cas.Lien
- [12] LEUCEMIE MYELOIDE CHRONIQUE ET BIOLOGIE MOLECULAIRE.Lien
- [13] Leucémie myéloïde chronique (LMC) - Hématologie et Oncologie.Lien
- [14] Leucémie Myéloïde Chronique à la phase d'accélération.Lien
- [15] Les symptômes et le diagnostic des leucémies aiguës.Lien
Publications scientifiques
- Recommandations 2022 du groupe Fi-LMC pour la gestion du risque d'événements cardiovasculaires sous ponatinib dans la leucémie myéloïde chronique (2022)2 citations
- Caractéristiques cliniques, facteurs pronostiques et évolution de la leucémie myéloïde chronique (LMC) traitée par l'imatinib mésylate (GLIVEC®) au Mali (2024)1 citations[PDF]
- [PDF][PDF] Application de la Biologie moléculaire dans la Leucémie Myéloïde Chronique [PDF]
- Leucémie myéloïde chronique: vingt ans d'analyses ciblées sur l'imatinib (2023)
- [PDF][PDF] Le rôle passé, présent et l'éventuel regain d'intérêt de l'interféron dans le traitement de la leucémie myéloïde chronique [PDF]
Ressources web
- Leucémie myéloïde chronique (LMC) - Hématologie et ... (msdmanuals.com)
Phase chronique: une phase chronique indolente initiale qui peut durer 5 à 6 ans. Phase accélérée: échec du traitement, aggravation de l'anémie, thrombopénie ...
- Leucémie Myéloïde Chronique à la phase d'accélération (arcagy.org)
6 mars 2009 — Un amaigrissement, · Des sueurs nocturnes, · Des signes en rapport avec d'insuffisance de production de la moelle osseuse ou « insuffisance ...
- Les symptômes et le diagnostic des leucémies aiguës (fondation-arc.org)
10 févr. 2025 — Durant la phase accélérée, on compte 6 à 30 % de cellules anormales. Elles commencent à perturber la différenciation des autres cellules du sang ...
- Leucémie myéloïde chronique (LMC) - Troubles du sang (msdmanuals.com)
Phase accélérée : la maladie commence à progresser plus rapidement, les traitements sont moins efficaces et les symptômes s'aggravent. Phase blastique : des ...
- Pronostic et survie pour la leucémie myéloïde chronique (cancer.ca)
Une LMC en phase accélérée ou blastique au moment du diagnostic engendre un pronostic moins favorable qu'une LMC diagnostiquée à la phase chronique. Chromosome ...

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
