Leucémie Myéloïde Chronique BCR-ABL+ : Guide Complet 2025 | Symptômes, Traitements
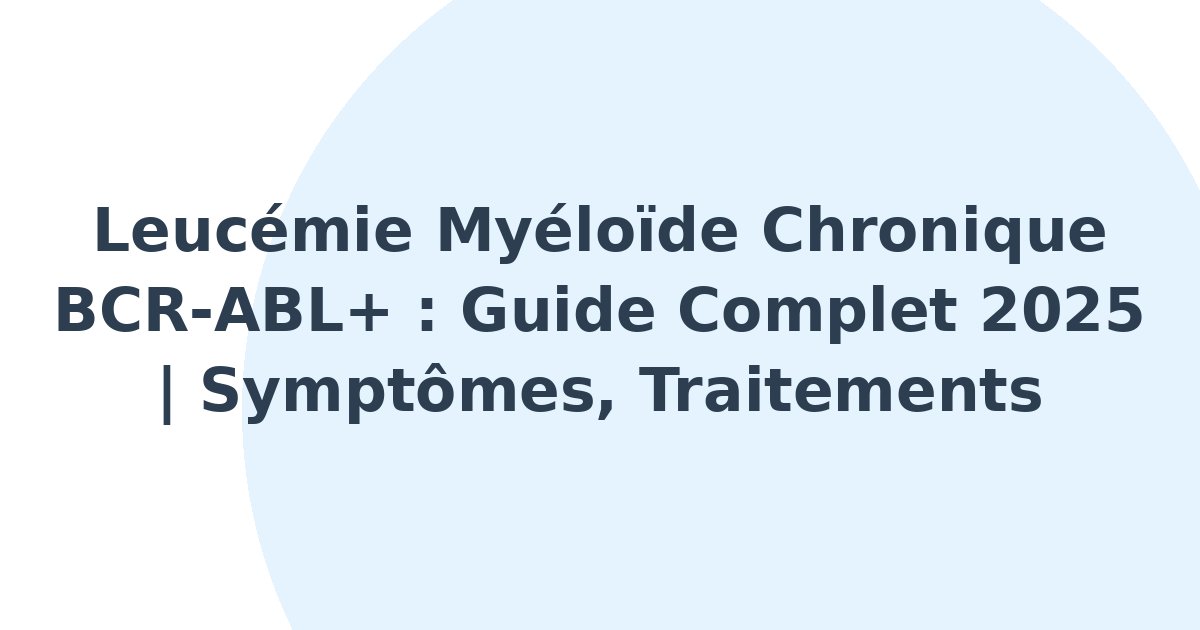
La leucémie myéloïde chronique BCR-ABL positive représente une forme particulière de cancer du sang qui touche environ 1 000 nouvelles personnes chaque année en France. Cette pathologie, caractérisée par la présence d'un chromosome anormal appelé chromosome de Philadelphie, a connu une révolution thérapeutique majeure ces dernières décennies. Grâce aux innovations récentes, notamment les inhibiteurs de tyrosine kinase, le pronostic s'est considérablement amélioré, transformant cette maladie autrefois fatale en pathologie chronique gérable.

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Leucémie myéloïde chronique BCR-ABL positive : Définition et Vue d'Ensemble
La leucémie myéloïde chronique BCR-ABL positive est un cancer du sang qui affecte les cellules souches de la moelle osseuse. Cette pathologie se caractérise par la présence d'une anomalie génétique spécifique : le gène de fusion BCR-ABL, résultant d'une translocation entre les chromosomes 9 et 22 [14].
Cette anomalie génétique crée ce qu'on appelle le chromosome de Philadelphie, découvert en 1960 dans cette ville américaine. Le gène BCR-ABL produit une protéine anormale qui stimule de façon excessive la production de globules blancs immatures [2]. Ces cellules s'accumulent progressivement dans le sang, la moelle osseuse et parfois d'autres organes.
Contrairement aux leucémies aiguës, cette forme chronique évolue lentement sur plusieurs années. Elle représente environ 15% de toutes les leucémies chez l'adulte [14]. La maladie touche principalement les personnes âgées de 50 à 60 ans, avec une légère prédominance masculine.
L'important à retenir : cette pathologie n'est pas héréditaire dans la grande majorité des cas. L'anomalie génétique se développe au cours de la vie, généralement sans cause identifiable [7].
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, la leucémie myéloïde chronique représente un enjeu de santé publique modéré mais significatif. L'incidence annuelle s'établit à environ 1,5 cas pour 100 000 habitants, soit près de 1 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année [8]. Cette incidence reste stable depuis une décennie, contrairement à d'autres cancers hématologiques.
La répartition par âge montre une nette prédominance après 50 ans. L'âge médian au diagnostic se situe autour de 57 ans, avec 60% des patients diagnostiqués entre 45 et 70 ans [8]. Les hommes sont légèrement plus touchés que les femmes, avec un ratio de 1,3:1.
Au niveau européen, la France se situe dans la moyenne des pays développés. L'Allemagne et le Royaume-Uni présentent des taux similaires, tandis que les pays nordiques affichent des incidences légèrement supérieures [15]. Cette variation pourrait s'expliquer par des différences dans les systèmes de dépistage et de diagnostic.
Bon à savoir : la prévalence totale en France est estimée à environ 8 000 à 10 000 patients vivants avec cette pathologie [8]. Ce chiffre relativement élevé par rapport à l'incidence s'explique par l'amélioration considérable du pronostic depuis l'introduction des thérapies ciblées.
Les Causes et Facteurs de Risque
La cause exacte de la leucémie myéloïde chronique reste largement mystérieuse. Dans plus de 95% des cas, aucun facteur déclenchant spécifique ne peut être identifié [14]. L'anomalie génétique BCR-ABL apparaît de façon spontanée dans une cellule souche de la moelle osseuse.
Cependant, certains facteurs de risque ont été identifiés. L'exposition aux radiations ionisantes constitue le seul facteur de risque clairement établi. Les survivants des bombardements atomiques d'Hiroshima et Nagasaki ont présenté une incidence 5 à 10 fois supérieure à la normale [14]. De même, les patients ayant reçu une radiothérapie pour d'autres cancers voient leur risque légèrement augmenté.
L'âge représente le principal facteur de risque non modifiable. Bien que la maladie puisse survenir à tout âge, y compris chez l'enfant, l'incidence augmente progressivement avec l'âge [8]. Certaines expositions professionnelles, notamment au benzène, ont été suspectées mais leur rôle reste débattu.
Contrairement à d'autres cancers, le tabac, l'alcool ou les facteurs alimentaires ne semblent pas influencer le risque de développer cette pathologie. Il n'existe pas non plus de prédisposition génétique héréditaire connue [14].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes de la leucémie myéloïde chronique apparaissent généralement de façon progressive et insidieuse. Paradoxalement, près de 40% des patients ne présentent aucun symptôme au moment du diagnostic, la maladie étant découverte lors d'un bilan sanguin de routine [14].
Quand ils sont présents, les symptômes les plus fréquents incluent une fatigue persistante et inexpliquée, touchant plus de 70% des patients. Cette asthénie peut s'accompagner d'un essoufflement à l'effort, même modéré. Beaucoup de patients rapportent également des sueurs nocturnes abondantes et une perte de poids involontaire [16].
L'augmentation du volume de la rate (splénomégalie) constitue un signe caractéristique, présent chez environ 60% des patients au diagnostic. Elle se manifeste par une sensation de pesanteur ou de douleur dans la partie gauche de l'abdomen, parfois accompagnée d'une satiété précoce lors des repas [14].
D'autres symptômes peuvent inclure des douleurs osseuses, des infections à répétition ou des saignements anormaux. Mais attention : ces signes ne sont pas spécifiques et peuvent évoquer de nombreuses autres pathologies. Seuls des examens complémentaires permettent d'établir le diagnostic [16].
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic de la leucémie myéloïde chronique repose sur une série d'examens complémentaires spécialisés. Tout commence généralement par une prise de sang de routine qui révèle une augmentation anormale des globules blancs, souvent supérieure à 20 000/mm³ [16].
L'étape cruciale consiste à rechercher le chromosome de Philadelphie et le gène BCR-ABL. Cette analyse peut être réalisée par plusieurs techniques : la cytogénétique conventionnelle, l'hybridation in situ fluorescente (FISH) ou la biologie moléculaire par PCR [9]. Cette dernière technique, particulièrement sensible, permet de détecter même de très faibles quantités de cellules anormales.
Un myélogramme (ponction de moelle osseuse) est généralement nécessaire pour confirmer le diagnostic et évaluer l'étendue de la maladie. Cet examen, réalisé sous anesthésie locale, permet d'analyser directement les cellules de la moelle osseuse [16]. Parallèlement, une biopsie ostéo-médullaire peut être effectuée pour étudier l'architecture de la moelle.
Le bilan d'extension comprend également une échographie abdominale pour mesurer la taille de la rate et du foie, ainsi que des examens biologiques complets. L'ensemble de ces investigations permet de déterminer la phase de la maladie et d'adapter le traitement [9].
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
La révolution thérapeutique de la leucémie myéloïde chronique a commencé avec l'introduction de l'imatinib (Glivec®) en 2001. Ce premier inhibiteur de tyrosine kinase a transformé le pronostic de cette maladie, permettant de passer d'une survie médiane de 3-5 ans à une espérance de vie quasi-normale [7].
Aujourd'hui, plusieurs inhibiteurs de tyrosine kinase sont disponibles en première ligne. Outre l'imatinib, le nilotinib (Tasigna®) et le dasatinib (Sprycel®) constituent des alternatives efficaces [12]. Le choix entre ces molécules dépend du profil du patient, de ses comorbidités et de la phase de la maladie au diagnostic.
Pour les patients en échec ou intolérants aux traitements de première ligne, des options de deuxième et troisième ligne existent. Le bosutinib (Bosulif®) et le ponatinib (Iclusig®) ont démontré leur efficacité dans ces situations [13]. Ces médicaments permettent souvent de retrouver une réponse thérapeutique satisfaisante.
Le traitement vise à obtenir une réponse moléculaire majeure, définie par une réduction d'au moins 1000 fois du taux de transcrits BCR-ABL. Cette réponse, généralement obtenue en 12 à 18 mois, s'accompagne d'une normalisation de la qualité de vie et d'un pronostic excellent [10]. Dans certains cas favorables, un arrêt thérapeutique peut même être envisagé sous surveillance étroite.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024 marque une nouvelle étape dans la prise en charge de la leucémie myéloïde chronique avec l'émergence de thérapies innovantes. L'olverembatinib, un inhibiteur de troisième génération, montre des résultats prometteurs chez les patients en échec des traitements conventionnels [4]. Cette molécule présente l'avantage de franchir la barrière hémato-encéphalique, ouvrant de nouvelles perspectives.
Les peptides antimicrobiens représentent une approche thérapeutique révolutionnaire en cours d'investigation. Ces molécules naturelles, initialement découvertes pour leurs propriétés antibactériennes, démontrent des effets anticancéreux prometteurs dans plusieurs modèles précliniques [3]. Leur mécanisme d'action, différent des inhibiteurs de tyrosine kinase, pourrait permettre de surmonter certaines résistances.
La recherche 2024-2025 se concentre également sur l'optimisation du choix thérapeutique en première ligne. Des études récentes suggèrent que certains biomarqueurs pourraient prédire la réponse aux différents inhibiteurs, permettant une médecine personnalisée plus précise [5]. Cette approche pourrait améliorer l'efficacité tout en réduisant les effets secondaires.
D'ailleurs, les stratégies d'arrêt thérapeutique font l'objet d'investigations approfondies. Les critères de sélection des patients candidats à l'arrêt se précisent, avec l'identification de nouveaux marqueurs prédictifs de rechute [1]. Ces avancées pourraient permettre à davantage de patients de vivre sans traitement tout en conservant leur rémission.
Vivre au Quotidien avec Leucémie myéloïde chronique BCR-ABL positive
Vivre avec une leucémie myéloïde chronique nécessite certains ajustements, mais la plupart des patients maintiennent une qualité de vie satisfaisante. Les traitements actuels permettent généralement de reprendre une activité professionnelle normale après la phase d'adaptation initiale [8].
La prise quotidienne du traitement constitue l'élément central de la gestion de la maladie. Il est crucial de respecter scrupuleusement les horaires et les modalités de prise, car l'efficacité dépend directement de l'observance thérapeutique. Certains médicaments doivent être pris à jeun, d'autres au cours des repas [13].
Les effets secondaires varient selon le traitement utilisé. L'imatinib peut provoquer des crampes musculaires, des œdèmes ou des troubles digestifs. Le nilotinib nécessite une surveillance cardiaque particulière, tandis que le dasatinib peut occasionner des épanchements pleuraux [13]. Heureusement, la plupart de ces effets sont gérables et s'atténuent avec le temps.
Le suivi médical régulier reste indispensable. Des prises de sang mensuelles permettent de surveiller l'efficacité du traitement et de détecter d'éventuels effets secondaires. Le monitoring moléculaire, réalisé tous les 3 à 6 mois, évalue la réponse thérapeutique [10]. Cette surveillance peut sembler contraignante, mais elle garantit une prise en charge optimale.
Les Complications Possibles
Bien que généralement bien contrôlée, la leucémie myéloïde chronique peut parfois évoluer vers des formes plus agressives. La transformation en phase accélérée ou en crise blastique représente la complication la plus redoutée, survenant chez moins de 5% des patients traités précocement [15].
La myélofibrose secondaire constitue une complication rare mais documentée. Cette évolution se caractérise par le développement d'une fibrose dans la moelle osseuse, pouvant compromettre la production normale des cellules sanguines [6]. Le diagnostic repose sur l'analyse histologique de la moelle et nécessite une adaptation thérapeutique.
Les complications liées aux traitements méritent également attention. Certains inhibiteurs de tyrosine kinase peuvent provoquer des troubles cardiovasculaires, notamment des troubles du rythme ou une hypertension artérielle pulmonaire [13]. Une surveillance cardiologique régulière est donc recommandée, particulièrement avec le nilotinib et le dasatinib.
Les thrombopénies immunologiques iatrogènes, bien que rares, ont été rapportées sous imatinib. Cette complication se manifeste par une chute brutale du taux de plaquettes et nécessite parfois l'arrêt temporaire du traitement [11]. Heureusement, elle est généralement réversible à l'arrêt du médicament incriminé.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de la leucémie myéloïde chronique s'est considérablement amélioré depuis l'introduction des inhibiteurs de tyrosine kinase. Aujourd'hui, l'espérance de vie des patients diagnostiqués en phase chronique et traités précocement approche celle de la population générale [15].
Les données récentes montrent une survie globale à 10 ans supérieure à 85% pour les patients traités en première ligne par imatinib [7]. Cette survie atteint même 95% chez les patients qui obtiennent une réponse moléculaire majeure dans les deux premières années de traitement. Ces chiffres remarquables témoignent de l'efficacité des thérapies actuelles.
Plusieurs facteurs influencent le pronostic. L'âge au diagnostic, la phase de la maladie et la réponse précoce au traitement constituent les principaux éléments prédictifs [8]. Les scores pronostiques, comme le score de Sokal ou l'EUTOS, permettent d'évaluer le risque individuel et d'adapter la stratégie thérapeutique.
L'important à retenir : cette pathologie est devenue une maladie chronique avec laquelle on peut vivre normalement. La clé du succès réside dans un diagnostic précoce, un traitement adapté et un suivi régulier [15]. Pour beaucoup de patients, la leucémie myéloïde chronique n'impacte plus significativement leur espérance de vie.
Peut-on Prévenir Leucémie myéloïde chronique BCR-ABL positive ?
Malheureusement, il n'existe actuellement aucun moyen de prévenir la leucémie myéloïde chronique. L'anomalie génétique BCR-ABL survient de façon spontanée et imprévisible dans la grande majorité des cas [14].
La seule mesure préventive établie concerne la limitation de l'exposition aux radiations ionisantes. Cependant, cette recommandation s'applique surtout aux expositions professionnelles ou médicales répétées. Les examens radiologiques diagnostiques, réalisés selon les bonnes pratiques, présentent un risque négligeable [14].
Contrairement à d'autres cancers, les facteurs de mode de vie habituels (alimentation, activité physique, tabac) ne semblent pas influencer le risque de développer cette pathologie. Il n'existe donc pas de recommandations spécifiques de prévention primaire.
En revanche, la prévention secondaire par un diagnostic précoce reste essentielle. Un bilan sanguin annuel après 50 ans peut permettre de détecter une anomalie avant l'apparition des symptômes. Cette détection précoce améliore significativement le pronostic et facilite la prise en charge thérapeutique [16].
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités de santé françaises ont établi des recommandations précises pour la prise en charge de la leucémie myéloïde chronique. La Haute Autorité de Santé (HAS) préconise un diagnostic rapide dès la découverte d'une hyperleucocytose inexpliquée, avec recherche systématique du chromosome de Philadelphie [12].
Concernant le traitement, les recommandations privilégient l'utilisation des inhibiteurs de tyrosine kinase en première intention. L'imatinib reste le traitement de référence, mais le nilotinib et le dasatinib constituent des alternatives validées, particulièrement chez les patients à haut risque [12]. Le choix thérapeutique doit tenir compte du profil du patient et de ses comorbidités.
Le monitoring moléculaire fait l'objet de recommandations spécifiques. La recherche des transcrits BCR-ABL par PCR quantitative doit être réalisée tous les 3 mois pendant les deux premières années, puis tous les 6 mois en cas de réponse stable [10]. Cette surveillance permet d'adapter le traitement et de détecter précocement une éventuelle résistance.
Les recommandations insistent également sur l'importance de la prise en charge multidisciplinaire. L'hématologue reste le référent principal, mais l'intervention d'autres spécialistes (cardiologue, endocrinologue) peut s'avérer nécessaire pour gérer les effets secondaires des traitements [13].
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs associations accompagnent les patients atteints de leucémie myéloïde chronique en France. L'Association Laurette Fugain, bien connue pour son action dans les leucémies, propose des services d'information et de soutien aux patients et à leurs familles. Elle organise régulièrement des conférences et des groupes de parole.
France Lymphome Espoir constitue une autre ressource précieuse, même si elle se concentre principalement sur les lymphomes. Cette association propose des documents d'information de qualité et met en relation les patients avec des spécialistes reconnus. Son site internet regorge d'informations pratiques et actualisées.
Au niveau local, de nombreux centres hospitaliers universitaires proposent des consultations spécialisées et des programmes d'éducation thérapeutique. Ces programmes permettent aux patients de mieux comprendre leur maladie et d'optimiser leur prise en charge. Ils incluent souvent des ateliers sur l'observance thérapeutique et la gestion des effets secondaires.
Les réseaux sociaux et forums en ligne offrent également des espaces d'échange entre patients. Bien qu'il faille rester prudent quant à la qualité des informations partagées, ces plateformes permettent de rompre l'isolement et de partager des expériences concrètes. L'important est de toujours valider les informations avec son équipe médicale.
Nos Conseils Pratiques
Vivre avec une leucémie myéloïde chronique nécessite quelques adaptations pratiques au quotidien. Premier conseil essentiel : organisez-vous pour ne jamais oublier votre traitement. Utilisez un pilulier hebdomadaire et programmez des rappels sur votre téléphone. L'observance thérapeutique maladiene directement l'efficacité du traitement.
Tenez un carnet de suivi détaillé de vos symptômes et effets secondaires. Notez la date d'apparition, l'intensité et la durée de chaque manifestation. Ces informations aideront votre médecin à adapter le traitement si nécessaire. N'hésitez pas à signaler même les symptômes qui vous paraissent mineurs.
Adoptez une hygiène de vie équilibrée sans pour autant vous imposer de contraintes excessives. Une alimentation variée, une activité physique adaptée et un sommeil suffisant contribuent à votre bien-être général. Évitez les régimes restrictifs non validés médicalement, qui pourraient interférer avec votre traitement.
Préparez soigneusement vos consultations médicales. Listez vos questions à l'avance et n'hésitez pas à demander des explications si quelque chose n'est pas clair. Votre médecin est là pour vous accompagner, et une bonne communication améliore la qualité de votre prise en charge. Enfin, gardez toujours sur vous une carte mentionnant votre pathologie et vos traitements en cours.
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes doivent vous amener à consulter rapidement votre hématologue ou votre médecin traitant. Une fièvre persistante supérieure à 38°C, surtout si elle s'accompagne de frissons, peut signaler une infection nécessitant une prise en charge urgente. Les patients sous traitement peuvent présenter une immunité diminuée.
Des saignements anormaux constituent également un motif de consultation en urgence. Cela inclut les saignements de nez répétés, les ecchymoses spontanées ou les saignements des gencives. Ces symptômes peuvent révéler une chute du taux de plaquettes nécessitant une surveillance rapprochée.
L'apparition ou l'aggravation de symptômes digestifs (nausées, vomissements, douleurs abdominales) sous traitement doit être signalée. Ces manifestations peuvent témoigner d'effets secondaires nécessitant un ajustement thérapeutique. De même, tout essoufflement inhabituel ou douleur thoracique mérite une évaluation médicale.
En cas de doute, n'hésitez jamais à contacter votre équipe médicale. La plupart des services d'hématologie disposent d'un numéro d'urgence permettant de joindre un médecin 24h/24. Il vaut mieux consulter pour rien que de passer à côté d'une complication potentiellement grave [13].
Questions Fréquentes
La leucémie myéloïde chronique est-elle héréditaire ?Non, cette pathologie n'est pas héréditaire dans l'immense majorité des cas. L'anomalie génétique BCR-ABL se développe au cours de la vie et n'est pas transmise aux enfants [14].
Peut-on guérir complètement de cette maladie ?
Avec les traitements actuels, beaucoup de patients atteignent une rémission moléculaire profonde. Certains peuvent même arrêter leur traitement sous surveillance médicale stricte. On parle plutôt de contrôle à long terme que de guérison au sens traditionnel [7].
Les traitements ont-ils beaucoup d'effets secondaires ?
Les inhibiteurs de tyrosine kinase sont généralement bien tolérés. Les effets secondaires existent mais sont le plus souvent gérables et s'atténuent avec le temps. Chaque patient réagit différemment [13].
Faut-il suivre un régime alimentaire particulier ?
Aucun régime spécifique n'est nécessaire. Une alimentation équilibrée et variée suffit. Certains médicaments doivent être pris à jeun ou au cours des repas, selon les recommandations médicales.
Peut-on continuer à travailler normalement ?
La plupart des patients peuvent reprendre une activité professionnelle normale après la phase d'adaptation initiale. Seuls les métiers exposant aux radiations ou nécessitant un effort physique intense peuvent poser problème [8].
Questions Fréquentes
La leucémie myéloïde chronique est-elle héréditaire ?
Non, cette pathologie n'est pas héréditaire dans l'immense majorité des cas. L'anomalie génétique BCR-ABL se développe au cours de la vie et n'est pas transmise aux enfants.
Peut-on guérir complètement de cette maladie ?
Avec les traitements actuels, beaucoup de patients atteignent une rémission moléculaire profonde. Certains peuvent même arrêter leur traitement sous surveillance médicale stricte. On parle plutôt de contrôle à long terme que de guérison au sens traditionnel.
Les traitements ont-ils beaucoup d'effets secondaires ?
Les inhibiteurs de tyrosine kinase sont généralement bien tolérés. Les effets secondaires existent mais sont le plus souvent gérables et s'atténuent avec le temps. Chaque patient réagit différemment.
Peut-on continuer à travailler normalement ?
La plupart des patients peuvent reprendre une activité professionnelle normale après la phase d'adaptation initiale. Seuls les métiers exposant aux radiations ou nécessitant un effort physique intense peuvent poser problème.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Actualités 2024 par le Comité de rédaction du Bulletin du Cancer - Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [2] Leucemie Comprendre les bases de la leucemie myeloide chronique - Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [3] Les peptides antimicrobiens dans la lutte contre le cancer - Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [4] Olverembatinib After Failure of Tyrosine Kinase Inhibitors - Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [5] Choice of Frontline Tyrosine-Kinase Inhibitor and Early Response - Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [6] Myélofibrose secondaire à la leucémie myéloïde chronique, à propos d'un cas - 2025Lien
- [7] Traitement par imatinib de la leucémie myéloïde chronique: 20 ans après - Bulletin de l'Académie Nationale de Médecine 2023Lien
- [8] Caractéristiques cliniques, facteurs pronostiques et évolution de la leucémie myéloïde chronique traitée par l'imatinib mésylate au Mali - 2024Lien
- [9] Application de la Biologie moléculaire dans la Leucémie Myéloïde ChroniqueLien
- [10] Monitoring moléculaire par le genexpert de la leucémie myéloïde chronique chez les patients traités par le nilotinib - 2023Lien
- [11] Leucémie myéloide chronique et thrombopénie Immunologique iatrogène sous Imatinib Mesylate - 2023Lien
- [12] Leucémie myéloïde chronique: vingt ans d'analyses ciblées sur l'imatinib - Bulletin de l'Académie Nationale de Médecine 2023Lien
- [13] Effets secondaires des inhibiteurs de tyrosine kinase dans la leucémie myéloïde chronique - 2023Lien
- [14] Leucémie myéloïde chronique (LMC) - Hématologie et Oncologie - MSD ManualsLien
- [15] Pronostic et survie pour la leucémie myéloïde chronique - Société canadienne du cancerLien
- [16] Diagnostic d'une Leucémie Myéloïde Chronique - InfoCancer ARCAGYLien
Publications scientifiques
- Myélofibrose secondaire à la leucémie myéloïde chronique, à propos d'un cas (2025)
- Traitement par imatinib de la leucémie myéloïde chronique: 20 ans après (2023)
- Caractéristiques cliniques, facteurs pronostiques et évolution de la leucémie myéloïde chronique (LMC) traitée par l'imatinib mésylate (GLIVEC®) au Mali (2024)1 citations[PDF]
- [PDF][PDF] Application de la Biologie moléculaire dans la Leucémie Myéloïde Chronique [PDF]
- Monitoring moléculaire par le genexpertde la leucémie myéloïde chronique chez les patients traités par le nilotinib (ta signa®) (2023)[PDF]
Ressources web
- Leucémie myéloïde chronique (LMC) - Hématologie et ... (msdmanuals.com)
La leucémie myéloïde chronique (LMC) apparaît lorsqu'une cellule-souche pluripotente subit une transformation maligne et clonale, entraînant une surproduction ...
- Pronostic et survie pour la leucémie myéloïde chronique (cancer.ca)
La rate risque donc d'enfler et de devenir plus grosse. Si la rate est plus grosse qu'à la normale lors du diagnostic, le pronostic est moins favorable.
- Diagnostic dune Leucémie Myéloïde Chronique - InfoCancer (arcagy.org)
3 avr. 2025 — C'est une augmentation du nombre absolu de globules blancs, habituellement supérieure à 25 000 et parfois au-delà de 100 000. Cette élévation ...
- La leucémie myéloïde chronique (centreleonberard.fr)
Le diagnostic repose sur l'examen clinque (débord de la rate), la prise de sang (notamment la numération) et l'examen au microscope des fractions de globules ...
- Les symptômes et le diagnostic des leucémies aiguës (fondation-arc.org)
10 févr. 2025 — Une leucémie myéloïde chronique est suspectée dès lors que la NFS met en évidence une myélémie, c'est-à-dire la présence de nombreuses cellules ...

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
