Leucémie Myéloïde Chronique : Guide Complet 2025 - Symptômes, Traitements
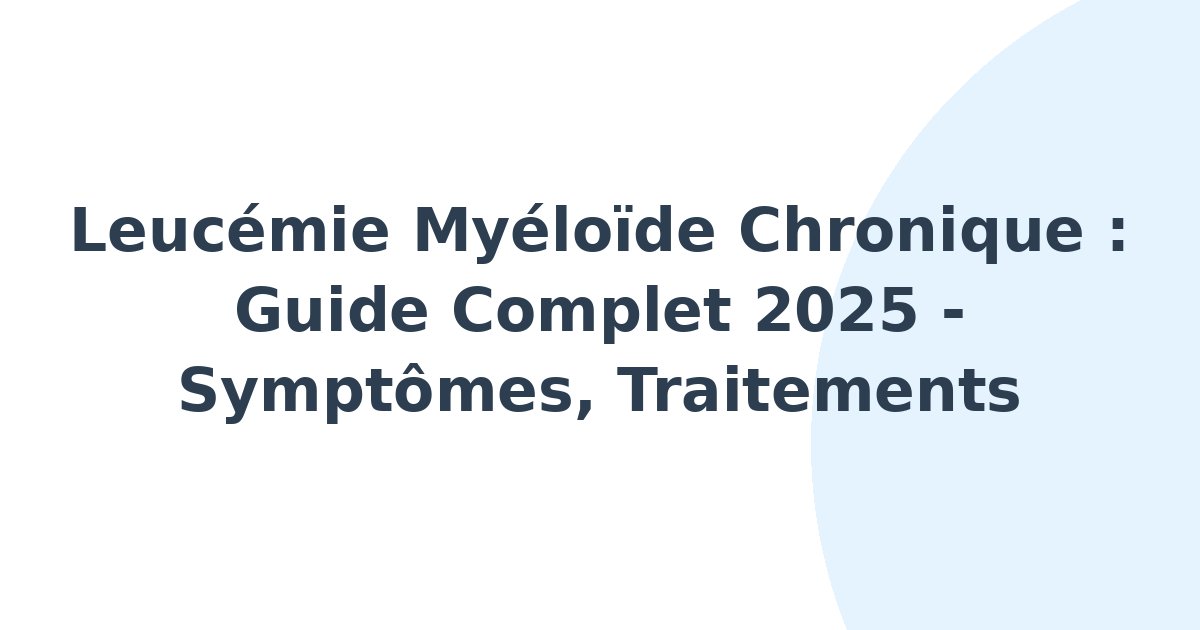
La leucémie myéloïde chronique (LMC) est une pathologie du sang qui touche environ 1 000 nouvelles personnes chaque année en France. Cette maladie, caractérisée par une production excessive de globules blancs anormaux, évolue généralement lentement. Grâce aux avancées thérapeutiques récentes, notamment les inhibiteurs de tyrosine kinase, le pronostic s'est considérablement amélioré ces dernières années.

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Leucémie myéloïde en phase chronique : Définition et Vue d'Ensemble
La leucémie myéloïde chronique est une pathologie maligne du sang qui affecte principalement la moelle osseuse. Cette maladie se caractérise par une anomalie génétique spécifique : le chromosome Philadelphie, présent dans plus de 95% des cas [14,15].
Concrètement, cette anomalie entraîne une production excessive et incontrôlée de globules blancs immatures. Ces cellules anormales envahissent progressivement la circulation sanguine et peuvent s'accumuler dans différents organes, notamment la rate et le foie.
La LMC évolue classiquement en trois phases distinctes. La phase chronique, qui nous intéresse ici, représente environ 85% des cas au moment du diagnostic [13]. Cette phase se caractérise par une évolution lente, souvent sur plusieurs années, avec des symptômes qui peuvent rester discrets pendant longtemps.
Il est important de comprendre que cette pathologie diffère fondamentalement des leucémies aiguës par sa progression plus lente. D'ailleurs, de nombreux patients mènent une vie quasi normale pendant des années avec un traitement adapté. L'important à retenir, c'est que le diagnostic précoce et la prise en charge appropriée permettent aujourd'hui d'obtenir d'excellents résultats thérapeutiques.
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, la leucémie myéloïde chronique touche environ 1 000 nouvelles personnes chaque année, avec une incidence stable de 1,5 cas pour 100 000 habitants [9,13]. Cette pathologie représente 15% de toutes les leucémies chez l'adulte.
L'âge médian au diagnostic se situe autour de 60 ans, mais la maladie peut survenir à tout âge. On observe une légère prédominance masculine avec un ratio homme/femme de 1,3:1 [14,15]. Fait intéressant, l'incidence augmente progressivement avec l'âge, particulièrement après 50 ans.
Au niveau européen, la France se situe dans la moyenne avec des taux similaires à ceux observés en Allemagne et au Royaume-Uni. Cependant, des variations géographiques existent : certaines régions françaises, notamment le Sud-Est, présentent des taux légèrement supérieurs, sans explication claire à ce jour [9].
Bon à savoir : la prévalence de la LMC a considérablement augmenté ces vingt dernières années. En effet, grâce aux progrès thérapeutiques, notamment l'arrivée de l'imatinib en 2001, la survie des patients s'est spectaculairement améliorée [13]. Aujourd'hui, on estime qu'environ 8 000 personnes vivent avec cette pathologie en France.
Les projections pour 2025-2030 suggèrent une stabilisation de l'incidence, mais une augmentation continue de la prévalence due à l'amélioration du pronostic. L'impact économique sur le système de santé français est estimé à environ 150 millions d'euros annuels, principalement liés aux coûts des traitements ciblés.
Les Causes et Facteurs de Risque
La cause exacte de la leucémie myéloïde chronique reste largement inconnue dans la majorité des cas. Contrairement à d'autres cancers, il n'existe pas de facteurs de risque clairement identifiés pour cette pathologie [14,15].
L'exposition aux radiations ionisantes constitue le seul facteur de risque formellement établi. Les survivants des bombardements atomiques d'Hiroshima et Nagasaki ont présenté une incidence accrue de LMC. De même, les patients ayant reçu une radiothérapie pour d'autres cancers montrent un risque légèrement augmenté [14].
Certains facteurs environnementaux sont suspectés mais non prouvés. L'exposition professionnelle au benzène, bien qu'associée à d'autres leucémies, ne semble pas jouer de rôle significatif dans la LMC. Il en va de même pour le tabagisme ou l'exposition à certains pesticides.
Il est rassurant de savoir que la LMC n'est pas héréditaire. Bien que de rares cas familiaux aient été rapportés, ils restent exceptionnels et ne justifient pas de dépistage familial systématique [15]. La maladie résulte d'une mutation acquise, non transmissible à la descendance.
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes de la leucémie myéloïde chronique en phase chronique sont souvent discrets et non spécifiques. D'ailleurs, environ 40% des patients sont asymptomatiques au moment du diagnostic, la maladie étant découverte fortuitement lors d'un bilan sanguin de routine [14,15].
Lorsque des symptômes apparaissent, ils résultent principalement de l'augmentation du nombre de globules blancs et de l'hypertrophie de la rate. La fatigue constitue le symptôme le plus fréquent, touchant environ 70% des patients. Cette asthénie peut être progressive et parfois attribuée à tort au stress ou au surmenage.
Les douleurs abdominales, particulièrement dans la région sous-costale gauche, signalent souvent une augmentation du volume de la rate (splénomégalie). Cette sensation de pesanteur ou d'inconfort peut s'accompagner d'une satiété précoce lors des repas.
D'autres symptômes peuvent inclure une perte de poids inexpliquée, des sueurs nocturnes, ou encore une sensation de plénitude abdominale. Certains patients rapportent également des saignements inhabituels, comme des ecchymoses spontanées ou des saignements de nez répétés [15].
Il est important de noter que ces symptômes ne sont pas spécifiques à la LMC. Néanmoins, leur persistance, surtout chez un adulte de plus de 50 ans, justifie une consultation médicale et la réalisation d'un bilan sanguin.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic de leucémie myéloïde chronique repose sur une démarche méthodique combinant examens biologiques et analyses génétiques. La première étape consiste en une numération formule sanguine (NFS) qui révèle une hyperleucocytose, souvent supérieure à 50 000 globules blancs par microlitre [14,15].
L'examen du frottis sanguin montre une augmentation de tous les stades de maturation des polynucléaires neutrophiles, avec présence de myélocytes et de métamyélocytes. Cette image caractéristique oriente fortement vers le diagnostic de LMC.
La confirmation diagnostique nécessite la mise en évidence du chromosome Philadelphie. Cette anomalie génétique, présente dans plus de 95% des cas, résulte d'une translocation entre les chromosomes 9 et 22. L'analyse cytogénétique par caryotype ou la recherche du transcrit BCR-ABL par biologie moléculaire permettent cette confirmation [13,14].
Un myélogramme (ponction de moelle osseuse) complète généralement le bilan. Cet examen, bien que parfois redouté par les patients, reste indispensable pour évaluer l'infiltration médullaire et éliminer d'autres pathologies hématologiques.
Le bilan d'extension comprend également une échographie abdominale pour mesurer la taille de la rate et du foie. Des examens complémentaires, comme un scanner thoraco-abdomino-pelvien, peuvent être réalisés selon le contexte clinique.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement de la leucémie myéloïde chronique a été révolutionné par l'arrivée des inhibiteurs de tyrosine kinase (ITK). L'imatinib (Glivec®), commercialisé depuis 2001, reste le traitement de première ligne pour la plupart des patients [13,4].
Ce médicament cible spécifiquement la protéine BCR-ABL responsable de la maladie. Administré par voie orale à la dose de 400 mg par jour, l'imatinib permet d'obtenir une rémission complète chez plus de 85% des patients en phase chronique [13]. Les effets secondaires, généralement modérés, incluent nausées, crampes musculaires et rétention hydrique.
En cas de résistance ou d'intolérance à l'imatinib, des ITK de deuxième génération sont disponibles. Le dasatinib (Sprycel®) et le nilotinib (Tasigna®) offrent des alternatives efficaces avec des profils de tolérance différents [12]. Le bosutinib (Bosulif®) constitue une troisième option, particulièrement utile après échec des autres ITK [6].
Pour les formes les plus résistantes, le ponatinib (Iclusig®) représente un traitement de dernier recours. Cependant, ce médicament nécessite une surveillance cardiovasculaire renforcée en raison de ses effets secondaires potentiels [7,3].
L'objectif thérapeutique principal est l'obtention d'une réponse moléculaire majeure, définie par une réduction d'au moins 3 log du transcrit BCR-ABL. Cette réponse, généralement obtenue dans les 12 à 18 mois, s'accompagne d'un excellent pronostic à long terme.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024-2025 marque une période d'innovations importantes dans le traitement de la leucémie myéloïde chronique. Les recherches actuelles se concentrent sur l'optimisation des traitements existants et le développement de nouvelles approches thérapeutiques [1,2].
Une avancée majeure concerne la possibilité de réduction de dose de l'imatinib chez les patients ayant obtenu une réponse moléculaire majeure stable. Des études récentes montrent qu'une diminution de 50% de la dose peut être envisagée sans compromettre l'efficacité, tout en réduisant les effets secondaires [4].
Le développement de biomédicaments représente une autre innovation prometteuse. Des laboratoires français travaillent actuellement sur la production de nouvelles molécules ciblées, avec des essais cliniques prévus dès 2025 [2]. Ces traitements pourraient offrir une meilleure tolérance et une efficacité accrue.
L'optimisation du bosutinib fait également l'objet de recommandations actualisées du groupe Fi-LMC (France Intergroupe des leucémies myéloïdes chroniques). Ces nouvelles directives visent à améliorer la prise en charge des patients résistants aux traitements de première ligne [6].
Parallèlement, la recherche explore de nouvelles stratégies thérapeutiques, notamment l'immunothérapie et les thérapies combinées. L'objectif à terme est de permettre l'arrêt définitif du traitement chez un plus grand nombre de patients, un concept appelé "treatment-free remission" qui suscite beaucoup d'espoir.
Vivre au Quotidien avec Leucémie myéloïde en phase chronique
Vivre avec une leucémie myéloïde chronique nécessite certains ajustements, mais la plupart des patients maintiennent une qualité de vie satisfaisante. L'observance thérapeutique constitue l'élément clé du succès du traitement. Il est essentiel de prendre son médicament quotidiennement, de préférence à heure fixe et avec un repas pour limiter les troubles digestifs.
La gestion des effets secondaires fait partie intégrante du quotidien. Les crampes musculaires, fréquentes avec l'imatinib, peuvent être soulagées par des étirements réguliers et une supplémentation en magnésium. La rétention hydrique se manifeste parfois par un gonflement des paupières ou des chevilles, nécessitant une surveillance du poids [12].
L'activité physique reste non seulement possible mais recommandée. Une pratique sportive adaptée aide à maintenir la forme physique et à lutter contre la fatigue. Cependant, il convient d'éviter les sports de contact en cas de thrombopénie (diminution des plaquettes).
Sur le plan professionnel, la majorité des patients peuvent continuer à travailler normalement. Certains aménagements peuvent être nécessaires, notamment pour les postes physiquement exigeants ou exposant à des risques infectieux. Le médecin du travail peut accompagner ces adaptations.
Les relations sociales et familiales jouent un rôle crucial dans l'adaptation à la maladie. Il est important de maintenir ses activités habituelles et de ne pas s'isoler. Le soutien psychologique, parfois nécessaire, peut être apporté par des professionnels spécialisés en psycho-oncologie.
Les Complications Possibles
Bien que la leucémie myéloïde chronique en phase chronique évolue généralement favorablement sous traitement, certaines complications peuvent survenir. La plus redoutée reste la transformation en phase accélérée ou blastique, qui concerne heureusement moins de 5% des patients traités par ITK [14,15].
Cette transformation se manifeste par une augmentation rapide des blastes (cellules immatures) dans le sang ou la moelle osseuse, accompagnée d'une détérioration de l'état général. Les signes d'alerte incluent une fatigue intense, de la fièvre, des saignements ou une augmentation rapide du volume de la rate [8].
Les complications liées aux traitements méritent également attention. L'imatinib peut occasionnellement provoquer des troubles hépatiques, nécessitant une surveillance biologique régulière. Des cas rares de toxicité cardiaque ont été rapportés, particulièrement avec le dasatinib [12].
Le ponatinib, réservé aux formes résistantes, présente un risque cardiovasculaire spécifique nécessitant une surveillance renforcée. Des recommandations précises du groupe Fi-LMC encadrent son utilisation pour minimiser ces risques [7].
Certains patients peuvent développer une myélofibrose secondaire, complication rare mais sérieuse caractérisée par une fibrose de la moelle osseuse. Cette évolution, bien que peu fréquente, peut nécessiter une adaptation thérapeutique [8].
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de la leucémie myéloïde chronique s'est spectaculairement amélioré depuis l'introduction des inhibiteurs de tyrosine kinase. Aujourd'hui, l'espérance de vie des patients diagnostiqués en phase chronique et traités précocement approche celle de la population générale [13].
Les données françaises montrent une survie globale à 10 ans supérieure à 85% pour les patients traités par imatinib en première ligne. Cette amélioration remarquable contraste avec les 3-5 ans d'espérance de vie observés avant l'ère des thérapies ciblées [13].
Plusieurs facteurs influencent le pronostic. L'âge au diagnostic, le taux initial de globules blancs, et la taille de la rate constituent les principaux éléments pronostiques. Le score de Sokal, calculé à partir de ces paramètres, permet de stratifier les patients en groupes de risque faible, intermédiaire ou élevé [14,15].
La réponse au traitement représente le facteur pronostique le plus important. L'obtention d'une réponse moléculaire majeure dans les 18 premiers mois s'accompagne d'un excellent pronostic à long terme. À l'inverse, l'absence de réponse cytogénétique à 12 mois nécessite un changement thérapeutique [13].
Une perspective particulièrement encourageante concerne la possibilité d'arrêt thérapeutique chez certains patients. Environ 10-15% des patients ayant maintenu une réponse moléculaire profonde pendant au moins 2 ans peuvent envisager un arrêt de traitement sous surveillance étroite.
Peut-on Prévenir Leucémie myéloïde en phase chronique ?
Malheureusement, il n'existe actuellement aucun moyen de prévenir la leucémie myéloïde chronique. Cette pathologie résulte d'une mutation génétique acquise, survenant de manière imprévisible au cours de la vie [14,15].
Contrairement à d'autres cancers, les facteurs de risque modifiables sont quasi inexistants pour la LMC. L'exposition aux radiations ionisantes constitue le seul facteur de risque clairement établi, mais il concerne principalement les expositions médicales ou professionnelles spécifiques.
Les mesures de prévention générale du cancer (alimentation équilibrée, activité physique, arrêt du tabac) restent recommandées pour la santé globale, mais leur impact spécifique sur le risque de LMC n'est pas démontré.
En l'absence de prévention primaire possible, l'accent doit être mis sur le diagnostic précoce. Une consultation médicale s'impose devant des symptômes persistants comme une fatigue inexpliquée, des douleurs abdominales gauches, ou des anomalies lors d'un bilan sanguin de routine.
Il est important de rassurer les familles : la LMC n'étant pas héréditaire, aucun dépistage familial n'est nécessaire. Les proches ne présentent pas de risque accru de développer cette pathologie.
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises ont établi des recommandations précises pour la prise en charge de la leucémie myéloïde chronique. La Haute Autorité de Santé (HAS) a validé l'utilisation des inhibiteurs de tyrosine kinase comme traitement de référence, avec l'imatinib en première ligne [13].
Le groupe Fi-LMC (France Intergroupe des leucémies myéloïdes chroniques) publie régulièrement des recommandations actualisées. Leurs dernières directives de 2024 concernent l'optimisation du bosutinib et la gestion des résistances thérapeutiques [6]. Ces recommandations guident les hématologues dans leurs décisions thérapeutiques.
Concernant la surveillance cardiovasculaire, des recommandations spécifiques ont été établies pour le ponatinib. Le groupe Fi-LMC préconise un bilan cardiologique avant traitement, puis une surveillance régulière incluant ECG, échocardiographie et bilan lipidique [7].
L'Institut National du Cancer (INCa) recommande une prise en charge multidisciplinaire incluant hématologue, médecin traitant, et si nécessaire, psycho-oncologue. Cette approche globale vise à optimiser non seulement l'efficacité thérapeutique mais aussi la qualité de vie des patients.
Les recommandations insistent également sur l'importance de l'éducation thérapeutique. Les patients doivent comprendre leur maladie, connaître les signes d'alerte, et être formés à la gestion des effets secondaires de leur traitement.
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs associations de patients accompagnent les personnes atteintes de leucémie myéloïde chronique en France. L'Association Laurette Fugain, bien connue pour son action dans les leucémies, propose information, soutien et financement de la recherche.
L'association Leucémie Espoir offre un accompagnement spécialisé avec des groupes de parole, des forums en ligne, et des documents d'information adaptés. Leur site internet constitue une ressource précieuse pour les patients et leurs familles.
La Ligue contre le Cancer dispose de comités départementaux proposant aide sociale, soutien psychologique et information médicale. Leurs bénévoles, souvent d'anciens patients, apportent un témoignage précieux sur le vécu de la maladie.
Au niveau européen, l'European LeukemiaNet publie des recommandations internationales et finance des projets de recherche. Cette organisation facilite les échanges entre centres experts européens.
Les centres hospitaliers universitaires disposent généralement d'équipes dédiées incluant infirmières spécialisées, assistantes sociales et psychologues. Ces professionnels constituent le premier niveau de soutien pour les patients et leurs proches.
Enfin, les réseaux sociaux hébergent des groupes d'entraide entre patients. Ces communautés virtuelles permettent de partager expériences et conseils pratiques, tout en maintenant l'anonymat si souhaité.
Nos Conseils Pratiques
Vivre avec une leucémie myéloïde chronique nécessite quelques adaptations pratiques au quotidien. Voici nos recommandations pour optimiser votre prise en charge et votre qualité de vie.
Concernant la prise médicamenteuse, établissez une routine quotidienne. Prenez votre traitement à heure fixe, de préférence avec un repas pour limiter les troubles digestifs. Utilisez un pilulier hebdomadaire pour éviter les oublis. En cas de vomissement dans l'heure suivant la prise, contactez votre équipe médicale.
Pour gérer les effets secondaires, quelques astuces simples s'avèrent efficaces. Contre les crampes musculaires, pratiquez des étirements réguliers et maintenez une bonne hydratation. En cas de rétention d'eau, surveillez votre poids quotidiennement et limitez le sel. Les nausées peuvent être atténuées en fractionnant les repas.
Maintenez une activité physique adaptée. La marche, la natation ou le vélo sont particulièrement bénéfiques. Évitez les sports de contact si vos plaquettes sont basses. L'exercice aide à lutter contre la fatigue et maintient le moral.
Côté alimentation, privilégiez une alimentation équilibrée riche en fruits et légumes. Évitez les aliments crus en cas de neutropénie. Limitez les interactions médicamenteuses en évitant le pamplemousse qui peut modifier l'absorption de certains ITK.
Enfin, n'hésitez pas à communiquer avec votre équipe soignante. Signalez tout symptôme inhabituel, même s'il vous paraît bénin. Votre hématologue est votre meilleur allié dans cette bataille contre la maladie.
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes d'alerte nécessitent une consultation médicale urgente chez les patients atteints de leucémie myéloïde chronique. Il est crucial de savoir les reconnaître pour réagir rapidement.
Consultez immédiatement en cas de fièvre persistante supérieure à 38°C, surtout si elle s'accompagne de frissons. Cette situation peut signaler une infection grave, particulièrement préoccupante en cas de neutropénie (baisse des globules blancs).
Les saignements anormaux constituent un autre motif de consultation urgente. Saignements de nez répétés, ecchymoses spontanées étendues, ou saignements gingivaux importants peuvent révéler une chute des plaquettes nécessitant une prise en charge immédiate.
Une fatigue brutale et intense, différente de la fatigue habituelle, doit alerter. De même, l'apparition de douleurs abdominales intenses, particulièrement dans la région sous-costale gauche, peut signaler une complication au niveau de la rate.
Certains symptômes nécessitent une consultation programmée mais rapide. L'aggravation progressive de la fatigue, l'apparition de sueurs nocturnes profuses, ou une perte de poids inexpliquée peuvent indiquer une évolution de la maladie.
N'oubliez pas vos rendez-vous de surveillance réguliers. Ces consultations permettent de détecter précocement toute évolution et d'adapter le traitement si nécessaire. La surveillance biologique régulière reste la clé d'une prise en charge optimale.
Questions Fréquentes
La leucémie myéloïde chronique est-elle héréditaire ?Non, la LMC n'est pas une maladie héréditaire. Elle résulte d'une mutation génétique acquise au cours de la vie. Vos enfants ne présentent pas de risque accru de développer cette pathologie [14,15].
Puis-je continuer à travailler avec une LMC ?
Dans la majorité des cas, oui. La plupart des patients maintiennent leur activité professionnelle normale. Certains aménagements peuvent être nécessaires selon votre métier et votre état de santé.
Les traitements de la LMC provoquent-ils une chute des cheveux ?
Non, les inhibiteurs de tyrosine kinase ne causent généralement pas d'alopécie, contrairement à la chimiothérapie traditionnelle. Certains patients rapportent un éclaircissement capillaire, mais rarement une chute importante.
Peut-on guérir définitivement de la LMC ?
Le concept de guérison évolue. Certains patients peuvent arrêter leur traitement tout en maintenant une rémission, mais cela concerne encore une minorité. La recherche progresse dans ce domaine.
Combien coûte le traitement de la LMC ?
Les inhibiteurs de tyrosine kinase sont des médicaments coûteux (plusieurs milliers d'euros par mois), mais ils sont intégralement pris en charge par l'Assurance Maladie dans le cadre de l'ALD (Affection Longue Durée).
La LMC peut-elle récidiver après traitement ?
Sous traitement continu, la maladie reste généralement contrôlée. L'arrêt thérapeutique peut parfois entraîner une récidive, d'où l'importance d'une surveillance étroite.
Questions Fréquentes
La leucémie myéloïde chronique est-elle héréditaire ?
Non, la LMC n'est pas une maladie héréditaire. Elle résulte d'une mutation génétique acquise au cours de la vie.
Puis-je continuer à travailler avec une LMC ?
Dans la majorité des cas, oui. La plupart des patients maintiennent leur activité professionnelle normale.
Les traitements provoquent-ils une chute des cheveux ?
Non, les inhibiteurs de tyrosine kinase ne causent généralement pas d'alopécie.
Peut-on guérir définitivement de la LMC ?
Certains patients peuvent arrêter leur traitement en maintenant une rémission, mais cela concerne encore une minorité.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Comprendre la leucémie myéloïde aiguë. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [2] Un biomédicament contre la leucémie sera produit par l'EFS de BesançonLien
- [3] Ponatinib : un traitement ciblé pour les formes résistantes de LMCLien
- [4] Imatinib dose reduction after major molecular response in CMLLien
- [6] Optimisation du bosutinib dans la leucémie myéloïde chronique: recommandations du Fi-LMCLien
- [7] Recommandations 2022 du groupe Fi-LMC pour la gestion du risque cardiovasculaire sous ponatinibLien
- [8] Myélofibrose secondaire à la leucémie myéloïde chronique, à propos d'un casLien
- [9] Caractéristiques cliniques et évolution de la LMC traitée par imatinib au MaliLien
- [12] Prévalence des Effets Indésirables des ITK dans le traitement de la LMCLien
- [13] Traitement par imatinib de la leucémie myéloïde chronique: 20 ans aprèsLien
- [14] Leucémie myéloïde chronique (LMC) - MSD Manuals ProfessionalLien
- [15] Leucémie myéloïde chronique (LMC) - MSD Manuals PatientLien
Publications scientifiques
- [HTML][HTML] Optimisation du bosutinib dans la leucémie myéloïde chronique: recommandations du Fi-LMC (France Intergroupe des leucémies myéloïdes chroniques) (2024)
- Recommandations 2022 du groupe Fi-LMC pour la gestion du risque d'événements cardiovasculaires sous ponatinib dans la leucémie myéloïde chronique (2022)2 citations
- Myélofibrose secondaire à la leucémie myéloïde chronique, à propos d'un cas (2025)
- Caractéristiques cliniques, facteurs pronostiques et évolution de la leucémie myéloïde chronique (LMC) traitée par l'imatinib mésylate (GLIVEC®) au Mali (2024)1 citations[PDF]
- Epigénétique, vieillissement cellulaire et hétérogénéité intra-clonale: le modèle de la Leucémie Myéloïde Chronique (2023)
Ressources web
- Leucémie myéloïde chronique (LMC) - Hématologie et ... (msdmanuals.com)
Phase accélérée: échec du traitement, aggravation de l'anémie, thrombopénie ou thrombocytose progressives ou aggravation persistante de la splénomégalie, ...
- Leucémie myéloïde chronique (LMC) - Troubles du sang (msdmanuals.com)
Phase chronique : une période initiale pouvant durer 5 à 6 ans, pendant laquelle la maladie évolue très lentement. Phase accélérée : la maladie commence à ...
- La leucémie myéloïde chronique (centreleonberard.fr)
Le diagnostic repose sur l'examen clinque (débord de la rate), la prise de sang (notamment la numération) et l'examen au microscope des fractions de globules ...
- Les symptômes et le diagnostic des leucémies aiguës (fondation-arc.org)
10 févr. 2025 — Une leucémie myéloïde chronique est suspectée dès lors que la NFS met en évidence une myélémie, c'est-à-dire la présence de nombreuses cellules ...
- Diagnostic dune Leucémie Myéloïde Chronique - InfoCancer (arcagy.org)
3 avr. 2025 — Augmentation des globules blancs, supérieure à 25 000 et parfois au-delà de 100 000. myélémie, examen de la moelle osseuse, mise en évidence ...

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
