Leucémie-lymphome lymphoblastique à précurseurs T : Guide Complet 2025
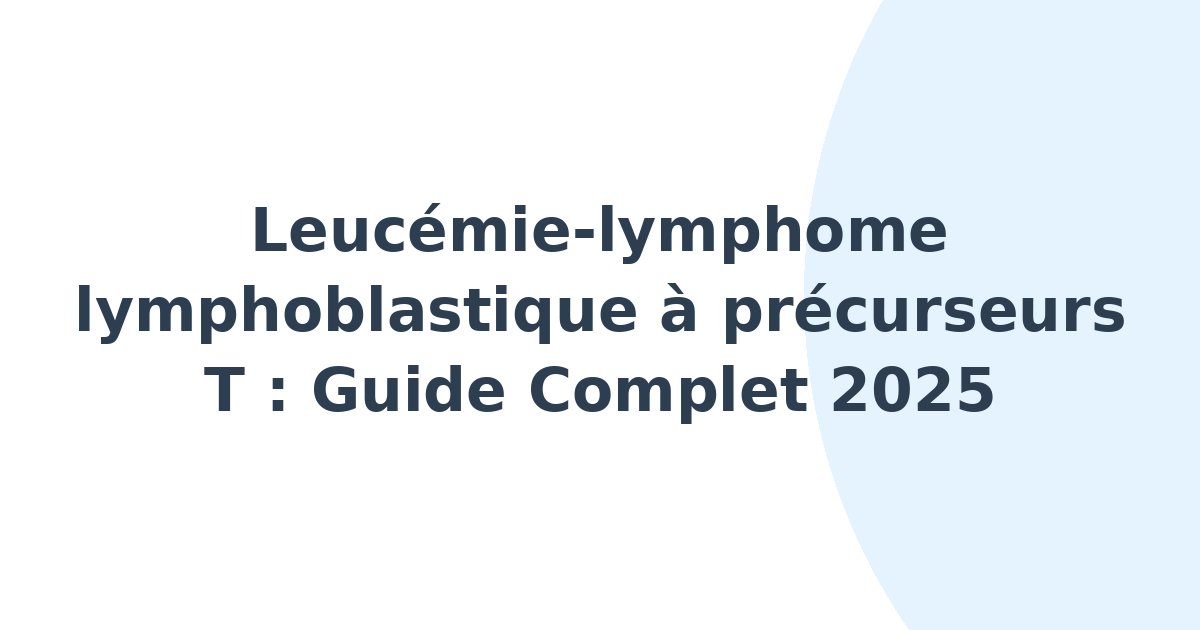
La leucémie-lymphome lymphoblastique à précurseurs T représente une pathologie hématologique rare mais complexe qui touche principalement les adolescents et jeunes adultes. Cette maladie du sang se caractérise par une prolifération anormale de cellules lymphoïdes immatures dans la moelle osseuse et les organes lymphoïdes. Bien que son nom puisse paraître intimidant, les avancées thérapeutiques récentes offrent aujourd'hui de réelles perspectives d'amélioration pour les patients.
Téléconsultation et Leucémie-lymphome lymphoblastique à précurseurs T
Téléconsultation non recommandéeLa leucémie-lymphome lymphoblastique à précurseurs T est une hémopathie maligne nécessitant un diagnostic histologique et cytogénétique complexe, ainsi qu'une prise en charge spécialisée urgente. Cette pathologie requiert des examens complémentaires approfondis (biopsie, myélogramme, immunophénotypage) et une évaluation clinique complète impossible à réaliser à distance.
Ce qui peut être évalué à distance
Description détaillée des symptômes généraux (fatigue, fièvre, sueurs nocturnes, perte de poids). Évaluation de l'évolution symptomatique et de la tolérance aux traitements en cours. Discussion des résultats d'examens déjà réalisés. Suivi de l'état général entre les consultations spécialisées. Coordination avec l'équipe d'hématologie pour le suivi thérapeutique.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examen physique complet pour recherche d'adénopathies, hépato-splénomégalie et signes de compression médiastinale. Réalisation du myélogramme, de la biopsie ganglionnaire ou médullaire. Immunophénotypage et analyses cytogénétiques indispensables au diagnostic. Évaluation du syndrome de lyse tumorale et des complications infectieuses.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Suspicion initiale de leucémie-lymphome nécessitant un diagnostic histologique urgent. Évaluation des masses médiastinales et du risque de compression des voies aériennes. Surveillance des complications du traitement (syndrome de lyse tumorale, neutropénie fébrile). Adaptation thérapeutique nécessitant un examen clinique complet et des prélèvements spécialisés.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Signes de compression médiastinale avec dyspnée ou stridor. Syndrome de lyse tumorale avec troubles électrolytiques sévères. Neutropénie fébrile ou suspicion d'infection grave chez un patient immunodéprimé.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Difficultés respiratoires, essoufflement au repos ou stridor évoquant une compression médiastinale
- Fièvre élevée chez un patient en cours de chimiothérapie (neutropénie fébrile)
- Troubles neurologiques (convulsions, confusion, céphalées intenses) évoquant une atteinte méningée
- Douleurs abdominales intenses avec vomissements pouvant signaler un syndrome de lyse tumorale
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Hématologue — consultation en présentiel indispensable
L'hématologue est indispensable pour le diagnostic, la stadification et la prise en charge thérapeutique de cette hémopathie maligne complexe. Une consultation en présentiel est obligatoire pour l'examen clinique spécialisé et la coordination des examens diagnostiques urgents.
Leucémie-lymphome lymphoblastique à précurseurs T : Définition et Vue d'Ensemble
La leucémie-lymphome lymphoblastique à précurseurs T constitue une pathologie maligne du système hématopoïétique qui se développe à partir de cellules lymphoïdes T immatures. Cette maladie présente la particularité de pouvoir se manifester sous deux formes principales : une forme leucémique avec atteinte médullaire prédominante, ou une forme lymphomateuse avec masses tumorales extramedullaires [11].
Concrètement, cette pathologie résulte d'une transformation maligne des lymphoblastes T, ces cellules précurseurs des lymphocytes T qui jouent un rôle crucial dans notre système immunitaire. Lorsque ces cellules deviennent cancéreuses, elles perdent leur capacité de maturation normale et prolifèrent de manière incontrôlée [12].
Il faut savoir que cette maladie représente environ 15% de toutes les leucémies aiguës lymphoblastiques chez l'adulte, mais sa fréquence varie considérablement selon l'âge. D'ailleurs, elle touche préférentiellement les adolescents et jeunes adultes de sexe masculin, avec un pic d'incidence entre 15 et 35 ans [13].
La classification actuelle de l'Organisation Mondiale de la Santé distingue cette pathologie des autres leucémies lymphoblastiques par ses caractéristiques immunophénotypiques spécifiques. Les cellules malignes expriment des marqueurs caractéristiques des précurseurs T comme CD1a, CD3, CD4, CD8 et TdT, permettant un diagnostic précis [4].
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, la leucémie-lymphome lymphoblastique à précurseurs T représente une pathologie rare avec une incidence estimée à 0,8 cas pour 100 000 habitants par an selon les données du registre national des hémopathies malignes [10]. Cette incidence reste relativement stable depuis une décennie, contrairement à d'autres hémopathies qui montrent une tendance à l'augmentation.
Les données épidémiologiques françaises révèlent une prédominance masculine marquée avec un ratio homme/femme de 3:1, particulièrement prononcé chez les patients de moins de 30 ans [5]. L'âge médian au diagnostic se situe autour de 28 ans, mais on observe deux pics d'incidence : un premier chez les adolescents de 15-19 ans et un second chez les adultes de 25-35 ans.
Au niveau européen, la France présente des taux d'incidence comparables à ceux observés en Allemagne et au Royaume-Uni, mais légèrement inférieurs aux pays nordiques où l'incidence atteint 1,2 cas pour 100 000 habitants [10]. Cette variation géographique pourrait s'expliquer par des facteurs génétiques ou environnementaux encore mal élucidés.
Concernant l'évolution temporelle, les registres français montrent une amélioration significative du pronostic au cours des 15 dernières années. Le taux de survie à 5 ans est passé de 45% en 2005 à 68% en 2020 chez les patients de moins de 60 ans, grâce notamment aux protocoles thérapeutiques intensifiés [8].
L'impact économique de cette pathologie sur le système de santé français est estimé à environ 15 000 euros par patient la première année, incluant les coûts de diagnostic, d'hospitalisation et de traitement initial. Ce coût tend à diminuer les années suivantes pour les patients en rémission complète [5].
Les Causes et Facteurs de Risque
Les causes exactes de la leucémie-lymphome lymphoblastique à précurseurs T demeurent largement méconnues, mais plusieurs facteurs de risque ont été identifiés par la recherche récente. Contrairement à d'autres leucémies, cette pathologie ne semble pas directement liée à des expositions environnementales spécifiques [9].
Les facteurs génétiques jouent un rôle prépondérant dans le développement de cette maladie. Des anomalies chromosomiques récurrentes ont été identifiées, notamment les translocations impliquant les gènes TAL1, LMO1, LMO2 et HOXA. Ces altérations génétiques perturbent la différenciation normale des lymphocytes T et favorisent leur transformation maligne [7].
Certaines pathologies héréditaires prédisposent également au développement de cette leucémie. L'ataxietélangiectasie, le syndrome de Li-Fraumeni et les déficits immunitaires primitifs constituent des facteurs de risque reconnus, bien que rares [9]. D'ailleurs, les patients porteurs de ces syndromes nécessitent une surveillance hématologique régulière.
L'exposition aux radiations ionisantes, qu'elles soient médicales ou environnementales, augmente modérément le risque de développer cette pathologie. Cependant, ce facteur de risque reste quantitativement limité comparé aux leucémies myéloïdes [7].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes de la leucémie-lymphome lymphoblastique à précurseurs T peuvent être trompeurs car ils ressemblent souvent à ceux d'infections banales. Cependant, leur persistance et leur association doivent alerter [12].
Les signes les plus fréquents incluent une fatigue intense et inexpliquée, présente chez plus de 85% des patients au diagnostic. Cette asthénie s'accompagne souvent d'un essoufflement à l'effort, même modéré, et d'une pâleur cutanéo-muqueuse liée à l'anémie [13].
La fièvre constitue un autre symptôme cardinal, présente chez environ 70% des patients. Elle peut être isolée ou accompagner des infections récurrentes dues à la diminution des défenses immunitaires. Attention, cette fièvre résiste souvent aux traitements antibiotiques classiques [12].
Les manifestations hémorragiques représentent un signe d'alarme important. Elles se traduisent par des ecchymoses spontanées, des saignements de nez répétés, ou des saignements gingivaux lors du brossage des dents. Ces symptômes résultent de la thrombopénie associée à la maladie [13].
Spécifiquement pour cette forme de leucémie, on observe fréquemment des adénopathies (ganglions augmentés de volume) et une masse médiastinale antérieure chez 50 à 70% des patients. Cette masse peut provoquer une toux sèche, une gêne respiratoire ou une sensation d'oppression thoracique [11].
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic de la leucémie-lymphome lymphoblastique à précurseurs T nécessite une approche méthodique combinant plusieurs examens complémentaires. La première étape consiste en un interrogatoire minutieux et un examen clinique complet recherchant les signes évocateurs [13].
L'hémogramme constitue l'examen de première intention qui révèle généralement une leucocytose avec présence de blastes circulants, une anémie et une thrombopénie. Cependant, dans 10 à 15% des cas, l'hémogramme peut être initialement normal, rendant le diagnostic plus difficile [11].
Le myélogramme reste l'examen de référence pour confirmer le diagnostic. Il met en évidence une infiltration médullaire par plus de 25% de blastes lymphoïdes. Ces cellules présentent des caractéristiques morphologiques spécifiques : taille moyenne, noyau à chromatine fine et cytoplasme basophile peu abondant [12].
L'immunophénotypage par cytométrie en flux permet de caractériser précisément les blastes et de confirmer leur origine T. Les marqueurs recherchés incluent CD1a, CD3 cytoplasmique, CD4, CD8, CD34 et TdT. Cette analyse est cruciale pour différencier cette pathologie des autres leucémies lymphoblastiques [4].
Les examens d'imagerie, notamment le scanner thoraco-abdomino-pelvien, recherchent des localisations extramedullaires et évaluent l'extension de la maladie. La présence d'une masse médiastinale antérieure est retrouvée chez deux tiers des patients [11].
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement de la leucémie-lymphome lymphoblastique à précurseurs T repose sur une chimiothérapie intensive adaptée à l'âge du patient et aux facteurs pronostiques. Les protocoles actuels s'inspirent largement des schémas pédiatriques qui ont démontré leur efficacité [6].
La phase d'induction vise à obtenir une rémission complète en 4 à 6 semaines. Elle associe généralement vincristine, daunorubicine, L-asparaginase et corticoïdes. Cette phase permet d'obtenir une rémission complète chez 85 à 90% des patients de moins de 60 ans [8].
La consolidation comprend plusieurs cycles de chimiothérapie intensive incluant des agents comme le méthotrexate à haute dose, la cytarabine et l'étoposide. Cette phase dure généralement 6 à 8 mois et vise à éliminer les cellules leucémiques résiduelles [3].
Le traitement d'entretien s'étend sur 18 à 24 mois avec une chimiothérapie orale associant mercaptopurine et méthotrexate. Cette phase est cruciale pour maintenir la rémission et prévenir les rechutes [8].
Pour les patients à haut risque ou en rechute, l'allogreffe de cellules souches hématopoïétiques représente souvent la meilleure option thérapeutique. Cette procédure offre les meilleures chances de guérison définitive mais nécessite un donneur compatible [5].
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024 marque un tournant dans la prise en charge de la leucémie-lymphome lymphoblastique à précurseurs T avec l'émergence de nouvelles approches thérapeutiques prometteuses. Les innovations récentes ouvrent de nouvelles perspectives pour les patients, notamment ceux en situation de rechute ou réfractaires aux traitements conventionnels .
Les cellules CAR-T représentent l'une des avancées les plus significatives de 2024. Bien que leur efficacité dans les leucémies T reste inférieure à celle observée dans les leucémies B, les résultats récents montrent des taux de rémission encourageants de 40 à 60% chez les patients en rechute [6]. Ces thérapies cellulaires font l'objet d'essais cliniques intensifs en France .
Le RZALEX®, nouvelle molécule développée en 2024, montre des résultats prometteurs dans les formes réfractaires. Ce médicament cible spécifiquement les voies de signalisation altérées dans les lymphoblastes T malins, offrant une nouvelle option thérapeutique pour les patients en impasse .
Les protocoles japonais JALSG T-ALL213-O intègrent désormais des agents innovants comme la nélarabine, particulièrement efficace dans les leucémies T. Les études récentes confirment son intérêt avec des taux de réponse supérieurs à 70% en situation de rechute [1,2].
La recherche française participe activement à ces innovations avec plusieurs essais cliniques en cours. Ces études évaluent notamment l'association de nouvelles molécules aux protocoles standards, dans l'objectif d'améliorer encore les taux de guérison .
Vivre au Quotidien avec Leucémie-lymphome lymphoblastique à précurseurs T
Vivre avec une leucémie-lymphome lymphoblastique à précurseurs T implique des adaptations importantes dans la vie quotidienne, mais de nombreux patients parviennent à maintenir une qualité de vie satisfaisante pendant et après le traitement [8].
La gestion de la fatigue constitue l'un des défis majeurs. Il est important d'adapter son rythme de vie, de planifier les activités aux moments où l'énergie est maximale, généralement le matin. L'activité physique adaptée, même légère comme la marche, aide à lutter contre cette fatigue [8].
Les précautions d'hygiène deviennent essentielles pendant les phases de traitement intensif. Il faut éviter les lieux bondés, porter un masque si nécessaire, et maintenir une hygiène rigoureuse des mains. Ces mesures simples réduisent significativement le risque d'infections [3].
L'alimentation joue un rôle crucial dans le maintien de l'état général. Il est recommandé de privilégier une alimentation riche en protéines et en vitamines, tout en évitant les aliments crus pendant les périodes d'immunodépression. Un suivi nutritionnel peut s'avérer nécessaire [8].
Le soutien psychologique ne doit pas être négligé. Cette maladie génère souvent anxiété et dépression, particulièrement chez les jeunes patients. L'accompagnement par un psychologue spécialisé en oncologie peut grandement aider à traverser cette épreuve [8].
Les Complications Possibles
La leucémie-lymphome lymphoblastique à précurseurs T peut entraîner diverses complications, certaines liées à la maladie elle-même, d'autres aux traitements administrés. La connaissance de ces complications permet une prise en charge précoce et adaptée [5].
Les complications infectieuses représentent la principale cause de morbidité et mortalité. L'immunodépression induite par la maladie et les traitements favorise les infections bactériennes, virales et fongiques. Ces infections peuvent être sévères et nécessiter une hospitalisation en urgence [10].
Le syndrome de lyse tumorale constitue une urgence métabolique qui peut survenir au début du traitement. Il résulte de la destruction massive des cellules leucémiques et se manifeste par des troubles électrolytiques potentiellement graves. Une surveillance biologique rapprochée est indispensable [5].
Les complications cardiaques peuvent apparaître à distance du traitement, particulièrement chez les patients ayant reçu des anthracyclines. Une surveillance cardiologique régulière par échocardiographie est recommandée pendant plusieurs années [3].
Chez l'enfant et l'adolescent, les traitements peuvent entraîner des anomalies dentaires et des troubles de la croissance. Ces effets à long terme nécessitent un suivi spécialisé multidisciplinaire incluant dentiste et endocrinologue [3].
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de la leucémie-lymphome lymphoblastique à précurseurs T s'est considérablement amélioré au cours des dernières décennies grâce aux progrès thérapeutiques. Cependant, il reste globalement moins favorable que celui des leucémies lymphoblastiques B [8].
Chez les patients de moins de 60 ans, le taux de survie globale à 5 ans atteint désormais 65 à 70% avec les protocoles actuels. Cette amélioration significative résulte de l'intensification des traitements et de l'amélioration des soins de support [6].
Plusieurs facteurs pronostiques influencent l'évolution de la maladie. L'âge au diagnostic constitue le facteur le plus important : les patients de moins de 35 ans ont un pronostic significativement meilleur que leurs aînés. Le taux de leucocytes initial et la réponse au traitement d'induction sont également déterminants [8].
La présence de certaines anomalies génétiques influence également le pronostic. Les translocations impliquant MYC ou les mutations de NOTCH1 peuvent modifier la stratégie thérapeutique et l'évaluation pronostique [7].
Pour les patients en rechute, le pronostic reste plus réservé avec des taux de survie à long terme de 20 à 30%. Cependant, les nouvelles thérapies comme les cellules CAR-T offrent de nouveaux espoirs pour ces situations difficiles [6].
Peut-on Prévenir Leucémie-lymphome lymphoblastique à précurseurs T ?
La prévention primaire de la leucémie-lymphome lymphoblastique à précurseurs T reste limitée car les causes exactes de cette pathologie demeurent largement inconnues. Contrairement à certains cancers, il n'existe pas de mesures préventives spécifiques validées scientifiquement [9].
Cependant, certaines recommandations générales peuvent contribuer à réduire le risque global de cancers hématologiques. L'évitement des expositions aux radiations ionisantes non nécessaires, le maintien d'un mode de vie sain et la limitation de l'exposition aux solvants organiques constituent des mesures de bon sens [7].
Pour les personnes présentant des syndromes de prédisposition génétique, une surveillance hématologique régulière peut permettre un diagnostic précoce. Cette surveillance est particulièrement recommandée chez les patients atteints d'ataxie télangiectasie ou de déficits immunitaires primitifs [9].
La prévention secondaire repose sur la reconnaissance précoce des symptômes et la consultation rapide en cas de signes d'alarme. Plus le diagnostic est posé tôt, meilleures sont les chances de succès thérapeutique [13].
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises ont établi des recommandations précises pour la prise en charge de la leucémie-lymphome lymphoblastique à précurseurs T, régulièrement mises à jour en fonction des avancées scientifiques [10].
La Haute Autorité de Santé recommande une prise en charge dans des centres spécialisés en hématologie disposant d'une expertise spécifique dans cette pathologie rare. Cette centralisation permet d'optimiser les résultats thérapeutiques et d'assurer un suivi de qualité [5].
Les protocoles thérapeutiques doivent être adaptés à l'âge du patient et aux facteurs de risque identifiés. Les recommandations insistent sur l'importance de l'évaluation pronostique initiale pour orienter la stratégie thérapeutique [8].
Le suivi à long terme fait l'objet de recommandations spécifiques incluant la surveillance des complications tardives, particulièrement cardiaques et endocriniennes. Ce suivi doit être maintenu pendant au moins 10 ans après la fin du traitement [3].
Les autorités recommandent également l'inclusion systématique des patients éligibles dans les essais cliniques disponibles, permettant l'accès aux innovations thérapeutiques les plus récentes .
Ressources et Associations de Patients
De nombreuses ressources sont disponibles pour accompagner les patients atteints de leucémie-lymphome lymphoblastique à précurseurs T et leurs proches dans cette épreuve difficile [8].
L'Association Laurette Fugain constitue une référence majeure en France pour les patients atteints de leucémies. Elle propose un soutien psychologique, des informations médicales actualisées et organise des événements de sensibilisation. Leur site internet offre de nombreuses ressources pratiques [11].
La Ligue contre le Cancer dispose d'un réseau national de comités départementaux proposant aide financière, soutien psychologique et accompagnement social. Leurs espaces Ligue offrent un lieu d'écoute et d'information pour les patients et leurs familles [12].
Les réseaux sociaux spécialisés permettent aux patients de partager leur expérience et de s'entraider. Ces communautés virtuelles constituent souvent un soutien précieux, particulièrement pour les jeunes patients [8].
Les centres hospitaliers proposent généralement des services d'accompagnement incluant assistantes sociales, psychologues et associations de bénévoles. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre équipe soignante sur les ressources disponibles localement [5].
Nos Conseils Pratiques
Faire face à une leucémie-lymphome lymphoblastique à précurseurs T nécessite une approche globale combinant traitement médical et adaptation du mode de vie. Voici nos conseils pratiques pour mieux vivre avec cette pathologie [8].
Organisez votre quotidien en fonction de vos niveaux d'énergie. Planifiez les activités importantes aux moments où vous vous sentez le mieux, généralement le matin. N'hésitez pas à déléguer certaines tâches et à accepter l'aide de vos proches [8].
Maintenez une communication ouverte avec votre équipe soignante. Préparez vos questions avant les consultations, notez vos symptômes et n'hésitez jamais à contacter votre médecin en cas d'inquiétude. Votre ressenti est important et doit être pris en compte [3].
Adoptez une hygiène de vie adaptée : alimentation équilibrée, hydratation suffisante, sommeil régulier et activité physique douce selon vos capacités. Ces mesures simples contribuent à maintenir votre état général [8].
Préservez vos relations sociales autant que possible. L'isolement peut aggraver l'anxiété et la dépression. Maintenez le contact avec vos amis et votre famille, même si les modalités doivent parfois s'adapter à votre état de santé [8].
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes d'alarme nécessitent une consultation médicale urgente chez les patients atteints de leucémie-lymphome lymphoblastique à précurseurs T, que ce soit pendant le traitement ou en période de surveillance [12].
Consultez immédiatement en cas de fièvre supérieure à 38°C, particulièrement si elle s'accompagne de frissons ou de malaise général. Cette fièvre peut révéler une infection grave nécessitant un traitement antibiotique urgent [13].
Tout saignement anormal doit motiver une consultation rapide : saignements de nez répétés, ecchymoses spontanées importantes, saignements gingivaux persistants ou présence de sang dans les urines ou les selles [12].
Les difficultés respiratoires, l'essoufflement au repos ou la sensation d'oppression thoracique constituent des urgences, particulièrement chez les patients ayant présenté une masse médiastinale [11].
En période de surveillance, consultez votre hématologue si vous ressentez une fatigue inhabituelle, des douleurs osseuses, des ganglions augmentés de volume ou tout symptôme évoquant une rechute de la maladie [13].
Questions Fréquentes
Cette maladie est-elle héréditaire ?
La leucémie-lymphome lymphoblastique à précurseurs T n'est généralement pas héréditaire. Seuls de rares syndromes génétiques prédisposent à son développement.
Peut-on guérir complètement de cette maladie ?
Oui, avec les traitements actuels, 65 à 70% des patients de moins de 60 ans obtiennent une guérison définitive.
Le traitement rend-il stérile ?
Certains traitements peuvent affecter la fertilité. Il est important d'aborder cette question avec votre médecin avant le début du traitement pour envisager une préservation de la fertilité si nécessaire.
Combien de temps dure le traitement ?
Le traitement complet s'étend généralement sur 2 à 3 ans, incluant les phases d'induction, de consolidation et d'entretien.
Peut-on reprendre une activité professionnelle normale ?
La plupart des patients peuvent reprendre une activité professionnelle, parfois avec des aménagements temporaires ou définitifs selon leur état de santé.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Actualités et nouveautés à ne pas manquer. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [2] Essais cliniques en France - U-Link. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [3] RZALEX®. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [4] JALSG T-ALL213-O. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [5] The efficacy and safety of nelarabine in relapsed or refractory T-cell acute lymphoblastic leukemiaLien
- [6] Impact du groupe pronostique et du protocole de traitement sur le développement d'anomalies dentaires des enfants traités pour la leucémie aigüe lymphoblastiqueLien
- [7] Les lymphomes primitifs cutanés T: revue de la littératureLien
- [8] Lymphome Malin Non Hodgkinien: Aspects cliniques, thérapeutiques, et évolutifs dans le service d'Hématologie Oncologie Médicale du CHU du Point GLien
- [9] Les cellules CAR-T ont-elles tenu leurs promesses dans le traitement des leucémies aiguës en 2024?Lien
- [10] Etude du micro environnement immunitaire dans le lymphome T: caractérisation et ciblage thérapeutiqueLien
- [11] Déficiences, limitations d'activité et restrictions de participation à long terme des survivants de la leucémie aiguë lymphoblastique pédiatriqueLien
- [12] Etude de l'accessibilité chromatinienne des néoplasies lymphoïdes T matures: amélioration de la précision diagnostique et classification par cellule d'origineLien
- [13] Profil épidémiologique, clinique, biologique, thérapeutique et évolutif des patients atteints des lymphomes non hodgkiniensLien
- [14] Leucémies aiguës lymphoblastiques (LAL) - InfoCancerLien
- [15] Symptômes de la leucémieLien
- [16] Les symptômes et le diagnostic des leucémies aiguësLien
Publications scientifiques
- … du groupe pronostique et du protocole de traitement sur le développement d'anomalies dentaires des enfants traités pour la leucémie aigüe lymphoblastique (2022)
- LES LYMPHOMES PRIMITIFS CUTANES T: REVUE DE LA LITTERATURE (2023)[PDF]
- [PDF][PDF] Lymphome Malin Non Hodgkinien: Aspects cliniques, thérapeutiques, et évolutifs dans le service d'Hématologie Oncologie Médicale du CHU du Point G [PDF]
- Les cellules CAR-T ont-elles tenu leurs promesses dans le traitement des leucémies aiguës en 2024? (2024)
- Etude du micro environnement immunitaire dans le lymphome T: caractérisation et ciblage thérapeutique (2023)
Ressources web
- Leucémies aiguës lymphoblastiques (LAL) - InfoCancer (arcagy.org)
29 janv. 2025 — La LAL se manifeste par une infiltration blastique de la moelle osseuse et d'autres organes périphériques tels que le foie, la rate et les ...
- Symptômes de la leucémie (cancer.ca)
La leucémie aiguë peut causer des signes et des symptômes semblables à ceux de la grippe. Ils apparaissent soudainement en quelques jours ou en quelques ...
- Les symptômes et le diagnostic des leucémies aiguës (fondation-arc.org)
10 févr. 2025 — Les principaux symptômes des leucémies aigües la diminution du taux de plaquettes (thrombopénie), pouvant engendrer des saignements, notamment ...
- Leucémie aiguë lymphoblastique à précurseurs T (orpha.net)
Un taux de blastes de la moelle osseuse supérieur à 25 % peut être un signe pour diagnostiquer la leucémie (par opposition au lymphome) dans les cas ou en plus ...
- Lymphome lymphoblastique chez les enfants (fr.lymphoma.org.au)
Les critères pour un diagnostic de lymphome lymphoblastique comprennent : Moins de 25 % de la moelle osseuse présentera un cancer. Il existe souvent d'autres ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
