Leucémie-lymphome lymphoblastique à précurseurs B et T : Guide Complet 2025
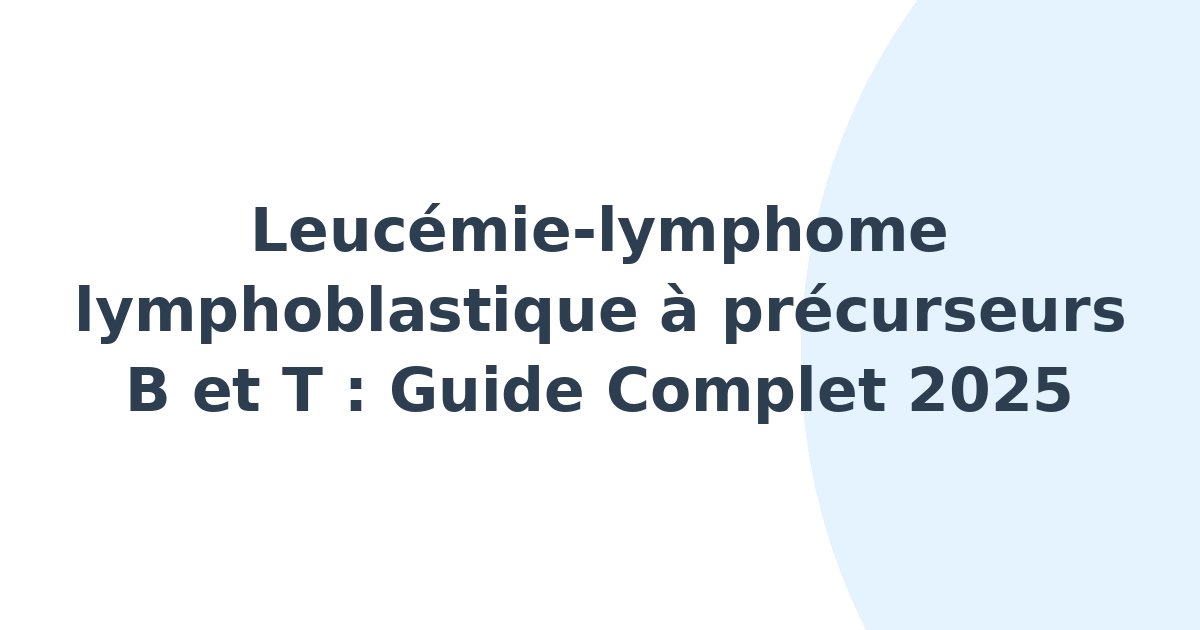
La leucémie-lymphome lymphoblastique à précurseurs B et T représente une pathologie complexe du système sanguin qui touche principalement les enfants et jeunes adultes. Cette maladie hématologique, caractérisée par une prolifération anormale de cellules immatures, nécessite une prise en charge spécialisée et précoce. Avec les avancées thérapeutiques récentes, notamment les innovations 2024-2025, le pronostic s'améliore considérablement pour les patients concernés.
Téléconsultation et Leucémie-lymphome lymphoblastique à précurseurs B et T
Téléconsultation non recommandéeLa leucémie-lymphome lymphoblastique à précurseurs B et T est une hémopathie maligne nécessitant un diagnostic histologique et cytologique précis, des examens biologiques spécialisés (myélogramme, immunophénotypage) et une prise en charge oncohématologique urgente. La complexité diagnostique et la gravité de cette pathologie rendent la téléconsultation inadaptée pour l'évaluation initiale.
Ce qui peut être évalué à distance
Discussion des symptômes généraux (fatigue, fièvre, perte de poids), évaluation de l'évolution des signes cliniques sous traitement, suivi de l'observance thérapeutique, coordination avec l'équipe d'oncohématologie, accompagnement psychologique du patient et de sa famille.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examen physique complet avec recherche d'adénopathies et d'hépatosplénomégalie, réalisation du myélogramme et de la biopsie ostéomédullaire, immunophénotypage des cellules blastiques, caryotype et biologie moléculaire, évaluation de l'extension de la maladie par imagerie.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Suspicion diagnostique initiale nécessitant un myélogramme, évaluation de la réponse au traitement par examens médullaires, apparition de complications infectieuses ou hémorragiques, surveillance de la toxicité des chimiothérapies nécessitant un examen clinique approfondi.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Syndrome de lyse tumorale avec troubles métaboliques, syndrome cave supérieur par masse médiastinale, neutropénie fébrile avec signes de sepsis, hémorragies graves par thrombopénie profonde.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Fièvre supérieure à 38°C chez un patient neutropénique sous chimiothérapie
- Saignements spontanés multiples (purpura, épistaxis, gingivorragies) évoquant une thrombopénie sévère
- Syndrome cave supérieur avec œdème du visage et du cou, circulation collatérale thoracique
- Signes neurologiques nouveaux évoquant une atteinte méningée ou une hyperleucocytose
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Onco-hématologue — consultation en présentiel indispensable
La leucémie-lymphome lymphoblastique nécessite impérativement une prise en charge spécialisée en oncohématologie pour le diagnostic, la classification pronostique et l'instauration du traitement adapté. La consultation en présentiel est obligatoire pour les examens diagnostiques et le suivi thérapeutique.
Leucémie-lymphome lymphoblastique à précurseurs B et T : Définition et Vue d'Ensemble
La leucémie-lymphome lymphoblastique à précurseurs B et T constitue une pathologie hématologique maligne caractérisée par l'accumulation de cellules lymphoïdes immatures, appelées lymphoblastes, dans la moelle osseuse, le sang et parfois les ganglions lymphatiques [4,5].
Cette maladie appartient au groupe des hémopathies malignes et se distingue par sa capacité à affecter deux lignées cellulaires distinctes : les précurseurs B et les précurseurs T. Concrètement, ces cellules normalement destinées à devenir des lymphocytes matures perdent leur capacité de différenciation et prolifèrent de manière anarchique [6].
Il faut savoir que cette pathologie présente deux formes principales selon la localisation prédominante des cellules malignes. Quand les lymphoblastes envahissent principalement la moelle osseuse et le sang circulant, on parle de leucémie lymphoblastique aiguë. En revanche, lorsque l'atteinte concerne surtout les organes lymphoïdes comme les ganglions ou le thymus, il s'agit plutôt d'un lymphome lymphoblastique [4].
D'ailleurs, cette distinction n'est pas toujours nette dans la pratique clinique. Bon nombre de patients présentent une forme mixte avec atteinte simultanée de plusieurs compartiments. L'important à retenir, c'est que ces deux présentations relèvent du même processus pathologique et bénéficient d'approches thérapeutiques similaires [5,6].
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, la leucémie lymphoblastique aiguë représente environ 80% des leucémies de l'enfant, avec une incidence annuelle de 3 à 4 cas pour 100 000 enfants de moins de 15 ans [5]. Cette pathologie touche principalement les jeunes patients, avec un pic d'incidence entre 2 et 5 ans.
Les données épidémiologiques récentes montrent une légère augmentation de l'incidence au cours des dernières décennies, probablement liée à l'amélioration des techniques diagnostiques [4,6]. Chez l'adulte, cette maladie reste plus rare, représentant seulement 20% des leucémies aiguës avec une incidence de 0,5 à 1 cas pour 100 000 habitants par an.
Concernant la répartition par sexe, on observe une prédominance masculine légère, avec un ratio homme/femme d'environ 1,3:1 [5]. Cette différence s'explique en partie par la plus grande fréquence des formes T chez les garçons, particulièrement à l'adolescence.
Au niveau européen, la France se situe dans la moyenne des pays développés pour cette pathologie. Cependant, des variations géographiques existent, avec des incidences légèrement plus élevées dans les régions industrialisées [6]. Les projections pour 2025 suggèrent une stabilisation de l'incidence, mais une amélioration continue du pronostic grâce aux innovations thérapeutiques .
Les Causes et Facteurs de Risque
Les causes exactes de la leucémie-lymphome lymphoblastique restent largement méconnues dans la majorité des cas. Néanmoins, la recherche a identifié plusieurs facteurs de risque qui peuvent contribuer au développement de cette pathologie [4,5].
Parmi les facteurs génétiques, certaines anomalies chromosomiques prédisposent à la maladie. Les syndromes de prédisposition héréditaire comme le syndrome de Down, le syndrome de Li-Fraumeni ou l'ataxietélangiectasie augmentent significativement le risque [6]. Mais rassurez-vous, ces formes héréditaires ne représentent qu'une minorité des cas.
Les facteurs environnementaux jouent également un rôle, bien que leur impact reste débattu. L'exposition aux radiations ionisantes, certains agents chimiques comme le benzène, ou encore certains traitements de chimiothérapie antérieurs peuvent favoriser l'apparition de la maladie [4]. D'ailleurs, les études récentes suggèrent que l'exposition prénatale à certains facteurs pourrait être déterminante [5].
Il est important de noter que dans plus de 90% des cas, aucun facteur de risque spécifique n'est identifié. Cette pathologie survient donc le plus souvent de manière sporadique, sans cause apparente [6]. Cela peut être frustrant pour les familles, mais c'est la réalité de cette maladie complexe.
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes de la leucémie-lymphome lymphoblastique résultent principalement de l'envahissement de la moelle osseuse par les cellules malignes et de leur infiltration dans divers organes [4,5]. Ces signes peuvent apparaître progressivement ou de manière plus brutale.
La fatigue intense et la pâleur constituent souvent les premiers signes d'alerte. Cette asthénie résulte de l'anémie causée par la diminution de production des globules rouges normaux. Vous pourriez également remarquer un essoufflement à l'effort, des palpitations ou une sensation de faiblesse générale [6].
Les troubles de la coagulation se manifestent par des saignements anormaux : ecchymoses spontanées, saignements de nez fréquents, ou saignements des gencives. Ces symptômes témoignent de la chute du nombre de plaquettes dans le sang [4]. Parallèlement, la diminution des globules blancs normaux favorise les infections à répétition, souvent plus sévères que d'habitude.
Dans les formes lymphomateuses, l'augmentation de volume des ganglions lymphatiques peut être le symptôme révélateur. Ces adénopathies sont généralement indolores et peuvent toucher différentes régions du corps [5]. Certains patients présentent également une masse médiastinale, particulièrement dans les formes T, pouvant entraîner une gêne respiratoire [6].
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic de la leucémie-lymphome lymphoblastique repose sur une démarche méthodique combinant examens cliniques et analyses biologiques spécialisées [4,5]. Cette approche permet non seulement de confirmer le diagnostic, mais aussi de préciser le sous-type exact de la maladie.
L'étape initiale consiste en un hémogramme complet avec examen du frottis sanguin. Cet examen révèle généralement des anomalies caractéristiques : présence de cellules blastiques circulantes, cytopénies variables selon les lignées touchées [6]. Cependant, il faut savoir que dans certains cas, l'hémogramme peut être initialement normal ou peu perturbé.
Le myélogramme représente l'examen de référence pour confirmer le diagnostic. Cette ponction de moelle osseuse, réalisée sous anesthésie locale, permet d'analyser directement les cellules médullaires. Un taux de blastes supérieur à 20% de la cellularité médullaire confirme le diagnostic de leucémie aiguë [4,5].
Les analyses complémentaires incluent l'immunophénotypage par cytométrie en flux, qui permet de déterminer précisément le type de cellules malignes (précurseurs B ou T) [6]. La cytogénétique et la biologie moléculaire recherchent des anomalies chromosomiques ou génétiques spécifiques, essentielles pour adapter le traitement et évaluer le pronostic [4]. D'ailleurs, ces examens spécialisés orientent désormais de plus en plus les décisions thérapeutiques grâce aux avancées de la médecine personnalisée .
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement de la leucémie-lymphome lymphoblastique repose sur une approche multimodale intensive, adaptée à l'âge du patient et aux caractéristiques biologiques de sa maladie [4,5]. Cette stratégie thérapeutique s'articule autour de plusieurs phases successives, chacune ayant des objectifs spécifiques.
La phase d'induction constitue le premier temps du traitement, visant à obtenir une rémission complète. Elle associe généralement plusieurs agents de chimiothérapie : vincristine, corticoïdes, anthracyclines et L-asparaginase [6]. Cette phase dure environ 4 à 6 semaines et permet d'obtenir une rémission chez plus de 95% des enfants.
Suit la phase de consolidation, qui vise à éliminer les cellules résiduelles non détectables. Cette étape comprend souvent une intensification avec des doses élevées de méthotrexate et de cytarabine [4]. Parallèlement, une prophylaxie du système nerveux central est systématiquement réalisée par injections intrathécales.
La phase d'entretien représente la période la plus longue du traitement, s'étendant généralement sur 2 à 3 ans. Elle repose principalement sur l'association méthotrexate oral et mercaptopurine, avec des cures mensuelles de vincristine et corticoïdes [5,6]. Cette phase ambulatoire permet aux patients de reprendre progressivement une vie normale tout en maintenant l'efficacité thérapeutique.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024-2025 marque une période d'innovations majeures dans le traitement de la leucémie-lymphome lymphoblastique, avec l'émergence de thérapies ciblées et d'approches personnalisées . Ces avancées révolutionnent la prise en charge, particulièrement pour les formes résistantes ou en rechute.
Les cellules CAR-T représentent l'une des innovations les plus prometteuses de 2024. Ces lymphocytes T génétiquement modifiés pour reconnaître spécifiquement les cellules leucémiques montrent des résultats encourageants, avec des taux de rémission dépassant 80% dans certaines études [2]. Cependant, leur utilisation reste encore limitée aux centres spécialisés et aux situations de rechute.
Le développement de nouveaux inhibiteurs de tyrosine kinase comme le RZALEX® ouvre de nouvelles perspectives thérapeutiques . Ces molécules ciblées permettent d'attaquer spécifiquement les voies de signalisation altérées dans les cellules malignes, tout en préservant les cellules saines.
Les essais cliniques français actuels explorent également l'utilisation de thérapies combinées innovantes . Ces protocoles associent chimiothérapie conventionnelle et agents ciblés, dans l'objectif d'améliorer l'efficacité tout en réduisant la toxicité. D'ailleurs, les premiers résultats suggèrent une amélioration significative de la survie sans rechute .
Vivre au Quotidien avec Leucémie-lymphome lymphoblastique à précurseurs B et T
Vivre avec une leucémie-lymphome lymphoblastique implique des adaptations importantes dans la vie quotidienne, mais il est tout à fait possible de maintenir une qualité de vie satisfaisante [3]. L'organisation du quotidien doit tenir compte des contraintes du traitement et des précautions nécessaires.
Pendant les phases intensives de traitement, la gestion de la fatigue devient prioritaire. Il est normal de ressentir une asthénie importante, et il faut apprendre à respecter ses limites. Planifiez vos activités aux moments où vous vous sentez le mieux, généralement le matin, et n'hésitez pas à faire des siestes régulières [3].
La prévention des infections constitue un aspect crucial du quotidien. Évitez les lieux bondés pendant les périodes de neutropénie, lavez-vous fréquemment les mains, et portez un masque si nécessaire. Cela dit, l'isolement complet n'est pas recommandé car le maintien des liens sociaux reste essentiel pour le moral [4,5].
L'alimentation joue également un rôle important. Privilégiez une alimentation équilibrée riche en protéines pour soutenir votre organisme pendant le traitement. En cas de nausées, fractionnez vos repas et n'hésitez pas à demander conseil à une diététicienne spécialisée [6]. Bon à savoir : certains aliments sont à éviter temporairement, comme les produits laitiers non pasteurisés ou les fruits et légumes crus pendant les phases d'immunodépression.
Les Complications Possibles
Les complications de la leucémie-lymphome lymphoblastique peuvent survenir soit du fait de la maladie elle-même, soit en raison des traitements administrés [4,5]. Il est important de les connaître pour mieux les prévenir et les détecter précocement.
Les complications infectieuses représentent l'un des risques majeurs, particulièrement pendant les phases d'immunosuppression intense. Les infections bactériennes, virales ou fongiques peuvent être sévères et nécessiter une hospitalisation d'urgence [6]. Heureusement, les protocoles de prévention et de surveillance permettent de limiter considérablement ces risques.
Les complications hémorragiques résultent de la thrombopénie et peuvent se manifester par des saignements cutanés, digestifs ou plus rarement cérébraux. La surveillance régulière du taux de plaquettes permet d'anticiper ces situations et de réaliser des transfusions si nécessaire [4].
À long terme, certains traitements peuvent entraîner des séquelles tardives. Les anthracyclines peuvent affecter la fonction cardiaque, nécessitant un suivi cardiologique régulier [1]. Les radiations et certains agents de chimiothérapie peuvent également impacter la fertilité, d'où l'importance de discuter de préservation de la fertilité avant le début du traitement [5,6]. D'ailleurs, les études récentes montrent que ces complications tardives peuvent être minimisées grâce aux protocoles thérapeutiques modernes [3].
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de la leucémie-lymphome lymphoblastique s'est considérablement amélioré au cours des dernières décennies, particulièrement chez l'enfant où les taux de guérison dépassent désormais 90% [4,5]. Cette amélioration résulte des progrès dans la compréhension de la maladie et de l'optimisation des protocoles thérapeutiques.
Chez l'enfant, plusieurs facteurs influencent le pronostic. L'âge au diagnostic constitue un élément déterminant : les enfants âgés de 1 à 10 ans ont généralement un meilleur pronostic que les nourrissons ou les adolescents [6]. Le nombre de globules blancs au diagnostic, les anomalies cytogénétiques et la réponse précoce au traitement sont également des facteurs pronostiques majeurs.
Chez l'adulte, le pronostic reste plus réservé avec des taux de guérison d'environ 40 à 50% [4]. Cependant, les innovations thérapeutiques récentes, notamment les thérapies ciblées et les cellules CAR-T, permettent d'espérer une amélioration significative de ces résultats [2].
Il est important de souligner que chaque patient est unique et que les statistiques générales ne présagent pas de l'évolution individuelle. La maladie résiduelle minimale, détectable par des techniques de biologie moléculaire ultra-sensibles, constitue aujourd'hui le meilleur marqueur pronostique et guide l'adaptation du traitement [5,6]. Concrètement, cette approche personnalisée permet d'optimiser les chances de guérison tout en limitant la toxicité.
Peut-on Prévenir Leucémie-lymphome lymphoblastique à précurseurs B et T ?
La prévention primaire de la leucémie-lymphome lymphoblastique reste limitée en raison de la méconnaissance des causes exactes de cette pathologie [4,5]. Néanmoins, certaines mesures peuvent contribuer à réduire les risques, particulièrement chez les personnes présentant des facteurs de prédisposition.
L'évitement des expositions environnementales connues pour être associées à un risque accru constitue une mesure de bon sens. Cela inclut la limitation de l'exposition aux radiations ionisantes non médicales, aux solvants organiques comme le benzène, et à certains pesticides [6]. Pour les professionnels exposés, le respect strict des mesures de protection individuelle est essentiel.
Chez les patients ayant des antécédents familiaux de cancers hématologiques ou porteurs de syndromes de prédisposition génétique, un conseil génétique peut être proposé. Cette démarche permet d'évaluer le risque individuel et de mettre en place une surveillance adaptée [4].
La prévention secondaire, c'est-à-dire le dépistage précoce, n'est pas recommandée en population générale en raison de la rareté de la maladie. Cependant, il est important de consulter rapidement en cas de symptômes évocateurs : fatigue persistante inexpliquée, infections répétées, saignements anormaux ou adénopathies [5,6]. Plus le diagnostic est précoce, meilleures sont les chances de succès thérapeutique.
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités de santé françaises et internationales ont établi des recommandations précises pour la prise en charge de la leucémie-lymphome lymphoblastique, régulièrement mises à jour en fonction des avancées scientifiques [4,5]. Ces guidelines visent à standardiser les pratiques et à optimiser les résultats thérapeutiques.
La Haute Autorité de Santé (HAS) recommande une prise en charge multidisciplinaire dans des centres spécialisés en hématologie pédiatrique ou adulte. Cette approche attendut l'accès aux plateaux techniques les plus performants et à l'expertise nécessaire pour cette pathologie complexe [6].
Concernant le diagnostic, les recommandations insistent sur la nécessité de réaliser un bilan d'extension complet incluant imagerie, ponction lombaire et analyses biologiques spécialisées. L'immunophénotypage et la cytogénétique sont désormais considérés comme indispensables pour adapter le traitement [4,5].
Les protocoles thérapeutiques recommandés s'appuient sur les essais cliniques internationaux les plus récents. L'intégration des innovations 2024-2025, notamment les thérapies ciblées et les cellules CAR-T, fait l'objet de recommandations spécifiques pour leur utilisation dans les situations de rechute ou de résistance [2]. D'ailleurs, ces nouvelles approches nécessitent des centres hautement spécialisés et une formation spécifique des équipes soignantes.
Ressources et Associations de Patients
De nombreuses associations de patients et ressources sont disponibles pour accompagner les personnes atteintes de leucémie-lymphome lymphoblastique et leurs proches [3]. Ces structures offrent un soutien précieux, tant sur le plan pratique qu'émotionnel.
L'Association Laurette Fugain constitue l'une des principales associations françaises dédiées aux leucémies. Elle propose des services d'accompagnement, d'information et de soutien aux familles, ainsi qu'un financement de la recherche. Leurs équipes peuvent vous orienter vers les ressources locales les plus adaptées à votre situation.
La Ligue contre le Cancer dispose également de comités départementaux offrant des services de proximité : aide sociale, soutien psychologique, transport vers les lieux de soins. Ces services sont particulièrement précieux pendant les phases intensives de traitement [5].
Sur le plan informatif, les sites institutionnels comme celui de l'Institut National du Cancer (INCa) proposent des guides patients détaillés et régulièrement mis à jour. Ces ressources permettent de mieux comprendre la maladie et les traitements, facilitant ainsi le dialogue avec l'équipe soignante [6]. N'hésitez pas également à vous rapprocher des assistantes sociales hospitalières qui connaissent parfaitement les dispositifs d'aide disponibles dans votre région.
Nos Conseils Pratiques
Faire face à une leucémie-lymphome lymphoblastique nécessite une organisation particulière et l'adoption de stratégies pratiques pour mieux vivre cette épreuve [3]. Voici nos conseils issus de l'expérience des patients et des équipes soignantes.
Tenez un carnet de suivi détaillé avec vos symptômes, vos traitements et vos questions pour les consultations. Cette démarche facilite grandement la communication avec l'équipe médicale et permet un suivi plus précis de votre évolution. Notez également vos effets secondaires, même mineurs, car ils peuvent orienter les ajustements thérapeutiques.
Organisez votre environnement domestique pour limiter les risques d'infection : nettoyage régulier, éviction des plantes en pot, attention particulière à l'hygiène alimentaire. Cela dit, il ne s'agit pas de vivre dans une bulle stérile, mais d'adopter des précautions raisonnables [4,5].
Maintenez une activité physique adaptée selon vos capacités et les recommandations médicales. Même une marche quotidienne de quelques minutes peut contribuer à maintenir votre forme physique et votre moral. L'important est de rester à l'écoute de votre corps et de ne pas vous forcer [6].
Enfin, n'hésitez pas à solliciter un soutien psychologique si vous en ressentez le besoin. Cette maladie bouleverse la vie quotidienne et il est normal d'avoir besoin d'aide pour traverser cette épreuve. De nombreux hôpitaux proposent des consultations de psycho-oncologie spécialement dédiées aux patients atteints de cancer [3].
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes d'alerte doivent vous amener à consulter rapidement, que ce soit dans le cadre du diagnostic initial ou du suivi d'une leucémie-lymphome lymphoblastique connue [4,5]. La reconnaissance précoce de ces symptômes peut être déterminante pour l'efficacité de la prise en charge.
Consultez en urgence en cas de fièvre supérieure à 38°C, particulièrement si vous êtes en cours de traitement. Cette situation peut témoigner d'une infection grave nécessitant une antibiothérapie immédiate. N'attendez pas que la fièvre persiste ou s'aggrave [6].
Les saignements anormaux constituent également un motif de consultation urgente : saignements de nez prolongés, ecchymoses multiples apparues spontanément, saignements des gencives importants. Ces signes peuvent indiquer une chute dangereuse du taux de plaquettes [4].
Une fatigue brutalement aggravée, un essoufflement au repos, des palpitations ou des malaises doivent également vous alerter. Ces symptômes peuvent témoigner d'une aggravation de l'anémie nécessitant une transfusion [5].
En dehors des urgences, consultez votre médecin si vous présentez des symptômes persistants inexpliqués : fatigue inhabituelle durant plusieurs semaines, infections à répétition, perte de poids non intentionnelle, ou augmentation de volume des ganglions [6]. Il vaut toujours mieux consulter pour rien que de passer à côté d'un diagnostic important.
Questions Fréquentes
La leucémie-lymphome lymphoblastique est-elle héréditaire ?
Dans la grande majorité des cas, cette pathologie n'est pas héréditaire. Seuls certains syndromes génétiques rares prédisposent à son développement. Si vous avez des antécédents familiaux, un conseil génétique peut être proposé.
Peut-on guérir complètement de cette maladie ?
Oui, les taux de guérison sont excellents, particulièrement chez l'enfant où ils dépassent 90%. Chez l'adulte, bien que plus modestes, les résultats s'améliorent constamment grâce aux innovations thérapeutiques.
Combien de temps dure le traitement ?
Le traitement complet s'étend généralement sur 2 à 3 ans, avec des phases d'intensité variable. La phase d'entretien, la plus longue, se déroule principalement en ambulatoire.
Peut-on avoir des enfants après le traitement ?
Certains traitements peuvent affecter la fertilité. Il est important d'aborder cette question avec votre équipe médicale avant le début du traitement pour envisager des mesures de préservation si nécessaire.
Les innovations 2024-2025 sont-elles accessibles à tous ?
Les nouvelles thérapies comme les cellules CAR-T sont progressivement intégrées dans les protocoles de soins, mais leur accès reste encore limité aux centres spécialisés et à certaines situations cliniques.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Actualités et nouveautés à ne pas manquer. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [2] Essais cliniques en France - U-Link. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [3] RZALEX®. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [4] Population Pharmacokinetic and Exposure-Response. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [5] CT-P10 Drug Profile. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [6] C Boutin. du groupe pronostique et du protocole de traitement sur le développement d'anomalies dentaires des enfants traités pour la leucémie aigüe lymphoblastique. 2022Lien
- [8] MÉ Dourthe, K Yakouben. Les cellules CAR-T ont-elles tenu leurs promesses dans le traitement des leucémies aiguës en 2024? 2024Lien
- [12] A Brochu. Déficiences, limitations d'activité et restrictions de participation à long terme des survivants de la leucémie aiguë lymphoblastique pédiatrique: une étude descriptive. 2022Lien
- [14] Leucémie lymphoblastique aiguë - Hématologie et oncologie. MSD ManualsLien
- [15] Leucémies aiguës lymphoblastiques (LAL) - InfoCancer. ARCAGYLien
- [16] Qu'est-ce que la leucémie lymphoblastique aiguë? Société canadienne du cancerLien
Publications scientifiques
- … du groupe pronostique et du protocole de traitement sur le développement d'anomalies dentaires des enfants traités pour la leucémie aigüe lymphoblastique (2022)
- [PDF][PDF] Lymphome Malin Non Hodgkinien: Aspects cliniques, thérapeutiques, et évolutifs dans le service d'Hématologie Oncologie Médicale du CHU du Point G [PDF]
- Les cellules CAR-T ont-elles tenu leurs promesses dans le traitement des leucémies aiguës en 2024? (2024)
- LES LYMPHOMES PRIMITIFS CUTANES T: REVUE DE LA LITTERATURE (2023)[PDF]
- Profil épidémiologique, clinique, biologique, thérapeutique et évolutif des patients atteints des lymphomes non hodgkiniens au sein de l'EPH-Ouargla-durant une … (2023)1 citations[PDF]
Ressources web
- Leucémie lymphoblastique aiguë - Hématologie et oncologie (msdmanuals.com)
Les symptômes comprennent asthénie, pâleur, infections, douleurs osseuses, symptômes du système nerveux central (p. ex., céphalées), ecchymoses et hémorragies.
- Leucémies aiguës lymphoblastiques (LAL) - InfoCancer (arcagy.org)
29 janv. 2025 — La LAL se manifeste par une infiltration blastique de la moelle osseuse et d'autres organes périphériques tels que le foie, la rate et les ...
- Qu'est-ce que la leucémie lymphoblastique aiguë? (cancer.ca)
La leucémie lymphoblastique aiguë (LLA) est un cancer qui prend naissance dans les cellules souches du sang. Les cellules souches sont des cellules de base ...
- Les symptômes et le diagnostic des leucémies aiguës (fondation-arc.org)
10 févr. 2025 — Une leucémie peut être suspectée à la suite d'une simple prise de sang, lorsque la numération de la formule sanguine (NFS) est anormale : l' ...
- Symptômes de la leucémie (cancer.ca)
La leucémie aiguë peut causer des signes et des symptômes semblables à ceux de la grippe. Ils apparaissent soudainement en quelques jours ou en quelques ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
