Leucémie-lymphome lymphoblastique à précurseurs B : Guide Complet 2025
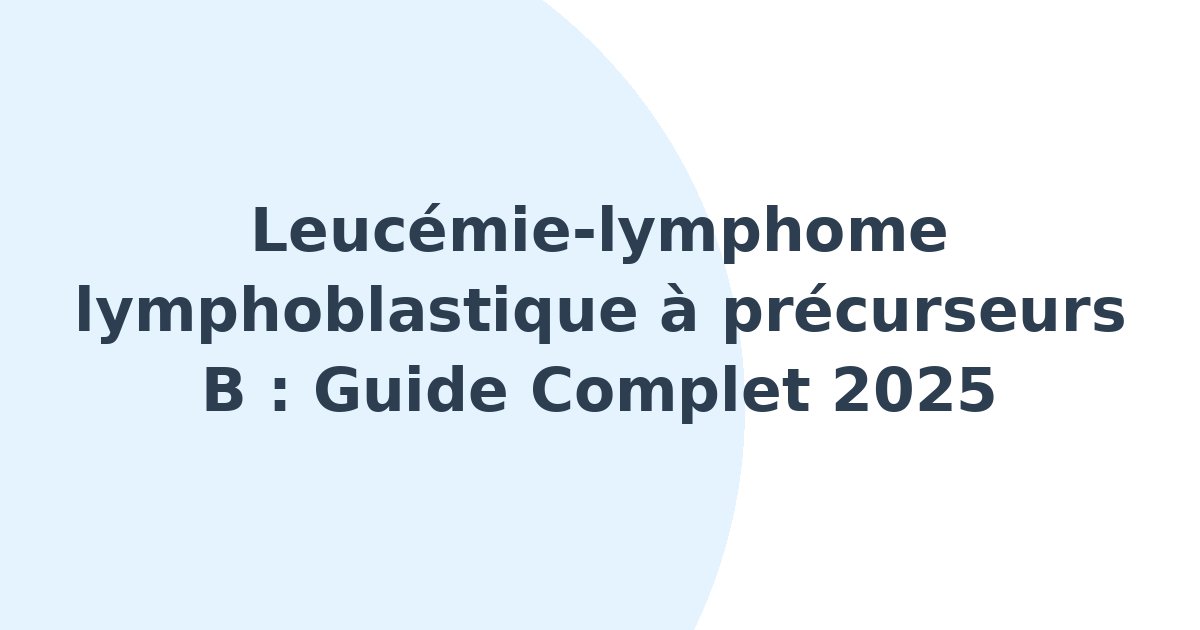
La leucémie-lymphome lymphoblastique à précurseurs B représente une pathologie hématologique complexe touchant principalement les enfants et jeunes adultes. Cette maladie du sang se caractérise par une prolifération anormale de cellules lymphoblastiques immatures dans la moelle osseuse et les organes lymphoïdes. Bien que rare, elle nécessite une prise en charge spécialisée et rapide. Les avancées thérapeutiques récentes, notamment les innovations 2024-2025, offrent aujourd'hui de nouveaux espoirs aux patients et leurs familles.
Téléconsultation et Leucémie-lymphome lymphoblastique à précurseurs B
Téléconsultation non recommandéeLa leucémie-lymphome lymphoblastique à précurseurs B est une pathologie hématologique maligne nécessitant un diagnostic histologique et cytologique complexe, avec examens spécialisés en urgence. Cette pathologie requiert une prise en charge oncohématologique immédiate en milieu spécialisé, rendant la téléconsultation inadaptée pour le diagnostic initial.
Ce qui peut être évalué à distance
Recueil de l'histoire clinique et des symptômes généraux (fatigue, perte de poids, sueurs nocturnes). Évaluation de l'évolution des symptômes sous traitement en cours. Analyse des résultats d'examens déjà réalisés. Coordination avec l'équipe spécialisée pour le suivi. Discussion des effets secondaires du traitement oncologique.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examen physique complet avec palpation des aires ganglionnaires et recherche d'organomégalie. Réalisation d'examens biologiques spécialisés (hémogramme, myélogramme, immunophénotypage). Biopsie ganglionnaire ou médullaire pour confirmation diagnostique. Évaluation de l'extension de la maladie par imagerie.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Suspicion de syndrome de lyse tumorale nécessitant une surveillance biologique urgente. Neutropénie fébrile requérant une évaluation clinique et des hémocultures immédiates. Syndrome cave supérieur par compression médiastinale. Signes neurologiques évoquant une atteinte méningée leucémique.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Détresse respiratoire par compression médiastinale ou syndrome leucostasique. Signes de compression médullaire par infiltration rachidienne. Syndrome hémorragique sévère avec thrombopénie profonde.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Détresse respiratoire avec dyspnée de repos ou stridor inspiratoire
- Syndrome hémorragique avec purpura extensif, saignements spontanés ou hémorragies
- Signes neurologiques : convulsions, troubles de conscience, paralysies ou céphalées intenses
- Fièvre élevée avec frissons chez un patient neutropénique
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Hématologue — consultation en présentiel indispensable
L'hématologie est la spécialité de référence pour cette pathologie maligne complexe nécessitant des examens spécialisés et une prise en charge oncologique immédiate. Une consultation en présentiel est obligatoire pour le diagnostic et la mise en route du traitement.
Leucémie-lymphome lymphoblastique à précurseurs B : Définition et Vue d'Ensemble
La leucémie-lymphome lymphoblastique à précurseurs B constitue une pathologie maligne du système hématopoïétique. Elle se développe à partir de cellules lymphoïdes B immatures, appelées lymphoblastes, qui prolifèrent de manière incontrôlée [9,10].
Cette maladie présente deux formes principales selon sa localisation. D'une part, la forme leucémique affecte principalement la moelle osseuse et le sang périphérique. D'autre part, la forme lymphomateuse touche davantage les ganglions lymphatiques et autres organes lymphoïdes [11].
Concrètement, les cellules malades perdent leur capacité à se différencier normalement. Elles s'accumulent alors dans différents organes, perturbant leur fonctionnement. Cette accumulation explique la diversité des symptômes observés chez les patients.
L'important à retenir : cette pathologie nécessite un diagnostic précoce et une prise en charge spécialisée. Les progrès récents en immunothérapie et thérapies ciblées transforment aujourd'hui le pronostic de nombreux patients [1,2].
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, la leucémie-lymphome lymphoblastique à précurseurs B représente environ 80% des leucémies aiguës lymphoblastiques de l'enfant. L'incidence annuelle s'établit à 3-4 cas pour 100 000 enfants de moins de 15 ans [7,8].
Les données épidémiologiques récentes montrent une légère augmentation de l'incidence depuis 2020. Cette tendance s'observe également dans d'autres pays européens, suggérant des facteurs environnementaux communs [7]. Bon à savoir : le pic d'incidence se situe entre 2 et 5 ans, avec une prédominance masculine (ratio 1,3:1).
Comparativement aux standards internationaux, la France présente des taux similaires aux autres pays développés. Cependant, les taux de survie français figurent parmi les meilleurs mondiaux, dépassant 90% à 5 ans pour les formes pédiatriques standard [1,7].
D'ailleurs, les projections pour 2025-2030 anticipent une stabilisation de l'incidence. Mais l'amélioration continue des techniques diagnostiques pourrait révéler des cas auparavant non détectés. L'impact économique sur le système de santé français est estimé à 150-200 millions d'euros annuels, incluant les coûts de traitement et de suivi à long terme [1].
Les Causes et Facteurs de Risque
Les causes exactes de la leucémie-lymphome lymphoblastique à précurseurs B restent largement méconnues. Néanmoins, plusieurs facteurs de risque ont été identifiés par la recherche récente [4,9].
Les facteurs génétiques jouent un rôle déterminant. Certaines anomalies chromosomiques, comme la translocation t(12;21), prédisposent au développement de la maladie. En fait, ces altérations génétiques peuvent être présentes dès la naissance, mais la maladie ne se déclare qu'ultérieurement [4].
L'exposition aux radiations ionisantes constitue un facteur de risque établi. Cela inclut les examens radiologiques répétés ou l'exposition professionnelle. Mais rassurez-vous : les doses utilisées en imagerie médicale moderne présentent un risque très faible [9].
Certaines infections virales pourraient également jouer un rôle déclencheur. Le microenvironnement de la moelle osseuse influence aussi le développement de la pathologie, comme l'ont démontré des études récentes sur les résistances thérapeutiques [4]. Cependant, il faut savoir que dans la majorité des cas, aucun facteur de risque spécifique n'est identifiable.
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes de la leucémie-lymphome lymphoblastique à précurseurs B résultent de l'infiltration des organes par les cellules malignes. Ils apparaissent généralement de façon progressive, mais peuvent parfois être d'installation brutale [9,10].
La fatigue intense et la pâleur constituent souvent les premiers signes. Ces symptômes reflètent l'anémie causée par l'envahissement de la moelle osseuse. Vous pourriez également observer une diminution de l'appétit et une perte de poids inexpliquée [10].
Les infections répétées représentent un autre signe d'alarme important. Fièvre persistante, infections ORL récurrentes ou cicatrisation difficile doivent alerter. En effet, la maladie perturbe la production de globules blancs normaux, affaiblissant les défenses immunitaires [9].
D'autres symptômes peuvent inclure des saignements anormaux (ecchymoses, saignements de nez), des douleurs osseuses ou articulaires, et parfois des ganglions gonflés. Chez l'enfant, une irritabilité inhabituelle ou des difficultés scolaires peuvent également être observées [10]. Il est normal de s'inquiéter face à ces signes, mais seul un bilan médical complet permettra d'établir le diagnostic.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic de la leucémie-lymphome lymphoblastique à précurseurs B repose sur une démarche méthodique et rigoureuse. La première étape consiste en un examen clinique approfondi, suivi d'analyses biologiques spécialisées [9,11].
L'hémogramme complet constitue l'examen de première intention. Il révèle généralement une anémie, une thrombopénie et parfois une hyperleucocytose avec présence de cellules anormales. Cependant, certains patients peuvent présenter un hémogramme initialement normal [9].
Le myélogramme représente l'examen clé du diagnostic. Cette ponction de moelle osseuse permet d'identifier les lymphoblastes et de déterminer leur pourcentage. Un taux supérieur à 20% de blastes confirme le diagnostic de leucémie aiguë [11].
L'analyse immunophénotypique par cytométrie en flux précise ensuite le type exact de leucémie. Elle identifie les marqueurs spécifiques des précurseurs B, permettant de différencier cette pathologie des autres leucémies [9]. Parallèlement, l'étude cytogénétique recherche les anomalies chromosomiques pronostiques importantes.
Enfin, le bilan d'extension comprend une imagerie thoraco-abdominale et parfois une ponction lombaire. Ces examens évaluent l'atteinte des différents organes et guident la stratégie thérapeutique [11].
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement de la leucémie-lymphome lymphoblastique à précurseurs B a considérablement évolué ces dernières années. Il repose sur une approche multimodale associant chimiothérapie, thérapies ciblées et parfois greffe de cellules souches [1,3,6].
La chimiothérapie reste le pilier du traitement. Elle se déroule en plusieurs phases : induction, consolidation et maintenance. Les protocoles actuels permettent d'obtenir une rémission complète chez plus de 95% des enfants [11]. Chez l'adulte, les taux de rémission atteignent 80-90% avec les protocoles intensifiés.
Le blinatumomab, anticorps bispécifique, représente une avancée majeure dans le traitement. Cet immunomédicament redirige les lymphocytes T du patient contre les cellules leucémiques. Les études récentes montrent son efficacité remarquable, notamment dans les formes réfractaires [1,3].
Les thérapies CAR-T constituent une autre innovation révolutionnaire. Ces cellules T génétiquement modifiées du patient ciblent spécifiquement les cellules B malignes. Bien que prometteuses, elles restent réservées aux cas les plus difficiles en raison de leur complexité et de leurs effets secondaires potentiels [6].
La greffe de cellules souches peut être nécessaire dans certaines situations à haut risque. Elle offre une chance de guérison supplémentaire lorsque les traitements conventionnels s'avèrent insuffisants [11].
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024-2025 marque un tournant dans le traitement de la leucémie-lymphome lymphoblastique à précurseurs B. Plusieurs innovations thérapeutiques prometteuses émergent des laboratoires de recherche mondiaux [2].
Le RZALEX® représente l'une des avancées les plus significatives de 2024. Ce nouveau médicament ciblé montre des résultats encourageants dans les essais cliniques de phase II, avec un profil de tolérance amélioré par rapport aux chimiothérapies conventionnelles .
En France, les essais cliniques se multiplient grâce à l'initiative U-Link, qui facilite l'accès des patients aux thérapies innovantes. Cette plateforme collaborative permet d'accélérer le développement de nouveaux traitements et d'offrir des options thérapeutiques supplémentaires aux patients en impasse [2].
D'ailleurs, les découvertes récentes d'un hôpital de Shanghai ouvrent de nouvelles perspectives thérapeutiques. Bien que initialement développées pour le cancer du poumon, ces approches innovantes pourraient être adaptées aux hémopathies malignes .
Le CT-P10 fait également l'objet d'études approfondies en 2024-2025. Ce biosimilaire pourrait permettre de réduire significativement les coûts de traitement tout en maintenant une efficacité équivalente . Ces innovations s'inscrivent dans une démarche d'amélioration continue de la prise en charge, visant à optimiser à la fois l'efficacité thérapeutique et la qualité de vie des patients.
Vivre au Quotidien avec Leucémie-lymphome lymphoblastique à précurseurs B
Vivre avec une leucémie-lymphome lymphoblastique à précurseurs B implique des adaptations importantes dans la vie quotidienne. Cependant, de nombreux patients parviennent à maintenir une qualité de vie satisfaisante grâce à un accompagnement adapté [8].
La gestion de la fatigue constitue souvent le défi principal. Il est important d'apprendre à écouter son corps et à adapter ses activités en conséquence. Des périodes de repos régulières et une activité physique douce, adaptée à vos capacités, peuvent considérablement améliorer votre bien-être [8].
L'alimentation joue un rôle crucial pendant le traitement. Une nutrition équilibrée aide à maintenir les forces et à mieux tolérer les thérapies. Votre équipe soignante pourra vous orienter vers un diététicien spécialisé si nécessaire.
Sur le plan professionnel ou scolaire, des aménagements sont souvent possibles. Pour les enfants, un projet d'accueil individualisé peut être mis en place pour faciliter la scolarité. Les adultes peuvent bénéficier d'un temps partiel thérapeutique ou d'adaptations de poste [8].
Le soutien psychologique s'avère précieux pour traverser cette épreuve. N'hésitez pas à exprimer vos inquiétudes et à solliciter l'aide de professionnels. Beaucoup de patients trouvent également du réconfort dans les groupes de parole ou les associations de patients.
Les Complications Possibles
La leucémie-lymphome lymphoblastique à précurseurs B peut entraîner diverses complications, liées soit à la maladie elle-même, soit aux traitements administrés. Une surveillance attentive permet de les prévenir ou de les traiter rapidement [5,9].
Les complications infectieuses représentent le risque le plus fréquent. L'immunosuppression causée par la maladie et les traitements favorise les infections bactériennes, virales ou fongiques. Ces infections peuvent être graves et nécessiter une hospitalisation d'urgence [9].
Les complications hémorragiques résultent de la diminution des plaquettes. Elles se manifestent par des ecchymoses, des saignements de nez ou, plus rarement, des hémorragies internes. Une surveillance régulière de la numération plaquettaire est donc indispensable [9].
Chez l'enfant, des anomalies dentaires peuvent survenir suite aux traitements intensifs. Une étude récente a montré que le groupe pronostique et le protocole de traitement influencent significativement le développement de ces complications [5]. Un suivi odontologique spécialisé est donc recommandé.
D'autres complications peuvent inclure des troubles de la croissance chez l'enfant, des problèmes de fertilité, ou des seconds cancers à long terme. Heureusement, les protocoles actuels visent à minimiser ces risques tout en préservant l'efficacité thérapeutique [5].
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de la leucémie-lymphome lymphoblastique à précurseurs B s'est considérablement amélioré ces dernières décennies. Aujourd'hui, la majorité des patients peut espérer une guérison complète, particulièrement dans les formes pédiatriques [7,8].
Chez l'enfant, le taux de survie à 5 ans dépasse désormais 90% pour les formes de risque standard. Cette amélioration remarquable résulte des progrès dans la compréhension de la maladie et l'optimisation des protocoles thérapeutiques [7]. Les formes à haut risque atteignent également des taux de survie de 70-80%.
Pour les adultes, le pronostic reste plus réservé mais s'améliore progressivement. Les taux de survie à 5 ans varient entre 40% et 70% selon l'âge et les facteurs pronostiques. Les patients jeunes adultes (moins de 40 ans) bénéficient généralement d'un meilleur pronostic [8].
Plusieurs facteurs influencent le pronostic : l'âge au diagnostic, la réponse au traitement initial, les anomalies cytogénétiques et la maladie résiduelle minimale. La réponse précoce au traitement constitue l'un des facteurs pronostiques les plus importants [7].
Il faut savoir que chaque situation est unique. Votre équipe médicale pourra vous donner des informations plus précises sur votre pronostic personnel, en tenant compte de tous les facteurs spécifiques à votre cas.
Peut-on Prévenir Leucémie-lymphome lymphoblastique à précurseurs B ?
La prévention de la leucémie-lymphome lymphoblastique à précurseurs B reste limitée en raison de la méconnaissance de ses causes exactes. Cependant, certaines mesures peuvent contribuer à réduire les risques [4,9].
La limitation de l'exposition aux radiations constitue la seule mesure préventive clairement établie. Cela concerne principalement l'exposition professionnelle ou les examens radiologiques répétés non justifiés. Rassurez-vous : les doses utilisées en imagerie médicale moderne présentent un risque négligeable [9].
Maintenir un système immunitaire en bonne santé pourrait également jouer un rôle protecteur. Une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et un sommeil suffisant contribuent au bon fonctionnement des défenses naturelles [9].
Concernant les facteurs génétiques, aucune prévention n'est actuellement possible. Cependant, la recherche sur le microenvironnement médullaire ouvre de nouvelles perspectives pour comprendre et potentiellement prévenir le développement de la maladie [4].
L'important est de rester vigilant face aux symptômes évocateurs et de consulter rapidement en cas de signes d'alarme. Un diagnostic précoce améliore significativement les chances de guérison, même si la prévention primaire reste impossible dans la plupart des cas.
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités de santé françaises ont émis des recommandations précises concernant la prise en charge de la leucémie-lymphome lymphoblastique à précurseurs B. La HAS a notamment publié une décision importante en septembre 2024 concernant l'accès au Blincyto® [1].
Cette décision de la HAS du 5 septembre 2024 élargit l'accès au blinatumomab pour certaines formes de leucémie lymphoblastique. Cette immunothérapie innovante devient ainsi disponible dans des indications spécifiques, marquant une avancée significative dans l'arsenal thérapeutique français [1].
Les recommandations nationales insistent sur la nécessité d'une prise en charge dans des centres spécialisés en hématologie pédiatrique ou adulte. Cette centralisation permet d'optimiser les résultats thérapeutiques et de attendur un suivi de qualité [1].
Le suivi à long terme fait également l'objet de recommandations spécifiques. Les survivants de leucémie de l'enfance doivent bénéficier d'une surveillance prolongée pour dépister d'éventuelles complications tardives [7]. Cette surveillance inclut des bilans cardiologiques, endocriniens et de fertilité.
Enfin, les autorités recommandent l'inclusion des patients éligibles dans les essais cliniques disponibles. Cette démarche permet d'accéder aux thérapies les plus innovantes tout en contribuant au progrès de la recherche médicale [2].
Ressources et Associations de Patients
De nombreuses ressources sont disponibles pour accompagner les patients atteints de leucémie-lymphome lymphoblastique à précurseurs B et leurs familles. Ces structures offrent soutien, information et entraide [8].
L'Association Laurette Fugain constitue une référence majeure en France pour les leucémies et lymphomes. Elle propose des programmes d'accompagnement, des aides financières et soutient la recherche médicale. Ses antennes régionales offrent un accompagnement de proximité.
La Ligue contre le Cancer dispose également de services spécialisés dans les hémopathies malignes. Ses comités départementaux proposent des aides concrètes : transport, hébergement, soutien psychologique et social.
Pour les familles d'enfants malades, l'association Imagine for Margo développe des programmes spécifiques. Elle finance la recherche pédiatrique et accompagne les familles dans leur parcours de soins [8].
Les réseaux sociaux et forums spécialisés permettent également d'échanger avec d'autres patients. Ces espaces d'entraide offrent un soutien précieux, particulièrement pour partager les expériences et conseils pratiques.
N'oubliez pas que votre équipe soignante reste votre premier interlocuteur. Les assistantes sociales hospitalières peuvent vous orienter vers les ressources les plus adaptées à votre situation personnelle.
Nos Conseils Pratiques
Faire face à une leucémie-lymphome lymphoblastique à précurseurs B nécessite une approche globale. Voici nos conseils pratiques pour mieux vivre cette épreuve au quotidien.
Organisez votre suivi médical : tenez un carnet de bord avec vos rendez-vous, résultats d'examens et effets secondaires. Cette organisation facilite la communication avec votre équipe soignante et vous aide à mieux comprendre votre parcours.
Concernant l'alimentation, privilégiez des repas équilibrés et fractionnés. En cas de nausées, les aliments froids sont souvent mieux tolérés. Hydratez-vous régulièrement et n'hésitez pas à consulter un diététicien spécialisé.
Préservez votre énergie en planifiant vos activités aux moments où vous vous sentez le mieux. Alternez périodes d'activité et de repos. Une activité physique douce, adaptée à vos capacités, peut améliorer votre bien-être général.
Sur le plan psychologique, exprimez vos émotions et n'hésitez pas à demander de l'aide. Certains patients trouvent du réconfort dans la méditation, la relaxation ou les activités créatives. L'important est de trouver ce qui vous convient.
Enfin, maintenez autant que possible vos liens sociaux. Même si vos capacités sont réduites, garder le contact avec vos proches contribue à votre moral et à votre qualité de vie.
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes d'alarme nécessitent une consultation médicale urgente chez les patients atteints de leucémie-lymphome lymphoblastique à précurseurs B. La reconnaissance précoce de ces symptômes peut éviter des complications graves [9,10].
Consultez immédiatement en cas de fièvre supérieure à 38°C, surtout si elle persiste plus de 24 heures. Les patients sous traitement présentent un risque infectieux majoré nécessitant une prise en charge rapide [9].
Les saignements anormaux constituent également un motif de consultation urgente : saignements de nez prolongés, ecchymoses multiples apparues spontanément, ou tout saignement inhabituel. Ces signes peuvent témoigner d'une chute dangereuse des plaquettes [10].
Une dyspnée (essoufflement) inhabituelle, des douleurs thoraciques ou des palpitations doivent alerter. Ces symptômes peuvent révéler une atteinte cardiaque ou pulmonaire nécessitant une évaluation urgente [9].
D'autres signes justifient une consultation rapide : vomissements persistants empêchant l'alimentation, douleurs abdominales intenses, ou altération importante de l'état général. En cas de doute, il vaut toujours mieux consulter : votre équipe soignante préfère être sollicitée pour rien plutôt que de passer à côté d'une complication [10].
N'oubliez pas que vous disposez généralement d'un numéro d'urgence spécifique à votre service d'hématologie, disponible 24h/24.
Questions Fréquentes
La leucémie-lymphome lymphoblastique à précurseurs B est-elle héréditaire ?
Dans la grande majorité des cas, cette pathologie n'est pas héréditaire. Bien que certaines prédispositions génétiques existent, elles restent exceptionnelles. La maladie résulte généralement d'anomalies génétiques acquises au cours de la vie.
Peut-on guérir complètement de cette maladie ?
Oui, la guérison est possible et même fréquente, particulièrement chez l'enfant où les taux de guérison dépassent 90%. Chez l'adulte, les chances de guérison varient selon l'âge et les facteurs pronostiques, mais restent significatives.
Combien de temps dure le traitement ?
La durée totale du traitement varie généralement entre 2 et 3 ans. Elle comprend une phase intensive initiale de quelques mois, suivie d'un traitement de maintenance plus léger mais prolongé.
Peut-on avoir des enfants après le traitement ?
Les traitements peuvent affecter la fertilité, mais des mesures de préservation sont possibles avant le début des thérapies. De nombreux patients ont pu avoir des enfants après leur guérison. Une consultation spécialisée permet d'évaluer les options disponibles.
Faut-il éviter certains aliments pendant le traitement ?
Certaines précautions alimentaires sont recommandées, notamment éviter les aliments crus ou peu cuits en raison du risque infectieux. Votre équipe soignante vous donnera des conseils nutritionnels adaptés à votre situation.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Décision n° 2024.0232/DC/SEM du 5 septembre 2024 de la HAS concernant l'accès au Blincyto®Lien
- [2] Essais cliniques en France - U-Link, Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [3] La découverte d'un hôpital de Shanghai dans le traitement, Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [4] RZALEX®, Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [5] Blinatumomab in Standard-Risk B-Cell Acute, Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [6] CT-P10 Drug Profile, Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [8] Influence du microenvironnement de la moelle osseuse sur le développement des leucémies aigües lymphoblastiques B et les résistances thérapeutiques, 2023Lien
- [9] Impact du groupe pronostique et du protocole de traitement sur le développement d'anomalies dentaires des enfants traités pour la leucémie aigüe lymphoblastique, 2022Lien
- [10] Les cellules CAR-T ont-elles tenu leurs promesses dans le traitement des leucémies aiguës en 2024?, 2024Lien
- [12] Suivi des personnes atteintes d'un cancer de l'enfant en France métropolitaine depuis 2000, 2022Lien
- [13] Déficiences, limitations d'activité et restrictions de participation à long terme des survivants de la leucémie aiguë lymphoblastique pédiatrique, 2022Lien
- [15] Leucémie lymphoblastique aiguë - Hématologie et oncologie, MSD ManualsLien
- [16] Qu'est-ce que la leucémie lymphoblastique aiguë?, Société canadienne du cancerLien
- [17] Leucémies aiguës lymphoblastiques (LAL) - InfoCancer, ARCAGYLien
Publications scientifiques
- [PDF][PDF] Lymphome Malin Non Hodgkinien: Aspects cliniques, thérapeutiques, et évolutifs dans le service d'Hématologie Oncologie Médicale du CHU du Point G [PDF]
- Influence du microenvironnement de la moelle osseuse sur le développement desleucémies aigües lymphoblastiques B et les résistances thérapeutiques (2023)
- … du groupe pronostique et du protocole de traitement sur le développement d'anomalies dentaires des enfants traités pour la leucémie aigüe lymphoblastique (2022)
- Les cellules CAR-T ont-elles tenu leurs promesses dans le traitement des leucémies aiguës en 2024? (2024)
- LES LYMPHOMES PRIMITIFS CUTANES T: REVUE DE LA LITTERATURE (2023)[PDF]
Ressources web
- Leucémie lymphoblastique aiguë - Hématologie et oncologie (msdmanuals.com)
Les symptômes comprennent asthénie, pâleur, infections, douleurs osseuses, symptômes du système nerveux central (p. ex., céphalées), ecchymoses et hémorragies.
- Qu'est-ce que la leucémie lymphoblastique aiguë? (cancer.ca)
La leucémie lymphoblastique aiguë (LLA) est un cancer qui prend naissance dans les cellules souches du sang. Les cellules souches sont des cellules de base ...
- Leucémies aiguës lymphoblastiques (LAL) - InfoCancer (arcagy.org)
29 janv. 2025 — La LAL se manifeste par une infiltration blastique de la moelle osseuse et d'autres organes périphériques tels que le foie, la rate et les ...
- Symptômes de la leucémie (cancer.ca)
La leucémie aiguë peut causer des signes et des symptômes semblables à ceux de la grippe. Ils apparaissent soudainement en quelques jours ou en quelques ...
- Leucémie aiguë lymphoblastique à précurseurs B (orpha.net)
Les patients présentent des signes d'insuffisance de la moelle osseuse (à savoir, thrombocytopénie, anémie et/ou neutropénie) et un nombre de leucocytes ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
