Leucémie Aigüe Mégacaryoblastique : Guide Complet 2025 - Symptômes, Traitements
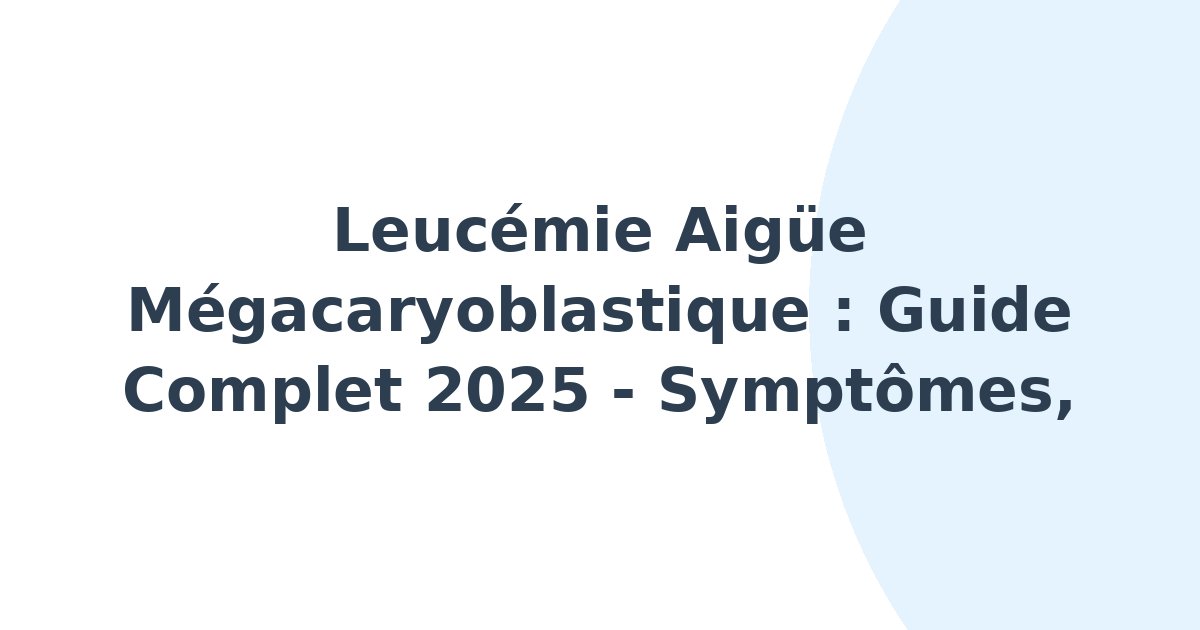
La leucémie aigüe mégacaryoblastique représente une forme rare mais particulièrement agressive de cancer du sang. Cette pathologie, qui touche principalement les cellules productrices de plaquettes, nécessite une prise en charge spécialisée et rapide. Heureusement, les avancées thérapeutiques récentes offrent de nouveaux espoirs aux patients et à leurs familles.
Téléconsultation et Leucémie aigüe mégacaryoblastique
Téléconsultation non recommandéeLa leucémie aiguë mégacaryoblastique est une urgence hématologique nécessitant un diagnostic immédiat par examens spécialisés (myélogramme, cytogénétique) et une prise en charge hospitalière rapide. L'examen clinique complet et les analyses biologiques approfondies sont indispensables pour confirmer le diagnostic et évaluer le pronostic.
Ce qui peut être évalué à distance
Recueil de l'historique des symptômes récents (fatigue, saignements, infections), évaluation de l'état général du patient, analyse des antécédents familiaux d'hémopathies malignes, orientation vers une prise en charge spécialisée urgente, suivi à distance après stabilisation du patient en traitement.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examen physique complet avec palpation des aires ganglionnaires et de la rate, réalisation du myélogramme avec analyse cytologique et immunophénotypage, bilan biologique complet incluant hémogramme et chimie, évaluation cardiaque pré-thérapeutique.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Suspicion diagnostique initiale nécessitant un myélogramme en urgence, évaluation de l'état général et des complications hémorragiques ou infectieuses, mise en place du traitement d'induction en milieu spécialisé, surveillance rapprochée des effets secondaires de la chimiothérapie.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Syndrome hémorragique sévère avec chute importante des plaquettes, syndrome infectieux grave avec neutropénies profondes, syndrome de lyse tumorale, détresse respiratoire ou signes de leucostase.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Saignements importants (hémorragies digestives, cérébrales, pulmonaires) ou purpura extensif
- Fièvre élevée persistante avec frissons et signes d'infection sévère
- Essoufflement majeur, douleurs thoraciques ou signes de leucostase pulmonaire
- Altération importante de l'état de conscience, confusion ou signes neurologiques
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Hématologue — consultation en présentiel indispensable
L'hématologue est indispensable pour le diagnostic par myélogramme et la prise en charge spécialisée de cette leucémie aiguë. Une consultation en présentiel est obligatoire pour l'examen clinique, les prélèvements diagnostiques et l'initiation du traitement en urgence.
Leucémie Aigüe Mégacaryoblastique : Définition et Vue d'Ensemble
La leucémie aigüe mégacaryoblastique (LAM-M7) constitue un sous-type particulier de leucémie aigüe myéloïde. Cette maladie se caractérise par une prolifération anormale et incontrôlée de cellules immatures appelées mégacaryoblastes, qui sont normalement destinées à devenir des plaquettes [5].
Concrètement, votre moelle osseuse produit massivement ces cellules défectueuses au lieu de fabriquer les cellules sanguines normales dont votre corps a besoin. Ces cellules malades envahissent progressivement l'espace médullaire, empêchant la production normale de globules rouges, globules blancs et plaquettes [6].
Cette pathologie représente environ 3 à 5% de toutes les leucémies aigües myéloïdes chez l'adulte, mais sa fréquence augmente significativement chez les enfants, particulièrement ceux atteints de trisomie 21 [3]. D'ailleurs, les recherches récentes montrent que cette association n'est pas fortuite et implique des mécanismes génétiques spécifiques [4].
Il faut savoir que la leucémie aigüe mégacaryoblastique se distingue des autres formes de leucémie par plusieurs caractéristiques uniques. Elle présente souvent une fibrose médullaire importante, rendant parfois difficile l'aspiration de moelle osseuse lors du diagnostic [7]. Cette particularité explique pourquoi le diagnostic peut parfois être plus complexe que pour d'autres types de leucémie.
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, la leucémie aigüe mégacaryoblastique touche environ 50 à 80 nouveaux patients chaque année, selon les données les plus récentes . Cette incidence relativement faible explique pourquoi cette pathologie est considérée comme une maladie rare nécessitant une expertise spécialisée.
L'âge médian au diagnostic varie considérablement selon les populations étudiées. Chez l'adulte, il se situe autour de 55-60 ans, mais on observe un pic d'incidence particulier chez les enfants de moins de 3 ans, notamment ceux porteurs d'anomalies chromosomiques . Cette distribution bimodale rend cette leucémie unique dans le paysage des hémopathies malignes.
Les données épidémiologiques récentes révèlent des disparités géographiques intéressantes. En Europe, l'incidence standardisée est légèrement supérieure dans les pays nordiques, tandis qu'en Asie, on observe une prévalence plus élevée de formes associées à des mutations spécifiques . Ces variations suggèrent l'implication de facteurs génétiques et environnementaux dans le développement de la maladie.
Concernant la répartition par sexe, les études montrent une légère prédominance masculine avec un ratio homme/femme de 1,3:1 chez l'adulte . Cependant, cette différence s'estompe dans les formes pédiatriques où la répartition devient plus équilibrée. L'évolution de l'incidence sur les dix dernières années reste stable, contrairement à d'autres types de leucémie qui montrent une tendance à l'augmentation.
Les Causes et Facteurs de Risque
Les causes exactes de la leucémie aigüe mégacaryoblastique restent largement méconnues, mais plusieurs facteurs de risque ont été identifiés. Le plus important est sans conteste la trisomie 21, qui multiplie par 10 à 20 le risque de développer cette forme particulière de leucémie [3,4].
Les anomalies génétiques acquises jouent également un rôle crucial. Les recherches récentes ont mis en évidence l'importance des mutations du gène GATA1, particulièrement fréquentes chez les patients porteurs de trisomie 21 [4]. Ces mutations semblent créer un terrain favorable au développement de la maladie en perturbant la différenciation normale des mégacaryocytes.
D'autres facteurs de risque incluent l'exposition à certains agents chimiothérapeutiques, notamment les inhibiteurs de topoisomérase II, ainsi que l'exposition aux radiations ionisantes [6]. Cependant, il faut noter que la majorité des patients ne présente aucun facteur de risque identifiable, ce qui souligne la complexité des mécanismes impliqués.
Les antécédents de syndrome myélodysplasique ou de leucémie myéloïde chronique constituent également des facteurs prédisposants, comme l'illustre une étude de cas récente documentant la transformation d'une LMC en leucémie aigüe mégacaryoblastique [2]. Cette évolution, bien que rare, souligne l'importance d'une surveillance régulière chez les patients atteints d'hémopathies chroniques.
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes de la leucémie aigüe mégacaryoblastique peuvent être trompeurs car ils ressemblent souvent à ceux d'autres pathologies plus courantes. La fatigue intense et persistante constitue généralement le premier signe d'alarme, accompagnée d'une pâleur inhabituelle due à l'anémie [5].
Les troubles de la coagulation représentent une caractéristique particulière de cette forme de leucémie. Vous pourriez remarquer des ecchymoses qui apparaissent sans raison apparente, des saignements de nez fréquents ou des règles anormalement abondantes chez la femme [5,7]. Ces manifestations hémorragiques résultent de la chute du nombre de plaquettes fonctionnelles.
La fièvre sans cause évidente, souvent accompagnée de frissons, traduit la vulnérabilité aux infections liée à la diminution des globules blancs normaux. Certains patients développent également des douleurs osseuses, particulièrement au niveau du sternum et des côtes, en raison de l'infiltration de la moelle osseuse par les cellules leucémiques [5].
Il est important de noter que chez l'enfant, les symptômes peuvent être plus subtils. Une irritabilité inhabituelle, un refus de jouer ou une perte d'appétit persistante doivent alerter les parents . D'ailleurs, la présence d'une splénomégalie (augmentation du volume de la rate) est plus fréquente dans les formes pédiatriques et peut se manifester par une sensation de pesanteur abdominale.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic de la leucémie aigüe mégacaryoblastique nécessite une approche méthodique et spécialisée. Tout commence généralement par une numération formule sanguine qui révèle des anomalies caractéristiques : anémie, thrombopénie sévère et présence de cellules anormales dans le sang circulant [7].
L'étape cruciale reste le myélogramme, bien que celui-ci puisse s'avérer techniquement difficile en raison de la fibrose médullaire fréquemment associée à cette pathologie. Lorsque l'aspiration médullaire est impossible, une biopsie ostéo-médullaire devient indispensable pour établir le diagnostic [7]. Cette procédure permet d'analyser l'architecture de la moelle osseuse et de quantifier l'infiltration leucémique.
L'identification précise du sous-type nécessite des techniques sophistiquées. L'immunophénotypage par cytométrie en flux recherche l'expression de marqueurs spécifiques des mégacaryoblastes, notamment CD41, CD42b et CD61 [5]. Ces marqueurs permettent de différencier cette forme des autres types de leucémie aigüe myéloïde.
Les analyses génétiques complètent le bilan diagnostique. La recherche de mutations du gène GATA1, particulièrement importante chez les patients porteurs de trisomie 21, influence directement les choix thérapeutiques [3,4]. D'autres anomalies chromosomiques, comme les translocations impliquant le chromosome 21, sont également recherchées systématiquement.
Le bilan d'extension comprend une imagerie thoraco-abdomino-pelvienne pour évaluer l'atteinte extramedullaire, ainsi qu'un bilan cardiaque et hépatique avant l'initiation du traitement. Ces examens permettent d'adapter la stratégie thérapeutique en fonction de l'état général du patient et des comorbidités éventuelles.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement de la leucémie aigüe mégacaryoblastique repose sur une approche multimodale adaptée à chaque patient. La chimiothérapie d'induction constitue généralement la première étape, utilisant des protocoles similaires à ceux des autres leucémies aigües myéloïdes, mais avec des adaptations spécifiques [3,7].
Chez l'enfant, les protocoles thérapeutiques ont été particulièrement affinés ces dernières années. Les recommandations récentes du comité leucémies de la SFCE préconisent une approche graduée, tenant compte de l'âge, du statut chromosomique et de la réponse au traitement initial [3]. Cette personnalisation du traitement a permis d'améliorer significativement le pronostic pédiatrique.
La greffe de cellules souches hématopoïétiques reste souvent nécessaire, particulièrement chez les patients présentant des facteurs de risque défavorables. Le choix du donneur et le maladienement pré-greffe sont adaptés aux spécificités de cette pathologie [6]. Les résultats de la greffe se sont améliorés grâce à une meilleure sélection des patients et à l'optimisation des protocoles de maladienement.
Les soins de support jouent un rôle crucial dans la prise en charge. La gestion des complications hémorragiques nécessite souvent des transfusions plaquettaires répétées, tandis que la prévention des infections repose sur une antibiothérapie prophylactique adaptée [5]. L'accompagnement psychologique et social fait partie intégrante de la prise en charge globale.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024 marque un tournant dans la recherche sur la leucémie aigüe mégacaryoblastique avec l'émergence de nouvelles approches thérapeutiques prometteuses. Les innovations récentes se concentrent particulièrement sur les thérapies ciblées et l'immunothérapie .
Une avancée majeure concerne la recherche de nouvelles vulnérabilités dans les formes résistantes au Vénétoclax, un inhibiteur de BCL-2 utilisé dans certaines leucémies [1]. Cette recherche ouvre la voie à de nouvelles combinaisons thérapeutiques pour les patients en rechute ou réfractaires aux traitements conventionnels.
Les thérapies CAR-T spécifiquement développées pour les leucémies mégacaryoblastiques font l'objet d'essais cliniques prometteurs en 2024-2025 . Ces cellules T génétiquement modifiées ciblent des antigènes spécifiques des mégacaryoblastes, offrant une approche thérapeutique personnalisée et potentiellement curative.
L'intelligence artificielle révolutionne également le diagnostic et le suivi thérapeutique. Les nouveaux outils de MedTech permettent une analyse plus précise des caractéristiques cellulaires et une prédiction améliorée de la réponse au traitement . Ces innovations facilitent la personnalisation des protocoles thérapeutiques dès le diagnostic initial.
Les recherches sur les oncogènes de fusion, notamment NUP98::KDM5A et CBFA2T3::GLIS2, ouvrent de nouvelles perspectives thérapeutiques ciblées [4]. Ces découvertes permettent d'identifier de nouveaux biomarqueurs pronostiques et des cibles thérapeutiques spécifiques pour les formes pédiatriques de la maladie.
Vivre au Quotidien avec la Leucémie Aigüe Mégacaryoblastique
Vivre avec une leucémie aigüe mégacaryoblastique transforme profondément le quotidien, mais de nombreuses stratégies permettent de maintenir une qualité de vie acceptable. La gestion de la fatigue chronique constitue souvent le défi principal, nécessitant une adaptation du rythme de vie et une planification minutieuse des activités [5].
L'alimentation joue un rôle crucial dans le maintien de votre état général. Il est recommandé de privilégier des repas riches en fer pour lutter contre l'anémie, tout en évitant les aliments crus qui pourraient présenter un risque infectieux en période de neutropénie [6]. Votre équipe soignante vous fournira des conseils nutritionnels personnalisés selon votre état et votre traitement.
La prévention des infections devient une priorité quotidienne. Cela implique des mesures d'hygiène renforcées, l'évitement des foules pendant les périodes de fragilité immunitaire, et une surveillance attentive de tout signe d'infection [5]. Rassurez-vous, ces précautions deviennent rapidement des habitudes et n'empêchent pas de maintenir une vie sociale épanouissante.
L'activité physique adaptée, même modérée, contribue significativement au bien-être général. Des exercices doux comme la marche, le yoga ou la natation peuvent être bénéfiques, toujours en accord avec votre équipe médicale [6]. L'important est de rester à l'écoute de votre corps et d'adapter l'intensité selon votre forme du moment.
Les Complications Possibles
La leucémie aigüe mégacaryoblastique peut entraîner diverses complications, certaines liées à la maladie elle-même, d'autres aux traitements nécessaires. Les complications hémorragiques représentent l'un des risques les plus préoccupants, en raison de la thrombopénie sévère caractéristique de cette pathologie [5,7].
Les saignements peuvent survenir à différents niveaux : cutanés (ecchymoses, pétéchies), muqueux (saignements de nez, gingivorragies) ou plus rarement viscéraux. Les hémorragies cérébrales, bien que rares, constituent une urgence vitale nécessitant une prise en charge immédiate [7]. C'est pourquoi une surveillance étroite de la numération plaquettaire est indispensable tout au long du traitement.
Les infections opportunistes représentent une autre complication majeure, particulièrement pendant les phases de neutropénie profonde induite par la chimiothérapie. Ces infections peuvent être bactériennes, virales ou fongiques, et nécessitent souvent une hospitalisation pour un traitement antibiotique intraveineux [5,6].
La fibrose médullaire, caractéristique de cette forme de leucémie, peut persister même après traitement et compliquer la récupération hématologique [7]. Cette fibrose peut également rendre difficiles les prélèvements médullaires ultérieurs nécessaires au suivi de la maladie. Heureusement, des techniques alternatives d'imagerie permettent aujourd'hui un suivi adapté.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de la leucémie aigüe mégacaryoblastique a considérablement évolué ces dernières années grâce aux progrès thérapeutiques et à une meilleure compréhension de la maladie. Globalement, le taux de survie à 5 ans varie entre 30 et 60% selon l'âge, les caractéristiques génétiques et la réponse au traitement initial [3].
Chez l'enfant, le pronostic est généralement plus favorable, particulièrement pour les formes associées à la trisomie 21. Les protocoles pédiatriques spécialisés permettent d'obtenir des taux de rémission complète supérieurs à 80% [3]. Cette amélioration résulte d'une meilleure adaptation des doses de chimiothérapie et d'une prise en charge multidisciplinaire optimisée.
Plusieurs facteurs influencent le pronostic. L'âge au diagnostic, la présence d'anomalies génétiques spécifiques, la réponse à la chimiothérapie d'induction et la possibilité de réaliser une greffe de cellules souches constituent les principaux éléments prédictifs [6]. Les patients présentant des mutations favorables du gène GATA1 ont généralement un meilleur pronostic [4].
Il est important de noter que chaque situation est unique. Votre équipe médicale évaluera votre pronostic individuel en tenant compte de tous ces facteurs. Les innovations thérapeutiques récentes, notamment les thérapies ciblées et l'immunothérapie, ouvrent de nouvelles perspectives pour améliorer encore ces résultats .
Peut-on Prévenir la Leucémie Aigüe Mégacaryoblastique ?
La prévention primaire de la leucémie aigüe mégacaryoblastique reste largement limitée en raison de la méconnaissance de ses causes exactes. Contrairement à d'autres cancers, il n'existe pas de mesures préventives spécifiques validées scientifiquement [6].
Cependant, certaines recommandations générales peuvent contribuer à réduire le risque de développer des hémopathies malignes. L'évitement de l'exposition aux radiations ionisantes non médicales, la limitation de l'exposition aux solvants organiques et aux pesticides constituent des mesures de bon sens [6]. Bien sûr, ces précautions ne attendussent pas une protection absolue.
Pour les patients porteurs de trisomie 21, une surveillance hématologique régulière est recommandée, particulièrement pendant l'enfance. Cette surveillance permet un diagnostic précoce et une prise en charge optimale en cas de développement de la maladie [3,4]. Les parents d'enfants trisomiques doivent être informés des signes d'alerte à surveiller.
La prévention secondaire revêt une importance particulière chez les patients ayant des antécédents d'hémopathie. Un suivi régulier avec numération formule sanguine permet de détecter précocement toute évolution vers une forme aigüe [2]. Cette surveillance est particulièrement importante chez les patients traités par chimiothérapie pour d'autres cancers.
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités de santé françaises et internationales ont établi des recommandations précises pour la prise en charge de la leucémie aigüe mégacaryoblastique. La Société Française de lutte contre les Cancers et leucémies de l'Enfant et de l'adolescent (SFCE) a publié en 2024 des recommandations actualisées pour la prise en charge néonatale et pédiatrique [3].
Ces recommandations préconisent une prise en charge centralisée dans des centres spécialisés disposant d'une expertise spécifique en hématologie pédiatrique. Cette centralisation permet d'optimiser les résultats thérapeutiques et de attendur l'accès aux innovations les plus récentes [3]. L'orientation précoce vers ces centres constitue un facteur pronostique favorable reconnu.
La Haute Autorité de Santé (HAS) insiste sur l'importance du diagnostic moléculaire systématique, incluant la recherche des mutations GATA1 et l'analyse cytogénétique complète. Ces examens maladienent les choix thérapeutiques et l'évaluation pronostique [4]. L'accès à ces techniques diagnostiques doit être attendu sur l'ensemble du territoire.
Les recommandations européennes soulignent l'importance de la préservation de la fertilité chez les patients jeunes avant l'initiation des traitements gonadotoxiques. Cette préoccupation, longtemps négligée, fait désormais partie intégrante de la prise en charge globale . Des consultations spécialisées doivent être proposées systématiquement aux patients concernés.
Ressources et Associations de Patients
De nombreuses ressources sont disponibles pour accompagner les patients atteints de leucémie aigüe mégacaryoblastique et leurs familles. La Fondation ARC pour la recherche sur le cancer propose des informations détaillées et régulièrement mises à jour sur les leucémies, incluant les formes rares comme la leucémie mégacaryoblastique [5].
L'association Laurette Fugain offre un soutien spécifique aux patients atteints de leucémie et à leurs proches. Elle propose des services d'accompagnement psychologique, des aides financières et organise des événements de sensibilisation. Leur site internet constitue une mine d'informations pratiques pour la vie quotidienne avec la maladie.
La Fondation pour la Recherche Médicale finance de nombreux projets de recherche sur les leucémies et publie régulièrement des actualités scientifiques accessibles au grand public [6]. Ces informations permettent aux patients de rester informés des dernières avancées thérapeutiques.
Au niveau local, de nombreux centres hospitaliers universitaires proposent des consultations d'annonce, des groupes de parole et des ateliers d'éducation thérapeutique. Ces services, souvent gratuits, constituent un complément précieux à la prise en charge médicale. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre équipe soignante sur les ressources disponibles dans votre région.
Nos Conseils Pratiques
Vivre avec une leucémie aigüe mégacaryoblastique nécessite quelques adaptations pratiques qui peuvent grandement améliorer votre qualité de vie. Tout d'abord, constituez-vous un dossier médical personnel complet incluant tous vos résultats d'examens, comptes-rendus d'hospitalisation et coordonnées de vos médecins. Cette organisation facilitera vos consultations et évitera la répétition d'examens.
Apprenez à reconnaître les signes d'alerte nécessitant une consultation urgente : fièvre supérieure à 38°C, saignements anormaux, essoufflement inhabituel ou douleurs intenses. Ayez toujours à portée de main les numéros d'urgence de votre service d'hématologie [5]. Cette vigilance peut faire la différence dans certaines situations.
Organisez votre domicile pour limiter les risques d'infection et de traumatisme. Évitez les plantes en pot qui peuvent héberger des champignons, maintenez une hygiène rigoureuse et éliminez les objets coupants ou contondants de votre environnement immédiat [6]. Ces précautions, bien qu'importantes, ne doivent pas vous empêcher de vivre normalement.
Maintenez une activité sociale adaptée en privilégiant les rencontres en petit comité et en évitant les lieux très fréquentés pendant vos périodes de fragilité immunitaire. La communication avec vos proches est essentielle : expliquez-leur votre maladie et vos besoins pour qu'ils puissent vous accompagner au mieux dans cette épreuve.
Quand Consulter un Médecin ?
Certains symptômes doivent vous amener à consulter rapidement votre médecin traitant ou votre hématologue. La fièvre constitue toujours un motif de consultation urgente chez un patient atteint de leucémie, même si elle semble bénigne. Une température supérieure à 38°C nécessite une évaluation médicale dans les plus brefs délais [5].
Les manifestations hémorragiques anormales représentent également des signes d'alarme importants. Des saignements de nez répétés, des règles anormalement abondantes, l'apparition d'ecchymoses sans traumatisme ou de petites taches rouges sur la peau (pétéchies) doivent vous conduire à consulter [5,7]. Ces signes peuvent témoigner d'une chute dangereuse du taux de plaquettes.
L'aggravation de la fatigue, particulièrement si elle s'accompagne d'un essoufflement au moindre effort, peut signaler une aggravation de l'anémie nécessitant une prise en charge rapide [5]. De même, l'apparition de douleurs osseuses intenses ou de ganglions palpables doit faire l'objet d'une consultation.
En cas de doute, n'hésitez jamais à contacter votre équipe soignante. Il vaut mieux une consultation de trop qu'une complication grave non détectée à temps. La plupart des services d'hématologie disposent d'une ligne téléphonique dédiée aux patients pour répondre à leurs interrogations et les orienter si nécessaire.
Questions Fréquentes
La leucémie aigüe mégacaryoblastique est-elle héréditaire ?
Cette pathologie n'est généralement pas héréditaire au sens strict. Cependant, certaines prédispositions génétiques, comme la trisomie 21, augmentent significativement le risque.
Peut-on guérir complètement de cette maladie ?
Oui, la guérison est possible, particulièrement chez l'enfant où les taux de rémission complète dépassent 80%. Les innovations thérapeutiques améliorent constamment les résultats.
Combien de temps dure le traitement ?
La durée varie entre 6 mois et 2 ans selon le protocole et la réponse thérapeutique. La greffe peut prolonger cette durée.
Puis-je avoir des enfants après le traitement ?
Les techniques de préservation de la fertilité sont systématiquement proposées avant traitement chez les patients jeunes.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Archives des Cancer. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [2] Conditions and Diseases - MedTech-Tracker. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [3] Y Belloucif. Recherche de nouvelles vulnérabilités dans la leucémie aiguë mégacaryoblastique résistante au Vénétoclax. 2023Lien
- [4] Z Karouchi, H Bencharef. Transformation d'une leucémie myéloïde chronique (LMC) en Leucémie aigue mégacaryoblastique: A propos d'un cas. 2023Lien
- [5] S Ducassou, W Abou Chahla. Orientation et prise en charge de la leucémie aiguë myéloïde néonatale: recommandations du comité leucémies de la SFCE. 2024Lien
- [6] M Roussy. Études des leucémies de l'enfant induites par les oncogènes de fusion NUP98:: KDM5A et CBFA2T3:: GLIS2. 2023Lien
- [11] Les symptômes et le diagnostic des leucémies aiguës. Fondation ARCLien
- [12] Leucémies : enjeux et recherche. Fondation pour la Recherche MédicaleLien
- [13] Les leucémies aiguës diagnostic et évolution. URML NormandieLien
Publications scientifiques
- Recherche de nouvelles vulnérabilités dans la leucémie aiguë mégacaryoblastique résistante au Vénétoclax (2023)
- Transformation d'une leucémie myéloïde chronique (LMC) en Leucémie aigue mégacaryoblastique: A propos d'un cas (2023)
- Orientation et prise en charge de la leucémie aiguë myéloïde néonatale: recommandations du comité leucémies de la SFCE (2024)
- Études des leucémies de l'enfant induites par les oncogènes de fusion NUP98:: KDM5A et CBFA2T3:: GLIS2 (2023)
- LEUCEMIE AIGUE PROMYELOCYTAIRE: ASPECTS HEMATOLOGIQUES (2023)[PDF]
Ressources web
- Les symptômes et le diagnostic des leucémies aiguës (fondation-arc.org)
10 févr. 2025 — Le myélogramme est l'examen clé permettant de poser un diagnostic de leucémie aigüe. Il consiste à analyser les cellules de la moelle osseuse ...
- Leucémies : enjeux et recherche (frm.org)
On recherche la présence d'une diminution des cellules sanguines : une anémie (globules rouges), une leucopénie (globules blancs) ou une thrombopénie ( ...
- LES LEUCEMIES AIGUËS DIAGNOSTIC ET EVOLUTION (urml-normandie.org)
Les leucémies aiguës (LA) sont des proliférations malignes du tissu hématopoïétique. Elles se caractérisent par l'accumulation dans la moelle et le sang de ...
- Leucémie: symptômes, traitements et espérance de vie (radiotherapie-hartmann.fr)
1 mai 2024 — Quels sont les symptômes de la leucémie aiguë ? · Une fatigue, un essoufflement , une pâleur ou des palpitations liées à l'anémie (baisse de ...
- Leucémies aiguës myéloblastiques (LAM) - InfoCancer (arcagy.org)
16 juin 2023 — Les leucémies aiguës myéloïdes (LAM) représentent un ensemble très hétérogène de proliférations clonales de progéniteurs hématopoïétiques ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
