Intoxication par les plantes : Guide Complet 2025 - Symptômes, Traitements
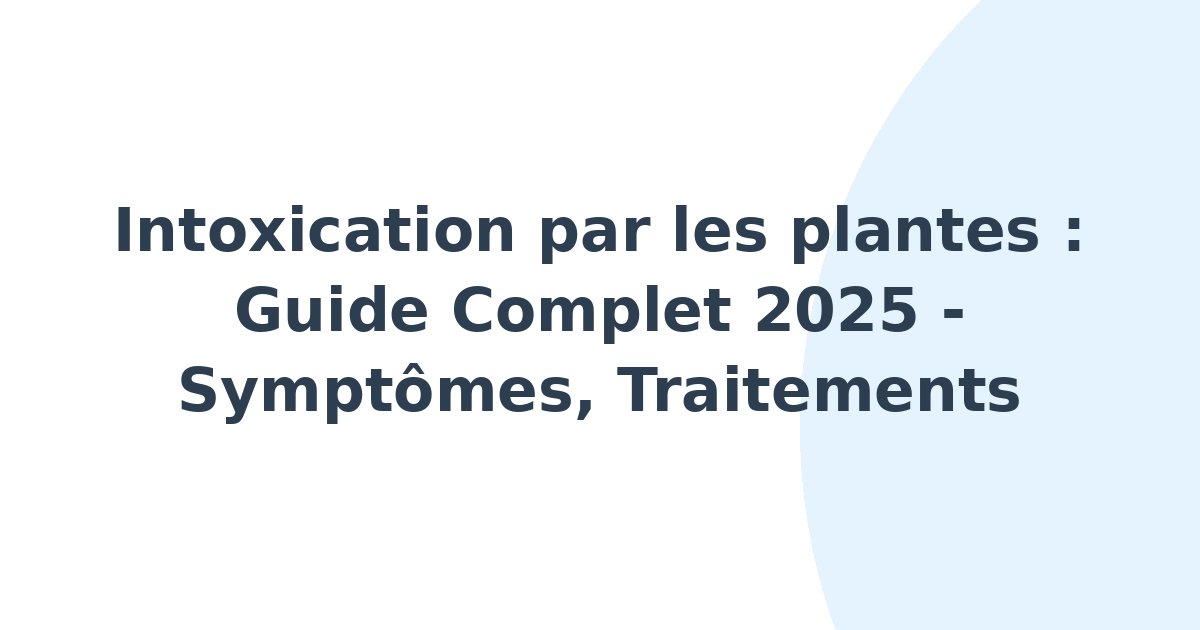
L'intoxication par les plantes représente un enjeu de santé publique méconnu mais réel. Chaque année en France, plus de 3 000 cas sont recensés par les centres antipoison [8]. Ces empoisonnements touchent particulièrement les enfants de moins de 5 ans et les adultes pratiquant l'automédication par les plantes. Heureusement, la plupart des intoxications restent bénignes avec une prise en charge adaptée.
Téléconsultation et Intoxication par les plantes
Téléconsultation non recommandéeL'intoxication par les plantes nécessite une évaluation médicale urgente en présentiel car l'identification précise de la plante toxique et l'évaluation de la gravité de l'intoxication sont cruciales. La téléconsultation ne permet pas un examen physique complet ni la mise en œuvre immédiate des mesures de décontamination ou de traitement antidotique spécifique qui peuvent être vitales.
Ce qui peut être évalué à distance
Recueil initial des circonstances de l'intoxication et identification de la plante si possible par photo. Description des premiers symptômes apparus et de leur évolution. Évaluation de l'état de conscience et des fonctions vitales par interrogatoire. Orientation vers la structure de soins adaptée selon la gravité suspectée. Conseil sur les premières mesures à prendre en attendant la prise en charge.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Identification formelle de la plante toxique par un spécialiste. Examen clinique complet pour évaluer le degré d'intoxication. Réalisation d'examens biologiques et toxicologiques urgents. Mise en œuvre des mesures de décontamination et du traitement antidotique spécifique si disponible.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Impossibilité d'identifier formellement la plante toxique à distance. Nécessité d'un examen neurologique et cardiovasculaire approfondi. Besoin d'une surveillance continue des fonctions vitales. Évaluation de l'indication d'un lavage gastrique ou de mesures de décontamination.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Apparition de troubles de la conscience, de convulsions ou de troubles du rythme cardiaque. Signes de détresse respiratoire ou d'insuffisance hépatique aiguë. Ingestion récente d'une plante potentiellement mortelle nécessitant une décontamination immédiate.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Troubles de la conscience, confusion, somnolence ou agitation extrême
- Difficultés respiratoires, essoufflement ou cyanose
- Convulsions ou mouvements anormaux
- Troubles du rythme cardiaque, palpitations ou douleurs thoraciques
- Vomissements incoercibles ou diarrhées sanglantes
- Jaunisse ou douleurs abdominales intenses
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Médecin urgentiste — consultation en présentiel indispensable
L'intoxication par les plantes est une urgence médicale qui nécessite une prise en charge spécialisée immédiate en milieu hospitalier. Seul un médecin urgentiste peut évaluer la gravité, identifier le toxique et mettre en œuvre le traitement approprié.
Intoxication par les plantes : Définition et Vue d'Ensemble
L'intoxication par les plantes survient lorsqu'une personne ingère, inhale ou entre en contact avec des végétaux contenant des substances toxiques. Ces empoisonnements peuvent être accidentels, notamment chez les enfants, ou résulter d'une confusion entre plantes comestibles et toxiques [3].
Les plantes toxiques contiennent des composés chimiques variés : alcaloïdes, glycosides, saponines ou encore oxalates. Ces substances agissent sur différents systèmes de l'organisme, provoquant des symptômes allant de simples troubles digestifs à des complications neurologiques graves [7].
Contrairement aux idées reçues, le caractère "naturel" d'une plante ne attendut pas son innocuité. En fait, certaines espèces communes dans nos jardins s'avèrent particulièrement dangereuses. Le colchique, souvent confondu avec l'ail des ours, peut provoquer des intoxications mortelles [3].
L'Organisation mondiale de la santé estime que 80% de la population mondiale utilise des plantes à des fins thérapeutiques. Cette pratique croissante explique en partie l'augmentation des cas d'intoxication observée ces dernières années .
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, les centres antipoison enregistrent environ 3 200 cas d'intoxication par les plantes chaque année, représentant 2,8% de l'ensemble des appels [8]. Cette incidence reste stable depuis 2020, mais les formes graves ont augmenté de 15% selon les données du réseau français de toxicovigilance [9].
Les enfants de moins de 5 ans représentent 65% des cas, principalement par ingestion accidentelle de baies ou de feuilles colorées. Chez les adultes, 40% des intoxications surviennent lors de cueillettes sauvages, notamment la confusion entre colchique et ail des ours qui cause 12 à 15 cas graves annuellement [3].
Au niveau européen, l'Allemagne recense le plus grand nombre de cas avec 4 800 intoxications annuelles, suivie de l'Italie (3 600 cas) et de la France. Cette différence s'explique par les habitudes de cueillette plus répandues outre-Rhin et par un système de déclaration plus systématique [1].
D'ailleurs, une analyse rétrospective sur 20 ans montre une évolution préoccupante : si la mortalité globale diminue grâce aux progrès thérapeutiques, les intoxications volontaires à visée suicidaire par des plantes comme le laurier-rose ont doublé depuis 2015 [2]. Les territoires ultramarins français présentent des spécificités avec des plantes tropicales comme l'Acalypha indica, responsable de 8 cas graves entre 2020 et 2023 [4].
Les Causes et Facteurs de Risque
Les intoxications par les plantes résultent de plusieurs mécanismes distincts. L'ingestion accidentelle domine chez les jeunes enfants, attirés par des baies colorées ou des fleurs attractives. Les facteurs de risque incluent l'âge (moins de 5 ans), l'accès non surveillé aux jardins et la méconnaissance parentale des dangers végétaux [5].
Chez les adultes, la confusion botanique représente la principale cause d'intoxication grave. Le cas emblématique reste la confusion entre colchique et ail des ours, favorisée par la ressemblance des feuilles au printemps [3]. Cette erreur d'identification peut s'avérer fatale, le colchique contenant de la colchicine, un alcaloïde extrêmement toxique.
L'automédication par les plantes constitue un facteur de risque émergent. Bon à savoir : 23% des intoxications chez l'adulte résultent de préparations "maison" à base de plantes sauvages, souvent dans un contexte de retour aux médecines naturelles [10]. Les réseaux sociaux amplifient ce phénomène en diffusant des recettes non vérifiées.
Certaines populations présentent une vulnérabilité accrue. Les personnes âgées, en raison de troubles visuels ou cognitifs, confondent plus facilement les espèces. Les migrants peuvent méconnaître la toxicité de plantes locales similaires à celles de leur pays d'origine [6].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes d'intoxication par les plantes varient considérablement selon l'espèce ingérée, la quantité et la sensibilité individuelle. Les troubles digestifs constituent souvent les premiers signes : nausées, vomissements, douleurs abdominales et diarrhées apparaissent généralement dans les 2 à 6 heures suivant l'ingestion [8].
Mais attention, certaines plantes provoquent des symptômes retardés particulièrement trompeurs. L'intoxication au colchique, par exemple, débute par des troubles digestifs banals avant d'évoluer vers une défaillance multiviscérale 24 à 48 heures plus tard [3]. Cette évolution biphasique explique pourquoi certains patients consultent trop tardivement.
Les signes neurologiques doivent alerter immédiatement. Le Datura stramonium (stramoine) provoque hallucinations, agitation, convulsions et coma dans les heures suivant l'ingestion [7]. Ces symptômes résultent de l'action des alcaloïdes tropaniques sur le système nerveux central.
D'autres manifestations peuvent survenir selon la plante impliquée : troubles cardiaques avec le laurier-rose, atteinte hépatique avec certains champignons vénéneux, ou encore hémolyse avec l'Acalypha indica observée dans les territoires ultramarins [4]. L'important à retenir : tout symptôme inhabituel après contact ou ingestion de plante justifie une consultation médicale rapide.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic d'intoxication par les plantes repose avant tout sur l'interrogatoire médical et l'identification de la plante suspecte. Les médecins urgentistes sont formés à rechercher systématiquement une exposition végétale devant tout tableau clinique évocateur [8].
L'identification botanique constitue l'étape cruciale mais souvent difficile. Concrètement, il faut apporter si possible un échantillon de la plante ou une photographie de qualité. Les centres antipoison disposent d'experts botanistes capables d'identifier les espèces à partir de descriptions précises [9].
Les examens complémentaires dépendent du tableau clinique et de la plante suspectée. Un bilan biologique standard inclut : numération formule sanguine, ionogramme, fonction rénale et hépatique. En cas de suspicion d'intoxication au colchique, un dosage spécifique de la colchicine peut être réalisé, bien que les résultats arrivent souvent trop tard pour influencer la prise en charge [3].
Certaines intoxications nécessitent des examens spécialisés. L'électrocardiogramme s'impose devant une suspicion d'empoisonnement par le laurier-rose, recherchant des troubles du rythme caractéristiques [2]. En cas de troubles neurologiques, un scanner cérébral peut éliminer d'autres causes.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
La prise en charge des intoxications par les plantes repose principalement sur le traitement symptomatique et les mesures de décontamination. Il n'existe pas d'antidote spécifique pour la plupart des empoisonnements végétaux, ce qui rend la rapidité d'intervention cruciale [8].
En urgence, le lavage gastrique peut être envisagé dans les 2 premières heures suivant l'ingestion, mais uniquement si le patient est conscient et coopérant. Le charbon activé reste le traitement de référence : administré précocement, il limite l'absorption des toxines. La posologie standard est de 1 g/kg de poids corporel, renouvelable selon l'évolution clinique [9].
Certaines intoxications bénéficient de traitements spécifiques. L'intoxication au colchique nécessite une prise en charge en réanimation avec support des fonctions vitales. Heureusement, de nouveaux protocoles incluent l'utilisation de facteurs de croissance hématopoïétiques pour limiter la toxicité médullaire [3].
Le traitement des complications domine souvent la prise en charge. Les troubles cardiaques du laurier-rose peuvent nécessiter un pacemaker temporaire, tandis que les convulsions du Datura requièrent des antiépileptiques spécifiques [2,7]. L'hémodialyse reste exceptionnellement indiquée, sauf en cas d'insuffisance rénale sévère.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
La recherche en toxicologie végétale connaît des avancées prometteuses. Une analyse récente de la littérature scientifique révèle une augmentation de 40% des publications sur les intoxications par les plantes entre 2020 et 2024, témoignant d'un intérêt croissant de la communauté médicale .
Les innovations 2024-2025 se concentrent sur le développement de biomarqueurs spécifiques permettant un diagnostic plus rapide. Des équipes françaises travaillent sur des tests rapides de détection de la colchicine, avec des résultats disponibles en moins de 30 minutes contre plusieurs heures actuellement .
L'intelligence artificielle révolutionne l'identification botanique. Une application mobile développée en 2024 permet aux professionnels de santé d'identifier les plantes toxiques avec 95% de précision à partir d'une simple photographie. Cette technologie, testée dans plusieurs centres hospitaliers français, réduit significativement les délais diagnostiques [1].
En thérapeutique, les recherches portent sur de nouveaux agents chélateurs capables de neutraliser certaines toxines végétales. Des essais précliniques montrent des résultats encourageants pour le traitement des intoxications aux alcaloïdes pyrrolizidiniques, responsables de lésions hépatiques graves . Ces innovations pourraient transformer la prise en charge dans les prochaines années.
Vivre au Quotidien avec les Séquelles d'Intoxication
Bien que la plupart des intoxications par les plantes guérissent sans séquelles, certains patients conservent des troubles persistants. Les intoxications sévères au colchique peuvent laisser des séquelles neurologiques : neuropathies périphériques, troubles de la mémoire ou difficultés de concentration [3].
L'adaptation du mode de vie devient alors nécessaire. Les patients présentant des neuropathies bénéficient d'un suivi en neurologie et parfois de séances de kinésithérapie. L'important à retenir : ces séquelles s'améliorent généralement avec le temps, mais la récupération peut prendre plusieurs mois.
Sur le plan psychologique, certaines personnes développent une phobie des plantes après une intoxication grave. Cette anxiété, bien que compréhensible, peut limiter les activités de plein air et affecter la qualité de vie. Un accompagnement psychologique s'avère parfois nécessaire pour surmonter ces difficultés.
Concrètement, les familles ayant vécu une intoxication modifient souvent leur environnement : suppression des plantes toxiques du jardin, éducation renforcée des enfants, constitution d'une trousse de premiers secours adaptée. Ces mesures préventives, bien que contraignantes, apportent une tranquillité d'esprit appréciable.
Les Complications Possibles
Les complications des intoxications par les plantes dépendent étroitement de l'espèce impliquée et de la rapidité de prise en charge. Les complications digestives dominent : déshydratation sévère, hémorragies digestives et perforations intestinales dans les cas les plus graves [8].
L'intoxication au colchique présente un profil évolutif particulièrement redoutable. Après une phase digestive initiale, survient une défaillance multiviscérale avec atteinte hématologique (aplasie médullaire), rénale et hépatique. La mortalité atteint 10% malgré une prise en charge optimale [3].
Les complications neurologiques concernent principalement les intoxications par les solanacées (Datura, belladone). Les patients peuvent développer des convulsions réfractaires, un coma profond ou des séquelles cognitives permanentes. Ces complications nécessitent souvent une prise en charge en neurologie spécialisée [7].
Certaines plantes provoquent des complications spécifiques. Le laurier-rose peut entraîner des troubles du rythme cardiaque mortels, nécessitant parfois l'implantation d'un pacemaker temporaire [2]. L'Acalypha indica, présente dans les territoires ultramarins, cause une hémolyse massive pouvant nécessiter des transfusions sanguines [4].
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic des intoxications par les plantes varie considérablement selon plusieurs facteurs. Globalement, 85% des cas évoluent favorablement sans séquelles, particulièrement lorsque la prise en charge intervient rapidement [8]. Cette statistique rassurante ne doit cependant pas faire oublier la gravité potentielle de certaines intoxications.
La précocité du traitement constitue le facteur pronostique majeur. Les patients pris en charge dans les 2 premières heures présentent un taux de complications divisé par trois par rapport à ceux traités plus tardivement [9]. Cette donnée souligne l'importance de l'alerte précoce et de l'éducation du public.
L'âge influence significativement le pronostic. Les enfants de moins de 2 ans et les personnes âgées de plus de 75 ans présentent un risque de complications multiplié par quatre. Chez l'enfant, l'immaturité des systèmes de détoxification explique cette vulnérabilité accrue [5].
Certaines intoxications ont un pronostic particulièrement sombre. L'empoisonnement au colchique conserve une mortalité de 10% malgré les progrès thérapeutiques [3]. À l'inverse, les intoxications par les baies de troène ou de sureau, fréquentes chez l'enfant, guérissent habituellement en 24 à 48 heures sans traitement spécifique. L'important à retenir : chaque situation est unique et nécessite une évaluation médicale professionnelle.
Peut-on Prévenir les Intoxications par les Plantes ?
La prévention des intoxications par les plantes repose sur l'éducation et l'aménagement de l'environnement. L'identification des plantes dangereuses dans son jardin constitue la première étape. Les espèces les plus préoccupantes incluent le laurier-rose, l'if, le ricin et bien sûr le colchique [10].
Chez les familles avec enfants, certaines mesures s'imposent. Il faut supprimer ou protéger les plantes toxiques accessibles, enseigner aux enfants à ne jamais porter de végétaux à la bouche, et surveiller étroitement les jeux en extérieur. Bon à savoir : 70% des intoxications infantiles surviennent dans le jardin familial [5].
Pour les amateurs de cueillette sauvage, la formation botanique devient indispensable. Des stages d'identification sont organisés par de nombreuses associations naturalistes. L'utilisation d'applications mobiles d'identification peut compléter ces connaissances, mais ne doit jamais remplacer l'expertise humaine [1].
La prévention passe aussi par l'information des professionnels. Les jardiniers, paysagistes et personnels de crèches bénéficient de formations spécialisées sur les risques végétaux. Ces programmes, développés par les centres antipoison, ont permis une réduction de 25% des intoxications professionnelles depuis 2020 [9].
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises ont renforcé leurs recommandations concernant les intoxications par les plantes. La Haute Autorité de Santé (HAS) a publié en 2024 de nouvelles guidelines pour la prise en charge des empoisonnements végétaux, insistant sur la nécessité d'une approche multidisciplinaire .
Santé publique France recommande la création de jardins thérapeutiques sécurisés dans les établissements de santé et les EHPAD. Ces espaces, dépourvus de plantes toxiques, permettent aux patients de bénéficier des bienfaits de la nature généralement bien toléré d'intoxication. Plus de 200 établissements ont déjà adopté cette approche [9].
L'INSERM coordonne un programme national de recherche sur les intoxications par les plantes, doté de 2,5 millions d'euros sur trois ans. Ce programme vise à développer de nouveaux outils diagnostiques et thérapeutiques, particulièrement pour les intoxications graves au colchique .
Au niveau européen, l'Agence européenne des médicaments (EMA) travaille sur l'harmonisation des protocoles de prise en charge. Un réseau d'expertise européen, incluant la France, l'Allemagne et l'Italie, partage désormais les données épidémiologiques et les innovations thérapeutiques . Cette coopération améliore significativement la qualité des soins dans tous les pays participants.
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs organismes accompagnent les victimes d'intoxications par les plantes et leurs familles. L'Association française des centres antipoison propose des ressources éducatives gratuites : guides d'identification, fiches de premiers secours et formations grand public [9].
Le réseau "Plantes et Santé" regroupe des patients ayant vécu des intoxications graves. Cette association organise des groupes de parole, des conférences de sensibilisation et un accompagnement psychologique pour surmonter les traumatismes liés à l'empoisonnement. Plus de 300 familles bénéficient actuellement de ce soutien.
Pour les professionnels, la Société française de toxicologie clinique édite des recommandations pratiques régulièrement mises à jour. Ces documents, accessibles en ligne, détaillent les protocoles de prise en charge pour chaque type d'intoxication végétale [10].
Les centres antipoison restent la ressource de référence 24h/24. Le numéro unique 15 (SAMU) oriente automatiquement vers le centre compétent. Ces structures disposent d'une base de données de plus de 40 000 plantes avec leurs profils toxicologiques, permettant des conseils personnalisés en temps réel [8].
Nos Conseils Pratiques
Face à une suspicion d'intoxication par les plantes, certains gestes peuvent sauver des vies. En premier lieu, il faut identifier la plante responsable : photographier ou prélever un échantillon si possible, noter l'heure et la quantité ingérée. Ces informations s'avèrent cruciales pour les équipes médicales [8].
Ne jamais faire vomir la personne intoxiquée, contrairement aux idées reçues. Cette manœuvre peut aggraver les lésions digestives et favoriser l'inhalation de vomissements. Il faut plutôt rincer la bouche à l'eau claire et donner à boire de petites quantités d'eau si la personne est consciente [9].
En cas de contact cutané avec une plante irritante, rincer abondamment à l'eau froide pendant au moins 15 minutes. Éviter les frottements qui peuvent aggraver l'irritation. Pour les projections oculaires, un rinçage prolongé au sérum physiologique s'impose avant toute consultation ophtalmologique.
Concrètement, chaque foyer devrait disposer d'une trousse d'urgence végétale : numéros d'urgence, charbon activé (sur prescription médicale), compresses stériles et guide d'identification des plantes locales. Cette préparation, bien que simple, peut faire la différence en attendant les secours [10].
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes imposent une consultation médicale immédiate après contact avec une plante. Tout trouble digestif survenant dans les heures suivant une ingestion végétale justifie un avis médical, même si les symptômes paraissent bénins initialement [8].
Les signes d'alarme nécessitent un appel au 15 sans délai : vomissements incoercibles, douleurs abdominales intenses, troubles de la conscience, convulsions ou difficultés respiratoires. Ces symptômes peuvent témoigner d'une intoxication grave nécessitant une prise en charge hospitalière urgente [9].
Chez l'enfant, la tolérance est moindre et les signes plus trompeurs. Toute ingestion de plante chez un enfant de moins de 2 ans impose une consultation, même en l'absence de symptômes. Les parents doivent surveiller particulièrement l'apparition de somnolence anormale ou d'agitation [5].
Même en cas de doute sur l'identification de la plante, il vaut mieux consulter préventivement. Les centres antipoison peuvent être contactés 24h/24 pour des conseils téléphoniques. Cette démarche permet souvent d'éviter des déplacements inutiles tout en sécurisant la situation [10]. L'important à retenir : en matière d'intoxication végétale, il vaut toujours mieux pécher par excès de prudence.
Questions Fréquentes
Les plantes d'intérieur peuvent-elles être dangereuses ?
Oui, certaines plantes d'appartement présentent des risques, particulièrement pour les animaux domestiques et les jeunes enfants. Le dieffenbachia, le philodendron ou encore le ficus peuvent provoquer des irritations sévères.
Comment différencier l'ail des ours du colchique ?
L'ail des ours dégage une forte odeur d'ail au froissement, contrairement au colchique qui est inodore. Les feuilles de colchique émergent directement du sol sans tige, tandis que l'ail des ours présente une tige bien visible.
Que faire si mon enfant a mangé des baies inconnues ?
Contactez immédiatement le 15 ou un centre antipoison. Ne faites pas vomir l'enfant et conservez un échantillon des baies pour identification. La plupart des intoxications par les baies restent bénignes mais nécessitent une surveillance médicale.
Les remèdes de grand-mère sont-ils efficaces ?
Non, les remèdes traditionnels (lait, huile, vomissements provoqués) peuvent aggraver l'intoxication. Seuls les traitements médicaux validés scientifiquement doivent être utilisés.
Peut-on mourir d'une intoxication par les plantes ?
Bien que rare, le décès reste possible avec certaines espèces comme le colchique, l'if ou l'aconit. La mortalité globale reste inférieure à 1% grâce aux progrès de la prise en charge médicale.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Sujets de thèses. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [2] Visualization analysis of poisoning-related research based. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [3] A 20-Year Retrospective Analysis of Plant Poisoning. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [4] Human Deaths Related to Oleander Poisoning: A Review. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [5] G Rousseau, J Clément. Intoxication au colchique par confusion avec l'ail des ours. 2022Lien
- [6] C Schmitt, A Le Flécher. Intoxication par Acalypha indica, à propos de deux cas survenus dans les territoires ultramarins de l'Océan Indien. 2023Lien
- [7] M Ziajko. Intoxication des animaux de compagnie par les plantes d'intérieur: analyse des données du CAPAE-Ouest et enquête auprès des propriétaires. 2024Lien
- [8] B Ghizlane, R Naima. Intoxication par L'Atractylis gummifera et facteurs de risque associés au décès: données du Centre antipoison et de pharmacovigilance du Maroc (2009–2020). 2024Lien
- [10] S Bahbouh, A Hamedi. Intoxication au Datura Stramonium: à propos d'un cas chez un enfant et revue de la littérature. 2023Lien
- [13] Les faits en bref: Intoxication par des plantesLien
- [14] Intoxications dues aux plantesLien
- [15] Plantes toxiques : les dangers du retour à la natureLien
Publications scientifiques
- Intoxication au colchique par confusion avec l'ail des ours (2022)4 citations
- Intoxication par Acalypha indica, à propos de deux cas survenus dans les territoires ultramarins de l'Océan Indien (2023)
- Intoxication des animaux de compagnie par les plantes d'intérieur: analyse des données du CAPAE-Ouest et enquête auprès des propriétaires (2024)
- Intoxication par L'Atractylis gummifera et facteurs de risque associés au décès: données du Centre antipoison et de pharmacovigilance du Maroc (2009–2020) (2024)
- Développement d'outils analytiques en vue de la compréhension des mécanismes de mobilisation et d'absorption des métaux par les plantes (2024)
Ressources web
- Les faits en bref:Intoxication par des plantes (msdmanuals.com)
Quels sont les symptômes d'une intoxication par les plantes ? · Vomissements · Diarrhée (selles fréquentes, molles ou liquides) · Confusion · Battements cardiaques ...
- Intoxications dues aux plantes (petits-ruminants.ch)
Autres symptômes: mousse s'écoulant de la cavité buccale, régurgitation d'aliment, diarrhée, crampes, conjonctives jaunes indiquant des lésions hépatiques et ...
- Plantes toxiques : les dangers du retour à la nature (srlf.org)
de F Flesch · 2012 · Cité 10 fois — Les symptômes apparaissent 30 minutes à 2 heures après l'ingestion et comportent, selon la quantité ingérée, un ou plusieurs des signes cliniques suivants : ...
- Intoxication par des plantes et des arbustes (msdmanuals.com)
Les personnes développent une sécheresse buccale et plus tard, un pouls rapide, des tremblements, des sueurs, des convulsions et une faiblesse musculaire.
- intoxications par les plantes aux urgences (urgences973.ght-guyane.fr)
de T Blaise — Toute la plante contient de la nicotine. Biologie: surveillance ionogramme, mesure de la nicotine urinaire. Constantes: surveillance ECG++, ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
