Infections à Rhabdoviridae : Guide Complet 2025 - Symptômes, Traitements
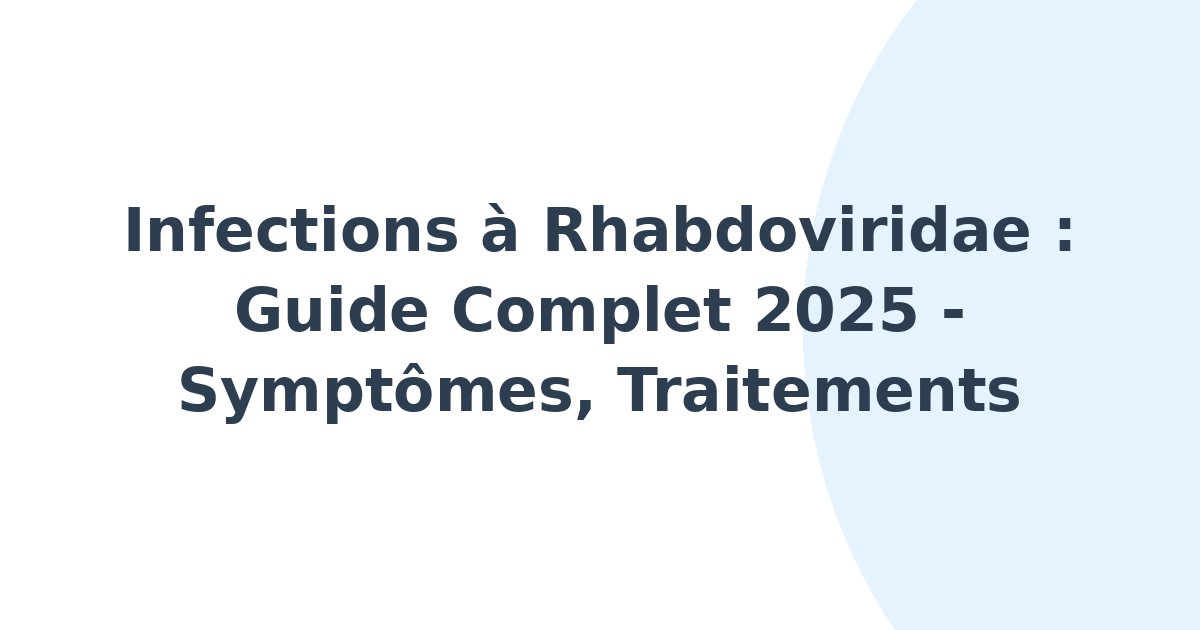
Les infections à Rhabdoviridae regroupent plusieurs maladies virales graves, dont la plus connue reste la rage. Cette famille de virus touche chaque année des milliers de personnes dans le monde. En France, bien que rare grâce à la vaccination préventive, ces pathologies nécessitent une prise en charge d'urgence. Découvrez dans ce guide complet tout ce qu'il faut savoir sur ces infections : symptômes, diagnostic, traitements et innovations 2025.
Téléconsultation et Infections à Rhabdoviridae
Téléconsultation non recommandéeLes infections à Rhabdoviridae, incluant la rage et d'autres encéphalites virales, représentent des urgences médicales majeures nécessitant une prise en charge hospitalière immédiate. Le diagnostic repose sur des examens spécialisés et la gravité potentielle de ces infections impose une évaluation clinique directe et des soins intensifs.
Ce qui peut être évalué à distance
Recueil de l'historique d'exposition (morsures d'animaux, contact avec chauves-souris). Description des premiers symptômes neurologiques ou prodromiques. Évaluation du statut vaccinal antirabique. Orientation vers une prise en charge d'urgence appropriée. Suivi post-exposition en complément du présentiel.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examen neurologique complet et évaluation de l'état de conscience. Prélèvements spécialisés pour diagnostic virologique (salive, LCR, biopsies). Mise en place du traitement post-exposition d'urgence. Hospitalisation et surveillance en soins intensifs.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Tout soupçon d'infection à Rhabdoviridae nécessite une hospitalisation immédiate. Évaluation neurologique approfondie impossible à distance. Mise en place urgente de la prophylaxie post-exposition. Surveillance continue de l'évolution neurologique.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Apparition de signes neurologiques après exposition à risque. Morsure ou griffure d'animal suspect de rage. Évolution rapidement progressive des symptômes avec altération de l'état de conscience.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Troubles de la déglutition avec hydrophobie ou aérophobie
- Signes neurologiques progressifs (confusion, agitation, paralysies)
- Spasmes musculaires involontaires ou convulsions
- Altération rapide de l'état de conscience ou coma
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Infectiologue — consultation en présentiel indispensable
Les infections à Rhabdoviridae sont des urgences infectieuses nécessitant l'expertise d'un infectiologue en milieu hospitalier. La prise en charge doit être immédiate et spécialisée, avec surveillance en soins intensifs.
Infections à Rhabdoviridae : Définition et Vue d'Ensemble
Les Rhabdoviridae constituent une famille de virus à ARN négatif responsables d'infections potentiellement mortelles chez l'homme et l'animal [4,10]. Ces virus se caractérisent par leur forme allongée en balle de fusil, d'où leur nom dérivé du grec "rhabdos" signifiant bâton.
Cette famille comprend plusieurs genres pathogènes pour l'homme. Le plus redoutable reste le virus de la rage (genre Lyssavirus), mais d'autres membres émergent comme préoccupations sanitaires [3]. Le virus Chandipura en Inde ou encore les virus vésiculaires constituent des exemples d'infections à Rhabdoviridae moins connues mais tout aussi préoccupantes [7].
Ces virus partagent des caractéristiques communes importantes. Ils possèdent une enveloppe lipidique qui les rend sensibles aux désinfectants usuels. Leur transmission s'effectue principalement par morsure d'animal infecté, mais certaines espèces peuvent se transmettre par d'autres vecteurs comme les moustiques [8]. L'important à retenir : ces infections nécessitent toujours une prise en charge médicale urgente.
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, les infections à Rhabdoviridae restent exceptionnelles grâce aux politiques de vaccination préventive. Selon Santé publique France, moins de 5 cas de rage humaine sont déclarés par décennie sur le territoire métropolitain [9]. Cette situation contraste fortement avec la situation mondiale où l'OMS estime à 59 000 le nombre de décès annuels dus à la rage [1].
L'épidémiologie varie considérablement selon les régions. En Asie et en Afrique, la rage reste endémique avec des taux d'incidence pouvant atteindre 10 cas pour 100 000 habitants dans certaines zones rurales [2]. Les innovations en matière de vaccins antirabiques développées en 2024-2025 visent justement à réduire ces disparités géographiques [1].
Concernant les autres Rhabdoviridae, les données épidémiologiques restent fragmentaires. Le virus Chandipura a causé plusieurs épidémies en Inde avec des taux de mortalité dépassant 70% chez les enfants [7]. En Europe, la surveillance des virus émergents de cette famille s'intensifie, notamment avec les changements climatiques qui modifient la répartition des vecteurs [3].
L'évolution sur les 10 dernières années montre une stabilité en France mais une recrudescence dans certaines régions du monde. Les projections pour 2025-2030 suggèrent une possible augmentation des cas importés liés aux voyages internationaux [5].
Les Causes et Facteurs de Risque
Les infections à Rhabdoviridae résultent principalement de l'exposition à des animaux infectés. Pour la rage, les mammifères carnivores constituent le réservoir principal : chiens, chats, renards, chauves-souris [9,11]. Mais attention, tous les mammifères peuvent potentiellement transmettre le virus.
Plusieurs facteurs augmentent votre risque d'exposition. Les activités professionnelles comme la médecine vétérinaire, la manipulation d'animaux sauvages ou les voyages en zones endémiques constituent des situations à risque élevé [11]. D'ailleurs, les spéléologues présentent un risque particulier d'exposition aux chauves-souris infectées.
Les facteurs environnementaux jouent également un rôle. Les changements climatiques modifient la répartition des vecteurs et réservoirs animaux [5]. En fait, certaines espèces de moustiques peuvent transmettre des Rhabdoviridae émergents, élargissant ainsi les modes de transmission traditionnels [8].
Bon à savoir : l'âge constitue un facteur de risque important. Les enfants, par leur comportement exploratoire et leur proximité avec les animaux, présentent une vulnérabilité accrue. Les personnes immunodéprimées développent également des formes plus sévères de ces infections [7].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes des infections à Rhabdoviridae évoluent classiquement en plusieurs phases. Pour la rage, la période d'incubation varie de quelques semaines à plusieurs mois, selon la localisation de la morsure et la charge virale [9,11]. Plus la morsure est proche du système nerveux central, plus l'incubation est courte.
La phase prodromique débute par des symptômes non spécifiques. Vous pourriez ressentir de la fièvre, des maux de tête, une fatigue inhabituelle. Ces signes ressemblent à une grippe banale, ce qui retarde souvent le diagnostic [11]. Cependant, une sensation de brûlure ou de picotement au site de morsure doit alerter.
Puis survient la phase neurologique caractéristique. Deux formes cliniques se distinguent : la rage furieuse avec hydrophobie, spasmes et agitation, et la rage paralytique avec paralysie progressive [9]. Les autres Rhabdoviridae peuvent provoquer des encéphalites avec convulsions, notamment chez l'enfant [7].
L'important à retenir : dès l'apparition des symptômes neurologiques, le pronostic devient sombre. C'est pourquoi la prophylaxie post-exposition reste cruciale avant cette phase symptomatique [11].
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic des infections à Rhabdoviridae repose avant tout sur l'anamnèse et l'examen clinique. Votre médecin recherchera systématiquement une notion d'exposition animale récente [11]. Cette enquête épidémiologique constitue l'élément clé du diagnostic, car les symptômes initiaux restent non spécifiques.
Les examens complémentaires varient selon le stade de la maladie. En phase pré-symptomatique, aucun test ne permet de confirmer l'infection. C'est pourquoi la prophylaxie post-exposition se base uniquement sur l'évaluation du risque d'exposition [9]. Concrètement, mieux vaut traiter par précaution que d'attendre une confirmation biologique.
Une fois les symptômes apparus, plusieurs tests deviennent disponibles. La recherche d'antigènes viraux dans la salive, les larmes ou une biopsie cutanée peut confirmer le diagnostic [11]. La sérologie reste peu fiable car les anticorps apparaissent tardivement. Les techniques de biologie moléculaire (PCR) offrent une sensibilité accrue mais nécessitent des laboratoires spécialisés.
Malheureusement, le diagnostic de certitude s'établit souvent post-mortem par examen histologique du cerveau. Cette réalité souligne l'importance cruciale de la prévention et du traitement précoce [9].
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement des infections à Rhabdoviridae repose principalement sur la prophylaxie post-exposition avant l'apparition des symptômes. Cette approche préventive associe un nettoyage soigneux de la plaie, l'administration d'immunoglobulines spécifiques et la vaccination antirabique [9,11].
Le protocole de vaccination a évolué ces dernières années. Désormais, 4 injections suffisent (J0, J3, J7, J14) contre 5 auparavant, grâce aux nouveaux vaccins plus immunogènes [1]. Cette simplification améliore l'observance du traitement, facteur crucial de son efficacité.
Une fois les symptômes neurologiques apparus, les options thérapeutiques restent limitées. Seuls quelques cas de guérison ont été rapportés avec le protocole de Milwaukee, associant coma artificiel et antiviraux [11]. Cependant, ce traitement expérimental présente des résultats inconstants et de lourdes séquelles.
Pour les autres Rhabdoviridae, les traitements demeurent symptomatiques. Les soins de réanimation visent à contrôler les convulsions et maintenir les fonctions vitales [7]. Rassurez-vous, la recherche progresse avec de nouvelles molécules antivirales en développement [6].
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024-2025 marque une révolution dans la prise en charge des infections à Rhabdoviridae. Les innovations portent principalement sur le développement de nouveaux vaccins antirabiques plus efficaces et mieux tolérés [1]. Ces vaccins de nouvelle génération utilisent des technologies d'ARN messager similaires à celles développées pour la COVID-19.
La recherche antivirale connaît également des avancées prometteuses. Le remdésivir, initialement développé contre d'autres virus, montre une activité intéressante contre certains Rhabdoviridae en modèles expérimentaux [6]. D'autres molécules ciblant spécifiquement la réplication virale sont en cours d'évaluation clinique.
Les approches diagnostiques évoluent rapidement. De nouveaux tests rapides permettront bientôt de détecter l'infection en quelques heures plutôt qu'en plusieurs jours [2]. Cette rapidité diagnostique pourrait révolutionner la prise en charge, notamment dans les zones reculées où l'accès aux laboratoires reste difficile.
Enfin, la surveillance épidémiologique s'améliore grâce aux technologies de séquençage génétique. Ces outils permettent de mieux comprendre l'évolution des virus et d'anticiper l'émergence de nouvelles souches [3,5]. L'intelligence artificielle aide désormais à prédire les zones à risque d'épidémie.
Vivre au Quotidien avec Infections à Rhabdoviridae
Heureusement, la plupart des personnes exposées aux Rhabdoviridae n'développent jamais la maladie grâce à la prophylaxie post-exposition. Cependant, cette période de traitement préventif peut générer de l'anxiété compréhensible [9]. Il est normal de s'inquiéter après une morsure suspecte.
Pour les rares survivants d'infections symptomatiques, la récupération s'avère longue et complexe. Les séquelles neurologiques peuvent inclure des troubles de la mémoire, des difficultés de concentration ou des troubles moteurs [11]. Un suivi neurologique prolongé et une rééducation adaptée deviennent alors nécessaires.
L'impact psychologique ne doit pas être négligé. La peur de développer la maladie, même après traitement préventif, peut persister plusieurs mois. Un soutien psychologique peut s'avérer bénéfique pour surmonter cette période d'incertitude [7].
Concrètement, les personnes à risque professionnel bénéficient d'une vaccination préventive. Cette protection permet de poursuivre sereinement les activités exposantes tout en maintenant une vigilance appropriée [9].
Les Complications Possibles
Les complications des infections à Rhabdoviridae dépendent largement du stade auquel le diagnostic est posé et le traitement initié. En l'absence de prophylaxie post-exposition, la mortalité approche les 100% une fois les symptômes neurologiques apparus [9,11].
Même avec un traitement préventif approprié, de rares échecs peuvent survenir. Ces situations exceptionnelles s'observent principalement lors d'expositions massives ou de retards de prise en charge [11]. C'est pourquoi la rapidité d'intervention reste cruciale après toute exposition suspecte.
Chez les rares survivants d'infections symptomatiques, les séquelles neurologiques constituent la règle plutôt que l'exception. Ces complications incluent des troubles cognitifs, des paralysies résiduelles et des troubles comportementaux [7]. La récupération fonctionnelle reste souvent partielle malgré une rééducation intensive.
Les autres Rhabdoviridae peuvent provoquer des complications spécifiques. Le virus Chandipura cause notamment des hémorragies cérébrales chez l'enfant, aggravant considérablement le pronostic [7]. Ces formes hémorragiques nécessitent une prise en charge en réanimation spécialisée.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic des infections à Rhabdoviridae dépend entièrement de la précocité de la prise en charge. Avec une prophylaxie post-exposition appropriée, le pronostic est excellent avec un taux de protection supérieur à 99% [9]. Cette efficacité remarquable explique l'importance cruciale du traitement préventif.
Malheureusement, une fois les symptômes neurologiques apparus, le pronostic devient sombre. Moins de 10 cas de guérison de rage symptomatique ont été rapportés dans la littérature médicale mondiale [11]. Ces rares survivants présentent généralement de lourdes séquelles neurologiques.
Pour les autres membres de la famille Rhabdoviridae, le pronostic varie selon l'espèce virale et l'âge du patient. Les infections à virus Chandipura présentent une mortalité particulièrement élevée chez l'enfant, dépassant 70% dans certaines séries [7]. Cependant, les formes adultes peuvent présenter une évolution plus favorable.
L'évolution à long terme des survivants nécessite un suivi spécialisé. Les troubles neurologiques peuvent s'améliorer partiellement avec le temps et la rééducation, mais une récupération complète reste exceptionnelle [11]. D'où l'importance capitale de la prévention primaire.
Peut-on Prévenir Infections à Rhabdoviridae ?
La prévention des infections à Rhabdoviridae repose sur plusieurs stratégies complémentaires. La vaccination préventive constitue la mesure la plus efficace pour les personnes à risque professionnel : vétérinaires, manipulateurs d'animaux, spéléologues [9]. Cette vaccination confère une protection durable nécessitant des rappels périodiques.
Les mesures comportementales jouent un rôle essentiel. Évitez tout contact avec les animaux sauvages, même apparemment inoffensifs. En voyage, méfiez-vous particulièrement des chiens et chats errants dans les zones endémiques [11]. Bon à savoir : même un animal domestique peut être porteur du virus sans présenter de symptômes évidents.
En cas d'exposition, la rapidité d'action détermine l'efficacité de la prévention. Nettoyez immédiatement la plaie à l'eau et au savon pendant 15 minutes minimum, puis désinfectez avec un antiseptique [9]. Consultez ensuite rapidement un médecin pour évaluer la nécessité d'une prophylaxie post-exposition.
Les campagnes de vaccination animale contribuent également à la prévention collective. En France, la vaccination obligatoire des carnivores domestiques a permis d'éliminer la rage autochtone [9]. Cette approche "One Health" illustre l'importance de la collaboration entre médecine humaine et vétérinaire.
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises ont établi des recommandations précises concernant la prise en charge des infections à Rhabdoviridae. La Haute Autorité de Santé (HAS) préconise une évaluation systématique du risque après toute exposition animale suspecte [9]. Cette évaluation tient compte de l'espèce animale, des circonstances de l'exposition et du statut vaccinal de l'animal.
Santé publique France maintient une surveillance épidémiologique active de ces infections. Tout cas suspect doit être déclaré immédiatement aux autorités sanitaires pour permettre une enquête épidémiologique et des mesures de contrôle appropriées [9]. Cette surveillance permet de détecter précocement toute réémergence de la rage sur le territoire.
Les recommandations vaccinales évoluent régulièrement. Depuis 2024, la vaccination préventive est recommandée pour un cercle élargi de professionnels, incluant notamment les agents des services de fourrière et les garde-chasses [1]. Cette extension reflète une meilleure compréhension des situations à risque.
Au niveau international, l'OMS coordonne les efforts de lutte contre la rage avec l'objectif "Zéro décès humain dû à la rage transmise par le chien d'ici 2030" [2]. Cette initiative globale mobilise les ressources pour améliorer l'accès aux traitements préventifs dans les pays en développement.
Ressources et Associations de Patients
Bien que les infections à Rhabdoviridae restent rares en France, plusieurs ressources peuvent vous accompagner en cas d'exposition ou d'inquiétude. L'Institut Pasteur dispose d'un centre antirabique de référence offrant consultations spécialisées et traitements préventifs [9]. Ce centre assure également une permanence téléphonique pour les urgences.
Les centres hospitaliers universitaires proposent des consultations de médecine des voyages. Ces consultations permettent d'évaluer les risques avant un départ en zone endémique et de mettre en place une prophylaxie adaptée [11]. N'hésitez pas à consulter avant tout voyage dans des régions à risque.
Au niveau associatif, plusieurs organisations internationales œuvrent pour la prévention de la rage. L'Alliance pour le contrôle de la rage coordonne les efforts de recherche et de sensibilisation à l'échelle mondiale. Ces associations proposent des ressources éducatives et soutiennent la recherche de nouveaux traitements.
Les réseaux sociaux et forums spécialisés peuvent également apporter un soutien psychologique. Cependant, privilégiez toujours l'avis médical professionnel pour toute question concernant votre santé. Les informations trouvées sur internet ne remplacent jamais une consultation médicale appropriée.
Nos Conseils Pratiques
Face aux infections à Rhabdoviridae, la prévention reste votre meilleure alliée. Avant tout voyage en zone endémique, renseignez-vous sur la situation épidémiologique locale et consultez un médecin spécialisé en médecine des voyages [11]. Cette consultation permettra d'évaluer l'opportunité d'une vaccination préventive.
En cas de morsure ou griffure animale, adoptez immédiatement les bons réflexes. Nettoyez abondamment la plaie à l'eau courante et au savon pendant au moins 15 minutes. Désinfectez ensuite avec un antiseptique et consultez rapidement un médecin [9]. Ne négligez jamais une blessure même apparemment bénigne.
Gardez vos vaccinations à jour, particulièrement si vous exercez une profession à risque. La vaccination préventive offre une protection efficace mais nécessite des rappels réguliers [9]. Tenez un carnet de vaccination à jour et respectez les échéances de rappel.
Sensibilisez votre entourage aux risques et aux mesures de prévention. L'éducation sanitaire constitue un outil puissant de prévention collective. Partagez vos connaissances, notamment avec les enfants qui présentent une vulnérabilité particulière face aux animaux [7].
Quand Consulter un Médecin ?
Consultez immédiatement un médecin après toute morsure, griffure ou contact avec la salive d'un mammifère, même domestique [9,11]. Cette consultation d'urgence permet d'évaluer le risque de transmission et de débuter si nécessaire une prophylaxie post-exposition. Chaque heure compte dans cette situation.
Certaines situations nécessitent une prise en charge particulièrement urgente. Les morsures à la tête, au cou ou aux mains présentent un risque majoré en raison de la proximité du système nerveux [11]. De même, les morsures profondes ou multiples nécessitent une évaluation spécialisée immédiate.
N'attendez pas l'apparition de symptômes pour consulter. Une fois les signes neurologiques présents, les options thérapeutiques deviennent très limitées [9]. La fenêtre d'efficacité du traitement préventif se situe avant l'apparition des premiers symptômes.
En cas de voyage récent en zone endémique, signalez-le systématiquement à votre médecin lors de toute consultation. Cette information peut orienter le diagnostic devant des symptômes apparemment banals comme de la fièvre ou des maux de tête [7]. Votre médecin pourra ainsi adapter sa prise en charge.
Questions Fréquentes
Peut-on attraper la rage par simple contact avec un animal ?
Non, la transmission nécessite un contact avec la salive de l'animal infecté, généralement par morsure ou griffure. Le simple contact avec le pelage ne présente pas de risque.
Combien de temps après une morsure peut-on encore débuter le traitement ?
Le traitement préventif reste efficace tant que les symptômes neurologiques ne sont pas apparus. Cependant, plus il est débuté tôt, plus il est efficace.
La vaccination préventive protège-t-elle à vie ?
Non, la vaccination préventive nécessite des rappels réguliers. La durée de protection varie selon les individus et nécessite un suivi sérologique.
Tous les mammifères peuvent-ils transmettre la rage ?
Théoriquement oui, mais certaines espèces présentent un risque plus élevé : carnivores domestiques, chauves-souris, renards. Les rongeurs et lagomorphes présentent un risque très faible.
Que faire si l'animal mordeur disparaît ?
Il faut débuter immédiatement la prophylaxie post-exposition. L'observation de l'animal pendant 10 jours permet parfois d'interrompre le traitement si l'animal reste sain.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] 13305 PDFs | Review articles in RABIES VACCINES. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [2] Rabies Virus | Concise Medical Knowledge. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [4] JG Shepherd, C Davis. Emerging rhabdoviruses and human infection. 2023Lien
- [5] SM Moore, DS McVey - Veterinary Microbiology. Rhabdoviridae. 2022Lien
- [6] M Zhao, X Ran. Genetic diversity of Flaviviridae and Rhabdoviridae EVEs in Aedes aegypti and Aedes albopictus. 2024Lien
- [7] HJ Choi, SC Hong. Antiviral effects of remdesivir on fish viruses from the Rhabdoviridae family. 2025Lien
- [9] P Punasanvala, RR Sahay. A rare case of Chandipura virus infection with haemorrhagic complications from Gujarat, India. 2023Lien
- [11] EE Schirtzinger, DC Jasperson. Establishment of a Culex tarsalis Cell Line and its Permissiveness to Arbovirus Infection. 2023Lien
- [12] Rage : symptômes, traitement, prévention. Institut PasteurLien
- [13] Rhabdoviridae. Microbes-edu.orgLien
- [14] Rage - Troubles neurologiques - Édition professionnelle. MSD ManualsLien
Publications scientifiques
- Emerging rhabdoviruses and human infection (2023)16 citations
- Rhabdoviridae (2022)3 citations
- [HTML][HTML] Genetic diversity of Flaviviridae and Rhabdoviridae EVEs in Aedes aegypti and Aedes albopictus on Hainan Island and the Leizhou Peninsula, China (2024)
- Antiviral effects of remdesivir on fish viruses from the Rhabdoviridae family (2025)
- Découverte et pathologie de virus associés à la mouche soldat noire (Hermetia illucens) (2024)
Ressources web
- Rage : symptômes, traitement, prévention (pasteur.fr)
Quels sont les symptômes ? Le virus rabique est neurotrope : il infecte le système nerveux et affecte son fonctionnement. Il ne provoque pas de lésions ...
- Rhabdoviridae (microbes-edu.org)
une antibiothérapie est prescrite pour éviter l'infection de la blessure par d'autres agents pathogènes pouvant être transmis par l'animal (Pasteurella, ...
- Rage - Troubles neurologiques - Édition professionnelle ... (msdmanuals.com)
Les symptômes comprennent une dépression et une fièvre, suivies d'une agitation, d'une hypersalivation et de spasmes laryngés avec hydrophobie. Le diagnostic ...
- Rage (infovac.ch)
La maladie commence par un malaise général, des maux de tête, de la fièvre, des démangeaisons ainsi que des douleurs à l'endroit de la morsure ou de la griffure ...
- Rage (maladie) (fr.wikipedia.org)
Causés par un virus neurotrope, les symptômes sont principalement neurologiques accompagnés de désordres comportementaux. Classiquement, le sujet atteint peut ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
