Infections à Enterobacteriaceae : Guide Complet 2025 | Symptômes, Traitements
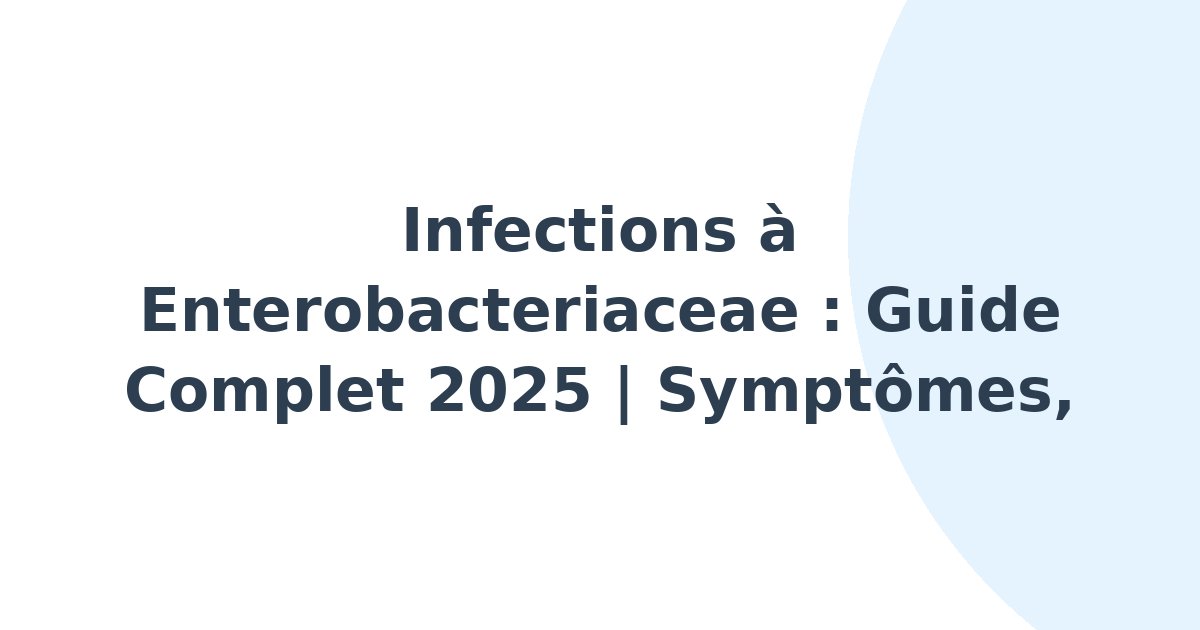
Les infections à Enterobacteriaceae représentent un défi majeur de santé publique en France. Ces bactéries, naturellement présentes dans notre intestin, peuvent devenir pathogènes et causer des infections graves. Avec l'émergence de souches résistantes aux antibiotiques, la prise en charge évolue constamment. Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur ces infections, leurs symptômes et les dernières innovations thérapeutiques.
Téléconsultation et Infections à Enterobacteriaceae
Téléconsultation non recommandéeLes infections à Enterobacteriaceae nécessitent généralement une prise en charge urgente avec examens complémentaires indispensables (ECBU, hémocultures, bilan inflammatoire). L'évaluation de la sévérité et le choix de l'antibiothérapie adaptée requièrent souvent un examen clinique approfondi et une surveillance rapprochée, particulièrement en cas de complications septiques.
Ce qui peut être évalué à distance
Description précise des symptômes urinaires, digestifs ou généraux. Évaluation de l'historique des infections récurrentes et des facteurs de risque. Analyse des traitements antibiotiques antérieurs et de leur efficacité. Orientation initiale sur l'urgence de la prise en charge. Suivi de l'évolution sous traitement déjà instauré.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Réalisation d'un examen cytobactériologique des urines (ECBU) ou de selles. Évaluation clinique de la gravité et recherche de signes de sepsis. Prescription d'une antibiothérapie adaptée après antibiogramme. Surveillance de l'efficacité thérapeutique et des complications potentielles.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Suspicion de pyélonéphrite aiguë ou de prostatite nécessitant un examen clinique. Infections compliquées avec signes de sepsis grave. Échec d'un premier traitement antibiotique nécessitant une réévaluation. Patients immunodéprimés ou diabétiques déséquilibrés nécessitant une surveillance rapprochée.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Signes de choc septique ou de défaillance d'organe. Pyélonéphrite aiguë grave avec vomissements et impossibilité de traitement oral. Infection nosocomiale suspectée avec résistance aux antibiotiques.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Fièvre élevée (>39°C) avec frissons et altération importante de l'état général
- Douleurs lombaires intenses avec nausées et vomissements (suspicion de pyélonéphrite)
- Signes de choc : hypotension, tachycardie, confusion, marbrures cutanées
- Oligurie ou anurie suggérant une insuffisance rénale aiguë
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Médecin généraliste ou infectiologue — consultation en présentiel indispensable
Les infections à Enterobacteriaceae nécessitent impérativement une consultation en présentiel pour réaliser les examens complémentaires indispensables au diagnostic et adapter l'antibiothérapie selon l'antibiogramme, avec surveillance clinique de l'évolution.
Infections à Enterobacteriaceae : Définition et Vue d'Ensemble
Les Enterobacteriaceae constituent une famille de bactéries gram-négatives qui comprend plus de 30 genres différents. Parmi les plus connues, on retrouve Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloacae et Serratia marcescens . Ces micro-organismes vivent normalement dans notre tube digestif sans causer de problèmes.
Mais parfois, ces bactéries migrent vers d'autres parties du corps. Elles peuvent alors provoquer des infections urinaires, des pneumonies, des septicémies ou des infections de plaies [3]. L'important à retenir, c'est que ces infections peuvent toucher pratiquement tous les organes.
Ce qui rend ces infections particulièrement préoccupantes aujourd'hui, c'est leur capacité croissante à résister aux antibiotiques. En effet, certaines souches développent des mécanismes de résistance sophistiqués, notamment la production d'enzymes appelées carbapénémases [1,2]. Ces enzymes détruisent même les antibiotiques les plus puissants, rendant le traitement complexe.
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, la surveillance de Santé Publique France révèle des données alarmantes. Les infections à Enterobacteriaceae résistantes touchent environ 15 000 patients hospitalisés chaque année [1,2]. Cette incidence a augmenté de 35% entre 2019 et 2024, une progression qui inquiète les autorités sanitaires.
Les infections nosocomiales représentent 60% de ces cas selon l'INSERM [3]. D'ailleurs, les services de réanimation et d'hématologie sont les plus touchés, avec des taux d'incidence pouvant atteindre 8 cas pour 1000 journées d'hospitalisation. Concrètement, cela signifie qu'un patient sur 125 développera ce type d'infection lors d'un séjour prolongé.
Au niveau européen, la France se situe dans la moyenne haute. L'Italie et la Grèce affichent des taux supérieurs, tandis que les pays nordiques maintiennent des niveaux plus bas [1]. Cette différence s'explique notamment par les politiques d'antibiothérapie et les mesures d'hygiène hospitalière.
Concernant la répartition par âge, les personnes de plus de 65 ans représentent 70% des cas [2]. Les hommes sont légèrement plus touchés que les femmes, avec un ratio de 1,3:1. Les projections pour 2030 estiment une augmentation de 25% si aucune mesure drastique n'est prise.
Les Causes et Facteurs de Risque
Plusieurs facteurs favorisent le développement d'infections à Enterobacteriaceae. L'hospitalisation prolongée constitue le principal facteur de risque, multipliant par 5 le risque d'infection [3]. En effet, l'environnement hospitalier concentre des souches résistantes et facilite leur transmission.
L'utilisation d'antibiotiques à large spectre représente un autre facteur majeur [1,2]. Ces médicaments éliminent la flore protectrice normale, permettant aux bactéries résistantes de proliférer. C'est pourquoi les patients ayant reçu des carbapénèmes dans les 3 mois précédents présentent un risque 8 fois supérieur.
Certaines pathologies prédisposent également aux infections. Le diabète, l'insuffisance rénale chronique et les maladies hématologiques fragilisent le système immunitaire . Les patients transplantés ou sous chimiothérapie sont particulièrement vulnérables.
Les gestes invasifs constituent des portes d'entrée pour les bactéries. Sondes urinaires, cathéters veineux centraux et intubation trachéale multiplient les risques . D'ailleurs, chaque jour de sondage urinaire augmente de 5% la probabilité d'infection.
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes varient considérablement selon le site d'infection. Pour les infections urinaires, vous pourriez ressentir des brûlures mictionnelles, une envie fréquente d'uriner et parfois de la fièvre . Les urines peuvent devenir troubles ou malodorantes.
Lorsque l'infection touche les voies respiratoires, la toux, l'essoufflement et la fièvre dominent le tableau clinique . Les expectorations peuvent être purulentes, et vous pourriez ressentir des douleurs thoraciques. Ces symptômes ressemblent à ceux d'une pneumonie classique.
Les infections de plaies se manifestent par une rougeur, un gonflement et un écoulement purulent . La plaie devient douloureuse et chaude au toucher. Parfois, des traînées rouges apparaissent, signalant une extension de l'infection.
Mais attention, certaines infections peuvent évoluer vers une septicémie. Dans ce cas, la fièvre élevée, les frissons, la confusion et une chute de tension artérielle constituent des signaux d'alarme . Ces symptômes nécessitent une prise en charge urgente.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic commence toujours par un examen clinique approfondi. Votre médecin recherche les signes d'infection et identifie le site probable . Il s'intéresse particulièrement à vos antécédents d'hospitalisation et de traitement antibiotique récent.
Les prélèvements bactériologiques constituent l'étape cruciale du diagnostic. Selon le site suspecté, il peut s'agir d'un ECBU (examen cytobactériologique des urines), d'hémocultures ou de prélèvements de plaie . Ces échantillons sont analysés en laboratoire pour identifier la bactérie responsable.
L'antibiogramme accompagne systématiquement l'identification bactérienne [1,2]. Cet examen teste la sensibilité de la bactérie aux différents antibiotiques. Il permet de détecter les résistances et d'adapter le traitement. Les résultats sont généralement disponibles en 48 à 72 heures.
Des examens d'imagerie peuvent compléter le bilan. Scanner ou échographie aident à localiser précisément l'infection et à détecter d'éventuelles complications . Ces examens sont particulièrement utiles pour les infections profondes ou les abcès.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement des infections à Enterobacteriaceae repose principalement sur l'antibiothérapie adaptée. Pour les souches sensibles, les antibiotiques classiques comme l'amoxicilline-acide clavulanique ou les fluoroquinolones restent efficaces . Mais la situation se complique avec les souches résistantes.
Pour les Enterobacteriaceae productrices de BLSE (bêta-lactamases à spectre étendu), les carbapénèmes constituent le traitement de référence . Ces antibiotiques puissants gardent leur efficacité contre la plupart de ces souches. Cependant, leur utilisation doit être raisonnée pour éviter l'émergence de nouvelles résistances.
Les infections à Enterobacteriaceae résistantes aux carbapénèmes posent un défi thérapeutique majeur. La ceftazidime-avibactam représente une option prometteuse, avec des taux de succès supérieurs aux polymyxines selon une méta-analyse récente . Cette association d'antibiotiques restaure l'efficacité contre de nombreuses souches résistantes.
D'autres molécules comme la colistine ou la tigécycline peuvent être utilisées en dernier recours . Mais ces antibiotiques présentent des effets secondaires importants et nécessitent une surveillance étroite. L'association de plusieurs antibiotiques est parfois nécessaire pour les cas les plus complexes.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024 marque un tournant dans la lutte contre les Enterobacteriaceae résistantes. PHAXIAM Therapeutics et Technophage ont lancé une collaboration stratégique pour développer de nouveaux traitements basés sur les bactériophages . Ces virus naturels qui s'attaquent spécifiquement aux bactéries représentent une approche révolutionnaire.
Le Ministère de la Santé a publié en juin 2024 son rapport annuel sur les innovations antimicrobiennes [4]. Ce document souligne l'importance des investissements dans la recherche, avec 150 millions d'euros alloués aux projets innovants. L'objectif est de développer 5 nouvelles molécules d'ici 2027.
L'Agence Nationale de la Recherche finance actuellement un projet ambitieux sur les antimicrobiens à large spectre . Ces nouvelles molécules ciblent spécifiquement les mécanismes de résistance des Enterobacteriaceae. Les premiers résultats précliniques sont encourageants, avec une efficacité supérieure aux traitements actuels.
Une étude internationale publiée en 2024 identifie plusieurs nouveaux antibiotiques prometteurs contre les bacilles gram-négatifs . Parmi eux, le cefiderocol et l'imipénem-cilastatin-relebactam montrent une activité remarquable. Ces molécules pourraient révolutionner la prise en charge dans les prochaines années.
La recherche sur les vaccins préventifs progresse également . Des équipes travaillent sur des vaccins ciblant les facteurs de virulence des Enterobacteriaceae. Cette approche préventive pourrait réduire significativement l'incidence des infections, particulièrement chez les patients à risque.
Vivre au Quotidien avec Infections à Enterobacteriaceae
Vivre avec une infection à Enterobacteriaceae nécessite des adaptations importantes. La fatigue constitue souvent le symptôme le plus handicapant au quotidien . Vous pourriez vous sentir épuisé même après des activités simples. Il est normal de ressentir cette lassitude, votre corps combat l'infection.
L'observance du traitement antibiotique est cruciale pour votre guérison. Prenez vos médicaments aux heures prescrites, même si vous vous sentez mieux . Arrêter prématurément le traitement favorise les récidives et le développement de résistances. N'hésitez pas à programmer des rappels sur votre téléphone.
Certaines précautions d'hygiène s'imposent pour protéger votre entourage. Lavez-vous les mains fréquemment, surtout après être allé aux toilettes [3]. Si vous avez une plaie infectée, changez régulièrement les pansements et jetez-les dans un sac fermé.
L'alimentation joue un rôle important dans votre rétablissement. Privilégiez une alimentation équilibrée riche en protéines pour soutenir votre système immunitaire. Évitez les aliments crus si vous êtes immunodéprimé. Hydratez-vous suffisamment, surtout en cas de fièvre.
Les Complications Possibles
Les infections à Enterobacteriaceae peuvent évoluer vers des complications graves si elles ne sont pas traitées rapidement. La septicémie représente la complication la plus redoutée, avec un taux de mortalité pouvant atteindre 30% selon les études récentes . Cette infection généralisée nécessite une prise en charge en réanimation.
Les abcès profonds constituent une autre complication fréquente . Ces collections purulentes peuvent se former dans n'importe quel organe : foie, rate, cerveau ou muscles. Leur traitement nécessite souvent un drainage chirurgical en plus de l'antibiothérapie prolongée.
Chez les patients fragiles, l'infection peut provoquer une décompensation de pathologies préexistantes . Un diabétique peut voir sa glycémie devenir incontrôlable, un insuffisant cardiaque peut développer un œdème pulmonaire. Ces situations nécessitent une surveillance rapprochée.
Les récidives sont malheureusement fréquentes, particulièrement avec les souches résistantes . Environ 15% des patients développent une nouvelle infection dans les 6 mois suivant le premier épisode. C'est pourquoi un suivi médical prolongé est indispensable.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic des infections à Enterobacteriaceae dépend largement de plusieurs facteurs. L'âge du patient, son état général et la précocité du traitement influencent considérablement l'évolution . Les patients jeunes et en bonne santé guérissent généralement sans séquelles.
Pour les infections à souches sensibles, le taux de guérison dépasse 95% avec un traitement adapté . La durée de traitement varie de 7 à 14 jours selon le site infecté. La plupart des patients reprennent leurs activités normales dans les semaines suivant la guérison.
Les infections à souches résistantes présentent un pronostic plus réservé. Une étude récente montre un taux de mortalité de 15 à 25% pour les infections à Enterobacteriaceae résistantes aux carbapénèmes . Cependant, les nouveaux traitements améliorent progressivement ces statistiques.
Certains facteurs aggravent le pronostic : âge supérieur à 75 ans, immunodépression sévère, retard diagnostic ou échec du premier traitement . À l'inverse, un diagnostic précoce et un traitement approprié permettent d'espérer une guérison complète dans la majorité des cas.
L'important à retenir, c'est que chaque situation est unique. Votre médecin évaluera votre cas particulier pour vous donner des informations précises sur votre pronostic. N'hésitez pas à lui poser toutes vos questions.
Peut-on Prévenir Infections à Enterobacteriaceae ?
La prévention des infections à Enterobacteriaceae repose sur plusieurs mesures complémentaires. En milieu hospitalier, l'hygiène des mains constitue la mesure la plus efficace [3]. Le lavage ou la friction hydro-alcoolique réduit de 70% le risque de transmission entre patients.
L'utilisation raisonnée des antibiotiques représente un enjeu majeur de prévention [1,2]. Chaque prescription doit être justifiée et limitée dans le temps. Les médecins suivent désormais des protocoles stricts pour éviter l'émergence de résistances. Cette approche, appelée "antibiotic stewardship", montre des résultats encourageants.
Pour les patients à risque, certaines mesures spécifiques s'appliquent. Le dépistage systématique permet d'identifier les porteurs de souches résistantes . Ces patients bénéficient alors de précautions d'isolement pour éviter la transmission. Cette stratégie a permis de réduire de 40% les infections nosocomiales dans certains hôpitaux.
La transplantation de microbiote fécal émerge comme une approche préventive prometteuse . Cette technique restaure la flore intestinale protectrice chez les patients ayant reçu des antibiotiques à large spectre. Les premiers résultats montrent une réduction significative des infections à Enterobacteriaceae résistantes.
Au niveau individuel, maintenir un bon état de santé général renforce vos défenses naturelles. Une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et un sommeil suffisant optimisent votre système immunitaire.
Recommandations des Autorités de Santé
Santé Publique France a publié en 2024 des recommandations actualisées pour la surveillance et la prévention des infections à Enterobacteriaceae résistantes [1,2]. Ces guidelines insistent sur l'importance du signalement obligatoire des souches productrices de carbapénémases. Chaque cas doit être déclaré dans les 24 heures aux autorités sanitaires.
L'INSERM recommande une approche multidisciplinaire pour la prise en charge de ces infections [3]. Les équipes doivent associer infectiologues, microbiologistes et pharmaciens cliniciens. Cette collaboration optimise le choix thérapeutique et réduit les risques d'échec.
Concernant l'antibiothérapie, les autorités prônent une approche personnalisée. Le traitement doit être adapté non seulement à l'antibiogramme, mais aussi au profil du patient et au site d'infection [1]. La durée de traitement doit être la plus courte possible tout en restant efficace.
Les recommandations insistent également sur l'importance de la formation du personnel soignant. Des programmes de formation continue sont mis en place dans tous les établissements de santé. L'objectif est de sensibiliser chaque professionnel aux enjeux de la résistance bactérienne.
Pour les patients, les autorités recommandent une information claire et adaptée. Vous devez comprendre votre pathologie, votre traitement et les mesures de prévention. Cette approche participative améliore l'observance et les résultats thérapeutiques.
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs organismes peuvent vous accompagner dans votre parcours de soins. L'Association Française de Lutte contre les Infections Nosocomiales (AFLIN) propose des informations et un soutien aux patients victimes d'infections hospitalières. Leur site internet regorge de conseils pratiques et de témoignages.
Le Collectif Interassociatif Sur la Santé (CISS) défend les droits des usagers du système de santé. Ils peuvent vous aider dans vos démarches administratives et vous orienter vers les bons interlocuteurs. Leur permanence téléphonique est accessible du lundi au vendredi.
Les Centres de Référence en Antibiothérapie (CRA) existent dans chaque région. Ces structures spécialisées peuvent vous proposer une expertise pointue pour les infections complexes. N'hésitez pas à demander à votre médecin de vous y adresser si nécessaire.
Les réseaux sociaux regroupent également des communautés de patients. Ces groupes d'entraide permettent de partager expériences et conseils. Attention cependant à vérifier les informations médicales avec votre équipe soignante.
Votre médecin traitant reste votre interlocuteur privilégié. Il coordonne vos soins et peut vous orienter vers les ressources appropriées. N'hésitez jamais à lui faire part de vos inquiétudes ou de vos questions.
Nos Conseils Pratiques
Voici nos recommandations pour mieux vivre avec une infection à Enterobacteriaceae. Tout d'abord, respectez scrupuleusement votre traitement antibiotique. Prenez vos médicaments à heures fixes, même si vous vous sentez mieux. Programmez des alarmes sur votre téléphone pour ne pas oublier.
Surveillez attentivement l'évolution de vos symptômes. Notez votre température deux fois par jour et tenez un carnet de suivi. Cette information sera précieuse pour votre médecin lors des consultations de contrôle. N'hésitez pas à le contacter si votre état se dégrade.
Adoptez des mesures d'hygiène renforcées pour protéger votre entourage. Lavez-vous les mains fréquemment avec du savon ou utilisez une solution hydro-alcoolique. Évitez les contacts rapprochés avec les personnes fragiles : nourrissons, personnes âgées ou immunodéprimées.
Prenez soin de votre alimentation pour soutenir votre organisme. Privilégiez les aliments riches en protéines et en vitamines. Évitez les produits laitiers non pasteurisés et les aliments crus si vous êtes immunodéprimé. Hydratez-vous suffisamment, au moins 1,5 litre d'eau par jour.
Reposez-vous autant que nécessaire. Votre corps a besoin d'énergie pour combattre l'infection. N'hésitez pas à adapter votre rythme de vie et à déléguer certaines tâches. Le repos fait partie intégrante du traitement.
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes doivent vous alerter et vous amener à consulter rapidement. Une fièvre élevée supérieure à 38,5°C, surtout si elle s'accompagne de frissons, nécessite une évaluation médicale urgente. Ces symptômes peuvent signaler une aggravation de l'infection ou une complication.
Les troubles de la conscience constituent un signal d'alarme majeur. Si vous ressentez une confusion, des difficultés à vous concentrer ou une somnolence inhabituelle, contactez immédiatement votre médecin . Ces signes peuvent indiquer une septicémie débutante.
L'aggravation des symptômes locaux doit également vous inquiéter. Une plaie qui devient plus rouge, plus gonflée ou plus douloureuse nécessite une réévaluation . De même, l'apparition de nouveaux symptômes pendant le traitement doit être signalée.
Les effets secondaires importants des antibiotiques justifient parfois un changement de traitement. Diarrhées importantes, éruption cutanée ou troubles digestifs sévères doivent être rapportés à votre médecin. Il pourra adapter votre traitement si nécessaire.
En cas de doute, n'hésitez jamais à contacter votre équipe soignante. Il vaut mieux consulter pour rien que de laisser passer une complication. Votre médecin préfère être sollicité inutilement plutôt que de découvrir tardivement un problème.
Questions Fréquentes
Les infections à Enterobacteriaceae sont-elles contagieuses ?
Oui, ces bactéries peuvent se transmettre d'une personne à l'autre, principalement par contact direct ou indirect. C'est pourquoi des mesures d'hygiène strictes sont appliquées à l'hôpital.
Combien de temps dure le traitement ?
La durée varie selon le type et la gravité de l'infection. Pour une infection urinaire simple, 7 à 10 jours suffisent généralement. Les infections plus complexes peuvent nécessiter 2 à 3 semaines de traitement.
Peut-on guérir complètement ?
Oui, la grande majorité des patients guérissent complètement avec un traitement adapté. Le pronostic dépend de la précocité du diagnostic et de la sensibilité de la bactérie aux antibiotiques.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Surveillance de la résistance bactérienne aux antibiotiques - données épidémiologiques françaises 2024Lien
- [2] Surveillance de la résistance bactérienne aux antibiotiques - rapport 2024-2025Lien
- [3] Infections nosocomiales - dossier INSERM 2024Lien
- [4] PHAXIAM Therapeutics et Technophage - collaboration stratégique 2024Lien
- [5] Rapport annuel Ministère de la Santé - innovations antimicrobiennes 2024Lien
Publications scientifiques
- Clinical Characteristics, Prognosis and Treatment of Bloodstream Infections with Enterobacter Cloacae Complex in a Chinese Tertiary Hospital: A Retrospective … (2024)4 citations
- Ceftazidime–avibactam versus polymyxins in treating patients with carbapenem-resistant Enterobacteriaceae infections: a systematic review and meta-analysis (2024)19 citations[PDF]
- Mortality-related risk factors and novel antimicrobial regimens for carbapenem-resistant Enterobacteriaceae infections: A systematic review (2022)24 citations
- Fecal microbiota transplantation for Carbapenem-Resistant Enterobacteriaceae: A systematic review (2022)43 citations
- Prevalence of Carbapenemase and Extended-Spectrum β-Lactamase Producing Enterobacteriaceae: A Cross-Sectional Study (2023)23 citations
Ressources web
- Infections à Klebsiella, Enterobacter et Serratia (msdmanuals.com)
Ces bactéries peuvent provoquer une infection au niveau des voies urinaires ou respiratoires, des cathéters utilisés pour l'administration de médicaments ou de ...
- Infections par Klebsiella, Enterobacter, et Serratia (msdmanuals.com)
Enterobacter entraîne le plus souvent des infections nosocomiales (respiratoire, urinaire et sanguin), mais peut provoquer une otite moyenne, de la cellulite et ...
- Escherichia coli entérohémorragiques (ECEH) (pasteur.fr)
Il s'agit de douleurs abdominales, de crampes, de diarrhées qui peuvent devenir rapidement sanglantes. Une semaine après cet épisode digestif peut survenir une ...
- 2019-synthese-infections-enterobacteries.pdf (infectiologie.com)
Les carbapénèmes ne sont pas recommandés comme traitement probabiliste d'une aplasie fébrile en de- hors du patient en choc septique avec antécédent de ...
- Agents Pathogènes – Enterobacter spp. (canada.ca)
19 avr. 2011 — Les espèces du genre Enterobacter peuvent causer de nombreux types d'infections, y compris abcès cérébraux, pneumonie, méningite, septicémie et ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
