Infections à Échovirus : Symptômes, Diagnostic et Traitements 2025
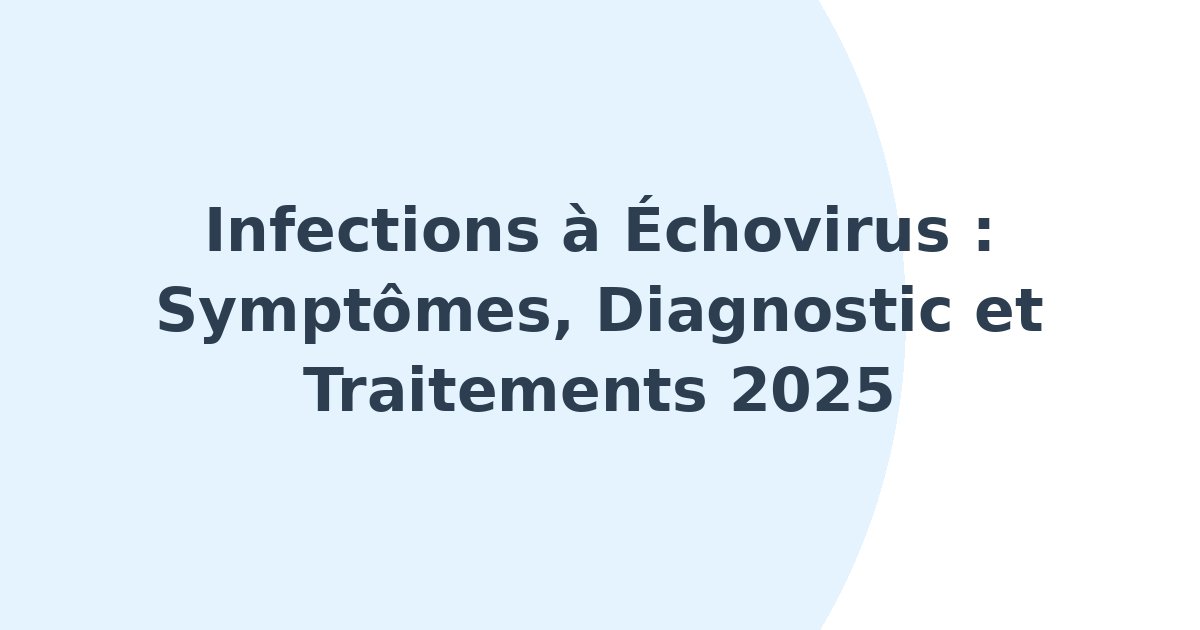
Les infections à échovirus touchent chaque année des milliers de personnes en France, particulièrement les nouveau-nés et jeunes enfants. Ces virus, appartenant à la famille des entérovirus, peuvent provoquer des manifestations variées allant de simples symptômes grippaux à des complications neurologiques sévères. Heureusement, la plupart des infections restent bénignes et guérissent spontanément.

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Infections à Échovirus : Définition et Vue d'Ensemble
Les échovirus sont des virus à ARN appartenant à la famille des entérovirus, au même titre que les virus Coxsackie et les poliovirus [14]. Le nom "ECHO" provient de l'acronyme "Enteric Cytopathic Human Orphan", car ces virus ont d'abord été découverts dans l'intestin humain sans pathologie associée connue.
On dénombre actuellement 31 sérotypes d'échovirus différents, numérotés de 1 à 33 (les types 10 et 28 ayant été reclassifiés). Chaque sérotype peut provoquer des manifestations cliniques distinctes, bien que certains symptômes se chevauchent [5]. Les échovirus 11 et 30 sont particulièrement surveillés en raison de leur potentiel pathogène élevé.
Ces virus se transmettent principalement par voie féco-orale et par gouttelettes respiratoires. Ils résistent bien dans l'environnement et peuvent survivre plusieurs semaines sur des surfaces inertes [15]. Cette résistance explique en partie leur capacité à provoquer des épidémies, notamment en collectivités.
L'important à retenir : les échovirus font partie de notre environnement quotidien. La plupart des infections passent inaperçues ou se manifestent par des symptômes légers ressemblant à une grippe banale.
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, Santé Publique France recense environ 15 000 à 20 000 cas d'infections à entérovirus chaque année, dont 30 à 40% sont dues aux échovirus [1]. Cette incidence place notre pays dans la moyenne européenne, avec des variations saisonnières marquées entre juin et octobre.
Les données 2024 révèlent une augmentation préoccupante des infections néonatales sévères à échovirus 11. Entre juillet 2022 et avril 2023, la France a signalé 47 cas d'infections néonatales graves, dont 7 décès [6]. Cette émergence d'un variant particulièrement virulent a conduit à un renforcement de la surveillance épidémiologique.
L'âge constitue un facteur déterminant : 60% des infections touchent les enfants de moins de 5 ans, avec un pic chez les nouveau-nés de moins de 3 mois [1,2]. Les adultes représentent environ 25% des cas, généralement avec des formes plus bénignes. Aucune différence significative n'existe entre les sexes.
Au niveau européen, l'Espagne et l'Italie rapportent des tendances similaires, avec une surveillance renforcée depuis l'alerte de 2023 [7,8]. Les projections pour 2025 suggèrent une stabilisation de l'incidence, sous réserve de l'émergence de nouveaux variants.
Les Causes et Facteurs de Risque
Les échovirus pénètrent dans l'organisme principalement par deux voies : l'ingestion d'eau ou d'aliments contaminés, et l'inhalation de gouttelettes infectieuses [14]. Une fois dans l'intestin, ils se multiplient rapidement avant de diffuser dans la circulation sanguine.
Plusieurs facteurs augmentent le risque d'infection. L'âge constitue le principal facteur : les nouveau-nés et nourrissons possèdent un système immunitaire immature, les rendant particulièrement vulnérables [11]. Les personnes immunodéprimées, qu'il s'agisse de patients sous chimiothérapie ou atteints du VIH, présentent également un risque accru.
L'environnement joue un rôle crucial. Les collectivités (crèches, écoles, hôpitaux) favorisent la transmission par contact direct ou indirect [12]. Les maladies d'hygiène précaires, l'eau non traitée et la promiscuité constituent autant de facteurs favorisants. D'ailleurs, les épidémies surviennent souvent dans ces contextes.
Certaines périodes de l'année sont plus propices aux infections. L'été et le début de l'automne correspondent au pic de circulation virale, probablement en raison des maladies climatiques favorables à la survie du virus [13].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les manifestations cliniques des infections à échovirus varient considérablement selon l'âge du patient et le sérotype viral impliqué. Chez l'adulte, l'infection passe souvent inaperçue ou se manifeste par un syndrome grippal banal : fièvre modérée, maux de tête, courbatures et fatigue [14].
Chez l'enfant, les symptômes sont plus marqués. La fièvre constitue le signe le plus constant, souvent élevée (39-40°C) et d'apparition brutale. Elle s'accompagne fréquemment de troubles digestifs : diarrhée, vomissements, douleurs abdominales. Une éruption cutanée peut apparaître, ressemblant à celle de la rougeole ou de la rubéole.
Les formes neurologiques représentent les manifestations les plus préoccupantes. La méningite aseptique se traduit par des maux de tête intenses, une raideur de nuque et une photophobie [2]. Chez le nouveau-né, les signes sont plus subtils : irritabilité, refus de s'alimenter, hypotonie ou au contraire hypertonie.
Bon à savoir : l'échovirus 30 provoque souvent des méningites bénignes, tandis que l'échovirus 11 peut causer des hépatites fulminantes chez le nouveau-né [6,7]. Cette variabilité explique l'importance du diagnostic virologique.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic des infections à échovirus repose sur une démarche clinique et biologique rigoureuse. Face à des symptômes évocateurs, le médecin recherche d'abord les signes de gravité, particulièrement chez le nouveau-né et l'enfant en bas âge.
L'examen clinique constitue la première étape. Le praticien évalue l'état général, recherche des signes neurologiques (raideur de nuque, troubles de conscience) et examine la peau à la recherche d'une éruption caractéristique. Chez le nourrisson, l'évaluation de la fontanelle et du tonus musculaire s'avère cruciale.
Les examens biologiques permettent de confirmer le diagnostic. La PCR (réaction en chaîne par polymérase) sur prélèvement de selles, gorge ou LCR constitue la méthode de référence [5]. Elle permet d'identifier spécifiquement l'échovirus et de déterminer son sérotype. Les résultats sont généralement disponibles en 24 à 48 heures.
En cas de suspicion de méningite, la ponction lombaire devient indispensable. Elle révèle un liquide clair avec une pléocytose lymphocytaire, une protéinorachie modérément élevée et une glycorachie normale [2]. Ces éléments orientent vers une méningite virale plutôt que bactérienne.
D'autres examens peuvent s'avérer nécessaires selon le contexte : échographie cardiaque en cas de suspicion de myocardite, scanner cérébral si troubles neurologiques, bilan hépatique chez le nouveau-né [7].
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Actuellement, il n'existe pas de traitement antiviral spécifique contre les échovirus. La prise en charge repose donc sur un traitement symptomatique et de soutien, adapté à la sévérité des manifestations cliniques [14].
Pour les formes bénignes, le traitement se limite aux mesures de confort : repos, hydratation abondante, paracétamol pour la fièvre et les douleurs. Chez l'enfant, la surveillance de l'hydratation s'avère particulièrement importante en cas de diarrhée et vomissements. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont généralement évités.
Les formes sévères nécessitent une hospitalisation. En cas de méningite, la surveillance neurologique devient prioritaire avec contrôle régulier de la conscience, des réflexes et de la pression intracrânienne [2]. L'hydratation intraveineuse permet de maintenir un équilibre hydroélectrolytique optimal.
Chez le nouveau-né, la prise en charge s'intensifie. Les formes avec atteinte hépatique peuvent nécessiter des mesures de réanimation : ventilation assistée, support hémodynamique, voire transplantation hépatique en urgence dans les cas les plus graves [7]. Heureusement, ces situations restent exceptionnelles.
Certaines équipes utilisent les immunoglobulines intraveineuses dans les formes sévères, bien que leur efficacité ne soit pas formellement démontrée. Cette approche reste expérimentale et réservée aux cas les plus critiques.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
La recherche sur les échovirus connaît un essor remarquable en 2024-2025, avec plusieurs pistes thérapeutiques prometteuses. Les modèles d'organoïdes intestinaux augmentés de macrophages permettent désormais de mieux comprendre les mécanismes d'infection et de tester de nouveaux traitements [3].
Une découverte majeure concerne le rôle de l'inflammasome NLRP3 dans la pathogenèse des infections à échovirus 11. Les chercheurs ont démontré que ce virus induit une mort cellulaire par pyroptose, ouvrant la voie à des thérapies ciblées [9]. Des inhibiteurs spécifiques de NLRP3 sont actuellement en phase préclinique.
Les antiviraux à large spectre représentent une autre voie d'avenir. Plusieurs molécules, initialement développées contre d'autres virus à ARN, montrent une activité prometteuse contre les échovirus in vitro. Les essais cliniques devraient débuter en 2025 pour les plus avancées d'entre elles [5].
La surveillance génomique s'améliore considérablement. L'Espagne a développé un système de surveillance renforcée permettant de détecter rapidement l'émergence de nouveaux variants recombinants [8]. Cette approche pourrait être généralisée à l'échelle européenne.
Enfin, les recherches sur les infections pendant la grossesse progressent. De nouveaux protocoles de prise en charge des femmes enceintes exposées aux échovirus sont en cours de validation, avec un focus particulier sur la prévention de la transmission materno-fœtale [4].
Vivre au Quotidien avec les Infections à Échovirus
La plupart des infections à échovirus guérissent spontanément en 7 à 10 jours sans séquelles. Cependant, la période aiguë peut être éprouvante, particulièrement pour les familles avec de jeunes enfants.
Pendant la phase aiguë, l'organisation familiale doit s'adapter. L'enfant malade nécessite une surveillance rapprochée, surtout en cas de fièvre élevée ou de troubles digestifs. Il est important de maintenir une hydratation suffisante et de fractionner l'alimentation. Le repos reste essentiel, même si l'enfant semble aller mieux.
L'isolement constitue un défi majeur. L'enfant doit rester à la maison jusqu'à disparition complète des symptômes, soit généralement 7 à 10 jours. Cette période d'éviction scolaire peut perturber l'organisation professionnelle des parents. Heureusement, la plupart des employeurs comprennent cette contrainte sanitaire.
Les mesures d'hygiène doivent être renforcées au domicile. Lavage fréquent des mains, désinfection des surfaces, aération des pièces et éviction des contacts avec les personnes fragiles (nouveau-nés, personnes âgées, immunodéprimés) s'imposent. Ces précautions protègent l'entourage et limitent la propagation virale.
Concrètement, la récupération complète peut prendre 2 à 3 semaines. Certains enfants conservent une fatigue résiduelle ou une irritabilité pendant quelques jours après la disparition de la fièvre. Cette phase de convalescence est normale et ne doit pas inquiéter.
Les Complications Possibles
Bien que la plupart des infections à échovirus évoluent favorablement, certaines complications peuvent survenir, particulièrement chez les populations vulnérables. La méningite aseptique représente la complication la plus fréquente, touchant environ 5 à 10% des patients infectés [2].
Chez le nouveau-né, les complications peuvent être dramatiques. L'hépatite fulminante à échovirus 11 constitue l'une des formes les plus redoutées, avec un taux de mortalité pouvant atteindre 15% [6,7]. Cette complication survient généralement dans les premières semaines de vie et nécessite une prise en charge en réanimation néonatale.
Les complications cardiaques restent rares mais possibles. Myocardite et péricardite peuvent survenir, principalement chez l'enfant et l'adulte jeune. Ces atteintes se manifestent par des douleurs thoraciques, un essoufflement et parfois des troubles du rythme cardiaque. Le pronostic est généralement favorable avec un traitement adapté.
L'encéphalite constitue une complication exceptionnelle mais grave. Elle se traduit par des troubles de conscience, des convulsions et peut laisser des séquelles neurologiques. Heureusement, cette évolution reste très rare, concernant moins de 1% des infections [10].
Chez les patients immunodéprimés, l'infection peut se chroniciser et provoquer des manifestations atypiques. Ces formes prolongées nécessitent une surveillance spécialisée et parfois des traitements expérimentaux.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic des infections à échovirus est globalement excellent, avec plus de 95% de guérisons complètes sans séquelles [14]. Cette évolution favorable concerne particulièrement les formes communes touchant les enfants et adultes en bonne santé.
Chez l'adulte immunocompétent, la guérison survient généralement en 7 à 14 jours. Les symptômes régressent progressivement, la fièvre disparaît en premier, suivie des troubles digestifs et de la fatigue. Aucune séquelle n'est attendue, et l'immunité acquise protège contre une réinfection par le même sérotype.
Pour les enfants, le pronostic reste excellent malgré des symptômes souvent plus marqués. La récupération peut prendre 2 à 3 semaines, avec parfois une phase de convalescence prolongée. Les parents doivent savoir que l'irritabilité et la fatigue peuvent persister quelques jours après la disparition de la fièvre.
Le nouveau-né présente un pronostic plus réservé, particulièrement en cas d'infection à échovirus 11. Cependant, même dans ce groupe à risque, la majorité des infections évoluent favorablement avec une prise en charge adaptée [11]. Les formes sévères nécessitent une surveillance prolongée mais guérissent généralement sans séquelles.
L'important à retenir : un diagnostic précoce et une surveillance appropriée permettent d'optimiser le pronostic, même dans les formes initialement inquiétantes. La collaboration entre familles et équipes soignantes reste essentielle.
Peut-on Prévenir les Infections à Échovirus ?
La prévention des infections à échovirus repose essentiellement sur des mesures d'hygiène, aucun vaccin n'étant actuellement disponible. Ces mesures simples mais efficaces permettent de réduire significativement le risque de transmission [15].
L'hygiène des mains constitue la mesure préventive la plus importante. Un lavage fréquent à l'eau et au savon, particulièrement après être allé aux toilettes, avant les repas et après contact avec une personne malade, limite considérablement la propagation virale. Les solutions hydroalcooliques représentent une alternative pratique en l'absence de point d'eau.
En collectivités, des protocoles spécifiques doivent être appliqués. Désinfection régulière des surfaces, aération des locaux, éviction des enfants malades et sensibilisation du personnel constituent les piliers de la prévention. Les crèches et écoles jouent un rôle crucial dans la limitation des épidémies [12].
Pour les femmes enceintes, certaines précautions s'imposent, particulièrement en fin de grossesse. Éviter les contacts avec des enfants malades, renforcer l'hygiène personnelle et consulter rapidement en cas de symptômes permettent de prévenir la transmission materno-fœtale [4].
La surveillance épidémiologique contribue également à la prévention. Le signalement des cas groupés permet aux autorités sanitaires de mettre en place des mesures de contrôle adaptées et d'alerter les professionnels de santé [1].
Recommandations des Autorités de Santé
Santé Publique France a renforcé ses recommandations concernant les infections à échovirus suite aux épidémies de 2022-2023. La surveillance des infections néonatales sévères fait désormais l'objet d'un signalement obligatoire, permettant une réaction rapide en cas d'émergence de variants pathogènes [1].
La Haute Autorité de Santé préconise une approche graduée selon l'âge et les facteurs de risque. Chez le nouveau-né, tout syndrome fébrile doit faire l'objet d'une évaluation médicale rapide, avec réalisation systématique d'examens biologiques en cas de signes de gravité [2].
Les recommandations européennes convergent vers un renforcement de la surveillance génomique. L'identification précoce des variants émergents permet d'adapter les stratégies de prise en charge et d'alerter les professionnels de santé. Cette approche collaborative s'avère particulièrement efficace [8].
Pour les professionnels de santé, les autorités insistent sur l'importance du diagnostic différentiel. Les infections à échovirus peuvent mimer d'autres pathologies plus graves, nécessitant une expertise clinique et biologique appropriée. La formation continue des équipes soignantes constitue un enjeu majeur.
Concernant la prévention, les recommandations mettent l'accent sur l'hygiène en collectivités et la sensibilisation des familles. Les campagnes d'information ciblées permettent d'améliorer les connaissances du grand public sur ces infections méconnues.
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs organismes peuvent accompagner les familles confrontées aux infections à échovirus. L'Association Française de Pédiatrie propose des ressources documentaires et des conseils pratiques pour les parents d'enfants atteints d'infections virales.
Le réseau Sentinelles de l'INSERM surveille en continu la circulation des entérovirus en France. Leurs bulletins épidémiologiques hebdomadaires fournissent des informations actualisées sur l'évolution des épidémies et les recommandations en vigueur.
Pour les professionnels de santé, le Centre National de Référence des Entérovirus et Parechovirus (CNR) constitue la référence en matière de diagnostic et de surveillance. Basé à Lyon, ce centre propose des formations, des protocoles diagnostiques et un appui technique aux laboratoires.
Les plateformes d'information comme Ameli.fr et le site de Santé Publique France offrent des fiches pratiques destinées au grand public. Ces ressources, régulièrement mises à jour, permettent aux familles de mieux comprendre ces infections et leurs modalités de prise en charge.
En cas de complications, les services de pédiatrie et de néonatologie des CHU disposent d'équipes spécialisées dans la prise en charge des infections virales sévères. Ces centres de référence assurent également le suivi à long terme des patients ayant présenté des formes compliquées.
Nos Conseils Pratiques
Face à une suspicion d'infection à échovirus, plusieurs réflexes peuvent vous aider. Surveillez attentivement la température, particulièrement chez l'enfant, et n'hésitez pas à consulter si elle dépasse 39°C ou persiste plus de 48 heures malgré le traitement antipyrétique.
L'hydratation constitue un élément clé de la prise en charge. Proposez régulièrement de petites quantités de liquide, même en cas de vomissements. Chez le nourrisson, maintenez l'allaitement ou le biberon en fractionnant les prises. Les solutés de réhydratation orale peuvent s'avérer utiles en cas de diarrhée importante.
Organisez l'isolement de manière pratique. Préparez-vous à une éviction scolaire d'une semaine environ et anticipez l'organisation familiale. Renforcez les mesures d'hygiène : lavage fréquent des mains, désinfection des surfaces de contact, aération régulière des pièces.
Surveillez les signes d'alarme qui doivent vous conduire à consulter en urgence : troubles de conscience, raideur de nuque, difficultés respiratoires, refus total de s'alimenter chez le nourrisson, ou aggravation brutale de l'état général. Ces situations, bien que rares, nécessitent une prise en charge immédiate.
Gardez en mémoire que la guérison prend du temps. Ne vous inquiétez pas si la fatigue persiste quelques jours après la disparition de la fièvre. Cette phase de convalescence est normale et témoigne de la récupération progressive de l'organisme.
Quand Consulter un Médecin ?
Certaines situations imposent une consultation médicale rapide, voire urgente. Chez le nouveau-né et le nourrisson de moins de 3 mois, tout épisode fébrile justifie un avis médical dans les heures qui suivent, en raison du risque de complications sévères [11].
Les signes neurologiques constituent des motifs de consultation en urgence à tout âge : maux de tête intenses, raideur de nuque, photophobie, troubles de conscience ou convulsions. Ces manifestations peuvent témoigner d'une méningite et nécessitent une évaluation immédiate [2].
Chez l'enfant plus grand, consultez si la fièvre dépasse 40°C, persiste plus de 72 heures malgré le traitement, ou s'accompagne de signes de déshydratation : pli cutané persistant, muqueuses sèches, diminution des urines, altération de l'état général.
Les troubles digestifs sévères justifient également une consultation : vomissements incoercibles empêchant toute hydratation, diarrhée profuse avec signes de déshydratation, douleurs abdominales intenses ou refus alimentaire complet chez le nourrisson.
N'hésitez jamais à faire confiance à votre instinct parental. Si vous sentez que quelque chose ne va pas, même sans signe objectif inquiétant, consultez votre médecin. Cette intuition s'avère souvent justifiée et permet parfois de détecter précocement une complication.
Questions Fréquentes
Mon enfant peut-il retourner à l'école dès que la fièvre tombe ?Non, il est recommandé d'attendre la disparition complète des symptômes, soit généralement 7 à 10 jours après le début de la maladie. Cette précaution évite la contamination d'autres enfants et permet une récupération optimale.
Les échovirus sont-ils dangereux pour les femmes enceintes ?
Les infections à échovirus pendant la grossesse sont généralement bénignes pour la mère. Cependant, une transmission au nouveau-né reste possible, particulièrement en fin de grossesse. En cas de symptômes, consultez rapidement votre obstétricien [4].
Peut-on attraper plusieurs fois la même infection ?
Une infection par un sérotype d'échovirus confère une immunité durable contre ce même sérotype. Cependant, il existe 31 sérotypes différents, et une infection par l'un d'eux ne protège pas contre les autres.
Les antibiotiques sont-ils efficaces ?
Non, les antibiotiques n'ont aucune efficacité contre les virus. Ils ne doivent être prescrits qu'en cas de surinfection bactérienne documentée, ce qui reste exceptionnel dans les infections à échovirus [14].
Combien de temps le virus reste-t-il contagieux ?
La contagiosité est maximale pendant la phase aiguë de la maladie. Le virus peut être éliminé dans les selles pendant plusieurs semaines, mais la contagiosité diminue rapidement après la disparition des symptômes [15].
Questions Fréquentes
Mon enfant peut-il retourner à l'école dès que la fièvre tombe ?
Non, il est recommandé d'attendre la disparition complète des symptômes, soit généralement 7 à 10 jours après le début de la maladie. Cette précaution évite la contamination d'autres enfants et permet une récupération optimale.
Les échovirus sont-ils dangereux pour les femmes enceintes ?
Les infections à échovirus pendant la grossesse sont généralement bénignes pour la mère. Cependant, une transmission au nouveau-né reste possible, particulièrement en fin de grossesse. En cas de symptômes, consultez rapidement votre obstétricien.
Peut-on attraper plusieurs fois la même infection ?
Une infection par un sérotype d'échovirus confère une immunité durable contre ce même sérotype. Cependant, il existe 31 sérotypes différents, et une infection par l'un d'eux ne protège pas contre les autres.
Les antibiotiques sont-ils efficaces ?
Non, les antibiotiques n'ont aucune efficacité contre les virus. Ils ne doivent être prescrits qu'en cas de surinfection bactérienne documentée, ce qui reste exceptionnel dans les infections à échovirus.
Combien de temps le virus reste-t-il contagieux ?
La contagiosité est maximale pendant la phase aiguë de la maladie. Le virus peut être éliminé dans les selles pendant plusieurs semaines, mais la contagiosité diminue rapidement après la disparition des symptômes.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Infections à entérovirus. Santé Publique France. 2024-2025.Lien
- [2] Méningite : définition, causes et circonstances de survenue. Assurance Maladie. 2024-2025.Lien
- [3] Macrophage-augmented intestinal organoids model virus-. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [4] Coxsackievirus Group B Infections during Pregnancy. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [5] Echovirus | Concise Medical Knowledge. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [6] Severe and fatal neonatal infections linked to a new variant of echovirus 11, France, July 2022 to April 2023. 2023.Lien
- [7] Fulminant echovirus 11 hepatitis in male non-identical twins in northern Italy, April 2023. 2023.Lien
- [8] Enhanced echovirus 11 genomic surveillance in neonatal infections in Spain following a European alert reveals new recombinant forms linked to severe. 2024.Lien
- [9] Echovirus 11 infection induces pyroptotic cell death by facilitating NLRP3 inflammasome activation. 2022.Lien
- [10] Pathological characteristics of Echovirus 30 infection in a mouse model. 2022.Lien
- [11] Congenital Echovirus 11 infection in a neonate. 2023.Lien
- [12] An outbreak of nosocomial infection of neonatal aseptic meningitis caused by echovirus 18. 2023.Lien
- [13] Epidemiology of echovirus 30 infections detected in a University Hospital in Catalonia, Spain, in 1995–2020. 2022.Lien
- [14] Présentation des infections à entérovirus. www.msdmanuals.com.Lien
- [15] Fiche Technique Santé-Sécurité : Agents Pathogènes. www.canada.ca.Lien
Publications scientifiques
- [HTML][HTML] Severe and fatal neonatal infections linked to a new variant of echovirus 11, France, July 2022 to April 2023 (2023)48 citations
- Fulminant echovirus 11 hepatitis in male non-identical twins in northern Italy, April 2023 (2023)26 citations[PDF]
- [HTML][HTML] Enhanced echovirus 11 genomic surveillance in neonatal infections in Spain following a European alert reveals new recombinant forms linked to severe … (2024)2 citations
- Echovirus 11 infection induces pyroptotic cell death by facilitating NLRP3 inflammasome activation (2022)21 citations
- Pathological characteristics of Echovirus 30 infection in a mouse model (2022)9 citations
Ressources web
- Présentation des infections à entérovirus (msdmanuals.com)
Symptômes des infections à entérovirus : fièvre, céphalées, maladie respiratoire, maux de gorge, et parfois aphtes ou éruption cutanée. Les médecins basent leur ...
- Fiche Technique Santé-Sécurité : Agents Pathogènes (canada.ca)
16 sept. 2014 — Le symptôme le plus courant d'une infection est une maladie fébrile aiguë non spécifique accompagnée ou non d'exanthème. Les échovirus sont ...
- Entérovirus : symptômes, diagnostic et traitements (passeportsante.net)
6 nov. 2024 — Les symptômes pouvant évoquer une infection à entérovirus comprennent : fièvre, céphalées, maladie respiratoire, maux de gorge et parfois aphtes ...
- Revue générale des infections à entérovirus (msdmanuals.com)
L'entérovirus D68 (EV-D68) provoque une maladie respiratoire, principalement chez les enfants; les symptômes ressemblent habituellement à ceux d'un rhume (p. ex ...
- Infections à échovirus 11 chez les nouveau-nés (hygienes.net)
6 nov. 2023 — Les symptômes comprennent la méningo-encéphalite et la myocardite. D'autres cas d'infection par le virus E11 ont été signalés en 2022 et 2023 ...

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
