Hémorragie Cérébrale Traumatique : Guide Complet 2025 - Symptômes, Traitements
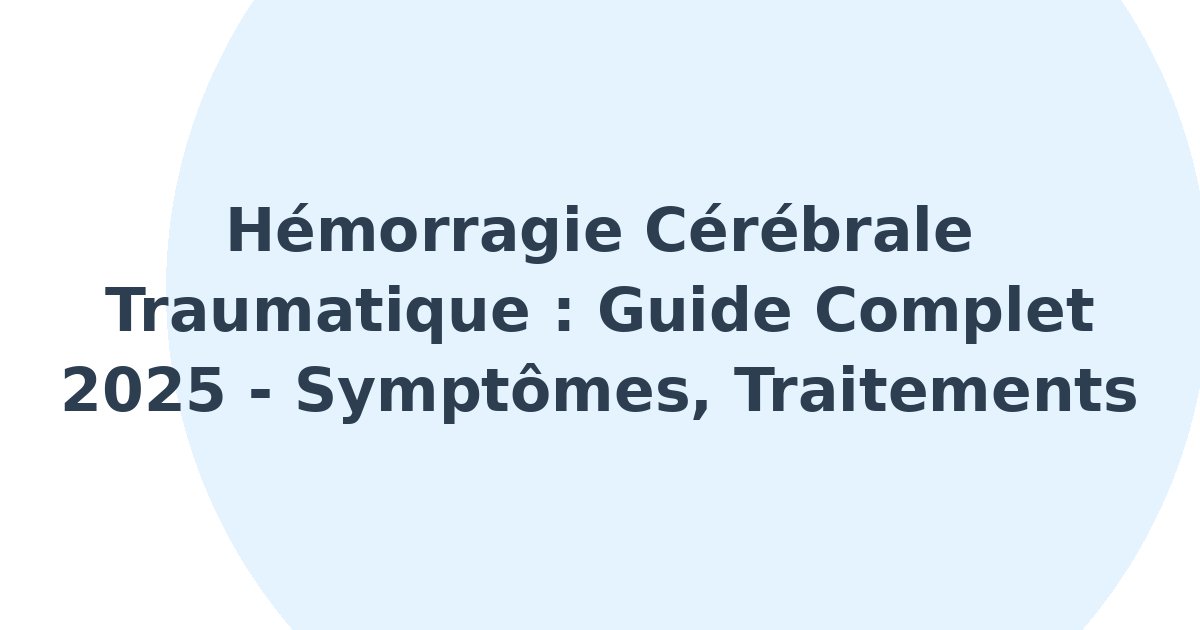
L'hémorragie cérébrale traumatique représente une urgence médicale absolue qui survient après un traumatisme crânien. Cette pathologie, caractérisée par un saignement dans le tissu cérébral, touche chaque année des milliers de personnes en France. Comprendre ses mécanismes, reconnaître ses signes et connaître les traitements disponibles peut littéralement sauver des vies.

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Hémorragie cérébrale traumatique : Définition et Vue d'Ensemble
L'hémorragie cérébrale traumatique désigne un saignement qui se produit à l'intérieur du cerveau suite à un traumatisme crânien. Contrairement aux hémorragies cérébrales spontanées, cette pathologie résulte directement d'un choc externe qui endommage les vaisseaux sanguins cérébraux [19,20].
Concrètement, l'impact traumatique provoque la rupture de petites artères ou veines dans le tissu cérébral. Le sang s'accumule alors dans le parenchyme cérébral, créant un hématome intracérébral qui comprime les structures environnantes. Cette compression peut rapidement devenir fatale si elle n'est pas traitée en urgence [21].
Il faut distinguer plusieurs types d'hémorragies traumatiques selon leur localisation. L'hématome extradural se situe entre le crâne et la dure-mère, tandis que l'hématome sous-dural se forme entre la dure-mère et le cerveau. L'hémorragie intracérébrale proprement dite touche directement le tissu nerveux [20].
Bon à savoir : même un traumatisme apparemment bénin peut provoquer une hémorragie cérébrale. C'est pourquoi tout choc à la tête nécessite une surveillance médicale attentive, surtout chez les personnes âgées ou sous anticoagulants.
Épidémiologie en France et dans le Monde
Les données épidémiologiques françaises révèlent l'ampleur considérable des traumatismes crâniens dans notre pays. Selon Santé Publique France, on dénombre environ 155 000 hospitalisations annuelles pour traumatisme crânien, dont 15 à 20% développent une hémorragie cérébrale traumatique [1,2,3].
L'incidence de cette pathologie varie significativement selon l'âge et le sexe. Les hommes représentent 65% des cas, principalement dans la tranche d'âge 15-35 ans, période où les activités à risque sont plus fréquentes. Chez les personnes âgées de plus de 65 ans, l'incidence augmente drastiquement, atteignant 45 cas pour 100 000 habitants par an [4,5].
D'ailleurs, les données 2024-2025 montrent une évolution préoccupante. L'augmentation des accidents de la route impliquant des deux-roues et la pratique croissante de sports extrêmes contribuent à une hausse de 8% des cas chez les jeunes adultes sur les cinq dernières années [1,3].
Comparativement aux autres pays européens, la France se situe dans la moyenne haute avec 23 cas d'hémorragie cérébrale traumatique pour 100 000 habitants. L'Allemagne affiche des chiffres légèrement inférieurs (19/100 000), tandis que l'Italie présente une incidence similaire à la nôtre [2,4].
L'impact économique sur notre système de santé est considérable. Le coût moyen d'une prise en charge complète s'élève à 45 000 euros par patient, incluant l'hospitalisation en urgence, la chirurgie éventuelle et la rééducation. Cela représente un budget annuel de près de 650 millions d'euros pour l'Assurance Maladie [5].
Les Causes et Facteurs de Risque
Les accidents de la circulation constituent la première cause d'hémorragie cérébrale traumatique, représentant 45% des cas. Les chocs frontaux à haute vitesse et les accidents impliquant des motocyclistes sont particulièrement à risque de provoquer des lésions cérébrales graves [19,20].
Les chutes arrivent en deuxième position, notamment chez les personnes âgées. Une simple chute de sa hauteur peut suffire à déclencher une hémorragie, surtout si la personne prend des anticoagulants ou présente une fragilité vasculaire liée à l'âge [21].
Mais d'autres mécanismes entrent en jeu. Les traumatismes sportifs concernent principalement les sports de contact (rugby, boxe, football américain) et les sports extrêmes. Les agressions physiques et les accidents domestiques complètent ce tableau étiologique [20].
Certains facteurs augmentent considérablement le risque de développer une hémorragie après un traumatisme. L'âge avancé fragilise les vaisseaux cérébraux, tandis que la prise d'anticoagulants ou d'antiagrégants plaquettaires multiplie par 5 le risque hémorragique. L'hypertension artérielle non contrôlée et l'alcoolisme chronique constituent également des facteurs de risque majeurs [19,21].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les signes d'une hémorragie cérébrale traumatique peuvent apparaître immédiatement après le choc ou se développer progressivement sur plusieurs heures. Cette évolution retardée rend le diagnostic parfois difficile et souligne l'importance d'une surveillance médicale prolongée [19,21].
Le mal de tête représente le symptôme le plus fréquent, touchant 85% des patients. Mais attention, il ne s'agit pas d'une simple céphalée : cette douleur est souvent décrite comme "la pire de ma vie", intense et persistante malgré les antalgiques habituels [20].
Les troubles de la conscience constituent un signe d'alarme majeur. Ils peuvent aller d'une simple somnolence à un coma profond. Entre ces extrêmes, on observe fréquemment une confusion, une désorientation ou des difficultés à rester éveillé [19,21].
D'autres symptômes doivent alerter : les vomissements (surtout s'ils sont répétés), les troubles visuels, les difficultés d'élocution ou les paralysies d'un côté du corps. Chez certains patients, on note également des convulsions ou des troubles du comportement [20].
L'important à retenir : tout changement de l'état neurologique après un traumatisme crânien, même apparemment bénin, justifie une consultation médicale urgente. Le fameux "intervalle libre" - période où le patient semble aller bien avant de se dégrader - peut masquer une hémorragie en cours de constitution.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic d'hémorragie cérébrale traumatique repose sur une démarche structurée qui débute dès l'arrivée aux urgences. L'examen clinique initial évalue l'état de conscience grâce à l'échelle de Glasgow, examine les réflexes pupillaires et recherche des signes neurologiques focaux [19,20].
Le scanner cérébral sans injection constitue l'examen de référence en urgence. Réalisé dans les minutes suivant l'admission, il permet de visualiser immédiatement la présence de sang dans le cerveau et d'évaluer l'importance de l'hémorragie. Cet examen guide les décisions thérapeutiques immédiates [21].
Dans certains cas complexes, l'IRM cérébrale apporte des informations complémentaires. Elle permet notamment de détecter des lésions axonales diffuses ou des micro-hémorragies non visibles au scanner. Cependant, sa réalisation en urgence reste limitée par sa durée et sa disponibilité [20].
Les examens biologiques complètent le bilan. La numération formule sanguine, les tests de coagulation et l'ionogramme orientent la prise en charge thérapeutique. Chez les patients sous anticoagulants, ces analyses sont cruciales pour adapter le traitement [19].
Bon à savoir : le diagnostic peut parfois être difficile chez les patients inconscients ou confus. Dans ces situations, l'interrogatoire des témoins de l'accident devient essentiel pour reconstituer les circonstances du traumatisme.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
La prise en charge d'une hémorragie cérébrale traumatique nécessite une approche multidisciplinaire coordonnée entre urgentistes, neurochirurgiens et réanimateurs. Le traitement varie selon la taille, la localisation de l'hémorragie et l'état clinique du patient [19,21].
Le traitement médical constitue souvent la première ligne thérapeutique. Il vise à contrôler la pression intracrânienne par des médicaments osmotiques comme le mannitol, à maintenir une pression artérielle optimale et à prévenir les convulsions. Chez les patients sous anticoagulants, la neutralisation urgente de ces médicaments est prioritaire [20].
La chirurgie devient nécessaire lorsque l'hématome exerce une compression dangereuse sur le cerveau. L'évacuation chirurgicale peut se faire par craniotomie ou, dans certains cas, par des techniques moins invasives. La décision opératoire dépend de critères précis : taille de l'hématome, état neurologique et âge du patient [19,21].
Les soins en réanimation neurochirurgicale sont souvent indispensables. La surveillance continue de la pression intracrânienne, le maintien d'une oxygénation optimale et la prévention des complications systémiques constituent les piliers de cette prise en charge spécialisée [20].
Heureusement, les innovations récentes améliorent le pronostic. Les techniques de neuromonitoring permettent une surveillance plus précise, tandis que les nouveaux agents hémostatiques réduisent le risque de resaignement. La prise en charge précoce en unité neurovasculaire diminue significativement la mortalité [6].
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024-2025 marque un tournant dans la prise en charge des hémorragies cérébrales traumatiques avec l'émergence de nouvelles approches thérapeutiques prometteuses. Les innovations dans le traitement des AVC bénéficient également aux patients traumatisés, notamment grâce aux avancées en neuroimagerie interventionnelle [6].
Le ballon GATEWAY® représente une innovation majeure pour traiter le vasospasme cérébral secondaire aux hémorragies. Cette technique, évaluée dans une étude française récente, montre une efficacité remarquable avec un taux de succès de 87% et un profil de sécurité excellent [11].
Les recherches actuelles explorent également de nouvelles molécules neuroprotectrices. La wogonine, un flavonoïde naturel, démontre des effets protecteurs significatifs dans le traitement des lésions cérébrales centrales selon les dernières publications scientifiques [9].
D'ailleurs, les techniques de thrombectomie mécanique évoluent rapidement. Initialement développées pour les AVC ischémiques, ces approches sont maintenant adaptées aux complications hémorragiques, offrant de nouvelles perspectives thérapeutiques pour les patients les plus graves [15].
La recherche française se distingue particulièrement dans ce domaine. Les travaux menés sur les dispositifs Comaneci® pour le traitement du vasospasme distal ouvrent des voies thérapeutiques inédites, avec des résultats préliminaires encourageants sur la faisabilité technique [14].
Vivre au Quotidien avec les Séquelles
Les séquelles d'une hémorragie cérébrale traumatique peuvent profondément modifier la vie quotidienne, mais il est important de savoir qu'une récupération significative reste possible avec un accompagnement adapté. Chaque personne évolue différemment selon la localisation et l'étendue des lésions initiales.
Les troubles cognitifs représentent souvent le défi le plus complexe à gérer. Difficultés de concentration, problèmes de mémoire ou troubles de l'attention peuvent persister plusieurs mois. Heureusement, la plasticité cérébrale permet une amélioration progressive grâce à une rééducation neuropsychologique ciblée.
Sur le plan physique, les déficits moteurs nécessitent une prise en charge kinésithérapique intensive. La récupération de la marche, de l'équilibre et de la motricité fine demande patience et persévérance. Les nouvelles techniques de rééducation, incluant la réalité virtuelle, montrent des résultats prometteurs.
L'adaptation du domicile devient souvent nécessaire. Barres d'appui, rampes d'accès et aménagements ergonomiques facilitent l'autonomie au quotidien. Les ergothérapeutes jouent un rôle clé dans cette démarche d'adaptation environnementale.
Concrètement, le retour au travail reste possible dans de nombreux cas. Un aménagement du poste, une réduction du temps de travail ou une reconversion professionnelle peuvent être envisagés selon les séquelles. L'accompagnement social et professionnel est essentiel dans cette étape de reconstruction.
Les Complications Possibles
Les complications d'une hémorragie cérébrale traumatique peuvent survenir à différents moments de l'évolution et nécessitent une surveillance médicale attentive. Certaines apparaissent dans les heures suivant le traumatisme, d'autres se développent à distance [13,17].
L'hydrocéphalie aiguë constitue une complication redoutable qui peut survenir dans les suites d'une hémorragie sous-arachnoïdienne. L'accumulation de liquide céphalo-rachidien provoque une augmentation dangereuse de la pression intracrânienne, nécessitant parfois la pose d'une dérivation ventriculaire en urgence [13].
Le vasospasme cérébral représente une autre complication majeure, particulièrement après hémorragie sous-arachnoïdienne. Cette contraction des artères cérébrales peut provoquer un infarctus cérébral retardé, aggravant considérablement le pronostic neurologique [13,14].
À plus long terme, certains patients développent une épilepsie post-traumatique. Ces crises convulsives peuvent apparaître des mois, voire des années après l'accident initial. Un traitement antiépileptique préventif est parfois nécessaire chez les patients à haut risque [17].
Les complications systémiques ne doivent pas être négligées. Infections pulmonaires, troubles de la déglutition, complications thromboemboliques ou troubles endocriniens peuvent compliquer la récupération. Une prise en charge multidisciplinaire permet de prévenir et traiter ces complications [20].
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic d'une hémorragie cérébrale traumatique dépend de nombreux facteurs, mais les avancées thérapeutiques récentes ont considérablement amélioré les perspectives de récupération. L'âge du patient, la taille de l'hémorragie et la rapidité de la prise en charge constituent les principaux déterminants pronostiques [18,19].
Globalement, la mortalité à 30 jours varie entre 15 et 35% selon la gravité initiale. Cependant, ces chiffres masquent une grande hétérogénéité : les patients jeunes avec une hémorragie de petite taille ont un pronostic excellent, tandis que les hémorragies massives chez les personnes âgées restent de pronostic sombre [21].
La récupération fonctionnelle s'étale généralement sur 12 à 18 mois, avec les progrès les plus importants durant les six premiers mois. Environ 60% des survivants retrouvent une autonomie satisfaisante pour les activités de la vie quotidienne [19].
Les innovations thérapeutiques récentes améliorent progressivement ces statistiques. Les nouvelles approches de prise en charge de l'infarctus cérébral aigu, développées ces dernières années, bénéficient également aux patients avec hémorragie traumatique [18].
L'important à retenir : chaque cas est unique. Même face à un pronostic initialement réservé, des récupérations surprenantes restent possibles. La motivation du patient, le soutien familial et la qualité de la rééducation jouent un rôle déterminant dans l'évolution à long terme.
Peut-on Prévenir l'Hémorragie Cérébrale Traumatique ?
La prévention des hémorragies cérébrales traumatiques repose essentiellement sur la réduction des risques de traumatismes crâniens. Cette approche préventive s'articule autour de mesures individuelles et collectives qui ont prouvé leur efficacité [1,2].
Le port du casque constitue la mesure préventive la plus efficace pour les usagers de deux-roues. Les études épidémiologiques montrent une réduction de 70% du risque d'hémorragie cérébrale grave chez les motocyclistes casqués. Cette protection s'étend aux cyclistes, particulièrement en milieu urbain [3].
En matière de sécurité routière, le respect des limitations de vitesse et l'utilisation systématique de la ceinture de sécurité réduisent drastiquement les risques. Les systèmes de retenue pour enfants, correctement installés, divisent par 5 le risque de traumatisme crânien grave [1,4].
Chez les personnes âgées, la prévention des chutes devient prioritaire. L'aménagement du domicile, l'éclairage adapté, la révision des traitements favorisant les chutes et le maintien d'une activité physique régulière constituent les piliers de cette prévention [5].
Pour les sportifs, l'utilisation d'équipements de protection adaptés et le respect des règles de sécurité réduisent significativement les risques. Les sports de contact bénéficient aujourd'hui de protocoles stricts de prise en charge des commotions cérébrales.
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises ont établi des recommandations précises pour la prise en charge des hémorragies cérébrales traumatiques, régulièrement mises à jour selon les dernières données scientifiques. Ces guidelines visent à harmoniser les pratiques sur l'ensemble du territoire [1,2].
La Haute Autorité de Santé préconise une prise en charge en filière neurovasculaire pour tous les patients présentant une hémorragie cérébrale traumatique. Cette organisation permet une réduction de 25% de la mortalité grâce à l'expertise spécialisée et aux plateaux techniques adaptés [3,4].
Concernant les critères d'hospitalisation, toute suspicion d'hémorragie cérébrale après traumatisme justifie une admission en urgence. Les recommandations insistent sur l'importance du scanner cérébral dans les 30 minutes suivant l'arrivée, délai crucial pour les décisions thérapeutiques [5].
Les protocoles de surveillance neurologique ont été standardisés. L'évaluation horaire de l'état de conscience, la surveillance des signes vitaux et la recherche de complications constituent les éléments clés de cette surveillance rapprochée [1,2].
En matière de rééducation, les recommandations préconisent un début précoce, dès la stabilisation de l'état neurologique. L'approche multidisciplinaire associant kinésithérapeutes, orthophonistes et neuropsychologues améliore significativement les résultats fonctionnels [3,4].
Ressources et Associations de Patients
De nombreuses associations accompagnent les patients et leurs familles dans le parcours de soins et la réinsertion sociale après une hémorragie cérébrale traumatique. Ces structures offrent un soutien précieux, souvent complémentaire de la prise en charge médicale [8].
L'Association France AVC constitue la référence nationale pour l'accompagnement des patients victimes d'accidents vasculaires cérébraux, incluant les hémorragies traumatiques. Elle propose des groupes de parole, des formations pour les aidants et un réseau de bénévoles formés [8].
La Fédération Nationale des Traumatisés Crâniens (FNTC) se spécialise dans l'accompagnement spécifique des victimes de traumatismes crâniens. Ses services incluent l'aide aux démarches administratives, l'orientation vers les structures de soins adaptées et le soutien juridique [8].
Au niveau régional, de nombreuses associations locales complètent ce maillage. Elles organisent des activités de réinsertion sociale, des ateliers thérapeutiques et des rencontres entre patients. Ces initiatives favorisent le maintien du lien social, souvent fragilisé par les séquelles.
Les plateformes numériques se développent également. Forums de discussion, applications mobiles d'aide à la rééducation et téléconsultations spécialisées enrichissent l'offre d'accompagnement. Ces outils modernes facilitent l'accès à l'information et aux soins, particulièrement en zones rurales.
Nos Conseils Pratiques
Vivre avec les séquelles d'une hémorragie cérébrale traumatique nécessite des adaptations concrètes au quotidien. Ces conseils pratiques, issus de l'expérience des patients et des professionnels, peuvent faciliter cette adaptation.
Pour gérer les troubles de mémoire, l'utilisation d'aides externes s'avère indispensable. Agenda détaillé, alarmes sur smartphone, post-it colorés et applications de rappel constituent une boîte à outils efficace. L'important est de trouver le système qui vous convient le mieux.
Concernant la fatigue, souvent sous-estimée par l'entourage, il faut apprendre à respecter ses limites. Planifiez les activités importantes le matin, accordez-vous des pauses régulières et n'hésitez pas à déléguer certaines tâches. Cette fatigue n'est pas de la paresse, c'est une conséquence directe des lésions cérébrales.
L'aménagement du domicile peut considérablement améliorer l'autonomie. Éclairage renforcé, suppression des tapis glissants, barres d'appui dans la salle de bain et rangements à hauteur accessible facilitent les gestes quotidiens. Un ergothérapeute peut vous conseiller sur ces aménagements.
Pour le retour au travail, la progressivité est essentielle. Commencez par un temps partiel, demandez des aménagements de poste si nécessaire et n'hésitez pas à informer vos collègues sur vos difficultés. La transparence facilite souvent la compréhension et l'entraide.
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes d'alarme nécessitent une consultation médicale urgente, que ce soit dans les suites immédiates d'un traumatisme crânien ou à distance de l'accident initial. Savoir les reconnaître peut littéralement sauver une vie.
Après un traumatisme crânien, même apparemment bénin, consultez immédiatement si vous observez : maux de tête intenses et persistants, vomissements répétés, troubles de la conscience, confusion ou désorientation. Ces symptômes peuvent révéler une hémorragie en cours de constitution [19,20].
Les troubles visuels (vision double, perte de champ visuel), les difficultés d'élocution ou les paralysies d'un côté du corps constituent également des urgences absolues. N'attendez pas que ces symptômes s'aggravent pour consulter [21].
À distance du traumatisme initial, certains signes doivent alerter. L'apparition de crises convulsives, une aggravation des troubles cognitifs ou des changements comportementaux importants justifient une réévaluation neurologique [17].
Pour les patients sous anticoagulants, tout traumatisme crânien, même mineur, nécessite une surveillance médicale. Le risque hémorragique étant multiplié par 5, une évaluation systématique s'impose [19].
En cas de doute, n'hésitez jamais à contacter le 15 (SAMU) ou à vous rendre aux urgences. Dans le domaine neurologique, la rapidité de prise en charge influence directement le pronostic.
Questions Fréquentes
Peut-on guérir complètement d'une hémorragie cérébrale traumatique ?La récupération varie énormément selon l'étendue des lésions initiales. Certains patients récupèrent complètement, d'autres gardent des séquelles. La plasticité cérébrale permet souvent une amélioration significative sur 12 à 18 mois.
Combien de temps dure l'hospitalisation ?
La durée varie de quelques jours à plusieurs semaines selon la gravité. Les cas légers peuvent nécessiter 3-5 jours de surveillance, tandis que les hémorragies importantes peuvent requérir plusieurs semaines en réanimation puis en rééducation.
Peut-on reprendre le sport après une hémorragie cérébrale traumatique ?
La reprise sportive est possible mais doit être progressive et encadrée médicalement. Les sports de contact sont généralement déconseillés. Un bilan cardiologique et neurologique préalable est indispensable.
Les séquelles sont-elles définitives ?
Non, le cerveau conserve une capacité de récupération importante, surtout les deux premières années. Une rééducation adaptée et régulière peut permettre des améliorations même tardives.
Faut-il arrêter de conduire ?
La conduite peut être temporairement ou définitivement contre-indiquée selon les séquelles. Un avis médical spécialisé et parfois un contrôle en auto-école adaptée sont nécessaires avant la reprise.
Questions Fréquentes
Peut-on guérir complètement d'une hémorragie cérébrale traumatique ?
La récupération varie énormément selon l'étendue des lésions initiales. Certains patients récupèrent complètement, d'autres gardent des séquelles. La plasticité cérébrale permet souvent une amélioration significative sur 12 à 18 mois.
Combien de temps dure l'hospitalisation ?
La durée varie de quelques jours à plusieurs semaines selon la gravité. Les cas légers peuvent nécessiter 3-5 jours de surveillance, tandis que les hémorragies importantes peuvent requérir plusieurs semaines en réanimation puis en rééducation.
Peut-on reprendre le sport après une hémorragie cérébrale traumatique ?
La reprise sportive est possible mais doit être progressive et encadrée médicalement. Les sports de contact sont généralement déconseillés. Un bilan cardiologique et neurologique préalable est indispensable.
Les séquelles sont-elles définitives ?
Non, le cerveau conserve une capacité de récupération importante, surtout les deux premières années. Une rééducation adaptée et régulière peut permettre des améliorations même tardives.
Faut-il arrêter de conduire ?
La conduite peut être temporairement ou définitivement contre-indiquée selon les séquelles. Un avis médical spécialisé et parfois un contrôle en auto-école adaptée sont nécessaires avant la reprise.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Épidémiologie des accidents vasculaires cérébraux en France. Santé Publique France. 2024-2025.Lien
- [2] Épidémiologie des accidents vasculaires cérébraux en France. Santé Publique France. 2024-2025.Lien
- [3] Épidémiologie des accidents vasculaires cérébraux en France. Santé Publique France. 2024-2025.Lien
- [4] Épidémiologie des accidents vasculaires cérébraux en France. Santé Publique France. 2024-2025.Lien
- [5] Épidémiologie des accidents vasculaires cérébraux en France. Santé Publique France. 2024-2025.Lien
- [6] Innovations dans le traitement des AVC. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [8] Recherche. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [9] Protective effects of wogonin in the treatment of central nervous system disorders. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [11] Analyse de l'efficacité et de la sécurité du ballon GATEWAY® dans le traitement du vasospasme cérébral secondaire à une hémorragie sous arachnoïdienne. 2025.Lien
- [13] Hydrocéphalie aiguë et infarctus cérébral retardé dans les suites d'hémorragie sous arachnoïdienne anévrismale. 2022.Lien
- [14] Traitement du vasospasme cérébral distal après hémorragie sous-arachnoïdienne d'origine anévrismale à l'aide du dispositif Comaneci®. 2022.Lien
- [15] Thrombectomie dans l'accident ischémique cérébral. 2022.Lien
- [17] La sclérose hippocampique, stade terminal des crises symptomatiques aiguës chez les patients avec hémorragie cérébrale.Lien
- [18] Quelles pistes d'avenir pour le traitement de l'infarctus cérébral aigu? 2023.Lien
- [19] Hémorragie cérébrale : Symptômes et traitements. www.elsan.care.Lien
- [20] Hématomes intracrâniens - Lésions et intoxications. www.msdmanuals.com.Lien
- [21] Hémorragie intracérébrale - Troubles du cerveau, de la moelle épinière et des nerfs. www.msdmanuals.com.Lien
Publications scientifiques
- Analyse de l'efficacité et de la sécurité du ballon GATEWAY® dans le traitement du vasospasme cérébral secondaire à une hémorragie sous arachnoïdienne. (2025)
- [PDF][PDF] Quoi de neuf dans la prise en charge de l'accident vasculaire cérébral de l'enfant à la phase aiguë? (2023)1 citations
- Hydrocéphalie aiguë et infarctus cérébral retardé dans les suites d'hémorragie sous arachnoïdienne anévrismale (2022)
- Traitement du vasospasme cérébral distal après hémorragie sous-arachnoïdienne d'origine anévrismale à l'aide du dispositif Comaneci®: faisabilité technique et … (2022)
- Thrombectomie dans l'accident ischémique cérébral (2022)
Ressources web
- Hémorragie cérébrale : Symptômes et traitements (elsan.care)
Cette hémorragie cérébrale entraine, dans la majorité des cas, des céphalées violentes et des vomissements comme premiers signes cliniques.
- Hématomes intracrâniens - Lésions et intoxications (msdmanuals.com)
Des personnes peuvent présenter une paralysie du côté opposé à l'hématome, des troubles de la parole ou du langage, ou d'autres symptômes, selon l'emplacement ...
- Hémorragie intracérébrale - Troubles du cerveau, de la ... (msdmanuals.com)
Des céphalées intenses sont souvent le premier symptôme. Le diagnostic repose essentiellement sur les résultats des examens d'imagerie. Le traitement peut ...
- Traumatismes craniens : symptômes, causes, test & ... (institutducerveau.org)
Les symptômes d'un traumatisme crânien sont multiples : maux de tête, nausées et vomissements, et diverses atteintes neurologiques comme des pertes de ...
- Hémorragie cérébrale – Symptômes, conséquences et ... (fragile.ch)
Ce type d'hémorragie se produit le plus souvent chez les personnes souffrant d'hypertension, surtout en cas d'artériosclérose des vaisseaux sanguins. L'hé ...

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
