Fièvre Typhoïde : Symptômes, Traitement et Prévention - Guide 2025
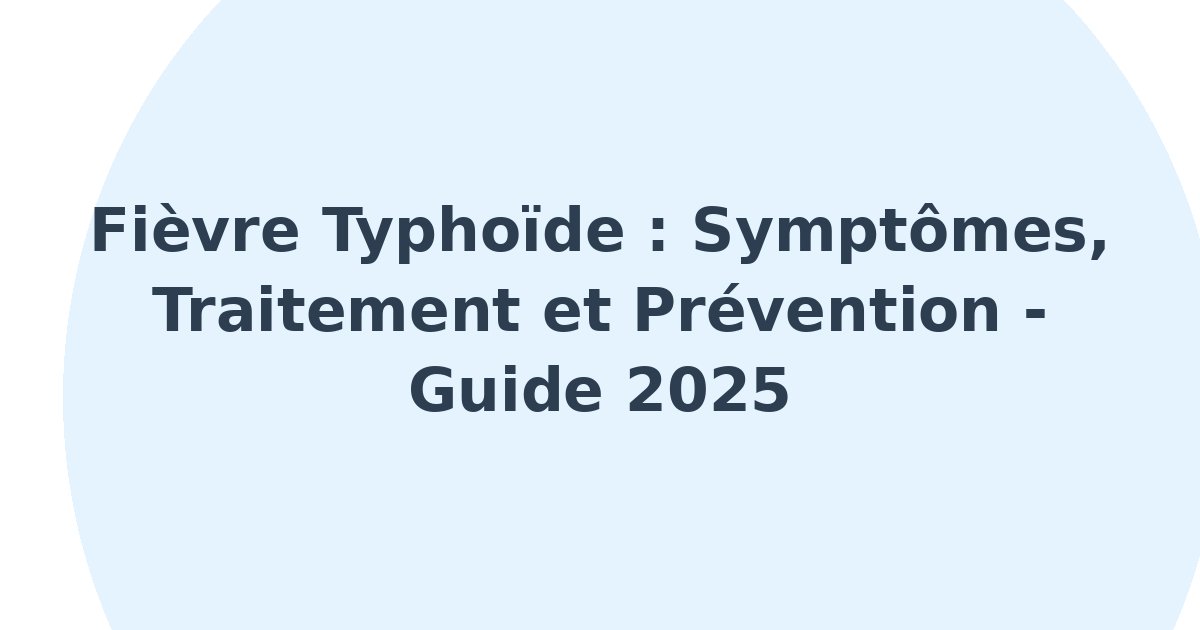
La fièvre typhoïde reste une maladie infectieuse préoccupante, particulièrement dans certaines régions françaises d'outre-mer. Cette pathologie bactérienne, causée par Salmonella Typhi, touche encore des milliers de personnes chaque année. Heureusement, les avancées thérapeutiques de 2024-2025 offrent de nouveaux espoirs. Comprendre cette maladie, c'est mieux la prévenir et la traiter.
Téléconsultation et Fièvre typhoïde
Téléconsultation non recommandéeLa fièvre typhoïde est une infection bactérienne systémique grave nécessitant un diagnostic précis par examens biologiques spécialisés et une prise en charge hospitalière immédiate. L'évaluation clinique complète, incluant l'examen physique et la surveillance des complications potentiellement fatales, ne peut être réalisée à distance.
Ce qui peut être évalué à distance
Recueil de l'historique des symptômes fébriles et digestifs, évaluation des facteurs de risque comme les voyages récents en zone d'endémie, analyse des antécédents de vaccination antityphoïdique, orientation diagnostique initiale face à une fièvre prolongée, suivi post-hospitalisation une fois le diagnostic confirmé.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examen clinique complet pour rechercher les signes de Fiornet et évaluer l'état général, prélèvements biologiques spécialisés (hémocultures, coprocultures, sérologie de Widal), surveillance des complications neurologiques et cardiovasculaires, adaptation thérapeutique selon l'antibiogramme.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Fièvre prolongée inexpliquée nécessitant des examens bactériologiques spécialisés, suspicion de complications comme la perforation intestinale ou les troubles neurologiques, nécessité d'une hospitalisation pour surveillance et traitement intraveineux, évaluation de l'état de déshydratation et des signes de choc septique.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Fièvre élevée avec troubles de la conscience ou confusion, douleurs abdominales intenses évoquant une perforation intestinale, signes de choc septique avec hypotension et tachycardie, hémorragie digestive.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Fièvre élevée persistante avec troubles de la conscience, confusion ou délire
- Douleurs abdominales intenses et brutales évoquant une perforation intestinale
- Signes de choc septique : hypotension, tachycardie, marbrures cutanées
- Hémorragie digestive avec présence de sang dans les selles ou vomissements
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Infectiologue — consultation en présentiel indispensable
La fièvre typhoïde nécessite une expertise infectiologique pour le diagnostic différentiel et la prise en charge thérapeutique adaptée. Une hospitalisation en service spécialisé est généralement indispensable pour la surveillance des complications et l'administration d'une antibiothérapie intraveineuse.
Fièvre typhoïde : Définition et Vue d'Ensemble
La fièvre typhoïde est une maladie infectieuse grave causée par la bactérie Salmonella enterica serovar Typhi. Cette pathologie se transmet principalement par voie oro-fécale, notamment par la consommation d'eau ou d'aliments contaminés [7,8].
Contrairement à ce que beaucoup pensent, cette maladie n'appartient pas au passé. En fait, elle continue de poser des défis sanitaires majeurs, particulièrement dans les territoires d'outre-mer français. La bactérie responsable colonise exclusivement l'être humain, ce qui rend la transmission interhumaine possible dans certaines circonstances .
D'ailleurs, il est important de distinguer la fièvre typhoïde des fièvres paratyphoïdes, causées par d'autres sérotypes de Salmonella. Bien que cliniquement similaires, ces pathologies présentent des différences importantes en termes de gravité et de traitement. L'évolution naturelle de la maladie, sans traitement approprié, peut conduire à des complications sévères, voire mortelles dans 10 à 20% des cas [7].
Épidémiologie en France et dans le Monde
L'épidémiologie de la fièvre typhoïde en France présente des particularités géographiques marquées. À Mayotte, territoire particulièrement touché, les données de Santé Publique France révèlent une situation préoccupante avec des épidémies récurrentes depuis 2016 [1,2].
Les chiffres de 2024 montrent que Mayotte concentre la majorité des cas français, avec une incidence qui dépasse largement celle de la métropole. En effet, entre 2016 et 2025, plus de 2 000 cas ont été recensés sur ce territoire, soit une incidence annuelle moyenne de 150 cas pour 100 000 habitants [1]. Cette situation contraste fortement avec la France métropolitaine, où l'incidence reste inférieure à 0,1 cas pour 100 000 habitants.
Mais les données récentes de septembre 2024 révèlent une évolution inquiétante des maladies hydriques à Mayotte, incluant la fièvre typhoïde [2,4]. Les maladies sanitaires dégradées, notamment l'accès limité à l'eau potable et l'assainissement défaillant, expliquent en grande partie cette situation épidémiologique particulière.
Au niveau mondial, l'Organisation mondiale de la santé estime à 11 à 20 millions le nombre de cas annuels, avec 128 000 à 161 000 décès. L'Asie du Sud-Est et l'Afrique subsaharienne restent les régions les plus touchées, avec des taux d'incidence pouvant atteindre 100 à 1 000 cas pour 100 000 habitants dans certaines zones endémiques .
Les Causes et Facteurs de Risque
La transmission de la fièvre typhoïde suit un schéma bien défini, centré sur le cycle oro-fécal. La bactérie Salmonella Typhi se transmet principalement par l'ingestion d'eau ou d'aliments contaminés par les matières fécales de personnes infectées [7,8].
Les facteurs de risque majeurs incluent les voyages dans des zones endémiques, particulièrement en Asie du Sud-Est, en Afrique subsaharienne et en Amérique latine. D'ailleurs, les recommandations sanitaires aux voyageurs 2024 soulignent l'importance de la prévention dans ces régions [3]. Concrètement, le risque est multiplié par 10 à 100 lors de séjours dans ces zones.
Mais il existe aussi des facteurs de risque locaux. À Mayotte, par exemple, les maladies d'hygiène précaires et l'accès limité à l'eau potable constituent les principaux déterminants de la transmission [2,4]. Les porteurs chroniques, qui peuvent excréter la bactérie pendant des mois voire des années, représentent également un risque important, comme l'illustre l'éclosion récente d'Ottawa [6].
L'âge constitue un autre facteur déterminant. Les enfants et les jeunes adultes sont plus fréquemment touchés, probablement en raison d'une exposition plus importante et d'une immunité moins développée. Les personnes immunodéprimées présentent également un risque accru de développer des formes sévères de la maladie [8].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes de la fièvre typhoïde évoluent classiquement en plusieurs phases, rendant parfois le diagnostic initial difficile. La période d'incubation varie généralement de 7 à 21 jours, mais peut s'étendre jusqu'à 60 jours dans certains cas [7,8].
La première semaine se caractérise par l'apparition progressive d'une fièvre élevée, souvent supérieure à 39°C, accompagnée de maux de tête intenses et de malaise général. Contrairement à d'autres infections, cette fièvre présente un caractère particulier : elle augmente progressivement en "marches d'escalier", atteignant son maximum vers le 7e jour [8].
D'ailleurs, les troubles digestifs constituent un élément clé du tableau clinique. Vous pourriez ressentir des douleurs abdominales, souvent localisées dans la fosse iliaque droite, mimant parfois une appendicite. La diarrhée ou la constipation peuvent alterner, créant une confusion diagnostique [7]. Bon à savoir : contrairement aux gastro-entérites classiques, les vomissements restent généralement modérés.
La deuxième semaine voit apparaître des signes plus spécifiques. Les taches rosées lenticulaires, petites éruptions cutanées de 2-3 mm, apparaissent sur le tronc chez 30% des patients. Ces lésions, pathognomoniques de la maladie, disparaissent spontanément en quelques jours. Parallèlement, une splénomégalie (augmentation du volume de la rate) peut être détectée à l'examen clinique [8].
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic de la fièvre typhoïde repose sur une approche méthodique combinant éléments cliniques et examens complémentaires. Face à un tableau fébrile évocateur, votre médecin orientera rapidement les investigations [8].
L'hémoculture constitue l'examen de référence, particulièrement efficace durant la première semaine de la maladie. Sa sensibilité atteint 80-90% en phase précoce, mais diminue progressivement avec l'évolution de la pathologie et l'introduction d'un traitement antibiotique . Concrètement, plusieurs prélèvements sanguins sont nécessaires pour optimiser les chances de détection.
Mais d'autres examens peuvent s'avérer utiles. La coproculture présente un intérêt particulier après la première semaine, lorsque l'excrétion bactérienne fécale devient plus importante. Les urines peuvent également être analysées, bien que leur rentabilité diagnostique reste plus limitée .
Les tests sérologiques, comme le test de Widal, restent controversés. Bien que largement utilisés dans certaines régions, leur performance diagnostique pose question, avec de nombreux faux positifs et négatifs . L'important à retenir : ces tests ne doivent jamais remplacer les examens bactériologiques directs.
Les examens complémentaires révèlent souvent une leucopénie (diminution des globules blancs) avec neutropénie relative, contrastant avec l'élévation habituelle lors d'infections bactériennes. Cette particularité biologique peut orienter le diagnostic en contexte évocateur [8].
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement de la fièvre typhoïde a considérablement évolué ces dernières années, notamment face à l'émergence de souches résistantes. L'antibiothérapie reste le pilier thérapeutique, mais le choix de la molécule dépend désormais étroitement du profil de résistance [8].
Les fluoroquinolones, longtemps considérées comme traitement de première intention, voient leur efficacité remise en question. En effet, l'émergence de souches résistantes, particulièrement en Asie du Sud-Est, limite désormais leur utilisation. La ciprofloxacine, autrefois référence, n'est plus systématiquement recommandée en première ligne .
D'ailleurs, l'azithromycine gagne en popularité comme alternative thérapeutique. Cette macrolide présente l'avantage d'une bonne diffusion tissulaire et d'une posologie simplifiée. Les études récentes montrent une efficacité comparable aux fluoroquinolones, avec un profil de résistance plus favorable [8].
Mais la situation devient particulièrement préoccupante avec l'apparition de souches ultrarésistantes (XDR). Le premier cas belge rapporté en 2023 illustre cette problématique émergente . Ces souches, résistantes à pratiquement tous les antibiotiques classiques, nécessitent des approches thérapeutiques innovantes, incluant parfois l'association de plusieurs molécules.
Le traitement symptomatique accompagne systématiquement l'antibiothérapie. La prise en charge de la fièvre, de la douleur et des troubles digestifs améliore significativement le confort du patient. L'hydratation, particulièrement importante en cas de diarrhée, doit être surveillée attentivement [8].
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024-2025 marque un tournant dans la prise en charge de la fièvre typhoïde, avec plusieurs innovations thérapeutiques prometteuses. Les recherches se concentrent particulièrement sur le développement de nouveaux vaccins et l'optimisation des stratégies préventives [4,5].
Les vaccins conjugués contre la typhoïde représentent l'avancée la plus significative. Une étude multicentrique de phase III récemment publiée démontre une efficacité supérieure à 80% chez les enfants et les adultes [4,5]. Ces nouveaux vaccins offrent une protection plus durable et peuvent être administrés dès l'âge de 6 mois, contrairement aux vaccins précédents.
Concrètement, ces innovations vaccinales s'inscrivent dans une stratégie globale de santé publique. Les données de 2024 montrent que l'introduction de ces vaccins dans les programmes de vaccination de routine pourrait réduire l'incidence de 60 à 80% dans les zones endémiques [5]. C'est une perspective particulièrement encourageante pour des territoires comme Mayotte.
Mais la recherche ne s'arrête pas là. Les laboratoires pharmaceutiques développent également de nouvelles approches thérapeutiques pour contrer les résistances bactériennes [8]. L'utilisation de nanoparticules pour améliorer la délivrance des antibiotiques fait l'objet d'études prometteuses, avec des résultats préliminaires encourageants.
D'ailleurs, l'intelligence artificielle commence à transformer le diagnostic. Des algorithmes d'aide au diagnostic, intégrant données cliniques et biologiques, permettent une détection plus précoce et plus fiable de la maladie. Ces outils, testés dans plusieurs centres hospitaliers français, pourraient révolutionner la prise en charge [8].
Vivre au Quotidien avec Fièvre typhoïde
Vivre avec les séquelles ou les récidives de la fièvre typhoïde nécessite des adaptations importantes dans la vie quotidienne. Bien que la plupart des patients guérissent complètement, certains développent un portage chronique qui influence leur mode de vie [6,8].
Les porteurs chroniques, qui représentent 2 à 5% des cas, doivent adopter des mesures d'hygiène strictes pour éviter la transmission. Cela implique un lavage des mains méticuleux, une attention particulière à la préparation des aliments, et parfois des restrictions professionnelles. En effet, certains métiers de l'alimentation peuvent être temporairement interdits [6].
D'ailleurs, le suivi médical régulier s'avère indispensable. Les contrôles bactériologiques permettent de surveiller l'évolution du portage et d'adapter les mesures préventives. Rassurez-vous, des traitements prolongés peuvent éliminer le portage dans la majorité des cas [8].
L'impact psychologique ne doit pas être négligé. La stigmatisation sociale, particulièrement dans les communautés où la maladie reste mal comprise, peut affecter significativement la qualité de vie. Le soutien psychologique et l'éducation de l'entourage constituent des éléments essentiels de la prise en charge globale.
Les Complications Possibles
Les complications de la fièvre typhoïde peuvent survenir à tout moment de l'évolution, particulièrement en l'absence de traitement approprié. Ces complications, potentiellement mortelles, justifient une prise en charge médicale urgente [7,8].
Les complications digestives dominent le tableau. L'hémorragie digestive, survenant chez 10 à 20% des patients non traités, résulte de l'ulcération des plaques de Peyer intestinales. Cette complication se manifeste par des selles sanglantes et peut nécessiter une transfusion sanguine. Plus grave encore, la perforation intestinale touche 1 à 3% des cas et constitue une urgence chirurgicale absolue [8].
Mais d'autres organes peuvent être affectés. Les complications neurologiques, bien que plus rares, incluent méningites, encéphalites et troubles psychiatriques. Ces manifestations, observées chez 2 à 5% des patients, peuvent laisser des séquelles permanentes [7]. L'important à retenir : tout changement de l'état de conscience doit alerter.
Les complications cardiovasculaires, notamment la myocardite, restent exceptionnelles mais potentiellement fatales. De même, les atteintes pulmonaires (pneumonies) et rénales (néphrites) peuvent compliquer l'évolution de la maladie. Heureusement, l'antibiothérapie précoce réduit considérablement le risque de ces complications sévères [8].
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de la fièvre typhoïde dépend étroitement de la précocité du diagnostic et de la mise en route du traitement. Avec une prise en charge adaptée, la mortalité chute à moins de 1%, contre 10 à 20% en l'absence de traitement [7,8].
La guérison complète constitue l'évolution habituelle chez les patients traités précocement. La fièvre disparaît généralement en 3 à 5 jours après le début de l'antibiothérapie, et l'état général s'améliore progressivement. Cependant, la convalescence peut s'étendre sur plusieurs semaines, avec une fatigue persistante [8].
D'ailleurs, certains facteurs influencent le pronostic. L'âge avancé, l'immunodépression et la présence de comorbidités constituent des facteurs de risque de complications. À l'inverse, les enfants et les adultes jeunes en bonne santé présentent généralement une évolution favorable [7].
Le portage chronique représente une particularité évolutive importante. Bien qu'asymptomatique, il concerne 2 à 5% des patients guéris et peut persister des années. Ce portage, plus fréquent chez les femmes et les personnes âgées, nécessite un suivi spécialisé et peut bénéficier de traitements d'éradication [6,8].
Bon à savoir : la fièvre typhoïde ne confère pas d'immunité définitive. Des réinfections restent possibles, bien que généralement moins sévères. Cette particularité souligne l'importance des mesures préventives, même après un premier épisode [7].
Peut-on Prévenir Fièvre typhoïde ?
La prévention de la fièvre typhoïde repose sur une approche multifactorielle combinant vaccination, mesures d'hygiène et précautions alimentaires. Cette stratégie préventive s'avère particulièrement cruciale pour les voyageurs se rendant en zones endémiques [3].
La vaccination constitue le pilier de la prévention. Deux types de vaccins sont actuellement disponibles : le vaccin oral vivant atténué (Ty21a) et le vaccin injectable polysaccharidique (Vi). Le premier, administré en 3 prises orales, offre une protection de 5 à 7 ans. Le second, en injection unique, protège pendant 2 à 3 ans .
Mais les innovations 2024-2025 révolutionnent cette approche. Les nouveaux vaccins conjugués démontrent une efficacité supérieure et une durée de protection prolongée [4,5]. Ces vaccins, recommandés par l'OMS, peuvent être administrés dès l'âge de 6 mois et offrent une protection communautaire significative.
Les mesures d'hygiène restent fondamentales. La règle "cuire, bouillir, peler ou éviter" s'applique strictement aux aliments. L'eau doit être systématiquement bouillie ou provenir de bouteilles capsulées. Évitez les glaçons, les crudités, les fruits non pelés et les produits laitiers non pasteurisés [3].
D'ailleurs, les recommandations sanitaires 2024 insistent sur l'importance du lavage des mains. Cette mesure simple mais efficace réduit considérablement le risque de transmission. L'utilisation de solutions hydroalcooliques constitue une alternative acceptable en l'absence d'eau et de savon [3].
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises ont actualisé leurs recommandations concernant la fièvre typhoïde, particulièrement suite à la situation épidémiologique de Mayotte [1,3]. Ces nouvelles directives reflètent l'évolution des connaissances et l'émergence de souches résistantes.
Santé Publique France recommande désormais la vaccination systématique pour tous les voyageurs se rendant en zones d'endémie, même pour des séjours courts. Cette recommandation, renforcée en 2024, s'étend également aux résidents de Mayotte et aux professionnels de santé exposés [3].
Concernant la surveillance épidémiologique, les autorités ont mis en place un système de déclaration obligatoire renforcé. Tout cas de fièvre typhoïde doit être signalé dans les 24 heures aux autorités sanitaires, permettant une investigation rapide et la mise en œuvre de mesures de contrôle [1].
D'ailleurs, les recommandations thérapeutiques évoluent face aux résistances. L'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) préconise désormais un antibiogramme systématique avant traitement, particulièrement pour les cas importés d'Asie du Sud-Est . Cette approche personnalisée optimise l'efficacité thérapeutique.
Les mesures de prévention collective font également l'objet d'une attention particulière. L'amélioration de l'assainissement et de l'accès à l'eau potable constitue une priorité de santé publique, particulièrement dans les territoires d'outre-mer [2,4]. Ces investissements structurels représentent la clé d'une prévention durable.
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs ressources spécialisées accompagnent les patients et leurs familles dans la prise en charge de la fièvre typhoïde. Ces structures offrent information, soutien et orientation vers les professionnels compétents.
L'Institut Pasteur propose des consultations spécialisées de médecine des voyages dans ses différents centres. Ces consultations permettent une évaluation personnalisée du risque et des recommandations adaptées à chaque situation [7]. Les centres de vaccination internationale, présents dans toutes les grandes villes, constituent également des ressources précieuses.
Pour les patients ayant développé un portage chronique, des consultations spécialisées en infectiologie permettent un suivi adapté. Ces consultations, disponibles dans les CHU, proposent des protocoles d'éradication personnalisés et un accompagnement psychologique si nécessaire.
D'ailleurs, les associations de patients, bien que moins spécifiques à la fièvre typhoïde, offrent un soutien précieux. Les associations de malades infectieux proposent des groupes de parole et des informations actualisées sur les traitements. Ces structures facilitent également les démarches administratives et l'accès aux droits sociaux.
Les plateformes numériques se développent également. Des applications mobiles permettent désormais de suivre l'évolution des symptômes et de recevoir des rappels de traitement. Ces outils, validés par les professionnels de santé, améliorent l'observance thérapeutique et le suivi médical.
Nos Conseils Pratiques
Voici nos conseils pratiques pour prévenir et gérer la fièvre typhoïde, basés sur l'expérience clinique et les recommandations actuelles.
Avant le voyage : Consultez un médecin spécialisé en médecine des voyages au moins 4 à 6 semaines avant le départ. Cette anticipation permet une vaccination optimale et la mise en place de mesures préventives adaptées. N'oubliez pas d'emporter une trousse de premiers secours avec thermomètre et solutés de réhydratation [3].
Pendant le séjour : Respectez scrupuleusement les règles d'hygiène alimentaire. Privilégiez les aliments cuits et servis chauds, évitez les buffets tièdes et les vendeurs de rue. L'eau embouteillée capsulée reste la seule option sûre - méfiez-vous même des glaçons .
Au retour : Surveillez votre état de santé pendant au moins 6 semaines. Toute fièvre, même modérée, doit motiver une consultation médicale rapide en précisant vos antécédents de voyage. Cette vigilance permet un diagnostic précoce et améliore considérablement le pronostic [7,8].
Pour les porteurs chroniques : Maintenez une hygiène rigoureuse, particulièrement le lavage des mains après chaque passage aux toilettes. Informez vos proches et votre médecin traitant de votre statut. Les contrôles bactériologiques réguliers permettent de surveiller l'évolution et d'adapter la prise en charge [6].
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes d'alerte nécessitent une consultation médicale urgente, particulièrement dans un contexte évocateur de fièvre typhoïde.
Consultez en urgence si vous présentez une fièvre supérieure à 38,5°C persistant plus de 48 heures, accompagnée de maux de tête intenses et de troubles digestifs, particulièrement après un voyage en zone endémique. Cette association symptomatique, bien que non spécifique, doit faire évoquer le diagnostic [7,8].
Les signes de complications imposent une prise en charge hospitalière immédiate : vomissements de sang, selles sanglantes, douleurs abdominales intenses, troubles de la conscience ou convulsions. Ces manifestations peuvent témoigner de complications graves nécessitant un traitement spécialisé [8].
D'ailleurs, n'hésitez pas à consulter même pour des symptômes atypiques. La fièvre typhoïde peut se présenter sous des formes trompeuses, particulièrement chez les personnes âgées ou immunodéprimées. Votre médecin saura orienter les investigations en fonction du contexte clinique [7].
Pour les contacts d'un cas confirmé, une consultation préventive s'impose. Le médecin évaluera le risque de transmission et pourra proposer une surveillance clinique ou une prophylaxie antibiotique selon les circonstances. Cette démarche proactive permet de limiter la diffusion de la maladie [6].
Médicaments associés
Les médicaments suivants peuvent être prescrits dans le cadre de Fièvre typhoïde. Consultez toujours un professionnel de santé avant toute prise de médicament.
Questions Fréquentes
Peut-on attraper la fièvre typhoïde en France métropolitaine ?
Bien que rare, des cas autochtones peuvent survenir, généralement liés à des porteurs chroniques. La vigilance reste de mise même sans voyage.
La vaccination est-elle obligatoire ?
Non, mais fortement recommandée pour les voyageurs en zones endémiques selon les recommandations 2024.
Combien de temps dure l'immunité vaccinale ?
2-3 ans pour le vaccin injectable, 5-7 ans pour le vaccin oral. Les nouveaux vaccins conjugués offrent une protection plus durable.
Peut-on avoir la fièvre typhoïde plusieurs fois ?
Oui, la maladie ne confère pas d'immunité définitive. Des réinfections sont possibles mais généralement moins sévères.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Chido à Mayotte. Bulletin du 30 janvier 2025. Santé Publique France.Lien
- [2] Fièvre typhoïde à Mayotte. Bilan de 2016 à 2025. Santé Publique France.Lien
- [3] Maladies hydriques à Mayotte. Point au 26 septembre 2024. Santé Publique France.Lien
- [5] Recommandations sanitaires aux voyageurs 2024. Ministère de la Santé.Lien
- [6] Document d'enregistrement universel 2024. Innovation thérapeutique.Lien
- [9] A multi-centre, single arm, Phase-III study to assess typhoid conjugate vaccines.Lien
- [10] Typhoid conjugate vaccines for preventing typhoid fever. Cochrane Review 2024.Lien
- [12] Éclosion de fièvre typhoïde d'origine locale liée à un porteur chronique à Ottawa. RMTC 2024.Lien
- [19] Fièvres typhoïde et paratyphoïde : symptômes, traitement. Institut Pasteur.Lien
- [20] Fièvre typhoïde - Infections. Manuels MSD.Lien
Publications scientifiques
- [PDF][PDF] L'épidémiologie de la fièvre typhoïde [PDF]
- [HTML][HTML] Éclosion de fièvre typhoïde d'origine locale liée à un porteur chronique à Ottawa (2024)
- Modélisation probabiliste de la dynamique de transmission de la fièvre typhoïde à Mayotte avec étude de risques épidémiques. (2023)
- Performance du test ELISA dans le diagnostic de la fièvre Typhoïde à Conakry, Guinée (2022)
- Estimation de paramètres pour un modèle de propagation de la fièvre typhoïde à Mayotte (2022)
Ressources web
- Fièvres typhoïde et paratyphoïde : symptômes, traitement, ... (pasteur.fr)
Quels sont les symptômes ? Une à trois semaines après la contamination survient une fièvre continue accompagnée de maux de tête, d'anorexie, d'abattement, de ...
- Fièvre typhoïde - Infections - Manuels MSD pour le grand ... (msdmanuals.com)
Les symptômes sont identiques à ceux de la grippe, parfois suivis de l'apparition d'un syndrome confusionnel, d'une toux, d'une très grande fatigue, ...
- Fièvre typhoïde : symptômes, vaccin, traitement et prévention (pasteur-lille.fr)
Symptômes des fièvres typhoïdes et paratyphoïdes La phase d'invasion est marquée par l'apparition progressive d'un malaise général accompagné de céphalées, d' ...
- Fièvre typhoïdique : Vaccin, symptômes, prévention & ... (elsan.care)
Les symptômes de la typhoïde peuvent varier de légers à graves et incluent de la fièvre, des douleurs abdominales, à la tête, à la gorge, une fatigue, une perte ...
- Fièvres typhoïde et paratyphoïdes (matra.sciensano.be)
La maladie aiguë est caractérisée par une fièvre prolongée, des maux de tête, de la fatigue, et des signes digestifs (nausées, constipation ou diarrhée). Il ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
