Endophtalmie : Guide Complet 2025 - Symptômes, Traitements et Innovations
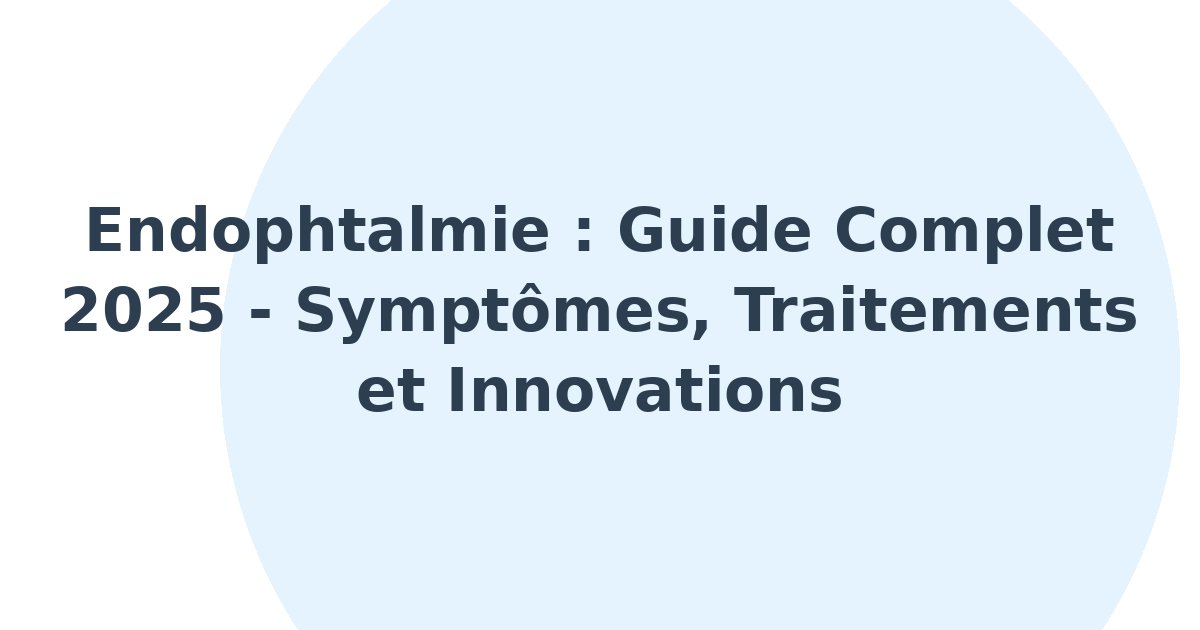
L'endophtalmie représente une infection grave de l'intérieur de l'œil qui peut compromettre définitivement la vision. Cette pathologie inflammatoire touche les structures internes oculaires et constitue une urgence ophtalmologique absolue. En France, l'incidence de l'endophtalmie post-chirurgicale a évolué grâce aux nouvelles mesures préventives et aux innovations thérapeutiques 2024-2025.
Téléconsultation et Endophtalmie
Téléconsultation non recommandéeL'endophtalmie est une infection intraoculaire grave nécessitant un diagnostic ophtalmologique urgent par examen du fond d'œil et des prélèvements bactériologiques. Cette urgence ophtalmologique requiert une prise en charge spécialisée immédiate pour préserver la vision, avec souvent une antibiothérapie intraoculaire qui ne peut être différée.
Ce qui peut être évalué à distance
Recueil des symptômes visuels et de leur évolution temporelle, évaluation de l'historique des interventions oculaires récentes, analyse du contexte post-chirurgical ou post-traumatique, orientation diagnostique d'urgence vers une structure spécialisée, suivi post-thérapeutique après traitement initial.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examen ophtalmologique complet avec biomicroscopie, mesure de l'acuité visuelle précise, examen du fond d'œil, prélèvements intraoculaires pour analyse bactériologique, injection d'antibiotiques intraoculaires, évaluation de la pression intraoculaire.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Toute suspicion d'endophtalmie nécessite un examen ophtalmologique urgent en présentiel, l'évaluation de l'acuité visuelle et du fond d'œil ne peut se faire qu'en consultation spécialisée, les prélèvements intraoculaires et injections thérapeutiques requièrent un plateau technique spécialisé, le suivi évolutif nécessite des examens ophtalmologiques répétés.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Baisse brutale de l'acuité visuelle post-chirurgicale, douleurs oculaires intenses avec rougeur et œdème, hypopion visible ou opacité vitréenne, tout contexte post-opératoire avec symptômes inflammatoires oculaires.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Baisse brutale et importante de l'acuité visuelle dans les jours suivant une chirurgie oculaire
- Douleurs oculaires intenses avec photophobie majeure et larmoiement
- Rougeur oculaire intense avec œdème palpébral et chémosis conjonctival
- Présence d'un hypopion (pus dans la chambre antérieure) ou d'opacités vitréennes visibles
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Ophtalmologue — consultation en présentiel indispensable
L'endophtalmie est une urgence ophtalmologique absolue nécessitant un diagnostic et une prise en charge spécialisée immédiate par un ophtalmologue. L'examen clinique spécialisé et les gestes thérapeutiques intraoculaires sont indispensables pour préserver la fonction visuelle.
Endophtalmie : Définition et Vue d'Ensemble
L'endophtalmie désigne une infection inflammatoire sévère qui affecte les cavités internes de l'œil, notamment le corps vitré et la chambre antérieure. Cette pathologie peut survenir de manière aiguë ou chronique [13,14].
Contrairement à une simple conjonctivite, l'endophtalmie pénètre profondément dans les structures oculaires. Elle peut être d'origine exogène (contamination externe) ou endogène (dissémination hématogène) [14]. L'infection peut rapidement détruire les tissus oculaires délicats.
Bon à savoir : cette pathologie constitue l'une des complications les plus redoutées en chirurgie ophtalmologique. Mais heureusement, les techniques préventives modernes ont considérablement réduit son incidence [10,11].
Les micro-organismes responsables incluent principalement les staphylocoques, les streptocoques et parfois des champignons [9]. Chaque type d'agent infectieux présente des caractéristiques cliniques spécifiques qui influencent le pronostic.
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, l'incidence de l'endophtalmie post-chirurgicale varie selon le type d'intervention. Après chirurgie de la cataracte, elle oscille entre 0,02% et 0,1% des cas, soit environ 200 à 500 cas annuels sur les 500 000 interventions réalisées [11,8].
Les données récentes montrent une évolution encourageante. L'étude de Hage et Bastelica (2025) révèle une diminution significative des taux d'endophtalmie sur les 23 dernières années, particulièrement depuis l'introduction de l'antibioprophylaxie par céfuroxime [11,8].
Concernant les injections intravitréennes, l'incidence reste faible mais préoccupante : 0,02 à 0,05% selon les séries françaises [6,7]. Avec plus de 2 millions d'injections annuelles en France, cela représente 400 à 1000 cas potentiels d'endophtalmie par an.
D'ailleurs, les variations régionales existent. Les centres hospitaliers universitaires rapportent des taux légèrement inférieurs grâce à des protocoles standardisés plus stricts [10]. L'âge moyen des patients atteints se situe autour de 72 ans, avec une légère prédominance masculine (55%) [8].
Au niveau international, les taux français se situent dans la moyenne européenne, mais restent supérieurs aux standards scandinaves qui affichent des incidences inférieures à 0,01% [11].
Les Causes et Facteurs de Risque
Les causes d'endophtalmie se divisent en deux catégories principales. L'endophtalmie exogène résulte d'une contamination directe lors d'une intervention chirurgicale, d'une injection ou d'un traumatisme pénétrant [14,15].
La chirurgie de la cataracte représente la cause la plus fréquente, suivie des injections intravitréennes d'anti-VEGF. Les facteurs de risque incluent l'âge avancé, le diabète, l'immunodépression et certaines pathologies oculaires préexistantes [8,10].
L'endophtalmie endogène, plus rare, survient par dissémination hématogène à partir d'un foyer infectieux distant. Elle touche particulièrement les patients diabétiques, immunodéprimés ou porteurs de prothèses valvulaires [14].
Concrètement, les staphylocoques coagulase-négatifs dominent dans les formes post-chirurgicales, tandis que les staphylocoques dorés et les streptocoques prédominent dans les formes endogènes [9]. Les champignons (Candida, Aspergillus) concernent surtout les patients immunodéprimés.
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes de l'endophtalmie apparaissent généralement dans les 48 à 72 heures suivant l'intervention ou le traumatisme. Mais attention, certaines formes chroniques peuvent se développer plus insidieusement sur plusieurs semaines [13,14].
La douleur oculaire intense constitue le symptôme d'alarme principal. Elle s'accompagne d'une baisse brutale de l'acuité visuelle, souvent décrite comme un voile ou un brouillard dense devant l'œil [15]. Vous pourriez également ressentir une sensation de corps étranger persistante.
À l'examen, l'œil présente une rougeur marquée, un œdème des paupières et parfois un écoulement purulent. La pupille peut paraître déformée ou présenter un reflet blanchâtre anormal [13]. Ces signes doivent immédiatement vous alerter.
Il est important de noter que l'intensité des symptômes varie selon l'agent infectieux. Les infections à staphylocoques coagulase-négatifs évoluent souvent plus lentement que celles à streptocoques [9]. Néanmoins, tout symptôme oculaire après une intervention nécessite une consultation urgente.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic d'endophtalmie repose sur un faisceau d'arguments cliniques et paracliniques. L'urgence de la situation impose une démarche diagnostique rapide mais rigoureuse [10,15].
L'examen ophtalmologique débute par la mesure de l'acuité visuelle et l'évaluation de la douleur. L'examen à la lampe à fente révèle les signes inflammatoires de la chambre antérieure : Tyndall, précipités rétrodescemétiques et parfois hypopion [14].
La ponction de chambre antérieure ou du vitré constitue l'examen clé. Elle permet l'analyse cytologique, la recherche directe de micro-organismes et la mise en culture [10]. Les prélèvements doivent être réalisés avant tout traitement antibiotique.
L'échographie oculaire en mode B objective les opacités vitréennes et évalue l'état rétinien. Cet examen non invasif guide également le pronostic fonctionnel [15]. Dans certains cas, l'OCT (tomographie par cohérence optique) apporte des informations complémentaires sur l'état maculaire.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement de l'endophtalmie constitue une urgence thérapeutique absolue. La prise en charge doit débuter dans les 6 heures suivant le diagnostic pour optimiser les chances de récupération visuelle [10,15].
L'antibiothérapie intravitréenne représente le traitement de première ligne. L'association vancomycine-ceftazidime couvre le spectre bactérien habituel. Les doses recommandées sont de 1 mg de vancomycine et 2,25 mg de ceftazidime dans 0,1 ml [10].
En complément, l'antibiothérapie systémique par voie intraveineuse renforce l'efficacité thérapeutique. Les fluoroquinolones (ciprofloxacine, lévofloxacine) pénètrent bien dans les tissus oculaires [14]. La durée du traitement varie de 7 à 14 jours selon l'évolution clinique.
La vitrectomie thérapeutique s'impose dans les formes sévères ou en cas d'échec du traitement médical. Cette intervention permet l'évacuation des débris infectieux et améliore la diffusion des antibiotiques [15]. Elle doit être réalisée par un chirurgien vitréo-rétinien expérimenté.
Les corticoïdes peuvent être associés après 48 heures de traitement antibiotique pour limiter l'inflammation. Cependant, leur utilisation reste controversée et doit être adaptée à chaque situation clinique [10].
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
Les innovations 2024-2025 transforment la prise en charge de l'endophtalmie. Le système de délivrance prolongée (PDS) pour les anti-VEGF révolutionne la prévention des infections liées aux injections répétées [1,4].
Le Port Delivery System réduit drastiquement le nombre d'injections intravitréennes nécessaires. Cette innovation diminue mécaniquement le risque d'endophtalmie en limitant les gestes invasifs [4]. Les premiers résultats montrent une incidence d'endophtalmie inférieure à 0,01% avec ce système.
Les présentations du Congrès ARMD 2024 ont mis en lumière de nouvelles approches préventives [2]. L'utilisation de la chlorhexidine aqueuse en remplacement de la povidone iodée montre des résultats prometteurs dans certaines populations [12].
D'ailleurs, la thérapie génique ouvre des perspectives révolutionnaires. Elle pourrait permettre de traiter certaines pathologies rétiniennes sans recours aux injections répétées, éliminant ainsi le risque d'endophtalmie iatrogène [1].
Les recommandations de la SFO 2024 intègrent ces nouvelles données pour optimiser les protocoles préventifs [3]. L'accent est mis sur la personnalisation des approches selon le profil de risque de chaque patient.
Vivre au Quotidien avec Endophtalmie
Vivre avec les séquelles d'une endophtalmie nécessite des adaptations importantes du quotidien. La récupération visuelle varie considérablement selon la précocité du traitement et la sévérité initiale de l'infection [15].
Les patients conservent souvent une baisse d'acuité visuelle résiduelle qui impacte les activités quotidiennes. La lecture, la conduite automobile et les tâches de précision peuvent devenir difficiles. Il est normal de ressentir une frustration face à ces limitations.
L'adaptation passe par l'apprentissage de nouvelles stratégies visuelles. Les aides optiques (loupes, éclairage adapté) améliorent significativement le confort visuel [13]. Les associations de patients proposent des formations pratiques très utiles.
Sur le plan psychologique, l'impact peut être considérable. La peur de récidive, l'anxiété liée aux contrôles médicaux et le sentiment d'isolement sont fréquents. Un accompagnement psychologique s'avère souvent bénéfique pour traverser cette épreuve.
Les Complications Possibles
Les complications de l'endophtalmie peuvent être précoces ou tardives, avec des conséquences parfois irréversibles sur la fonction visuelle [14,15]. La rapidité de prise en charge influence directement le pronostic.
La cécité complète représente la complication la plus redoutée, survenant dans 5 à 15% des cas selon les séries [15]. Elle résulte de la destruction des structures rétiniennes par l'infection et l'inflammation associée.
Le décollement de rétine complique environ 10% des endophtalmies sévères. Il peut survenir pendant la phase aiguë ou secondairement, nécessitant une prise en charge chirurgicale spécialisée [14]. La récupération visuelle reste alors très limitée.
D'autres complications incluent la cataracte secondaire, l'hypertonie oculaire et les opacités vitréennes persistantes. Ces séquelles altèrent durablement la qualité de vie des patients [15].
Mais heureusement, les formes diagnostiquées et traitées précocement évoluent favorablement dans 70 à 80% des cas. L'important est de ne jamais retarder la consultation devant des symptômes évocateurs.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de l'endophtalmie dépend de multiples facteurs, notamment la précocité du diagnostic, l'agent infectieux en cause et l'état oculaire initial [9,15]. Les données récentes montrent une amélioration progressive des résultats fonctionnels.
L'acuité visuelle finale constitue le critère pronostique principal. Environ 40 à 60% des patients conservent une vision utile (≥ 1/10) après traitement optimal [15]. Ce pourcentage varie selon le type d'endophtalmie et sa sévérité initiale.
Les infections à staphylocoques coagulase-négatifs présentent généralement un meilleur pronostic que celles à streptocoques ou à bacilles gram-négatifs [9]. L'étude de Adeghate et Yadav (2024) confirme cette différence pronostique selon l'espèce bactérienne.
Concrètement, les facteurs de bon pronostic incluent : un diagnostic précoce (< 24h), une acuité visuelle initiale conservée, l'absence d'hypopion massif et une bonne réponse au traitement initial [15]. À l'inverse, l'âge avancé et les comorbidités oculaires assombrissent le pronostic.
L'important à retenir : même avec des séquelles visuelles, une réhabilitation adaptée permet de maintenir une qualité de vie acceptable dans la majorité des cas.
Peut-on Prévenir l'Endophtalmie ?
La prévention de l'endophtalmie repose sur des mesures strictes d'asepsie et d'antibioprophylaxie. Les protocoles ont considérablement évolué ces dernières années, réduisant significativement l'incidence [5,7,10].
L'antibioprophylaxie peropératoire par céfuroxime intracamérulaire constitue désormais le standard en chirurgie de cataracte. Cette mesure a divisé par 5 l'incidence d'endophtalmie post-chirurgicale [8,11]. La dose recommandée est de 1 mg dans 0,1 ml de sérum physiologique.
Pour les injections intravitréennes, les recommandations de bonnes pratiques sont strictement codifiées [7]. Elles incluent la désinfection cutanée à la povidone iodée, l'utilisation de champs stériles et le port de masque par le patient [6].
L'étude de Hébert et You (2022) démontre l'efficacité du port du masque par les patients lors des injections intravitréennes [6]. Cette mesure simple réduit de 40% le risque de contamination bactérienne.
D'ailleurs, les innovations comme la chlorhexidine aqueuse offrent des alternatives intéressantes à la povidone iodée, particulièrement chez les patients allergiques [12]. Les résultats préliminaires sont encourageants.
Bon à savoir : le respect scrupuleux des protocoles préventifs par les équipes soignantes reste le meilleur moyen de prévention. Chaque geste compte dans cette démarche de sécurité.
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises ont émis des recommandations précises pour la prévention et la prise en charge de l'endophtalmie. Ces guidelines s'appuient sur les données scientifiques les plus récentes [10,7].
La Société Française d'Ophtalmologie (SFO) a publié en 2024 des recommandations actualisées intégrant les innovations thérapeutiques [3]. Ces guidelines standardisent les pratiques sur l'ensemble du territoire français.
Le guide de bonnes pratiques de Tessier et Guigou établit un protocole détaillé pour la prévention et la prise en charge des endophtalmies [10]. Il recommande notamment l'antibioprophylaxie systématique en chirurgie de cataracte.
Concernant les injections intravitréennes, les recommandations SROUR précisent les modalités d'asepsie et de surveillance post-injection [7]. Elles insistent sur la formation continue des équipes soignantes.
Ces recommandations évoluent régulièrement en fonction des nouvelles données scientifiques. L'objectif est d'harmoniser les pratiques et de réduire l'incidence de cette complication redoutable.
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs associations accompagnent les patients atteints d'endophtalmie et de ses séquelles visuelles. Ces structures offrent un soutien précieux dans le parcours de soins et la réadaptation.
L'Association DMLA propose des groupes de parole et des formations pratiques pour l'adaptation aux déficiences visuelles. Leurs conseillers en locomotion aident à maintenir l'autonomie au quotidien.
La Fédération des Aveugles de France met à disposition des ressources techniques et humaines. Elle organise des stages de réadaptation et facilite l'accès aux aides optiques et informatiques.
Les centres de rééducation basse vision proposent des bilans personnalisés et des programmes d'entraînement adaptés. Ces structures spécialisées optimisent l'utilisation du potentiel visuel résiduel.
D'ailleurs, les plateformes en ligne comme "Retina France" offrent des forums d'échange entre patients. Ces espaces permettent de partager expériences et conseils pratiques dans un environnement bienveillant.
Nos Conseils Pratiques
Voici nos conseils pratiques pour prévenir l'endophtalmie et optimiser votre prise en charge. Ces recommandations s'appuient sur l'expérience clinique et les données scientifiques récentes.
Avant une intervention oculaire : informez votre chirurgien de tous vos antécédents médicaux, notamment diabète, immunodépression ou infections récentes. Respectez scrupuleusement les consignes préopératoires.
Après l'intervention : surveillez attentivement l'apparition de symptômes d'alarme. Toute douleur intense, baisse visuelle brutale ou rougeur inhabituelle doit motiver une consultation immédiate, même en dehors des heures ouvrables.
En cas de traitement par injections répétées, maintenez une hygiène oculaire rigoureuse. Évitez de vous frotter les yeux et respectez les consignes de votre ophtalmologiste concernant les collyres préventifs.
Concrètement, gardez toujours les coordonnées de votre ophtalmologiste et du service d'urgences ophtalmologiques le plus proche. En cas de doute, il vaut mieux consulter pour rien que de passer à côté d'une urgence.
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes imposent une consultation ophtalmologique urgente, particulièrement après une intervention oculaire ou une injection intravitréenne. Ne prenez aucun risque avec votre vision.
Consultez immédiatement en cas de : douleur oculaire intense et inhabituelle, baisse brutale de l'acuité visuelle, vision de "mouches volantes" nombreuses ou voile devant l'œil [13,15].
D'autres symptômes doivent également vous alerter : rougeur oculaire marquée, écoulement purulent, sensation de corps étranger persistante ou photophobie intense. Ces signes peuvent révéler une endophtalmie débutante.
Bon à savoir : les symptômes peuvent apparaître dans les heures suivant l'intervention, mais parfois aussi plusieurs jours après. Ne vous fiez pas uniquement au délai d'apparition pour juger de la gravité.
En cas de doute, contactez votre ophtalmologiste ou rendez-vous aux urgences ophtalmologiques. L'endophtalmie constitue une urgence absolue où chaque heure compte pour préserver votre vision.
Médicaments associés
Les médicaments suivants peuvent être prescrits dans le cadre de Endophtalmie. Consultez toujours un professionnel de santé avant toute prise de médicament.
Questions Fréquentes
Quelle est la différence entre endophtalmie et conjonctivite ?
L'endophtalmie est une infection grave des structures internes de l'œil (vitré, chambre antérieure) qui menace la vision, tandis que la conjonctivite n'affecte que la surface oculaire. L'endophtalmie provoque une douleur intense et une baisse visuelle brutale, contrairement à la conjonctivite qui reste superficielle.
Combien de temps après une chirurgie peut survenir une endophtalmie ?
L'endophtalmie survient généralement dans les 48 à 72 heures suivant l'intervention, mais elle peut parfois apparaître plusieurs jours ou semaines après. Les formes chroniques se développent plus insidieusement sur plusieurs semaines. Tout symptôme oculaire anormal après une chirurgie nécessite une consultation urgente.
Peut-on guérir complètement d'une endophtalmie ?
La guérison complète est possible si le traitement débute très précocement (dans les 6 heures). Environ 40 à 60% des patients conservent une vision utile après traitement optimal. Cependant, des séquelles visuelles persistent souvent, nécessitant une adaptation du mode de vie et parfois une rééducation basse vision.
L'endophtalmie est-elle contagieuse ?
Non, l'endophtalmie n'est pas contagieuse. Il s'agit d'une infection localisée à l'intérieur de l'œil, généralement causée par une contamination lors d'une intervention chirurgicale ou d'une injection. Elle ne se transmet pas d'une personne à l'autre par contact direct.
Quels sont les facteurs qui augmentent le risque d'endophtalmie ?
Les principaux facteurs de risque incluent : l'âge avancé, le diabète, l'immunodépression, certaines pathologies oculaires préexistantes, et les antécédents d'infections. Le respect strict des protocoles d'asepsie lors des interventions reste la meilleure prévention.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Les nouvelles formes de délivrance des anti-VEGF : PDS et thérapie génique révolutionnent la prise en charge 2024-2025Lien
- [2] Congrès ARMD 2024 - Nouvelles approches préventives de l'endophtalmieLien
- [3] SFO 2024 - Recommandations actualisées pour la prévention de l'endophtalmieLien
- [4] Endophthalmitis in Eyes Treated with the Port Delivery System - Données 2024Lien
- [6] Prophylaxie de l'endophtalmie dans la chirurgie rétinovitréenne - Protocoles françaisLien
- [7] Impact of patient face mask use on endophthalmitis after intravitreal anti-VEGF injections (2022)Lien
- [8] Les recommandations de bonne pratique pour les injections intravitréennesLien
- [9] Profil et pronostic des endophtalmies depuis l'utilisation peropératoire de l'antibioprophylaxie par céfuroxime (2022)Lien
- [10] Coagulase-negative staphylococcal endophthalmitis: clinical severity and outcomes based on speciation (2024)Lien
- [11] Prévention et prise en charge des endophtalmies en 2022. Guide de bonnes pratiquesLien
- [12] Changes in rates of endophthalmitis after cataract surgery over the last 23 years (2025)Lien
- [13] Rates of endophthalmitis before and after transition from povidone-iodine to aqueous chlorhexidine asepsis (2024)Lien
- [14] Endophtalmie : Définition, symptômes, diagnostic et traitementsLien
- [15] Infection endoculaire (endophtalmie) - Manuel MSDLien
- [16] Endophtalmie - Infection grave de l'œil - Centre DavielLien
Publications scientifiques
- [PDF][PDF] Prophylaxie de l'endophtalmie dans la chirurgie rétinovitréenne [PDF]
- Impact of patient face mask use on endophthalmitis after intravitreal anti-VEGF injections (2022)14 citations
- [PDF][PDF] Les recommandations de bonne pratique pour les injections intravitréennes [PDF]
- Profil et pronostic des endophtalmies depuis l'utilisation peropératoire de l'antibioprophylaxie par céfuroxime (2022)
- Coagulase-negative staphylococcal endophthalmitis: clinical severity and outcomes based on speciation (2024)3 citations
Ressources web
- Endophtalmie : Définition, symptômes, diagnostic et traitements (sante-sur-le-net.com)
1 déc. 2022 — Le traitement repose généralement sur des antibiotiques par voie intraoculaire, éventuellement associés à des corticostéroïdes.
- Infection endoculaire (endophtalmie) - Troubles oculaires (msdmanuals.com)
Les symptômes de l'endophtalmie peuvent être sévères et comprendre une douleur oculaire sévère, une rougeur dans le blanc de l'œil, une sensibilité extrême à la ...
- Endophtalmie - Infection grave de l'œil (daviel.fr)
Elle se traduit par un œil brutalement rouge et douloureux, avec baisse de vision profonde. Son traitement repose sur les injections intravitréennes d' ...
- Endophtalmie - Troubles oculaires (msdmanuals.com)
Le traitement initial comprend une injection intravitréenne d'antibiotiques à larges spectres, le plus souvent la vancomycine et la ceftazidime. Le patient ...
- Les endophtalmies (cahiers-ophtalmologie.fr)
Le traitement est basé sur la corticothérapie locale parfois générale. Traitement. La prise en charge d'une endophtalmie se fait en urgence dès que le ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
