Choroïdite : Symptômes, Traitements et Innovations 2025 | Guide Complet
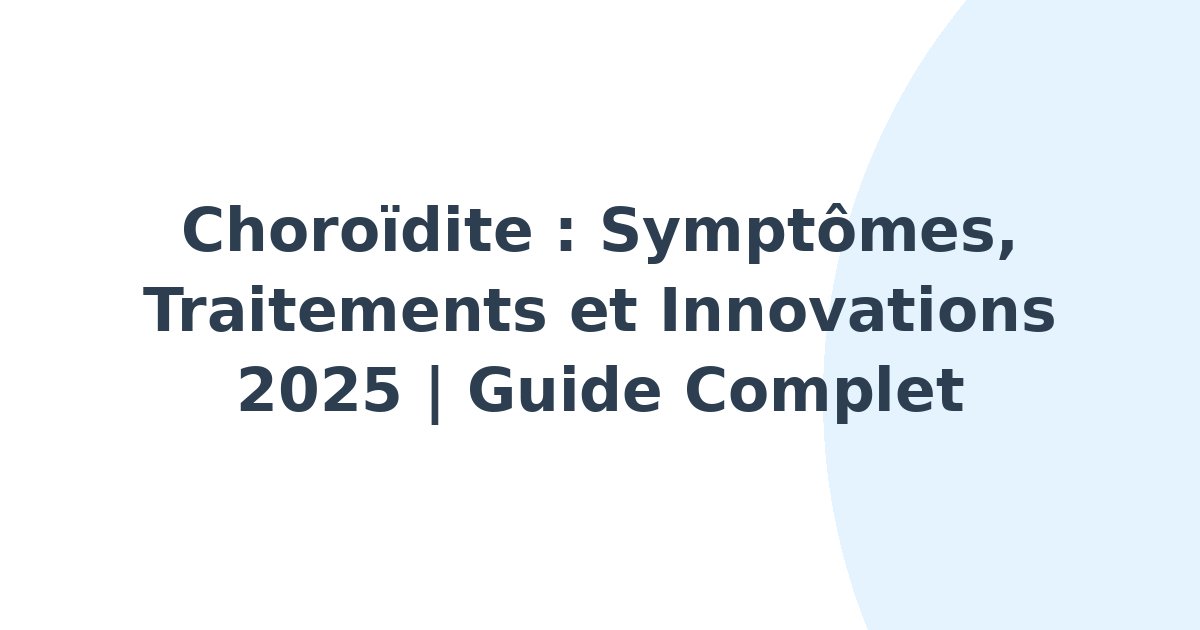
La choroïdite est une inflammation de la choroïde, cette membrane vasculaire située entre la rétine et la sclérotique de l'œil. Cette pathologie oculaire peut affecter votre vision de manière significative et nécessite une prise en charge spécialisée. Bien que relativement rare, elle touche environ 2 à 5 personnes sur 100 000 en France selon les dernières données épidémiologiques [1,3]. Heureusement, les innovations thérapeutiques récentes offrent de nouveaux espoirs aux patients.
Téléconsultation et Choroïdite
Téléconsultation non recommandéeLa choroïdite nécessite impérativement un examen ophtalmologique spécialisé avec fond d'œil et examens complémentaires pour confirmer le diagnostic et évaluer l'étendue de l'inflammation. L'examen à distance ne permet pas de visualiser les lésions choroïdiennes ni d'évaluer précisément l'acuité visuelle et le champ visuel, éléments essentiels au diagnostic et au suivi.
Ce qui peut être évalué à distance
Évaluation des symptômes visuels rapportés par le patient (baisse d'acuité, scotomes, métamorphopsies). Analyse de l'historique des épisodes inflammatoires oculaires antérieurs. Discussion des facteurs déclenchants potentiels et du contexte infectieux. Orientation diagnostique préliminaire et planification de la prise en charge spécialisée urgente.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examen du fond d'œil avec dilatation pupillaire pour visualiser les lésions choroïdiennes. Mesure précise de l'acuité visuelle et évaluation du champ visuel. Réalisation d'examens complémentaires (OCT, angiographie) pour caractériser l'inflammation et rechercher une cause infectieuse ou auto-immune.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Impossibilité d'examiner directement le fond d'œil pour visualiser les foyers de choroïdite. Incapacité à mesurer précisément l'acuité visuelle et à évaluer le retentissement fonctionnel. Nécessité d'examens complémentaires spécialisés (OCT, angiographie) non réalisables à distance. Besoin d'évaluer la pression intraoculaire et l'état du segment antérieur.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Baisse brutale et importante de l'acuité visuelle suggérant une atteinte maculaire. Douleurs oculaires intenses avec signes inflammatoires marqués. Suspicion de choroïdite infectieuse nécessitant un traitement urgent pour éviter les complications.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Baisse brutale et sévère de l'acuité visuelle d'un ou des deux yeux
- Douleurs oculaires intenses accompagnées de rougeur et de photophobie majeure
- Apparition rapide de scotomes centraux ou de déformation importante des images
- Signes généraux associés évoquant une maladie systémique (fièvre, éruption cutanée, troubles neurologiques)
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Ophtalmologue — consultation en présentiel indispensable
L'ophtalmologue est indispensable car la choroïdite nécessite un examen spécialisé du fond d'œil et des examens complémentaires spécifiques pour confirmer le diagnostic et adapter le traitement. La consultation en présentiel est obligatoire pour réaliser ces examens techniques.
Choroïdite : Définition et Vue d'Ensemble
La choroïdite désigne l'inflammation de la choroïde, cette fine membrane richement vascularisée qui nourrit les couches externes de la rétine. Imaginez la choroïde comme le système d'irrigation de votre jardin rétinien : quand elle s'enflamme, c'est tout l'écosystème visuel qui en pâtit.
Cette pathologie fait partie du groupe plus large des uvéites postérieures, qui représentent environ 15 à 20% de toutes les uvéites [6]. Mais contrairement à d'autres formes d'inflammation oculaire, la choroïdite présente des caractéristiques bien spécifiques. Elle peut être focale (limitée à une zone) ou multifocale (touchant plusieurs zones), et parfois même diffuse [2,8].
L'important à retenir ? Cette maladie n'est pas une fatalité. Avec un diagnostic précoce et un traitement adapté, la plupart des patients conservent une vision fonctionnelle. D'ailleurs, les récentes avancées en imagerie rétinienne permettent aujourd'hui de détecter des lésions choroïdiennes de plus en plus petites [6,8].
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, la choroïdite touche environ 2 à 5 personnes sur 100 000 habitants chaque année, selon les données de Santé Publique France [3]. Cette incidence reste relativement stable depuis une décennie, mais on observe une légère augmentation chez les patients immunodéprimés.
Les femmes sont plus fréquemment atteintes que les hommes, avec un ratio de 1,5:1, particulièrement pour les formes multifocales [3,10]. L'âge moyen de diagnostic se situe entre 30 et 50 ans, bien que la pathologie puisse survenir à tout âge. Concrètement, cela représente environ 1 300 à 3 250 nouveaux cas par an en France.
Au niveau européen, les chiffres varient sensiblement. L'Allemagne rapporte une incidence légèrement supérieure (6-8/100 000), tandis que les pays nordiques affichent des taux plus bas [2]. Cette variation s'explique en partie par les différences génétiques et environnementales.
Bon à savoir : les formes infectieuses, notamment liées à la tuberculose oculaire, représentent 15 à 25% des cas en France métropolitaine, mais ce pourcentage grimpe à 40% dans les départements d'outre-mer [5,7]. Les projections pour 2025-2030 suggèrent une stabilisation de l'incidence globale, mais une augmentation des formes liées aux nouveaux traitements immunosuppresseurs.
Les Causes et Facteurs de Risque
Les causes de la choroïdite sont multiples et parfois intriquées. Dans environ 40% des cas, on identifie une cause infectieuse : tuberculose, toxoplasmose, syphilis, ou encore infections virales comme l'herpès [5,7]. La tuberculose oculaire, en particulier, connaît une recrudescence inquiétante, même chez des patients sans antécédents pulmonaires [5].
Les causes auto-immunes représentent un autre pan important. La sarcoïdose, la maladie de Behçet, ou encore la maladie de Vogt-Koyanagi-Harada peuvent toutes déclencher une choroïdite [4]. Ces pathologies systémiques s'accompagnent souvent d'autres manifestations extra-oculaires.
Mais attention : certains médicaments peuvent aussi être en cause. Les récentes études de 2024 ont mis en évidence des cas de choroïdite induite par le brolucizumab, un traitement anti-VEGF utilisé en ophtalmologie [1]. Cette découverte a bouleversé les protocoles de surveillance.
Enfin, dans 30 à 40% des cas, aucune cause n'est identifiée : on parle alors de choroïdite idiopathique [2,3]. Ces formes "sans cause apparente" ne sont pas moins sérieuses et nécessitent le même niveau de prise en charge.
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes de la choroïdite peuvent être trompeurs au début. Vous pourriez d'abord remarquer une baisse progressive de l'acuité visuelle, souvent plus marquée d'un côté. Cette diminution n'est pas forcément spectaculaire : parfois, c'est juste une impression que "quelque chose ne va pas" avec votre vision.
Les scotomes - ces zones aveugles dans le champ visuel - constituent un symptôme caractéristique [6,8]. Ils peuvent apparaître comme des taches sombres fixes ou des zones floues qui bougent avec votre regard. Certains patients décrivent aussi des métamorphopsies : les lignes droites paraissent ondulées ou déformées.
D'autres signes peuvent vous alerter : une sensibilité accrue à la lumière (photophobie), des douleurs oculaires modérées, ou encore l'apparition de "mouches volantes" plus nombreuses que d'habitude. Il est normal de s'inquiéter face à ces symptômes, mais rassurez-vous : un diagnostic précoce permet généralement de limiter les dégâts.
L'important ? Ne pas attendre que les symptômes s'aggravent. Dès les premiers signes visuels inhabituels, consultez rapidement un ophtalmologiste. Car contrairement à d'autres pathologies oculaires, la choroïdite peut évoluer rapidement sans traitement [2,6].
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic de choroïdite commence toujours par un examen ophtalmologique complet. Votre médecin réalisera d'abord une acuité visuelle et un fond d'œil après dilatation pupillaire. C'est lors de cet examen qu'il pourra visualiser les lésions choroïdiennes caractéristiques [6].
L'angiographie à la fluorescéine reste l'examen de référence pour confirmer le diagnostic [8]. Cette technique permet de visualiser la circulation sanguine rétinienne et choroïdienne en temps réel. Vous recevrez une injection intraveineuse de colorant, puis des photos successives de votre rétine seront prises. L'examen dure environ 30 minutes et est généralement bien toléré.
L'OCT (tomographie par cohérence optique) complète le bilan en fournissant des coupes anatomiques précises de la rétine et de la choroïde [6,8]. Cet examen non invasif permet de mesurer l'épaisseur choroïdienne et de détecter des œdèmes rétiniens associés.
Parallèlement, un bilan général sera prescrit pour rechercher une cause sous-jacente : prise de sang complète, radiographie pulmonaire, tests tuberculiniques [5,7]. Dans certains cas, une ponction de chambre antérieure peut être nécessaire pour analyser l'humeur aqueuse. Ce parcours peut sembler long, mais chaque étape est cruciale pour adapter le traitement à votre situation spécifique.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement de la choroïdite dépend avant tout de sa cause. Quand une infection est identifiée, le traitement anti-infectieux spécifique constitue la priorité absolue [5,7]. Pour la tuberculose oculaire, par exemple, une quadrithérapie antituberculeuse sera instaurée pendant plusieurs mois.
Dans les formes inflammatoires, les corticoïdes restent le traitement de première ligne [3,4]. Ils peuvent être administrés par voie générale (comprimés), locale (injections péri-oculaires), ou directement dans l'œil (injections intravitréennes). Chaque voie d'administration a ses avantages et ses inconvénients que votre médecin évaluera avec vous.
Pour les formes récidivantes ou résistantes, les immunosuppresseurs entrent en jeu. Le méthotrexate, l'azathioprine, ou encore la ciclosporine peuvent être prescrits [3,4]. Une étude française récente de 2024 montre l'intérêt d'associer d'emblée un immunosuppresseur aux corticoïdes pour prévenir les rechutes [3].
Les biothérapies représentent l'avenir du traitement. L'adalimumab et l'infliximab ont déjà fait leurs preuves dans certaines formes sévères [4]. Et bonne nouvelle : les essais cliniques 2024-2025 explorent de nouvelles molécules prometteuses, notamment pour les formes réfractaires aux traitements classiques.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024 a marqué un tournant dans la prise en charge de la choroïdite. Les recherches d'Aura Biosciences ont montré des résultats prometteurs avec l'AU-011 pour certaines formes de mélanome choroïdien associé . Cette thérapie ciblée ouvre de nouvelles perspectives pour les patients présentant des lésions choroïdiennes complexes.
Mais attention aux effets indésirables des nouveaux traitements. L'identification récente de choroïdites induites par le brolucizumab a conduit à réviser les protocoles de surveillance [1]. Désormais, tout patient recevant ce traitement anti-VEGF bénéficie d'un suivi ophtalmologique renforcé.
Les innovations ne se limitent pas aux médicaments. Les nouvelles techniques d'imagerie, notamment l'OCT-angiographie, permettent une visualisation sans précédent de la vascularisation choroïdienne [8]. Cette technologie révolutionne le diagnostic précoce et le suivi thérapeutique.
Côté recherche fondamentale, les équipes françaises travaillent sur des biomarqueurs prédictifs de récidive [3]. L'objectif ? Identifier dès le diagnostic initial quels patients nécessiteront un traitement immunosuppresseur de fond. Ces avancées pourraient transformer la prise en charge dès 2025-2026.
Vivre au Quotidien avec Choroïdite
Vivre avec une choroïdite demande quelques adaptations, mais ne vous empêche pas de mener une vie normale. La première préoccupation concerne souvent la conduite automobile. Si votre champ visuel est altéré, une évaluation par un ophtalmologiste s'impose avant de reprendre le volant.
Au travail, certains aménagements peuvent s'avérer nécessaires. Un éclairage adapté, des pauses visuelles régulières, ou encore l'utilisation d'outils grossissants peuvent considérablement améliorer votre confort [9]. N'hésitez pas à en parler avec votre médecin du travail.
L'activité physique reste généralement possible et même recommandée. Cependant, évitez les sports de contact ou à risque de traumatisme oculaire pendant les phases inflammatoires actives. La natation en piscine chlorée peut parfois irriter vos yeux : préférez les lunettes de protection.
Psychologiquement, l'annonce du diagnostic peut être difficile à accepter. Il est normal de ressentir de l'anxiété face à l'incertitude sur l'évolution. Les associations de patients peuvent vous apporter un soutien précieux et des conseils pratiques de personnes qui vivent la même situation que vous.
Les Complications Possibles
Bien que la plupart des choroïdites évoluent favorablement sous traitement, certaines complications peuvent survenir. La néovascularisation choroïdienne représente la complication la plus redoutée [8]. Ces nouveaux vaisseaux anormaux peuvent saigner et créer des cicatrices définitives au niveau maculaire.
L'œdème maculaire constitue une autre complication fréquente, touchant environ 20% des patients [6,8]. Il se manifeste par une baisse brutale de l'acuité visuelle centrale et nécessite un traitement urgent. Heureusement, les injections intravitréennes d'anti-VEGF ou de corticoïdes donnent généralement de bons résultats.
Plus rarement, on peut observer un décollement de rétine secondaire à l'inflammation choroïdienne. Cette complication, bien qu'impressionnante, reste généralement réversible avec un traitement adapté [2]. Les formes étendues peuvent aussi évoluer vers une atrophie choroïdienne diffuse.
Il faut savoir que le risque de complications dépend largement de la précocité du diagnostic et de l'observance thérapeutique. C'est pourquoi votre ophtalmologiste insistera sur l'importance du suivi régulier, même quand tout va bien. Une surveillance tous les 3 à 6 mois permet de détecter précocement toute évolution défavorable.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de la choroïdite s'est considérablement amélioré ces dernières années. Dans 70 à 80% des cas, la vision se stabilise ou s'améliore avec le traitement [3,10]. Les formes focales ont généralement un meilleur pronostic que les formes multifocales étendues.
Plusieurs facteurs influencent l'évolution : l'âge au diagnostic, l'étendue des lésions initiales, la rapidité de prise en charge, et bien sûr la cause sous-jacente [2,3]. Les choroïdites infectieuses, une fois l'agent pathogène éradiqué, évoluent souvent vers la guérison complète.
Les formes auto-immunes nécessitent parfois un traitement au long cours, mais la qualité de vie reste généralement préservée [4]. Une étude française récente montre que 85% des patients conservent une acuité visuelle supérieure à 5/10 après 5 ans de suivi [3].
Concrètement, qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Que même si votre vision ne redevient pas parfaitement normale, vous pourrez très probablement continuer vos activités habituelles. La conduite, la lecture, le travail sur écran restent possibles dans l'immense majorité des cas. Et avec les innovations thérapeutiques actuelles, ce pronostic ne peut que s'améliorer.
Peut-on Prévenir Choroïdite ?
La prévention primaire de la choroïdite reste limitée, car on ne peut pas toujours agir sur les causes sous-jacentes. Cependant, certaines mesures peuvent réduire votre risque de développer cette pathologie ou d'en limiter la sévérité.
Pour les formes infectieuses, le dépistage et le traitement précoce des infections systémiques constituent la meilleure prévention [5,7]. Si vous présentez des facteurs de risque de tuberculose (voyage en zone endémique, contact avec un cas), n'hésitez pas à en parler à votre médecin.
Chez les patients sous traitement immunosuppresseur, une surveillance ophtalmologique régulière permet de détecter précocement toute inflammation oculaire [4]. Cette surveillance préventive a prouvé son efficacité pour limiter les séquelles visuelles.
Plus généralement, maintenir un bon état de santé général - alimentation équilibrée, activité physique régulière, gestion du stress - contribue à renforcer votre système immunitaire. Et si vous présentez une maladie auto-immune connue, le respect scrupuleux de votre traitement de fond reste la meilleure prévention des poussées oculaires.
Recommandations des Autorités de Santé
La Haute Autorité de Santé (HAS) a publié en 2024 des recommandations actualisées sur la prise en charge des uvéites postérieures, incluant la choroïdite [4]. Ces guidelines insistent sur l'importance d'un diagnostic étiologique systématique et d'une prise en charge multidisciplinaire.
Selon ces recommandations, tout patient présentant une choroïdite doit bénéficier d'un bilan infectieux complet, incluant la recherche de tuberculose latente [5]. Cette approche systématique a permis de réduire significativement le nombre de formes évoluant vers la chronicité.
La HAS préconise également une surveillance ophtalmologique rapprochée pendant les 6 premiers mois suivant le diagnostic [4]. Cette période critique détermine souvent l'évolution à long terme de la pathologie. Les contrôles doivent être mensuels initialement, puis espacés selon l'évolution clinique.
Concernant les traitements, les autorités françaises recommandent une approche graduée : corticoïdes en première intention, puis immunosuppresseurs en cas de récidive ou de résistance [3,4]. L'utilisation des biothérapies doit être réservée aux formes sévères et encadrée par des centres experts. Ces recommandations, régulièrement mises à jour, attendussent une prise en charge optimale sur tout le territoire français.
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs associations françaises accompagnent les patients atteints de choroïdite et d'uvéites. L'Association pour l'Information et la Recherche sur les maladies rares de l'Œil (AIRMO) propose des informations actualisées et organise des rencontres entre patients.
La Société Française d'Ophtalmologie (SFO) met à disposition des fiches d'information patient régulièrement actualisées [10]. Ces documents, validés par des experts, vous aideront à mieux comprendre votre pathologie et ses traitements.
Au niveau européen, l'European Society of Retina Specialists (EURETINA) développe des programmes d'éducation thérapeutique spécifiquement dédiés aux uvéites postérieures. Ces ressources multilingues constituent une mine d'informations fiables.
N'oubliez pas non plus les ressources numériques : forums de patients, applications mobiles de suivi, téléconsultations spécialisées. Ces outils modernes facilitent l'accès à l'information et rompent l'isolement que peuvent ressentir certains patients face à cette pathologie rare.
Nos Conseils Pratiques
Voici nos conseils pratiques pour mieux vivre avec une choroïdite. Tout d'abord, tenez un carnet de suivi visuel : notez quotidiennement votre acuité visuelle subjective, l'apparition de nouveaux symptômes, la prise de médicaments. Ces informations seront précieuses lors de vos consultations.
Adaptez votre environnement visuel : privilégiez un éclairage indirect et évitez les contrastes trop marqués. Un éclairage LED de qualité, réglable en intensité, peut considérablement améliorer votre confort au quotidien [9].
Côté alimentation, privilégiez les aliments riches en antioxydants : légumes verts, fruits rouges, poissons gras. Bien qu'aucune étude ne prouve leur efficacité spécifique dans la choroïdite, ces nutriments soutiennent la santé rétinienne globale.
Enfin, n'hésitez jamais à poser des questions à votre équipe médicale. Préparez vos consultations en listant vos interrogations. Une bonne communication avec vos soignants reste la clé d'une prise en charge réussie. Et rappelez-vous : chaque patient est unique, et votre expérience de la maladie le sera aussi.
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes doivent vous amener à consulter en urgence votre ophtalmologiste. Une baisse brutale de l'acuité visuelle, l'apparition soudaine de nouveaux scotomes, ou des douleurs oculaires intenses nécessitent une évaluation immédiate [6].
Même en dehors de ces situations d'urgence, ne négligez jamais les symptômes apparemment mineurs. L'augmentation du nombre de corps flottants, une gêne à la lumière qui s'aggrave, ou une sensation de voile qui s'étend progressivement méritent une consultation rapide.
Pour les patients déjà diagnostiqués, le respect du calendrier de suivi est crucial. Même si vous vous sentez bien, les contrôles programmés permettent de détecter précocement toute récidive ou complication [2,3]. N'annulez vos rendez-vous qu'en cas de force majeure.
Enfin, si vous développez des symptômes généraux - fièvre, fatigue inhabituelle, douleurs articulaires - en parallèle de votre choroïdite, signalez-le rapidement à votre médecin. Ces manifestations peuvent révéler une maladie systémique sous-jacente nécessitant une prise en charge spécifique [4,5].
Questions Fréquentes
La choroïdite est-elle héréditaire ?
Dans la plupart des cas, non. Seules certaines formes associées à des maladies génétiques rares peuvent présenter un caractère familial.
Puis-je continuer à porter des lentilles de contact ?
Cela dépend de l'activité inflammatoire. Pendant les poussées, les lentilles sont généralement déconseillées. Votre ophtalmologiste vous guidera selon votre situation.
La grossesse influence-t-elle l'évolution de la choroïdite ?
Les modifications hormonales peuvent parfois influencer l'inflammation. Un suivi ophtalmologique renforcé est recommandé pendant la grossesse.
Les écrans d'ordinateur aggravent-ils la choroïdite ?
Non, mais ils peuvent accentuer la fatigue visuelle. Des pauses régulières et un bon éclairage sont conseillés.
Combien de temps dure le traitement ?
Cela varie énormément : de quelques semaines pour les formes infectieuses à plusieurs années pour les formes auto-immunes.
Puis-je faire du sport ?
Oui, en évitant les sports de contact pendant les phases inflammatoires actives. L'activité physique modérée est même recommandée.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Drug-induced Vasculitis and Choroiditis after Brolucizumab - Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [2] Investor Relations - Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [3] Retina Society 2024: Aura Biosciences reports positive Phase 2 resultsLien
- [4] Épithéliopathie en plaque, choroïdite serpigineuse et leurs formes frontières (2023)Lien
- [5] Évaluation de l'intérêt d'un traitement de fond immunosuppresseur en prévention des rechutes dans la choroïdite multifocale (2024)Lien
- [6] Traitement de première ligne des uvéites sarcoïdosiques non antérieures (2025)Lien
- [7] Tuberculose à révélation oculaire: à propos de six cas (2024)Lien
- [8] Panorama des uvéites postérieuresLien
- [9] Tuberculose oculaire: diagnostic et prise en charge actuelleLien
- [10] Rapport de cas d'un nodule scléral focal chez un patient atteint d'un cancer de la prostate (2023)Lien
- [11] Lésions de l'épithélium pigmentaire rétinien dans les pathologies inflammatoiresLien
- [12] Choroïdite – symptômes, causes et traitementLien
- [13] Choroïdite multifocale et choroïdite ponctuée interne - SFOLien
Publications scientifiques
- Épithéliopathie en plaque, choroïdite serpigineuse et leurs formes frontières (2023)1 citations
- Évaluation de l'intérêt d'un traitement de fond immunosuppresseur en prévention des rechutes dans la choroïdite multifocale et la choroïdite ponctuée interne (2024)
- Traitement de première ligne des uvéites sarcoïdosiques non antérieures: corticothérapie seule comparée à une corticothérapie associée à un immunosuppresseur (2025)
- Tuberculose à révélation oculaire: à propos de six cas (2024)
- [PDF][PDF] Panorama des uvéites postérieures [PDF]
Ressources web
- Choroïdite – symptômes, causes et traitement (medicoverhospitals.in)
Une vision floue, des corps flottants, une sensibilité à la lumière et des douleurs oculaires sont des signes courants de choroïdite. Si vous ressentez ces ...
- Choroïdite multifocale et choroïdite ponctuée interne (sfo-online.fr)
Le terme de choroïdite multifocale caractérise des lésions choriorétiniennes inflammatoires du pôle postérieur, évoluant vers des lésions cicatricielles ...
- Syndrome des taches blanches du fond d'œil (cahiers-ophtalmologie.fr)
Un traitement par voie générale par corticoïdes éventuel lement associé à un traitement immunosuppresseur peut être proposé pour traiter la poussée et prévenir ...
- CHORIORETINOPATHIE SEREUSE CENTRALE - CRSC LILLE (docteurhamy.com)
Quels sont les symptômes d'une choriorétinite séreuse centrale? ... Une vision floue, une baisse de la vision, l'apparition d'une tâche sombre au centre de la ...
- Choriorétinite : symptômes, causes, diagnostic et traitement (medicoverhospitals.in)
La choriorétinite se caractérise par une inflammation de la choroïde et de la rétine. Cette affection peut entraîner une déficience visuelle et, si elle n'est ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
