Chordome : Symptômes, Diagnostic et Traitements 2025 | Guide Complet
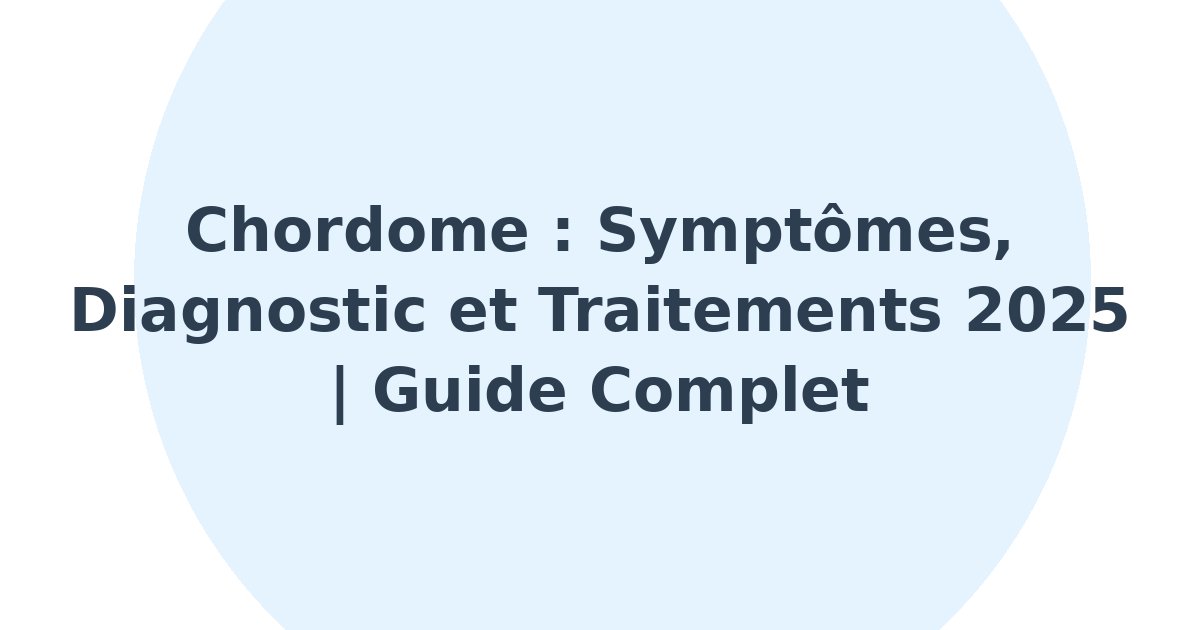
Le chordome est une tumeur osseuse rare qui se développe à partir des restes de la notochorde embryonnaire. Cette pathologie touche principalement la base du crâne et la colonne vertébrale, représentant moins de 1% de toutes les tumeurs osseuses. Bien que rare, le chordome nécessite une prise en charge spécialisée et multidisciplinaire pour optimiser les chances de guérison.

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Chordome : Définition et Vue d'Ensemble
Le chordome est une tumeur maligne primitive qui se développe à partir des vestiges de la notochorde, structure embryonnaire qui forme l'axe central du développement vertébral [6]. Cette pathologie présente des caractéristiques uniques qui la distinguent des autres tumeurs osseuses.
D'un point de vue histologique, le chordome se caractérise par la présence de cellules physaliphores, des cellules volumineuses contenant des vacuoles cytoplasmiques. Ces cellules expriment spécifiquement la brachyurie, un facteur de transcription qui constitue un marqueur diagnostique essentiel [11].
Les chordomes se développent préférentiellement dans trois localisations anatomiques principales. La base du crâne représente environ 35% des cas, particulièrement au niveau du clivus et de la région sphéno-occipitale [8,13]. La colonne vertébrale mobile (cervicale, thoracique, lombaire) compte pour 15% des cas, tandis que la région sacro-coccygienne constitue la localisation la plus fréquente avec 50% des chordomes [10].
Cette répartition anatomique s'explique par l'embryologie de la notochorde, qui régresse normalement au cours du développement fœtal. Cependant, des îlots de cellules notochordales peuvent persister et donner naissance, des décennies plus tard, à un chordome. L'important à retenir : cette tumeur peut survenir à tout âge, mais elle touche principalement les adultes entre 40 et 70 ans.
Épidémiologie en France et dans le Monde
Le chordome représente une pathologie d'une rareté exceptionnelle, avec une incidence mondiale estimée à 0,08 cas pour 100 000 habitants par an. En France, cela correspond approximativement à 50 à 60 nouveaux cas diagnostiqués chaque année, selon les données épidémiologiques les plus récentes.
La répartition par sexe montre une légère prédominance masculine, avec un ratio homme/femme de 1,3:1. Cette différence s'accentue pour les chordomes sacrés, où les hommes sont deux fois plus touchés que les femmes. À l'inverse, les chordomes de la base du crâne présentent une répartition plus équilibrée entre les sexes [14].
L'âge médian au diagnostic varie selon la localisation tumorale. Les chordomes sacrés surviennent généralement plus tardivement, avec un âge médian de 58 ans, tandis que ceux de la base du crâne touchent des patients plus jeunes, avec un âge médian de 45 ans [15]. Cette différence d'âge pourrait refléter des mécanismes oncogéniques distincts selon la localisation.
Au niveau européen, l'incidence reste stable dans la plupart des pays, suggérant que les facteurs environnementaux jouent un rôle limité dans le développement de cette pathologie. Les registres de cancer européens rapportent des taux similaires à ceux observés en France, confirmant la rareté universelle de cette tumeur.
Les Causes et Facteurs de Risque
Contrairement à de nombreuses tumeurs, le chordome ne présente pas de facteurs de risque environnementaux clairement identifiés. Cette pathologie résulte d'une transformation maligne de cellules notochordales résiduelles, processus qui semble largement indépendant des influences extérieures.
Les recherches récentes se concentrent sur les anomalies génétiques impliquées dans la chordomagenèse. La duplication du gène T (TBXT), codant pour la brachyurie, constitue l'altération génétique la plus fréquemment observée [11]. Cette duplication entraîne une surexpression de la brachyurie, favorisant la prolifération cellulaire et l'invasion tumorale.
D'autres mutations ont été identifiées, notamment dans les gènes CDKN2A/B, PIK3CA et PTEN. Ces altérations affectent les voies de signalisation cellulaire contrôlant la croissance et la survie cellulaire. Cependant, il faut savoir que ces mutations sont généralement acquises et non héréditaires.
Bon à savoir : les formes familiales de chordome sont exceptionnelles, représentant moins de 5% des cas. Quand elles surviennent, elles sont souvent associées à des duplications germinales du gène T, transmises selon un mode autosomique dominant avec une pénétrance incomplète.
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes du chordome varient considérablement selon la localisation tumorale et la taille de la lésion. Cette diversité clinique explique souvent le retard diagnostique, les premiers signes étant fréquemment attribués à des pathologies plus communes.
Pour les chordomes de la base du crâne, les symptômes neurologiques dominent le tableau clinique. Les patients peuvent présenter des céphalées persistantes, souvent localisées à la région occipitale. Les troubles visuels, incluant une diplopie ou une baisse de l'acuité visuelle, résultent de la compression des nerfs crâniens [8,12]. D'ailleurs, l'atteinte du nerf abducens (VI) est particulièrement fréquente, provoquant une paralysie oculomotrice caractéristique.
Les chordomes cervicaux peuvent mimer une tumeur oropharyngée, créant une confusion diagnostique [12]. Les patients rapportent des difficultés de déglutition, une sensation de corps étranger dans la gorge, ou des troubles de la phonation. Ces symptômes s'expliquent par l'extension tumorale vers les espaces parapharyngés.
Concernant les chordomes sacrés, la symptomatologie est dominée par les douleurs pelviennes et les troubles sphinctériens [10]. La douleur, initialement sourde et intermittente, devient progressivement constante et invalidante. Les troubles urinaires et intestinaux apparaissent généralement à un stade plus avancé, témoignant de l'atteinte des racines nerveuses sacrées.
L'important à retenir : ces symptômes évoluent lentement sur plusieurs mois, voire années. Cette progression insidieuse constitue une caractéristique majeure du chordome, expliquant pourquoi le diagnostic est souvent posé tardivement.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic du chordome repose sur une approche multidisciplinaire combinant imagerie, anatomopathologie et marqueurs moléculaires. Cette démarche diagnostique nécessite une expertise spécialisée, compte tenu de la rareté de cette pathologie.
L'imagerie par résonance magnétique (IRM) constitue l'examen de référence pour l'évaluation initiale. Le chordome présente des caractéristiques radiologiques spécifiques : signal hétérogène en T1, hypersignal en T2 avec des zones de restriction de diffusion [13]. La présence de calcifications intralésionnelles, mieux visualisées au scanner, oriente vers le diagnostic.
Cependant, l'imagerie seule ne permet pas d'affirmer le diagnostic. La biopsie reste indispensable pour l'analyse histologique et moléculaire. Cette procédure doit être réalisée dans un centre expert, car elle maladiene la qualité du diagnostic et la planification thérapeutique [15].
L'examen anatomopathologique révèle les cellules physaliphores caractéristiques, organisées en travées ou en cordons. Mais c'est l'immunohistochimie qui confirme le diagnostic, avec la positivité pour la brachyurie, marqueur spécifique du chordome [6]. D'autres marqueurs comme la cytokératine et l'EMA complètent le profil immunohistochimique.
Concrètement, le délai diagnostique moyen reste malheureusement long, souvent supérieur à 12 mois entre les premiers symptômes et le diagnostic définitif. Cette latence s'explique par la rareté de la pathologie et la non-spécificité des symptômes initiaux.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
La prise en charge du chordome repose principalement sur la chirurgie d'exérèse, complétée par la radiothérapie dans la majorité des cas. Cette approche multimodale vise à optimiser le contrôle local de la maladie tout en préservant les fonctions neurologiques.
La résection chirurgicale constitue le pilier du traitement. L'objectif est d'obtenir une exérèse complète avec des marges saines, ce qui représente un défi technique majeur compte tenu de la localisation anatomique complexe [16]. Pour les chordomes de la base du crâne, les approches endoscopiques endonasales ont révolutionné la prise en charge, permettant une résection moins invasive avec une morbidité réduite.
Concernant les chordomes sacrés, la chirurgie peut nécessiter une sacrectomie partielle ou totale selon l'extension tumorale [10]. Cette intervention complexe requiert une planification préopératoire minutieuse et une expertise neurochirurgicale spécialisée. Les techniques de reconstruction moderne permettent de préserver au maximum les fonctions pelviennes.
La radiothérapie joue un rôle crucial, particulièrement en situation adjuvante après chirurgie incomplète. Les techniques modernes comme la protonthérapie ou la radiothérapie stéréotaxique permettent de délivrer des doses élevées tout en épargnant les tissus sains environnants. Cette précision balistique est essentielle compte tenu de la proximité des structures nobles.
Malheureusement, la chimiothérapie conventionnelle montre une efficacité limitée dans le chordome. Les agents alkylants et les anthracyclines, efficaces dans d'autres sarcomes, ne démontrent pas d'activité significative. Cette résistance intrinsèque oriente vers le développement de thérapies ciblées.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024-2025 marque un tournant dans la recherche sur le chordome, avec plusieurs innovations thérapeutiques prometteuses en cours d'évaluation. Ces avancées offrent de nouveaux espoirs pour les patients atteints de cette pathologie rare.
L'immunothérapie représente l'axe de recherche le plus prometteur actuellement. Un essai clinique récent évalue l'association pemetrexed-pembrolizumab chez les patients atteints de chordome avancé [3]. Cette combinaison vise à sensibiliser les cellules tumorales à l'action des inhibiteurs de checkpoint immunitaire. Les premiers résultats montrent des réponses encourageantes, avec un taux de contrôle de la maladie supérieur aux traitements conventionnels.
Les recherches sur le microenvironnement immunitaire du chordome révèlent des caractéristiques particulières qui pourraient être exploitées thérapeutiquement [5]. L'infiltrat lymphocytaire T, bien que présent, semble fonctionnellement altéré. Les stratégies visant à restaurer l'immunité antitumorale, notamment par les inhibiteurs de PD-1/PD-L1, font l'objet d'investigations approfondies.
Parallèlement, les thérapies ciblées dirigées contre la brachyurie suscitent un intérêt croissant [4]. Bien que cette protéine soit considérée comme difficilement ciblable, de nouvelles approches utilisant des oligonucléotides antisens ou des dégradeurs de protéines (PROTACs) sont en développement. Ces stratégies innovantes pourraient révolutionner le traitement du chordome.
Les projets de recherche français, notamment ceux soutenus par l'Institut Curie, explorent également les biomarqueurs prédictifs de réponse thérapeutique [1]. L'identification de signatures moléculaires permettrait de personnaliser les traitements et d'optimiser l'efficacité thérapeutique. Cette médecine de précision représente l'avenir de la prise en charge du chordome.
Vivre au Quotidien avec un Chordome
Vivre avec un chordome implique des adaptations importantes dans la vie quotidienne, mais de nombreux patients parviennent à maintenir une qualité de vie satisfaisante. L'accompagnement multidisciplinaire joue un rôle essentiel dans cette démarche d'adaptation.
La gestion de la douleur constitue souvent un enjeu majeur, particulièrement pour les chordomes sacrés. Les douleurs neuropathiques nécessitent une approche spécialisée combinant antalgiques, antiépileptiques et parfois techniques interventionnelles. L'important est de ne pas hésiter à consulter un spécialiste de la douleur pour optimiser le traitement.
Les troubles fonctionnels varient selon la localisation tumorale et les séquelles thérapeutiques. Pour les patients ayant bénéficié d'une sacrectomie, la rééducation périnéale et vésico-sphinctérienne peut considérablement améliorer l'autonomie. La kinésithérapie adaptée aide à compenser les déficits moteurs et à prévenir les complications secondaires.
D'un point de vue professionnel, beaucoup de patients peuvent reprendre une activité, parfois avec des aménagements. Le maintien d'une activité sociale et professionnelle contribue positivement à l'équilibre psychologique. Rassurez-vous, des dispositifs d'aide existent pour faciliter cette réinsertion.
Le soutien psychologique ne doit pas être négligé. L'annonce d'un chordome génère souvent une anxiété importante, liée à la rareté de la pathologie et aux incertitudes pronostiques. L'accompagnement par un psycho-oncologue peut aider à traverser ces épreuves et à développer des stratégies d'adaptation efficaces.
Les Complications Possibles
Le chordome peut entraîner diverses complications, liées soit à l'évolution naturelle de la tumeur, soit aux traitements mis en œuvre. La connaissance de ces complications permet une surveillance adaptée et une prise en charge précoce.
Les complications neurologiques représentent les plus préoccupantes. Pour les chordomes de la base du crâne, l'extension tumorale peut comprimer les structures nerveuses adjacentes, provoquant des paralysies des nerfs crâniens [8]. La compression du tronc cérébral constitue une urgence neurochirurgicale nécessitant une décompression rapide.
Concernant les localisations sacrées, l'atteinte des racines nerveuses peut entraîner des troubles sphinctériens définitifs. Ces complications fonctionnelles impactent significativement la qualité de vie et nécessitent une prise en charge spécialisée en urologie et gastroentérologie [10].
Les complications post-opératoires varient selon la localisation et l'étendue de la résection. Les infections du site opératoire, bien que rares, peuvent survenir et nécessiter une antibiothérapie prolongée. Les fistules de liquide céphalorachidien représentent une complication spécifique des chirurgies de la base du crâne.
La récidive locale constitue la complication la plus redoutée à long terme. Elle survient dans 20 à 40% des cas selon les séries, généralement dans les 5 premières années suivant le traitement initial. Cette récidive impose souvent une reprise chirurgicale complexe avec un pronostic moins favorable.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic du chordome dépend de multiples facteurs, notamment la localisation tumorale, la qualité de la résection chirurgicale et l'âge du patient. Cette pathologie présente des caractéristiques évolutives particulières qui influencent les perspectives à long terme.
La survie globale varie considérablement selon la localisation. Les chordomes de la base du crâne présentent généralement un pronostic plus favorable, avec une survie à 10 ans d'environ 70-80%. À l'inverse, les chordomes sacrés ont un pronostic plus réservé, avec une survie à 10 ans de 50-60% [14].
La qualité de la résection chirurgicale constitue le facteur pronostique le plus important. Une exérèse complète avec marges saines (résection R0) améliore significativement le pronostic, réduisant le risque de récidive locale de 60% à 20%. Malheureusement, cette résection optimale n'est pas toujours techniquement réalisable compte tenu de la localisation anatomique complexe.
L'âge au diagnostic influence également le pronostic. Les patients jeunes (< 40 ans) présentent paradoxalement un pronostic moins favorable, possiblement lié à une agressivité tumorale plus importante. Cette observation souligne l'hétérogénéité biologique des chordomes selon l'âge.
Il faut savoir que le chordome évolue généralement lentement, sur plusieurs années. Cette croissance indolente permet souvent de maintenir une qualité de vie acceptable même en cas de maladie résiduelle. Les métastases, bien que possibles, restent relativement rares (10-15% des cas) et surviennent tardivement dans l'évolution.
Peut-on Prévenir le Chordome ?
La prévention primaire du chordome n'est actuellement pas possible, cette pathologie résultant d'anomalies génétiques acquises sans facteurs de risque environnementaux identifiés. Cependant, certaines stratégies peuvent contribuer à un diagnostic plus précoce.
La sensibilisation médicale constitue un enjeu majeur compte tenu de la rareté de cette pathologie. Les médecins de première ligne doivent être alertés sur les signes d'appel évocateurs : douleurs persistantes de la base du crâne, troubles neurologiques progressifs, ou douleurs sacrées résistantes aux traitements conventionnels.
Pour les formes familiales exceptionnelles, un conseil génétique peut être proposé. Bien que représentant moins de 5% des cas, ces formes héréditaires justifient une surveillance familiale et éventuellement un dépistage génétique chez les apparentés.
La prévention secondaire repose sur la détection précoce des récidives par une surveillance radiologique régulière. Cette surveillance, généralement basée sur l'IRM, permet de détecter une reprise évolutive avant l'apparition de symptômes cliniques.
Concrètement, il n'existe pas de recommandations de dépistage en population générale. La rareté extrême de cette pathologie ne justifie pas de programme de dépistage systématique. L'accent doit être mis sur la formation médicale continue et l'amélioration des délais diagnostiques.
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités de santé françaises reconnaissent le chordome comme une pathologie rare nécessitant une prise en charge spécialisée dans des centres de référence. Cette organisation vise à optimiser la qualité des soins et l'accès aux innovations thérapeutiques.
La Haute Autorité de Santé (HAS) recommande une approche multidisciplinaire impliquant neurochirurgiens, oncologues, radiothérapeutes et anatomopathologistes spécialisés. Cette concertation pluridisciplinaire doit intervenir dès le diagnostic pour définir la stratégie thérapeutique optimale.
Concernant la radiothérapie, les recommandations privilégient les techniques de haute précision comme la protonthérapie ou la radiothérapie stéréotaxique. Ces modalités permettent de délivrer des doses élevées tout en préservant les tissus sains, critère essentiel compte tenu de la localisation anatomique sensible.
L'Institut National du Cancer (INCa) soutient les réseaux de recherche dédiés aux tumeurs rares, favorisant l'inclusion des patients dans les essais cliniques. Cette démarche est cruciale pour faire progresser les connaissances et développer de nouvelles thérapeutiques [2].
Les recommandations insistent également sur l'importance du suivi à long terme. La surveillance doit être maintenue pendant au moins 10 ans après le traitement initial, compte tenu du risque de récidive tardive. Cette surveillance prolongée nécessite une coordination entre les différents intervenants médicaux.
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs associations et ressources sont disponibles pour accompagner les patients atteints de chordome et leurs proches. Ces structures offrent information, soutien et mise en réseau des patients.
La Chordoma Foundation constitue la référence internationale pour l'information sur cette pathologie [14]. Cette organisation propose des ressources éducatives complètes, finance la recherche et facilite les échanges entre patients. Leur site web français fournit des informations actualisées sur les traitements et les essais cliniques disponibles.
En France, l'Association des Patients Atteints de Tumeurs Rares (APATR) peut orienter les patients vers des ressources spécialisées. Bien que non spécifique au chordome, cette association offre un soutien précieux pour naviguer dans le système de soins et accéder aux droits sociaux.
Les centres de référence pour les tumeurs rares disposent généralement de coordinateurs patients qui facilitent les démarches administratives et l'accès aux soins. Ces professionnels constituent des interlocuteurs privilégiés pour les questions pratiques.
Les plateformes en ligne permettent aux patients de partager leurs expériences et de s'entraider. Ces communautés virtuelles offrent un soutien émotionnel précieux, particulièrement important compte tenu de la rareté de la pathologie qui peut générer un sentiment d'isolement.
Nos Conseils Pratiques
Vivre avec un chordome nécessite des adaptations pratiques qui peuvent considérablement améliorer la qualité de vie. Voici nos recommandations basées sur l'expérience clinique et les retours de patients.
Organisez votre suivi médical de manière rigoureuse. Tenez un carnet de santé détaillé avec les dates d'examens, les résultats d'imagerie et l'évolution des symptômes. Cette documentation facilite les consultations et permet un suivi optimal de votre pathologie.
Adaptez votre environnement selon vos limitations fonctionnelles. Pour les patients avec des troubles de l'équilibre, sécurisez votre domicile en éliminant les obstacles et en installant des barres d'appui. Ces aménagements simples préviennent les chutes et préservent l'autonomie.
Maintenez une activité physique adaptée à vos capacités. La kinésithérapie et la physiothérapie aident à conserver la mobilité et à gérer la douleur. Même des exercices doux comme la marche ou la natation peuvent apporter des bénéfices significatifs.
Communiquez ouvertement avec votre équipe soignante sur vos préoccupations et vos objectifs. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, même celles qui vous semblent triviales. Une bonne communication améliore la prise en charge et réduit l'anxiété.
Préparez vos consultations en listant vos questions à l'avance. Cette préparation optimise le temps de consultation et vous assure de ne rien oublier d'important. Venez accompagné si possible, un proche peut vous aider à retenir les informations importantes.
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes d'alarme doivent conduire à une consultation médicale rapide, que ce soit dans le cadre d'un diagnostic initial ou lors du suivi d'un chordome connu. La reconnaissance précoce de ces symptômes peut influencer significativement le pronostic.
Consultez en urgence en cas d'apparition brutale de troubles neurologiques : paralysie faciale, troubles de la déglutition, diplopie soudaine ou troubles de l'équilibre. Ces symptômes peuvent témoigner d'une compression nerveuse nécessitant une prise en charge immédiate [15].
Pour les douleurs persistantes, ne tardez pas à consulter si elles résistent aux antalgiques habituels ou s'intensifient progressivement. Les douleurs nocturnes, particulièrement invalidantes, constituent un signe d'appel important qui mérite une évaluation spécialisée.
Les troubles sphinctériens nouveaux ou qui s'aggravent nécessitent une consultation rapide. L'incontinence urinaire ou fécale peut témoigner d'une compression des racines nerveuses sacrées et justifier une réévaluation de la maladie.
Dans le cadre du suivi post-thérapeutique, respectez scrupuleusement le calendrier de surveillance établi par votre équipe médicale. N'hésitez pas à avancer une consultation si vous ressentez des symptômes nouveaux ou inquiétants, même s'ils vous semblent mineurs.
Bon à savoir : en cas de doute, il vaut toujours mieux consulter. Les équipes médicales préfèrent être sollicitées pour une fausse alerte plutôt que de passer à côté d'une complication importante.
Questions Fréquentes
Le chordome est-il héréditaire ?Dans la grande majorité des cas, le chordome n'est pas héréditaire. Moins de 5% des cas présentent un caractère familial. Ces formes rares sont liées à des duplications germinales du gène T et se transmettent selon un mode autosomique dominant.
Peut-on guérir complètement d'un chordome ?
La guérison est possible, particulièrement quand une résection complète avec marges saines peut être réalisée. Cependant, le risque de récidive impose une surveillance prolongée pendant au moins 10 ans après le traitement initial.
La radiothérapie est-elle toujours nécessaire ?
La radiothérapie n'est pas systématique. Elle est généralement recommandée en cas de résection incomplète ou de localisation à haut risque de récidive. Les techniques modernes comme la protonthérapie permettent de limiter les effets secondaires.
Puis-je avoir des enfants après un traitement pour chordome ?
La fertilité peut être préservée dans la plupart des cas. Cependant, certains traitements peuvent affecter la fonction reproductive. Il est important d'aborder cette question avec votre équipe médicale avant le début des traitements.
Existe-t-il des restrictions alimentaires particulières ?
Il n'existe pas de régime alimentaire spécifique pour le chordome. Une alimentation équilibrée et variée est recommandée pour maintenir un bon état nutritionnel pendant les traitements.
Comment gérer l'anxiété liée au diagnostic ?
L'anxiété est une réaction normale face au diagnostic de chordome. Un soutien psychologique spécialisé peut être très bénéfique. N'hésitez pas à en parler avec votre équipe médicale qui peut vous orienter vers des professionnels compétents.
Questions Fréquentes
Le chordome est-il héréditaire ?
Dans la grande majorité des cas, le chordome n'est pas héréditaire. Moins de 5% des cas présentent un caractère familial, liés à des duplications germinales du gène T.
Peut-on guérir complètement d'un chordome ?
La guérison est possible, particulièrement avec une résection complète. Cependant, une surveillance prolongée de 10 ans minimum est nécessaire.
La radiothérapie est-elle toujours nécessaire ?
Non, la radiothérapie dépend de la qualité de la résection et de la localisation. Elle est recommandée en cas de résection incomplète ou de haut risque de récidive.
Puis-je avoir des enfants après un traitement ?
La fertilité peut généralement être préservée. Il est important d'aborder cette question avec votre équipe médicale avant le début des traitements.
Comment gérer l'anxiété liée au diagnostic ?
L'anxiété est normale. Un soutien psychologique spécialisé peut être très bénéfique. Votre équipe médicale peut vous orienter vers des professionnels compétents.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] NOS PROJETS DE RECHERCHE. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [2] Semaine du Cerveau. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [3] New chordoma clinical trial launches along with pemetrexed-pembrolizumab combination.Lien
- [4] Chordoma: New Updates and Breakthroughs 2024.Lien
- [5] Immune microenvironment and immunotherapy for chordoma.Lien
- [6] Les tumeurs notochordales: de la notochorde au chordome. Annales de Pathologie 2022.Lien
- [8] Chordome Sphéno-Sellaire chez une Diabétique Âgée: À Propos d'un Cas. 2025.Lien
- [10] Behandlungsalternativen für sakrale Chordome. Die Wirbelsäule 2022.Lien
- [11] Molekulare Charakterisierung primärer und rezidivierter Chordome und Untersuchungen zu Protein-Interaktionen des Chordom-Schlüsseltreibers Brachyury. 2023.Lien
- [12] Les chordomes cervicaux mimant une tumeur oropharyngée. 2022.Lien
- [13] Brain Club. Cas clinique chordome. 2024.Lien
- [14] Comprendre le chordome. Chordoma Foundation.Lien
- [15] Symptômes et diagnostic. Chordoma Foundation.Lien
- [16] Chordome - Service de Neurochirurgie Hôpital Lariboisière.Lien
Publications scientifiques
- Les tumeurs notochordales: de la notochorde au chordome (2022)2 citations
- Chordome–Ein Update (2022)1 citations
- Chordome Sphéno-Sellaire chez une Diabétique Âgée: À Propos d'un Cas: Spheno-Sellar Chordoma in a Female Elderly Diabetics: a Case Report (2025)
- Chordome des fosses nasales (2024)
- Behandlungsalternativen für sakrale Chordome (2022)
Ressources web
- Comprendre le chordome (fr.chordomafoundation.org)
Les signes les plus courants du chordome sont la douleur et les changements neurologiques. Les chordomes de la base du crâne provoquent le plus souvent des maux ...
- Symptômes et diagnostic (fr.chordomafoundation.org)
Lorsqu'un chordome est suspecté, vous aurez besoin d'une imagerie par résonance magnétique, également appelée IRM, pour aider les médecins à poser un diagnostic ...
- Chordome - Service de Neurochirurgie Hôpital Lariboisière (neurochirurgie-lariboisiere.com)
3 déc. 2024 — Les chordomes du sacrum sont souvent découvert tardivement et ils se manifestent par des douleurs, des troubles urinaires voire une incontinence ...
- Chordomes de la base du crâne (fondazionecnao.it)
Le chordome se caractérise par une forte probabilité de récidive, c'est-à-dire de récidive après traitement, c'est pourquoi il est nécessaire d'effectuer un ...
- Chordome (orpha.net)
Ils peuvent métastaser dans les ganglions lymphatiques, les poumons, le foie et les os. Le diagnostic se fait par radiographie, scanner ou imagerie par ré ...

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
