Céphalées : Symptômes, Causes et Traitements - Guide Complet 2025
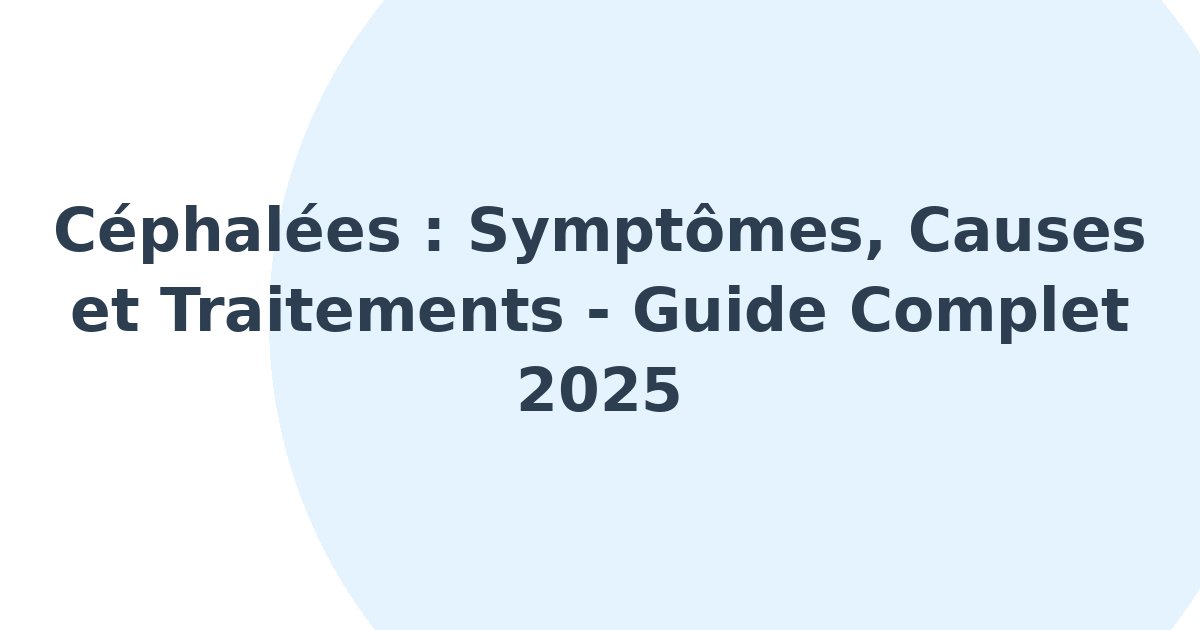
Les céphalées touchent plus de 12 millions de Français chaque année [3]. Mais derrière ce terme médical se cachent des réalités très différentes : du simple mal de tête passager aux migraines invalidantes. Vous vous demandez peut-être si vos maux de tête sont normaux ? Cette pathologie neurologique complexe mérite qu'on s'y attarde, car elle impacte considérablement la qualité de vie.

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Céphalées : Définition et Vue d'Ensemble
Une céphalée désigne toute douleur ressentie au niveau de la tête ou du cou supérieur [3]. Contrairement aux idées reçues, il ne s'agit pas d'une maladie unique mais d'un ensemble de troubles neurologiques aux mécanismes variés.
Les spécialistes distinguent deux grandes catégories. D'abord, les céphalées primaires où la douleur constitue elle-même la maladie : migraines, céphalées de tension, algie vasculaire de la face [13]. Ensuite, les céphalées secondaires qui résultent d'une autre pathologie : traumatisme crânien, infection, tumeur [10,12].
L'important à retenir ? Chaque type de céphalée a ses propres caractéristiques. La migraine provoque des douleurs pulsatiles souvent accompagnées de nausées. Les céphalées de tension créent plutôt une sensation d'étau autour de la tête [18]. Et les algies vasculaires de la face génèrent des douleurs atroces mais brèves, souvent nocturnes [13].
Bon à savoir : les céphalées peuvent survenir à tout âge, mais certaines formes prédominent selon les périodes de la vie. Les migraines débutent souvent à l'adolescence, tandis que les céphalées post-traumatiques peuvent apparaître à tout moment [10,12].
Épidémiologie en France et dans le Monde
Les données épidémiologiques françaises révèlent l'ampleur considérable de cette pathologie [1,2]. Selon Santé Publique France, les céphalées affectent environ 47% de la population adulte chaque année, avec une prévalence particulièrement élevée chez les femmes (60%) comparativement aux hommes (35%) [1].
L'incidence des migraines, forme la plus invalidante, touche 12% des Français, soit près de 8 millions de personnes [2]. Cette prévalence place la France dans la moyenne européenne, légèrement au-dessus de l'Allemagne (10,5%) mais en dessous du Royaume-Uni (14,2%) [4].
Les variations régionales sont significatives. Les bulletins de surveillance de La Réunion montrent une prévalence de céphalées chroniques de 8,3% en 2025, contre 6,1% en métropole [1,2]. Cette différence s'explique notamment par les facteurs climatiques et les spécificités génétiques des populations.
D'un point de vue économique, les céphalées représentent un coût annuel de 2,8 milliards d'euros pour l'Assurance Maladie [4]. Ce chiffre inclut les consultations, les arrêts de travail et les hospitalisations. En moyenne, un patient migraineux consulte 4,2 fois par an et s'arrête 12 jours de travail [15].
Les projections pour 2030 sont préoccupantes. L'évolution démographique et l'augmentation du stress professionnel pourraient porter la prévalence des céphalées chroniques à 15% de la population adulte [4]. Cette progression nécessite une adaptation de notre système de soins.
Les Causes et Facteurs de Risque
Comprendre les causes des céphalées, c'est d'abord accepter leur complexité [3]. Les mécanismes varient selon le type de céphalée, mais certains facteurs reviennent régulièrement.
Pour les migraines, la génétique joue un rôle majeur. Si l'un de vos parents souffre de migraines, vous avez 40% de risques d'en développer [18]. Les hormones féminines expliquent pourquoi les femmes sont trois fois plus touchées, particulièrement autour des règles et de la ménopause.
Les céphalées de tension résultent souvent du stress, des contractures musculaires cervicales ou d'une mauvaise posture [3]. Le travail sur écran prolongé, les troubles du sommeil et l'anxiété constituent des facteurs déclenchants fréquents.
Certaines céphalées secondaires ont des causes plus spécifiques. Les céphalées post-traumatiques peuvent persister des mois après un choc, même apparemment bénin [10,12]. L'apnée du sommeil provoque des maux de tête matinaux par manque d'oxygénation cérébrale [11].
D'autres facteurs environnementaux méritent attention : changements météorologiques, certains aliments (chocolat, fromages vieillis), alcool, parfums intenses [18]. Mais attention aux idées reçues ! Chaque personne a ses propres déclencheurs, et ce qui provoque une crise chez votre voisin ne vous affectera peut-être pas.
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Reconnaître une céphalée semble évident, mais la réalité est plus nuancée [18]. Chaque type présente des caractéristiques spécifiques qu'il faut savoir identifier.
La migraine se manifeste par des douleurs pulsatiles, souvent unilatérales, d'intensité modérée à sévère. Elle s'accompagne fréquemment de nausées, vomissements, et d'une hypersensibilité à la lumière (photophobie) et aux bruits (phonophobie) [3]. Certains patients décrivent une aura visuelle précédant la douleur : points lumineux, zigzags, ou perte de vision partielle.
Les céphalées de tension créent plutôt une sensation de serrement, comme un bandeau trop serré autour de la tête. La douleur est généralement bilatérale, d'intensité légère à modérée, sans nausées ni hypersensibilité [18].
L'algie vasculaire de la face provoque des douleurs atroces, strictement unilatérales, souvent autour de l'œil. Elle s'accompagne de larmoiement, congestion nasale et agitation [13]. Ces crises durent 15 minutes à 3 heures et surviennent souvent la nuit.
Certains signes doivent vous alerter immédiatement [16] : céphalée brutale et intense (« coup de tonnerre »), fièvre associée, troubles visuels persistants, raideur de nuque, ou changement brutal du caractère habituel de vos maux de tête. Ces symptômes nécessitent une consultation urgente car ils peuvent révéler une pathologie grave.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic des céphalées repose avant tout sur un interrogatoire médical minutieux [16]. Votre médecin vous demandera de décrire précisément vos douleurs : localisation, intensité, durée, fréquence, facteurs déclenchants et signes associés.
Tenir un agenda des céphalées s'avère particulièrement utile. Notez pendant quelques semaines : dates et heures des crises, intensité sur une échelle de 1 à 10, durée, médicaments pris et leur efficacité [18]. Ces informations orientent considérablement le diagnostic.
L'examen clinique comprend la prise de tension artérielle, l'examen neurologique et parfois ophtalmologique [16]. En effet, certaines céphalées révèlent une hypertension artérielle ou un glaucome. L'examen du fond d'œil peut détecter des signes d'hypertension intracrânienne.
Les examens complémentaires ne sont pas systématiques. Une IRM cérébrale sera demandée en cas de céphalées récentes, de signes neurologiques associés ou de changement du pattern habituel [12]. La ponction lombaire reste exceptionnelle, réservée aux suspicions de méningite ou d'hémorragie méningée.
Concrètement, dans 90% des cas, le diagnostic repose uniquement sur l'interrogatoire et l'examen clinique [18]. Les examens d'imagerie servent surtout à éliminer une cause secondaire chez les patients présentant des signes d'alarme.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement des céphalées s'articule autour de deux approches complémentaires : le traitement de crise et le traitement de fond [19]. Cette stratégie thérapeutique doit être personnalisée selon le type de céphalée et son impact sur votre quotidien.
Pour les crises aiguës, les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) comme l'ibuprofène constituent souvent la première ligne [3]. Les triptans restent le traitement de référence des crises migraineuses modérées à sévères, avec une efficacité de 70% quand ils sont pris précocement [19].
Le traitement de fond s'envisage quand les crises sont fréquentes (plus de 4 par mois) ou très invalidantes. Les bêta-bloquants, certains antiépileptiques et antidépresseurs ont fait leurs preuves [18]. Le choix dépend de vos autres pathologies et des effets secondaires potentiels.
Les approches non médicamenteuses méritent une place importante. La relaxation, la gestion du stress, l'activité physique régulière et l'amélioration de l'hygiène de sommeil réduisent significativement la fréquence des crises [19]. L'acupuncture montre également des résultats encourageants.
Pour les céphalées post-traumatiques, la rééducation multidisciplinaire associant kinésithérapie, ergothérapie et soutien psychologique améliore considérablement le pronostic [10]. Cette approche globale reconnaît la complexité de ces troubles.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024-2025 marque un tournant dans la prise en charge des céphalées avec l'arrivée de nouvelles thérapies révolutionnaires [5]. Les anticorps monoclonaux anti-CGRP (Calcitonin Gene-Related Peptide) transforment le traitement préventif des migraines.
L'eptinezumab, administré par perfusion trimestrielle, montre une efficacité remarquable dans les études à long terme [9]. Cette innovation réduit de 50% la fréquence des crises chez 60% des patients, avec un profil de tolérance excellent. Malheureusement, ces traitements restent sous-prescrits en France [5].
La Semaine du Cerveau 2025 a mis en lumière les avancées en neurostimulation [6]. Les dispositifs de stimulation du nerf vague et du nerf occipital offrent de nouvelles perspectives pour les céphalées résistantes aux traitements conventionnels.
Les Journées de Neurologie de Langue Française 2024 ont présenté des résultats prometteurs sur la thérapie génique [7]. Bien qu'encore expérimentale, cette approche pourrait révolutionner le traitement des migraines d'origine génétique dans les prochaines années.
Une étude prospective multicentrique de 24 semaines démontre l'efficacité des nouvelles molécules dans le monde réel [8]. Ces données confirment que les innovations thérapeutiques ne restent pas confinées aux essais cliniques mais bénéficient réellement aux patients.
Cependant, l'accès à ces innovations reste inégal. Les délais de remboursement et la formation des professionnels constituent encore des obstacles à leur diffusion [5].
Vivre au Quotidien avec des Céphalées
Vivre avec des céphalées chroniques transforme profondément le quotidien [15]. Cette pathologie invisible génère souvent incompréhension et isolement social, car l'entourage peine à mesurer l'impact réel de ces douleurs.
L'organisation de votre journée devient cruciale. Identifiez vos facteurs déclenchants personnels : stress, manque de sommeil, certains aliments, changements hormonaux [18]. Tenir un agenda détaillé vous aide à anticiper et éviter les situations à risque.
Au travail, n'hésitez pas à discuter avec votre employeur des aménagements possibles. Un éclairage adapté, des pauses régulières ou la possibilité de télétravail lors des crises peuvent considérablement améliorer votre qualité de vie professionnelle [15].
La gestion du stress mérite une attention particulière. Les techniques de relaxation, la méditation de pleine conscience ou le yoga réduisent significativement la fréquence des crises [19]. Ces approches demandent de la régularité mais leurs bénéfices sont durables.
Votre entourage a besoin d'être informé et impliqué. Expliquez-leur que vos céphalées ne sont pas « dans votre tête » mais constituent une vraie maladie neurologique [15]. Leur compréhension et leur soutien sont essentiels pour votre bien-être psychologique.
Les Complications Possibles
Bien que la plupart des céphalées soient bénignes, certaines complications méritent votre attention [14]. La chronicisation constitue l'évolution la plus redoutée : des céphalées épisodiques deviennent quotidiennes, impactant drastiquement la qualité de vie.
L'abus médicamenteux représente un piège fréquent. Prendre des antalgiques plus de 10 jours par mois peut paradoxalement entretenir et aggraver les céphalées [19]. Ce cercle vicieux nécessite souvent une hospitalisation pour sevrage médicamenteux.
Les céphalées résiduelles après traitement d'une hypertension intracrânienne idiopathique posent des défis thérapeutiques particuliers [14]. Ces douleurs persistent malgré la normalisation de la pression intracrânienne et altèrent significativement la qualité de vie des patients.
Certaines complications sont plus rares mais graves. Les céphalées peuvent révéler une méningite, une hémorragie méningée ou une tumeur cérébrale [16]. D'où l'importance de consulter rapidement en cas de céphalée inhabituelle, brutale ou accompagnée de signes neurologiques.
L'impact psychologique ne doit pas être négligé. Les céphalées chroniques favorisent l'apparition de dépression et d'anxiété [15]. Cette comorbidité psychiatrique complique la prise en charge et nécessite une approche multidisciplinaire.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic des céphalées varie considérablement selon leur type et leur prise en charge [15]. Rassurez-vous : dans la majorité des cas, l'évolution est favorable avec un traitement adapté.
Pour les migraines, 60% des patients voient leurs crises diminuer en fréquence et intensité avec un traitement préventif bien conduit [18]. Chez les femmes, la ménopause apporte souvent une amélioration naturelle, les fluctuations hormonales étant moins importantes.
Les céphalées de tension ont généralement un excellent pronostic. L'identification et la correction des facteurs déclenchants (stress, posture, sommeil) permettent une guérison complète dans 80% des cas [19].
Les céphalées post-traumatiques présentent une évolution plus variable [10,12]. Si 70% des patients récupèrent dans les 6 premiers mois, 15% développent des douleurs chroniques nécessitant une prise en charge spécialisée. La précocité de la rééducation influence favorablement le pronostic.
L'important à retenir : un diagnostic précoce et un traitement adapté améliorent considérablement le pronostic [15]. Les innovations thérapeutiques récentes offrent de nouveaux espoirs, même pour les formes résistantes aux traitements conventionnels.
Cependant, certains facteurs péjorent le pronostic : âge avancé, comorbidités multiples, retard diagnostic, abus médicamenteux [14]. D'où l'importance d'une prise en charge précoce et globale.
Peut-on Prévenir les Céphalées ?
La prévention des céphalées repose sur une approche globale combinant hygiène de vie et évitement des facteurs déclenchants [18]. Bonne nouvelle : de nombreuses mesures simples peuvent considérablement réduire leur fréquence.
Le sommeil constitue un pilier fondamental. Couchez-vous et levez-vous à heures régulières, même le week-end. Visez 7 à 8 heures de sommeil par nuit et évitez les grasses matinées qui peuvent déclencher des migraines [19].
L'activité physique régulière diminue de 40% la fréquence des céphalées. Privilégiez les sports d'endurance : marche rapide, natation, vélo. Évitez les efforts intenses et brutaux qui peuvent au contraire déclencher des crises [18].
Votre alimentation mérite attention. Mangez à heures régulières, ne sautez pas de repas et hydratez-vous suffisamment (1,5 à 2 litres d'eau par jour). Identifiez vos aliments déclencheurs personnels : chocolat, fromages vieillis, charcuterie, alcool [19].
La gestion du stress s'avère cruciale. Apprenez des techniques de relaxation, pratiquez la méditation ou le yoga. Organisez votre travail pour éviter les pics de stress et n'hésitez pas à déléguer [18].
Attention aux facteurs environnementaux : évitez les parfums intenses, les éclairages trop vifs ou clignotants, les bruits forts. Adaptez votre poste de travail pour maintenir une bonne posture [19].
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises ont actualisé leurs recommandations concernant la prise en charge des céphalées [4]. Ces guidelines s'appuient sur les dernières données scientifiques et l'expérience clinique des spécialistes.
Santé Publique France insiste sur l'importance du diagnostic différentiel précoce [1,2]. Les médecins généralistes, en première ligne, doivent savoir reconnaître les signes d'alarme nécessitant une orientation spécialisée urgente.
Les recommandations de voyage 2024-2025 incluent des conseils spécifiques pour les patients céphalalgiques [4]. Les changements d'altitude, de fuseau horaire et de climat peuvent déclencher des crises. Une préparation médicamenteuse adaptée est recommandée.
La Haute Autorité de Santé préconise une approche multidisciplinaire pour les céphalées chroniques. Cette prise en charge associe neurologue, médecin de la douleur, psychologue et kinésithérapeute selon les besoins [4].
Concernant les innovations thérapeutiques, les autorités encouragent la formation des professionnels aux nouveaux traitements [5]. L'objectif : réduire les inégalités d'accès et améliorer la qualité des soins sur tout le territoire.
Les recommandations insistent également sur l'éducation thérapeutique du patient. Comprendre sa maladie, identifier ses déclencheurs et savoir utiliser ses traitements constituent des éléments clés du succès thérapeutique [4].
Ressources et Associations de Patients
De nombreuses ressources existent pour vous accompagner dans votre parcours avec les céphalées [15]. Ces structures offrent information, soutien et parfois aide financière pour les traitements innovants.
La Société Française d'Étude des Migraines et Céphalées (SFEMC) propose des brochures d'information actualisées et organise des journées de sensibilisation. Leur site internet regorge de conseils pratiques validés scientifiquement.
L'Association France Migraine fédère patients et familles. Elle organise des groupes de parole, des conférences avec des spécialistes et milite pour l'amélioration de la prise en charge. Leurs forums en ligne permettent d'échanger avec d'autres patients.
Pour les céphalées post-traumatiques, l'Association des Traumatisés Crâniens propose un accompagnement spécialisé [10]. Leurs équipes comprennent les spécificités de ces douleurs souvent méconnues.
Les centres de la douleur hospitaliers constituent des ressources précieuses pour les cas complexes. Ils proposent des consultations multidisciplinaires et l'accès aux traitements les plus innovants [15].
N'oubliez pas les ressources numériques : applications de suivi des céphalées, sites d'information médicale fiables, téléconsultations spécialisées. Ces outils modernes facilitent votre prise en charge au quotidien.
Nos Conseils Pratiques
Voici nos conseils concrets pour mieux gérer vos céphalées au quotidien [18,19]. Ces astuces, validées par l'expérience clinique, peuvent faire la différence dans votre qualité de vie.
Créez votre trousse d'urgence : gardez toujours vos médicaments de crise à portée de main (bureau, voiture, sac). Ajoutez-y des lunettes de soleil, un masque occultant et des bouchons d'oreilles pour vous isoler des stimuli déclenchants.
Maîtrisez la technique du froid : appliquez une poche de glace sur le front ou la nuque dès les premiers signes. Cette méthode simple soulage 70% des patients en 15 minutes. Alternativement, certains préfèrent la chaleur sur les muscles cervicaux contractés.
Optimisez votre poste de travail : écran à hauteur des yeux, éclairage indirect, pauses toutes les heures. Investissez dans un bon siège ergonomique si vous travaillez assis [19].
Développez vos signaux d'alarme personnels : bâillements répétés, irritabilité, envie de sucré... Chaque personne a ses prodromes. Les reconnaître permet d'agir précocement et d'éviter la crise complète [18].
Constituez votre réseau de soutien : informez votre entourage professionnel et personnel. Avoir des collègues compréhensifs et une famille informée facilite grandement la gestion des crises [15].
Quand Consulter un Médecin ?
Savoir quand consulter peut vous éviter des complications graves [16]. Certains signaux d'alarme nécessitent une prise en charge médicale immédiate, d'autres justifient une consultation programmée.
Consultez en urgence si vous présentez : céphalée brutale et intense (« coup de tonnerre »), fièvre avec raideur de nuque, troubles de la conscience, paralysie ou troubles de la parole, céphalée après un traumatisme crânien [16].
Prenez rendez-vous rapidement en cas de : première céphalée après 50 ans, changement brutal du pattern habituel de vos maux de tête, céphalées matinales avec vomissements, troubles visuels persistants [16].
Une consultation programmée s'impose si : vos céphalées deviennent plus fréquentes (plus de 4 par mois), elles impactent votre travail ou vos loisirs, vous consommez des antalgiques plus de 10 jours par mois [19].
Préparez votre consultation en notant : fréquence, intensité, localisation, durée des crises, facteurs déclenchants identifiés, médicaments essayés et leur efficacité [18]. Ces informations orientent efficacement le diagnostic.
N'hésitez jamais à consulter par excès de prudence. Votre médecin préfère une consultation « pour rien » qu'un diagnostic tardif de pathologie grave [16]. La médecine moderne dispose d'outils diagnostiques performants pour vous rassurer ou identifier rapidement un problème.
Questions Fréquentes
Les céphalées sont-elles héréditaires ?Oui, particulièrement les migraines. Si l'un de vos parents souffre de migraines, vous avez 40% de risques d'en développer [18]. Cependant, l'hérédité n'est pas une fatalité : une bonne hygiène de vie peut prévenir leur apparition.
Peut-on guérir définitivement des céphalées ?
Cela dépend du type. Les céphalées de tension peuvent guérir complètement avec la correction des facteurs déclenchants [19]. Pour les migraines, on parle plutôt de contrôle : 60% des patients voient leurs crises diminuer significativement avec un traitement adapté.
Les nouveaux traitements sont-ils remboursés ?
Les anticorps monoclonaux anti-CGRP bénéficient d'un remboursement partiel depuis 2024, mais sous maladies strictes [5]. Votre neurologue évaluera votre éligibilité selon les critères de la Sécurité Sociale.
Faut-il éviter certains aliments ?
Les déclencheurs alimentaires sont très individuels [18]. Chocolat, fromages vieillis, charcuterie et alcool sont souvent incriminés, mais ne les évitez que s'ils déclenchent réellement vos crises. Un régime trop restrictif peut créer plus de stress que de bénéfices.
Les céphalées peuvent-elles cacher quelque chose de grave ?
Dans 95% des cas, les céphalées sont bénignes [16]. Cependant, certains signes doivent alerter : début brutal après 50 ans, fièvre associée, troubles neurologiques. En cas de doute, consultez sans tarder.
Questions Fréquentes
Les céphalées sont-elles héréditaires ?
Oui, particulièrement les migraines. Si l'un de vos parents souffre de migraines, vous avez 40% de risques d'en développer. Cependant, l'hérédité n'est pas une fatalité : une bonne hygiène de vie peut prévenir leur apparition.
Peut-on guérir définitivement des céphalées ?
Cela dépend du type. Les céphalées de tension peuvent guérir complètement avec la correction des facteurs déclenchants. Pour les migraines, on parle plutôt de contrôle : 60% des patients voient leurs crises diminuer significativement avec un traitement adapté.
Les nouveaux traitements sont-ils remboursés ?
Les anticorps monoclonaux anti-CGRP bénéficient d'un remboursement partiel depuis 2024, mais sous maladies strictes. Votre neurologue évaluera votre éligibilité selon les critères de la Sécurité Sociale.
Faut-il éviter certains aliments ?
Les déclencheurs alimentaires sont très individuels. Chocolat, fromages vieillis, charcuterie et alcool sont souvent incriminés, mais ne les évitez que s'ils déclenchent réellement vos crises. Un régime trop restrictif peut créer plus de stress que de bénéfices.
Les céphalées peuvent-elles cacher quelque chose de grave ?
Dans 95% des cas, les céphalées sont bénignes. Cependant, certains signes doivent alerter : début brutal après 50 ans, fièvre associée, troubles neurologiques. En cas de doute, consultez sans tarder.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Surveillance sanitaire à La Réunion. Bulletin du 9 mai 2025. Santé Publique France.Lien
- [2] Surveillance sanitaire à La Réunion. Bulletin du 4 avril 2025. Santé Publique France.Lien
- [3] Mal de tête (céphalée) : définition et causes. www.ameli.fr.Lien
- [4] RECOMMANDATIONS SANITAIRES AUX VOYAGEURS. sante.gouv.fr. 2024-2025.Lien
- [5] Migraines: les innovations sont peu prescrites - Planete sante. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [6] Semaine du Cerveau. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [7] JNLF 2024. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [8] A 24-week prospective, multicenter, real-world study. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [9] Long-term safety, tolerability, and efficacy of eptinezumab. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [10] D Plantier, C Calezis. Céphalées post-traumatiques: le point de vue du rééducateur. Revue Neurologique. 2025.Lien
- [11] C Raffeneau, E D'incau. Effets de l'orthèse d'avancée mandibulaire sur les céphalées. 2024.Lien
- [12] S Redon. Céphalées post-traumatiques: le point de vue du neurologue. Revue Neurologique. 2025.Lien
- [13] K Saghir, N Louhab. Les céphalées primaires non migraineuses rares. 2023.Lien
- [14] K Ouchen, S Bouchal. Phénotypes des céphalées résiduelles après traitement de l'HTIC idiopathique. 2025.Lien
- [15] F Ait Fatah, K Aitlahcen. Les céphalées chroniques, quel fardeau? 2023.Lien
- [16] Y Maalej, I Kaibi. Céphalées aux urgences: l'examen ophtalmologique au cœur du diagnostic. 2025.Lien
- [18] Céphalée : causes, symptômes, diagnostic et traitements. www.medecindirect.fr.Lien
- [19] Céphalée ou mal de tête : symptômes et traitements. www.elsan.care.Lien
Publications scientifiques
- Céphalées post-traumatiques: le point de vue du rééducateur (2025)
- Effets de l'orthèse d'avancée mandibulaire indiquée dans le syndrome d'apnées-hypopnées obstructives du sommeil sur les céphalées: revue systématique. (2024)
- Céphalées post-traumatiques: le point de vue du neurologue (2025)
- Les céphalées primaires non migraineuses rares (2023)
- Phénotypes des céphalées résiduelles après traitement de l'HTIC idiopathique et leur impact sur la qualité de vie (2025)
Ressources web
- Céphalée : causes, symptômes, diagnostic et traitements (medecindirect.fr)
Une céphalée est une douleur située dans une partie de la tête, y compris le crâne, le haut du cou, le visage et l'intérieur de la tête. Elle peut varier ...
- Céphalée ou mal de tête : symptômes et traitements (elsan.care)
20 mai 2025 — La céphalée, couramment appelée mal de tête, est une affection caractérisée par des crises de douleurs ou des sensations de pression dans la ...
- Mal de tête (céphalée) : définition et causes (ameli.fr)
26 févr. 2025 — Elle se traduit par des maux de tête surtout nocturnes et matinaux, une sensibilité anormale du cuir chevelu, une fatigue, etc. et des signes ...
- Céphalées de tension - Troubles neurologiques (msdmanuals.com)
Le diagnostic de céphalée tensionnelle repose sur une symptomatologie caractéristique et sur la normalité de l'examen clinique, y compris l'examen neurologique.
- Céphalée inhabituelle aiguë et chronique chez l'adulte et l' ... (cen-neurologie.fr)
Le diagnostic repose sur le dosage du taux de carboxyhémoglobine (HbCO) qui détermine la gravité (si > 30 % : céphalée sévère avec confusion puis coma). Un ...

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
