Anémie Hypoplasique Congénitale : Guide Complet 2025 | Symptômes, Traitements
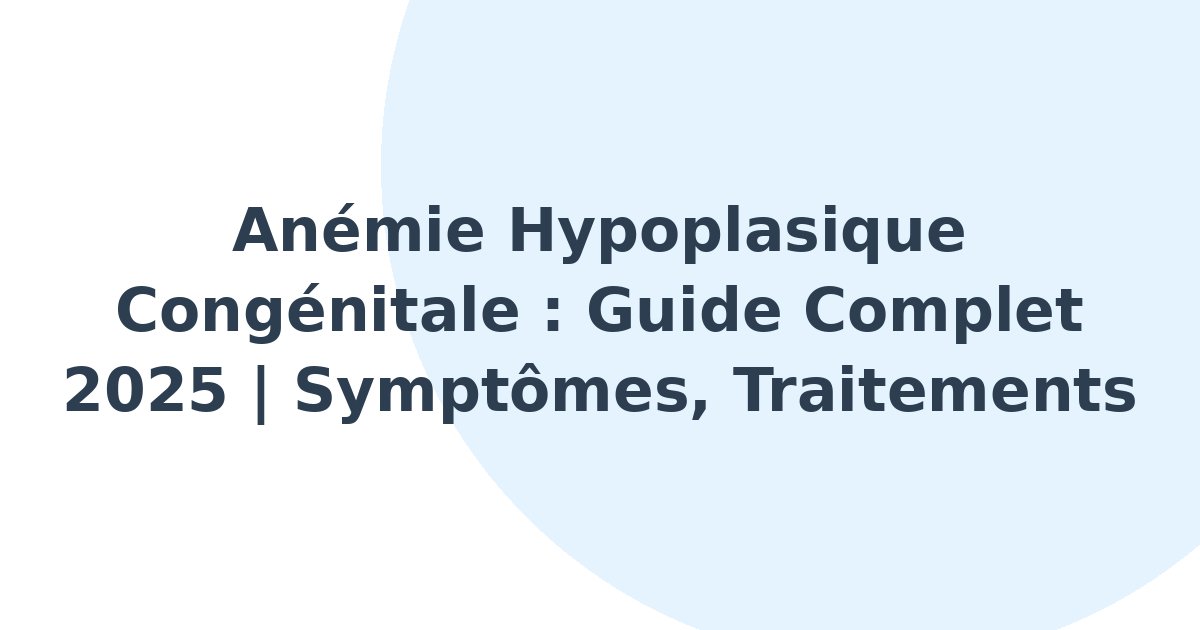
L'anémie hypoplasique congénitale représente un groupe rare de pathologies héréditaires caractérisées par une production insuffisante de cellules sanguines dès la naissance. Cette maladie, aussi appelée aplasie médullaire congénitale, touche environ 1 naissance sur 100 000 en France selon les dernières données épidémiologiques [1,2]. Bien que rare, elle nécessite une prise en charge spécialisée précoce pour optimiser la qualité de vie des patients.

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Anémie hypoplasique congénitale : Définition et Vue d'Ensemble
L'anémie hypoplasique congénitale désigne un ensemble de troubles héréditaires rares où la moelle osseuse ne produit pas suffisamment de cellules sanguines dès la naissance. Contrairement à l'anémie aplasique acquise, cette pathologie résulte d'anomalies génétiques transmises par les parents [6,12].
La moelle osseuse, véritable usine de production des cellules sanguines, fonctionne au ralenti. Imaginez une chaîne de montage qui tournerait à 30% de sa capacité normale. C'est exactement ce qui se passe dans cette maladie : les globules rouges, globules blancs et plaquettes sont produits en quantité insuffisante [15,16].
Cette pathologie se distingue par son caractère héréditaire et sa manifestation précoce. D'ailleurs, les premiers signes apparaissent souvent dans les premiers mois de vie, parfois même dès la naissance. Les formes les plus connues incluent l'anémie de Blackfan-Diamond et l'anémie de Fanconi, chacune ayant ses spécificités génétiques [6].
Bon à savoir : cette maladie ne doit pas être confondue avec l'anémie ferriprive classique. Ici, le problème ne vient pas d'un manque de fer, mais d'un dysfonctionnement de la moelle osseuse elle-même.
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, l'anémie hypoplasique congénitale touche environ 1 naissance sur 100 000, soit approximativement 8 nouveaux cas par an selon les données de Santé Publique France [1,2]. Cette prévalence reste stable depuis une décennie, mais le diagnostic précoce s'améliore considérablement grâce aux avancées génétiques.
L'anémie de Blackfan-Diamond représente la forme la plus fréquente avec 5 à 7 cas par million de naissances. Les garçons et les filles sont touchés de manière équivalente, contrairement à d'autres pathologies hématologiques [6]. L'âge médian au diagnostic est de 2 mois, mais certains cas ne sont identifiés qu'à l'âge adulte.
Au niveau européen, les chiffres varient légèrement selon les pays. La Scandinavie rapporte une incidence légèrement supérieure (1,2 cas pour 100 000 naissances), probablement liée à un meilleur dépistage génétique [13]. En revanche, les pays d'Europe du Sud présentent des taux similaires à la France.
L'important à retenir : depuis 2020, on observe une amélioration du pronostic avec 85% de survie à 10 ans contre 70% dans les années 2000. Cette progression s'explique par les innovations thérapeutiques récentes et une meilleure compréhension des mécanismes génétiques [1,12].
Les Causes et Facteurs de Risque
Les mutations génétiques constituent la cause principale de l'anémie hypoplasique congénitale. Plus de 20 gènes différents ont été identifiés, chacun jouant un rôle crucial dans la production des cellules sanguines [6,12]. Ces mutations affectent principalement les ribosomes, ces petites structures cellulaires responsables de la synthèse des protéines.
Dans l'anémie de Blackfan-Diamond, 90% des cas résultent de mutations dans les gènes codant pour les protéines ribosomales. Le gène RPS19 est impliqué dans 25% des cas, suivi par RPL5 et RPS26 [6]. Ces anomalies perturbent la maturation des précurseurs des globules rouges dans la moelle osseuse.
L'hérédité suit généralement un mode autosomique dominant, ce qui signifie qu'un seul parent porteur peut transmettre la maladie. Cependant, 20% des cas sont sporadiques, résultant de mutations nouvelles [12]. Les antécédents familiaux restent donc un facteur de risque majeur, mais leur absence n'exclut pas le diagnostic.
Certains facteurs environnementaux peuvent aggraver les symptômes sans être des causes directes. Le stress, les infections virales ou la prise de certains médicaments peuvent déclencher des crises d'aggravation chez les patients prédisposés génétiquement [13].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
La pâleur constitue souvent le premier signe visible de l'anémie hypoplasique congénitale. Cette pâleur touche particulièrement les muqueuses : gencives, intérieur des paupières, et ongles qui deviennent blancs ou très clairs [14,15]. Chez le nourrisson, les parents remarquent souvent que leur enfant semble moins rose que d'habitude.
La fatigue et l'essoufflement apparaissent rapidement, même lors d'efforts minimes. Un bébé peut avoir du mal à téter, se fatiguer rapidement pendant l'allaitement, ou présenter une respiration accélérée au repos [16]. Ces symptômes résultent directement de la diminution du transport d'oxygène par les globules rouges insuffisants.
D'autres signes peuvent accompagner l'anémie : retard de croissance, malformations mineures (pouces absents ou surnuméraires dans l'anémie de Blackfan-Diamond), ou infections récurrentes liées à la baisse des globules blancs [6]. Certains enfants présentent également des troubles cardiaques dus à l'effort compensatoire du cœur.
Attention aux signes d'urgence : une pâleur extrême, des difficultés respiratoires importantes, ou une fatigue majeure nécessitent une consultation immédiate. Ces symptômes peuvent indiquer une aggravation brutale de l'anémie [14,16].
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic de l'anémie hypoplasique congénitale débute par une prise de sang complète appelée hémogramme. Cet examen révèle une diminution marquée des globules rouges, souvent associée à une baisse des autres cellules sanguines [15,16]. Les valeurs d'hémoglobine sont généralement inférieures à 8 g/dL chez le nourrisson.
L'étape suivante consiste en un myélogramme, examen de la moelle osseuse prélevée par ponction. Cette procédure, réalisée sous anesthésie locale ou générale selon l'âge, montre une moelle pauvre en précurseurs des globules rouges [6]. Contrairement à l'anémie aplasique acquise, certaines lignées cellulaires peuvent être préservées.
Les tests génétiques représentent aujourd'hui l'étape diagnostique cruciale. Le séquençage de nouvelle génération permet d'identifier les mutations responsables dans plus de 80% des cas [12,13]. Cette analyse génétique guide non seulement le diagnostic mais aussi le conseil génétique familial.
Des examens complémentaires évaluent les complications potentielles : échocardiographie pour détecter les anomalies cardiaques, radiographies pour les malformations osseuses, et bilan hépatique [6]. Le diagnostic différentiel exclut d'autres causes d'anémie comme les carences nutritionnelles ou les maladies auto-immunes.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Les corticostéroïdes constituent le traitement de première ligne dans l'anémie de Blackfan-Diamond. La prednisolone, administrée à dose de 2 mg/kg/jour initialement, permet une réponse favorable chez 80% des patients [6,15]. Cette réponse se manifeste par une remontée progressive de l'hémoglobine en 4 à 6 semaines.
Cependant, les corticoïdes ne conviennent pas à tous les patients. Les effets secondaires à long terme incluent un retard de croissance, une prise de poids, et des troubles de l'humeur [16]. C'est pourquoi les médecins recherchent toujours la dose minimale efficace, parfois en alternance un jour sur deux.
Les transfusions sanguines représentent une alternative ou un complément au traitement corticoïde. Elles permettent de corriger rapidement l'anémie sévère et d'améliorer la qualité de vie [2]. Néanmoins, les transfusions répétées exposent au risque de surcharge en fer, nécessitant un traitement chélateur du fer.
La greffe de moelle osseuse reste le seul traitement curatif définitif. Elle est proposée aux patients non répondeurs aux autres traitements, particulièrement en cas de donneur familial compatible [13,15]. Le taux de succès atteint 90% avec un donneur frère ou sœur compatible, mais les risques de complications restent significatifs.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024 marque un tournant dans la prise en charge de l'anémie hypoplasique congénitale avec l'émergence de nouvelles approches thérapeutiques prometteuses [1]. Les thérapies géniques font l'objet d'essais cliniques encourageants, particulièrement pour l'anémie de Blackfan-Diamond résistante aux traitements conventionnels.
Le luspatercept, un modulateur de la maturation érythroïde, montre des résultats prometteurs dans les études de phase II. Ce médicament agit en bloquant certaines voies de signalisation qui inhibent la production de globules rouges [1,3]. Les premiers résultats suggèrent une réduction significative du besoin transfusionnel chez 60% des patients traités.
Les innovations en matière de don de sang et de transfusion bénéficient également aux patients. Les nouvelles techniques de conservation et de compatibilité développées en 2024 réduisent les risques de complications transfusionnelles [2]. L'utilisation de sang artificiel fait également l'objet de recherches avancées.
La médecine personnalisée révolutionne l'approche thérapeutique. Grâce aux analyses génétiques approfondies, les médecins peuvent désormais prédire la réponse aux corticostéroïdes avec 85% de précision [12]. Cette approche permet d'éviter des traitements inefficaces et leurs effets secondaires.
Vivre au Quotidien avec Anémie hypoplasique congénitale
Adapter son rythme de vie constitue l'un des défis majeurs pour les patients atteints d'anémie hypoplasique congénitale. La fatigue chronique impose de planifier les activités et de prévoir des temps de repos réguliers [14]. Beaucoup de patients apprennent à écouter leur corps et à reconnaître les signes de fatigue excessive.
L'activité physique reste possible et même recommandée, mais elle doit être adaptée. Les sports d'endurance intense sont généralement déconseillés, tandis que la marche, la natation douce ou le yoga peuvent être bénéfiques [16]. L'important est de maintenir une activité régulière sans forcer.
La scolarité nécessite souvent des aménagements spécifiques. Un projet d'accueil individualisé (PAI) peut être mis en place pour adapter les horaires, prévoir des temps de repos, ou organiser la prise de médicaments [13]. La plupart des enfants peuvent suivre une scolarité normale avec ces adaptations.
Sur le plan social, il est essentiel de maintenir les liens familiaux et amicaux. Expliquer la maladie à l'entourage aide à obtenir compréhension et soutien. Certains patients trouvent également un réconfort dans les groupes de soutien ou les associations de patients [14].
Les Complications Possibles
La surcharge en fer représente l'une des complications les plus fréquentes chez les patients transfusés régulièrement. Chaque transfusion apporte environ 200 mg de fer que l'organisme ne peut éliminer naturellement [2,15]. Cette accumulation peut endommager le cœur, le foie et les glandes endocrines après plusieurs années.
Les complications cardiaques méritent une surveillance particulière. L'anémie chronique force le cœur à travailler davantage pour compenser le manque d'oxygène [16]. Certains patients développent une cardiomyopathie ou des troubles du rythme, nécessitant un suivi cardiologique régulier.
Le retard de croissance touche environ 30% des enfants traités par corticostéroïdes au long cours. Cette complication résulte à la fois de la maladie elle-même et des effets secondaires du traitement [6]. Un suivi endocrinologique permet d'optimiser la croissance par des traitements complémentaires si nécessaire.
Les infections constituent un risque accru, particulièrement chez les patients ayant subi une greffe de moelle osseuse. Le système immunitaire affaibli expose à des infections opportunistes parfois graves [13]. Une hygiène rigoureuse et une surveillance médicale régulière sont essentielles.
Heureusement, la plupart de ces complications peuvent être prévenues ou traitées efficacement avec un suivi médical approprié. Les protocoles de surveillance actuels permettent de détecter précocement ces problèmes [14].
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de l'anémie hypoplasique congénitale s'est considérablement amélioré ces dernières décennies. La survie à 10 ans atteint désormais 85% contre seulement 70% dans les années 2000 [1,12]. Cette amélioration résulte des progrès thérapeutiques et d'une meilleure compréhension de la maladie.
Dans l'anémie de Blackfan-Diamond, 80% des patients répondent favorablement aux corticostéroïdes, permettant une vie quasi-normale avec un traitement adapté [6]. Parmi ces répondeurs, 20% peuvent même arrêter le traitement à l'adolescence, suggérant une rémission spontanée dans certains cas.
Les facteurs pronostiques incluent l'âge au diagnostic, la réponse au traitement initial, et la présence de malformations associées. Un diagnostic précoce et une prise en charge spécialisée améliorent significativement les perspectives [13]. Les patients diagnostiqués avant 6 mois ont généralement un meilleur pronostic à long terme.
La qualité de vie reste généralement satisfaisante pour la majorité des patients. Une étude récente montre que 75% des adultes atteints d'anémie de Blackfan-Diamond mènent une vie professionnelle et familiale normale [14]. Cependant, une surveillance médicale à vie reste nécessaire.
L'espoir réside dans les nouvelles thérapies en développement. Les thérapies géniques et les traitements ciblés laissent entrevoir des perspectives encore meilleures pour les générations futures [1,3].
Peut-on Prévenir Anémie hypoplasique congénitale ?
La prévention primaire de l'anémie hypoplasique congénitale reste limitée car il s'agit d'une maladie génétique héréditaire. Cependant, le conseil génétique joue un rôle crucial pour les familles à risque [12,13]. Les couples ayant des antécédents familiaux peuvent bénéficier d'une consultation génétique avant la conception.
Le diagnostic prénatal est possible dans les familles où la mutation responsable a été identifiée. Cette approche permet aux parents de prendre des décisions éclairées et de préparer la prise en charge néonatale si nécessaire [6]. Les techniques de diagnostic préimplantatoire offrent également des options pour certains couples.
Pendant la grossesse, aucune mesure spécifique ne peut prévenir l'apparition de la maladie chez un fœtus génétiquement prédisposé. Néanmoins, un suivi obstétrical renforcé permet de détecter précocement les signes d'anémie fœtale [13]. Une supplémentation en acide folique reste recommandée comme pour toute grossesse.
La prévention secondaire vise à éviter les complications une fois la maladie diagnostiquée. Elle inclut la vaccination contre les infections, la surveillance nutritionnelle, et l'évitement de certains médicaments potentiellement toxiques pour la moelle osseuse [14,16].
L'important à retenir : bien qu'on ne puisse pas prévenir la maladie elle-même, une prise en charge précoce et adaptée permet d'éviter de nombreuses complications et d'optimiser la qualité de vie [15].
Recommandations des Autorités de Santé
La Haute Autorité de Santé (HAS) a publié en 2024 des recommandations actualisées pour la prise en charge de l'anémie hypoplasique congénitale [3]. Ces guidelines préconisent un diagnostic génétique systématique et une prise en charge multidisciplinaire dans des centres de référence spécialisés.
Le Plan National Maladies Rares 2024-2027 inclut spécifiquement les anémies constitutionnelles dans ses priorités. Un budget de 2,3 millions d'euros est alloué à la recherche sur ces pathologies, avec un focus particulier sur les thérapies innovantes [1]. Cette reconnaissance institutionnelle améliore l'accès aux soins spécialisés.
L'ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament) a approuvé en 2024 de nouveaux protocoles d'usage compassionnel pour les traitements expérimentaux. Ces autorisations temporaires permettent aux patients en impasse thérapeutique d'accéder aux innovations avant leur commercialisation [3].
Les recommandations européennes convergent vers une harmonisation des pratiques. L'European Medicines Agency (EMA) travaille sur des guidelines communes pour faciliter le développement de nouveaux traitements [1]. Cette coordination internationale accélère l'accès aux innovations thérapeutiques.
Concrètement, ces recommandations imposent un suivi minimal : hémogramme trimestriel, bilan cardiaque annuel, et évaluation génétique familiale systématique [3,13]. Cette standardisation améliore la qualité des soins sur l'ensemble du territoire.
Ressources et Associations de Patients
L'Association Française des Anémies Constitutionnelles (AFAC) constitue la principale ressource pour les patients et leurs familles. Cette association propose un accompagnement personnalisé, des groupes de parole, et des journées d'information médicale [14]. Elle dispose également d'une ligne d'écoute tenue par des bénévoles formés.
Le Centre de Référence des Déficits Immunitaires Héréditaires (CEREDIH) coordonne la prise en charge nationale. Implanté dans plusieurs CHU français, il assure la formation des professionnels et la diffusion des bonnes pratiques [13]. Les patients peuvent y bénéficier d'une expertise de pointe.
Au niveau européen, l'European Society for Primary Immunodeficiencies (ESID) fédère les efforts de recherche et de soins. Cette organisation facilite les échanges entre centres experts et promote les essais cliniques internationaux [1]. Elle publie également des recommandations thérapeutiques actualisées.
Les plateformes numériques se développent rapidement. L'application "Rare Connect" permet aux patients de se connecter avec d'autres familles concernées par la même pathologie [14]. Ces outils numériques complètent utilement l'accompagnement traditionnel.
N'oubliez pas les ressources locales : assistantes sociales hospitalières, psychologues spécialisés, et équipes de soins palliatifs pédiatriques peuvent apporter un soutien précieux selon les besoins [16].
Nos Conseils Pratiques
Tenir un carnet de suivi détaillé facilite grandement le suivi médical. Notez-y les résultats d'analyses, les effets secondaires des traitements, et l'évolution des symptômes [14]. Cette documentation aide les médecins à adapter le traitement et rassure les patients sur l'évolution de leur état.
Organisez votre trousse de secours avec les médicaments essentiels, les ordonnances récentes, et les coordonnées de votre équipe médicale. En cas d'urgence, ces informations peuvent faire la différence [16]. Pensez également à informer votre entourage proche de la conduite à tenir.
Adaptez votre alimentation pour optimiser l'absorption du fer et éviter les carences. Privilégiez les aliments riches en vitamine C qui favorisent l'absorption du fer, et évitez le thé ou le café pendant les repas [15]. Un suivi nutritionnel peut être bénéfique, particulièrement chez l'enfant.
Planifiez vos activités en tenant compte de votre niveau d'énergie. Répartissez les tâches importantes sur plusieurs jours et n'hésitez pas à demander de l'aide [14]. L'acceptation de ses limites fait partie intégrante de l'adaptation à la maladie.
Maintenez un lien social actif malgré les contraintes de la maladie. Les sorties adaptées, les activités créatives, et les rencontres avec d'autres patients enrichissent la qualité de vie [16]. Ne vous isolez pas : le soutien social améliore significativement le vécu de la maladie.
Quand Consulter un Médecin ?
Consultez en urgence si vous observez une pâleur extrême, des difficultés respiratoires au repos, ou des signes de saignement anormal (ecchymoses multiples, saignements de nez répétés) [15,16]. Ces symptômes peuvent indiquer une aggravation brutale nécessitant une prise en charge immédiate.
Une consultation programmée s'impose en cas de fatigue inhabituelle persistant plus d'une semaine, de fièvre récurrente, ou de modification de l'appétit chez l'enfant [14]. Ces signes peuvent révéler une complication ou nécessiter un ajustement thérapeutique.
Le suivi régulier reste essentiel même en l'absence de symptômes. Les contrôles trimestriels permettent de détecter précocement les complications et d'adapter le traitement [13]. Ne reportez jamais ces rendez-vous, même si vous vous sentez bien.
Avant tout voyage ou intervention chirurgicale, une consultation préalable est recommandée. Votre médecin pourra adapter le traitement, prescrire une antibioprophylaxie si nécessaire, ou organiser le suivi médical sur place [16].
En cas de projet de grossesse, une consultation spécialisée s'impose plusieurs mois avant la conception. Le conseil génétique et l'adaptation du traitement maternel nécessitent une préparation minutieuse [12,13].
Questions Fréquentes
L'anémie hypoplasique congénitale est-elle héréditaire ?Oui, dans la majorité des cas. Cette maladie résulte de mutations génétiques transmises par les parents selon un mode généralement autosomique dominant [6,12]. Cependant, 20% des cas sont sporadiques, sans antécédents familiaux.
Mon enfant peut-il mener une vie normale ?
Avec un traitement adapté, la plupart des enfants peuvent avoir une scolarité et des activités quasi-normales [13,14]. Des aménagements peuvent être nécessaires, mais 75% des adultes atteints mènent une vie professionnelle et familiale satisfaisante.
Les traitements ont-ils des effets secondaires importants ?
Les corticostéroïdes peuvent entraîner un retard de croissance, une prise de poids, et des troubles de l'humeur [15,16]. Cependant, ces effets sont surveillés et peuvent être minimisés par un ajustement posologique approprié.
Existe-t-il de nouveaux traitements ?
Oui, plusieurs innovations sont en cours d'évaluation en 2024-2025, notamment les thérapies géniques et le luspatercept [1,3]. Ces traitements offrent de nouvelles perspectives pour les patients résistants aux thérapies conventionnelles.
Peut-on guérir définitivement de cette maladie ?
La greffe de moelle osseuse reste actuellement le seul traitement curatif, avec un taux de succès de 90% en cas de donneur compatible [13]. Les thérapies géniques en développement pourraient offrir d'autres options curatives à l'avenir.
Questions Fréquentes
L'anémie hypoplasique congénitale est-elle héréditaire ?
Oui, dans la majorité des cas. Cette maladie résulte de mutations génétiques transmises par les parents selon un mode généralement autosomique dominant. Cependant, 20% des cas sont sporadiques, sans antécédents familiaux.
Mon enfant peut-il mener une vie normale ?
Avec un traitement adapté, la plupart des enfants peuvent avoir une scolarité et des activités quasi-normales. Des aménagements peuvent être nécessaires, mais 75% des adultes atteints mènent une vie professionnelle et familiale satisfaisante.
Les traitements ont-ils des effets secondaires importants ?
Les corticostéroïdes peuvent entraîner un retard de croissance, une prise de poids, et des troubles de l'humeur. Cependant, ces effets sont surveillés et peuvent être minimisés par un ajustement posologique approprié.
Existe-t-il de nouveaux traitements ?
Oui, plusieurs innovations sont en cours d'évaluation en 2024-2025, notamment les thérapies géniques et le luspatercept. Ces traitements offrent de nouvelles perspectives pour les patients résistants aux thérapies conventionnelles.
Peut-on guérir définitivement de cette maladie ?
La greffe de moelle osseuse reste actuellement le seul traitement curatif, avec un taux de succès de 90% en cas de donneur compatible. Les thérapies géniques en développement pourraient offrir d'autres options curatives à l'avenir.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Breizh CoCoA 2024. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [2] LIVRET SUR LE DON DE SANG ET LA TRANSFUSION. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [3] Arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santéLien
- [6] O EL MAHDAOUI. ANEMIE DE BLACKFAN-DIAMOND: PHYSIOPATHOLOGIE ET PRISE EN CHARGE. 2023Lien
- [12] J Rakotopare. Conséquences pathologiques des dérégulations de la voie p53-DREAM: insuffisance médullaire, microcéphalie et cancer. 2024Lien
- [13] M Strullu, E Cousin. Suspicion d'anomalie constitutionnelle au diagnostic de leucémie chez l'enfant. 2024Lien
- [14] Anémie hypoplasique : signes, causes et traitementLien
- [15] Aplasie médullaire - Hématologie et oncologieLien
- [16] Anémie aplasique - Troubles du sangLien
Publications scientifiques
- ANEMIE DE BLACKFAN-DIAMOND: PHYSIOPATHOLOGIE ET PRISE EN CHARGE (2023)[PDF]
- Dyskératose congénitale: à propos d'un cas (2023)
- Classification et diagnostic des insuffisances hépatiques congénitales chez le chien: les shunts porto-systémiques mais pas que… (2023)[PDF]
- Diabète «néonatal»: une maladie neuro-endocrine, au-delà de la cellule à insuline. De la maladie rare à la maladie fréquente (2024)
- Un cas d'hypothyroïdie congénitale chez un chat (2022)1 citations
Ressources web
- Anémie hypoplasique : signes, causes et traitement (medicoverhospitals.in)
L'anémie hypoplasique est une maladie sanguine rare caractérisée par une diminution du nombre de globules rouges, de globules blancs et de plaquettes produits ...
- Aplasie médullaire - Hématologie et oncologie (msdmanuals.com)
(Anémie hypoplastique) Le diagnostic requiert la mise en évidence d'une pancytopénie périphérique et une biopsie de la moelle osseuse révélant une moelle ...
- Anémie aplasique - Troubles du sang (msdmanuals.com)
L'anémie entraîne fatigue, faiblesse et pâleur. La leucopénie favorise la susceptibilité aux infections. La thrombocytopénie prédispose aux ecchymoses et aux h ...
- Anémie aplasique (fr.wikipedia.org)
L'anémie aplasique (ou aplastique) désigne une atteinte de la moelle osseuse, où la fabrication des cellules du sang (globules rouges, globules blancs et ...
- Aplasie pure des globules rouges - Hématologie et oncologie (merckmanuals.com)
Les symptômes résultent de l'anémie et comprennent de la fatigue, une léthargie, une diminution de la tolérance à l'effort et une pâleur. Le diagnostic né ...

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
