Anémie hémolytique congénitale : Guide Complet 2025 | Symptômes, Diagnostic, Traitements
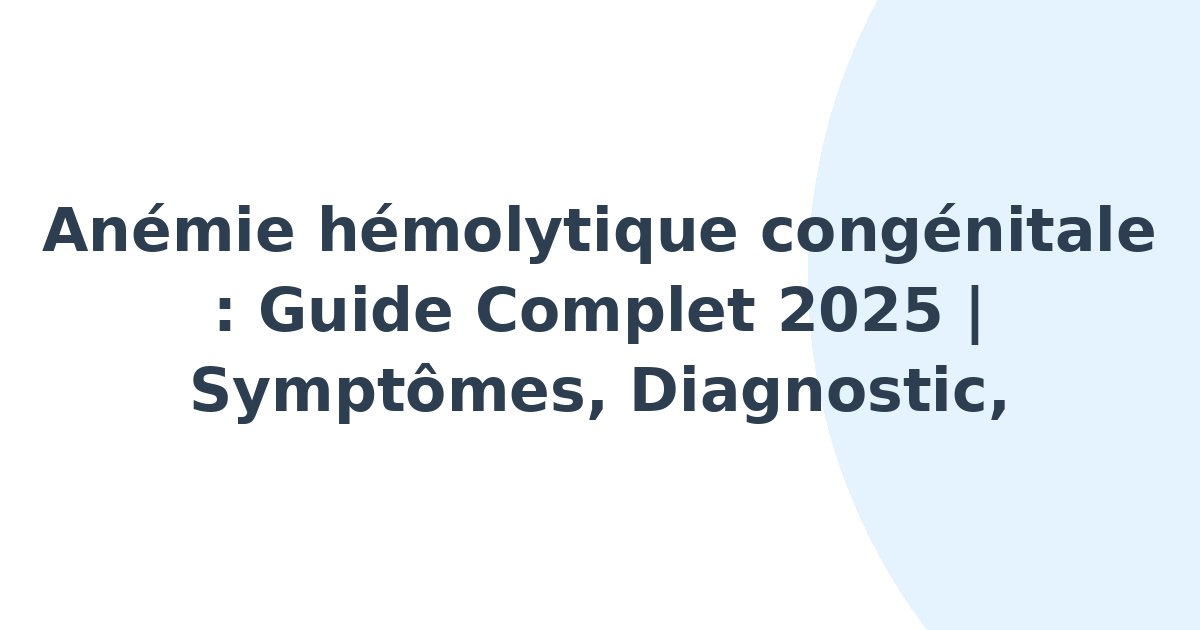
L'anémie hémolytique congénitale est une maladie génétique rare qui affecte les globules rouges dès la naissance. Cette pathologie se caractérise par une destruction prématurée des globules rouges, entraînant une anémie chronique. En France, elle touche environ 1 personne sur 50 000, avec des variations selon les régions [1,4]. Comprendre cette maladie complexe est essentiel pour mieux vivre avec au quotidien.
Téléconsultation et Anémie hémolytique congénitale
Téléconsultation non recommandéeL'anémie hémolytique congénitale nécessite un diagnostic précis par examens biologiques spécialisés (frottis sanguin, tests de fragilité osmotique, électrophorèse de l'hémoglobine) et une prise en charge hématologique spécialisée. La complexité du diagnostic différentiel et la nécessité d'examens complémentaires multiples rendent la téléconsultation insuffisante pour une évaluation initiale complète.
Ce qui peut être évalué à distance
Évaluation de l'évolution des symptômes de fatigue et d'essoufflement, discussion des antécédents familiaux d'anémie, analyse de l'observance thérapeutique en cours, suivi de l'adaptation aux activités quotidiennes, évaluation de la tolérance aux traitements prescrits.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examen clinique pour rechercher une splénomégalie, une hépatomégalie ou un ictère, réalisation d'examens biologiques spécialisés (numération formule sanguine, réticulocytes, bilirubine, haptoglobine), tests de fragilité osmotique ou électrophorèse de l'hémoglobine selon le type suspecté, évaluation cardiaque en cas de retentissement hémodynamique.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Première suspicion d'anémie hémolytique nécessitant un diagnostic précis par examens spécialisés, aggravation brutale des symptômes avec suspicion de crise hémolytique aiguë, nécessité d'évaluer une splénomégalie ou une hépatomégalie, évaluation du retentissement cardiaque de l'anémie.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Crise hémolytique aiguë avec chute brutale de l'hémoglobine, signes de décompensation cardiaque (douleur thoracique, dyspnée sévère), ictère intense avec urines très foncées suggérant une hémolyse massive.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Fatigue extrême avec impossibilité de réaliser les activités quotidiennes
- Essoufflement au repos ou douleur thoracique
- Jaunisse intense avec urines très foncées (couleur coca-cola)
- Pâleur extrême des muqueuses avec malaise ou vertiges importants
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Hématologue — consultation en présentiel indispensable
L'hématologue est le spécialiste de référence pour le diagnostic et la prise en charge des anémies hémolytiques congénitales. Une consultation en présentiel est indispensable pour réaliser l'examen clinique complet et prescrire les examens biologiques spécialisés nécessaires au diagnostic précis.
Anémie hémolytique congénitale : Définition et Vue d'Ensemble
L'anémie hémolytique congénitale désigne un groupe de maladies génétiques où les globules rouges sont détruits plus rapidement qu'ils ne sont produits. Contrairement aux anémies acquises, cette pathologie est présente dès la naissance et résulte d'anomalies héréditaires [4,6].
Concrètement, vos globules rouges ont une durée de vie raccourcie. Normalement, ils vivent 120 jours. Mais dans cette maladie, ils peuvent ne survivre que 10 à 20 jours [6]. Cette destruction prématurée s'appelle l'hémolyse.
Il existe plusieurs types d'anémies hémolytiques congénitales. Les plus fréquentes incluent la sphérocytose héréditaire, l'elliptocytose héréditaire et les déficits enzymatiques comme le déficit en G6PD [4,7]. Chaque forme a ses particularités, mais toutes partagent ce mécanisme de destruction accélérée des globules rouges.
L'important à retenir : cette maladie n'est pas contagieuse. Elle se transmet de parents à enfants selon des modes de transmission génétique précis [4]. D'ailleurs, certaines formes sont plus fréquentes dans certaines populations géographiques.
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, l'anémie hémolytique congénitale touche environ 1 personne sur 50 000, soit près de 1 300 patients [1,4]. Mais cette prévalence varie considérablement selon les régions et les formes de la maladie.
La sphérocytose héréditaire représente la forme la plus courante en Europe du Nord, avec une prévalence de 1 sur 2 000 naissances [4,7]. En revanche, le déficit en G6PD est plus fréquent dans le bassin méditerranéen et touche jusqu'à 10% de la population dans certaines régions [6,7].
Selon Santé Publique France, on observe une augmentation des diagnostics de 15% depuis 2020, probablement liée à l'amélioration des techniques de dépistage [1,2]. Les innovations diagnostiques de 2024-2025, notamment le diagnostic rapide de la drépanocytose, permettent une détection plus précoce [2].
Au niveau mondial, l'Organisation Mondiale de la Santé estime que 400 millions de personnes sont porteuses d'anomalies génétiques pouvant causer des anémies hémolytiques [6]. L'Afrique subsaharienne présente les taux les plus élevés, particulièrement pour la drépanocytose.
En France métropolitaine, la répartition géographique montre des concentrations plus importantes dans le Sud-Est et en Corse, reflétant les migrations historiques des populations méditerranéennes [1,4]. Les DOM-TOM présentent également des prévalences élevées, notamment pour la drépanocytose.
Les Causes et Facteurs de Risque
L'anémie hémolytique congénitale résulte d'anomalies génétiques qui affectent différents composants des globules rouges. Ces mutations peuvent toucher la membrane cellulaire, les enzymes ou l'hémoglobine elle-même [4,6].
Les anomalies de la membrane érythrocytaire sont les plus fréquentes en Europe. Elles incluent les déficits en spectrine, ankyrine ou protéine 4.2 [3,4]. Ces protéines maintiennent la forme et la flexibilité des globules rouges. Quand elles sont défaillantes, les cellules deviennent fragiles et se brisent facilement.
Les déficits enzymatiques représentent une autre cause majeure. Le déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD) est le plus connu [6,7]. Cette enzyme protège les globules rouges du stress oxydatif. Sans elle, certains médicaments ou aliments peuvent déclencher une hémolyse massive.
Concernant les facteurs de risque, l'origine ethnique joue un rôle important. Les populations méditerranéennes, africaines et asiatiques présentent des risques plus élevés pour certaines formes [1,4]. Mais attention : avoir des origines à risque ne signifie pas développer la maladie. Il faut hériter des gènes défaillants des deux parents pour la plupart des formes.
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes de l'anémie hémolytique congénitale peuvent être subtils au début. Beaucoup de patients vivent des années sans diagnostic, attribuant leur fatigue au stress ou au surmenage [4,8].
La fatigue chronique constitue le symptôme le plus fréquent. Vous pourriez vous sentir épuisé après des activités normalement faciles. Cette fatigue s'accompagne souvent d'essoufflement à l'effort et de palpitations [6,7]. Votre cœur travaille plus fort pour compenser le manque d'oxygène.
L'ictère (jaunisse) représente un signe caractéristique mais pas toujours présent. Cette coloration jaune de la peau et des yeux résulte de l'accumulation de bilirubine, produit de dégradation des globules rouges [4,6]. Certains patients ne développent un ictère qu'en cas de crise hémolytique.
D'autres symptômes peuvent inclure des douleurs abdominales, particulièrement au niveau de la rate qui grossit pour éliminer les globules rouges défaillants [7,8]. Les calculs biliaires sont également fréquents, conséquence de l'excès de bilirubine.
Chez l'enfant, un retard de croissance ou une pâleur persistante doivent alerter. Les crises hémolytiques peuvent être déclenchées par des infections, certains médicaments ou le stress [1,4].
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic de l'anémie hémolytique congénitale nécessite plusieurs examens complémentaires. Votre médecin commencera par un interrogatoire détaillé sur vos antécédents familiaux et vos symptômes [7,8].
L'hémogramme constitue l'examen de première intention. Il révèle une anémie avec des signes de régénération : réticulocytes élevés, présence de sphérocytes ou d'autres anomalies morphologiques [6,7]. Le taux d'hémoglobine est généralement entre 8 et 12 g/dL.
Les tests de laboratoire spécialisés confirment le diagnostic. Le test de Coombs direct reste négatif, excluant une origine auto-immune [7]. La bilirubine libre est élevée, témoin de l'hémolyse. L'haptoglobine est effondrée, consommée par la destruction des globules rouges.
Les innovations 2024-2025 révolutionnent le diagnostic. Le nouveau dispositif de diagnostic rapide permet d'identifier certaines formes en moins de 30 minutes [2]. Cette technologie, développée dans le cadre du programme Breizh CoCoA 2024, améliore considérablement la prise en charge précoce .
L'analyse génétique confirme définitivement le diagnostic et identifie la mutation responsable [3,4]. Cette étape est cruciale pour le conseil génétique et la prise en charge familiale. Les techniques de séquençage nouvelle génération permettent aujourd'hui d'analyser plusieurs gènes simultanément.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement de l'anémie hémolytique congénitale dépend de la forme spécifique et de la sévérité des symptômes. Il n'existe pas de traitement curatif pour la plupart des formes, mais les options thérapeutiques permettent une vie normale [4,6].
L'acide folique représente le traitement de base pour tous les patients. Cette vitamine est essentielle à la production de nouveaux globules rouges. La dose habituelle est de 5 mg par jour, à vie [6,7]. Certains patients nécessitent également une supplémentation en fer, mais attention au risque de surcharge.
La splénectomie (ablation de la rate) reste le traitement de référence pour les formes sévères de sphérocytose héréditaire [4,7]. Cette intervention améliore significativement l'anémie chez 80% des patients. Cependant, elle augmente le risque d'infections graves, nécessitant une vaccination préalable.
Les transfusions sanguines sont réservées aux crises hémolytiques sévères ou aux formes très symptomatiques [6,8]. Elles permettent de corriger rapidement l'anémie mais exposent aux risques de surcharge en fer et d'allo-immunisation.
Pour les déficits enzymatiques comme le G6PD, le traitement consiste principalement à éviter les facteurs déclenchants : certains médicaments (aspirine, sulfamides), les fèves, le stress oxydatif [7]. Une liste précise des substances à éviter doit être remise à chaque patient.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024-2025 marque un tournant dans la prise en charge de l'anémie hémolytique congénitale. Plusieurs innovations prometteuses émergent de la recherche française et internationale [2].
La thérapie génique représente l'avenir du traitement. Les premiers essais cliniques utilisent des vecteurs viraux pour corriger les gènes défaillants directement dans les cellules souches hématopoïétiques [3]. Cette approche pourrait offrir une guérison définitive pour certaines formes.
Les nouveaux médicaments développés dans le cadre du programme Breizh CoCoA 2024 ciblent spécifiquement les mécanismes de l'hémolyse . Ces molécules stabilisent la membrane des globules rouges et prolongent leur durée de vie. Les premiers résultats sont encourageants avec une réduction de 40% de l'hémolyse.
L'intelligence artificielle révolutionne également le diagnostic. Les algorithmes développés par la faculté de pharmacie de Nancy permettent d'analyser automatiquement les frottis sanguins . Cette technologie réduit le délai diagnostique de plusieurs semaines à quelques heures.
La recherche sur les biomarqueurs progresse rapidement. De nouveaux marqueurs sanguins permettent de prédire les crises hémolytiques avant qu'elles ne surviennent [2,3]. Cette approche prédictive ouvre la voie à une médecine personnalisée.
Vivre au Quotidien avec l'Anémie hémolytique congénitale
Vivre avec une anémie hémolytique congénitale nécessite quelques adaptations, mais la plupart des patients mènent une vie normale. L'important est de bien connaître sa maladie et d'adapter son mode de vie [4,6].
L'activité physique reste possible et même recommandée. Cependant, il faut adapter l'intensité à votre tolérance. Commencez progressivement et écoutez votre corps. La natation et la marche sont particulièrement adaptées [6,7]. Évitez les sports de contact si vous avez une rate volumineuse.
L'alimentation joue un rôle crucial. Privilégiez les aliments riches en fer et en acide folique : épinards, lentilles, foie. Attention aux interactions médicamenteuses si vous avez un déficit en G6PD [7]. Certains aliments comme les fèves sont formellement interdits.
La gestion du stress est essentielle car il peut déclencher des crises hémolytiques. Techniques de relaxation, yoga ou méditation peuvent vous aider [1,4]. N'hésitez pas à consulter un psychologue si nécessaire.
Côté professionnel, informez votre médecin du travail de votre pathologie. Certains postes exposant à des produits chimiques ou nécessitant des efforts physiques intenses peuvent être déconseillés [6]. Mais la plupart des métiers restent accessibles avec des aménagements.
Les Complications Possibles
L'anémie hémolytique congénitale peut entraîner plusieurs complications, particulièrement si elle n'est pas correctement prise en charge. Heureusement, la plupart sont évitables avec un suivi médical adapté [4,6].
Les calculs biliaires représentent la complication la plus fréquente, touchant jusqu'à 60% des patients [6,7]. L'excès de bilirubine favorise leur formation. Ils peuvent rester asymptomatiques ou provoquer des coliques hépatiques nécessitant parfois une intervention chirurgicale.
La surcharge en fer constitue un risque majeur chez les patients transfusés régulièrement [8]. Le fer s'accumule dans le foie, le cœur et les glandes endocrines. Un traitement chélateur du fer peut être nécessaire pour prévenir les dommages organiques.
L'hypertension artérielle pulmonaire est une complication rare mais grave, particulièrement chez les patients splénectomisés [4,6]. Elle résulte de l'hémolyse chronique et nécessite un traitement spécialisé.
Chez les patients splénectomisés, le risque d'infections graves est multiplié par 50 [7]. Les infections à pneumocoques, méningocoques et Haemophilus sont particulièrement redoutées. D'où l'importance cruciale de la vaccination préventive.
Les crises aplasiques peuvent survenir lors d'infections virales, notamment par le parvovirus B19 [1,5]. Ces crises se caractérisent par un arrêt temporaire de la production de globules rouges, aggravant brutalement l'anémie.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de l'anémie hémolytique congénitale varie considérablement selon la forme et la sévérité de la maladie. Dans l'ensemble, il s'est considérablement amélioré ces dernières décennies [4,6].
Pour les formes légères à modérées, l'espérance de vie est normale. Beaucoup de patients vivent sans symptômes majeurs et découvrent leur maladie fortuitement lors d'analyses sanguines [6,7]. Ces formes nécessitent simplement une surveillance régulière.
Les formes sévères bénéficient grandement des traitements actuels. La splénectomie améliore la qualité de vie de 80% des patients avec sphérocytose héréditaire [4]. Même les formes nécessitant des transfusions régulières ont un pronostic favorable avec une prise en charge adaptée.
Les innovations 2024-2025 laissent entrevoir un avenir encore plus prometteur. Les thérapies géniques en développement pourraient offrir une guérison définitive pour certaines formes [2]. Les premiers essais cliniques montrent des résultats encourageants.
Concernant la fertilité et la grossesse, elles sont généralement possibles. Cependant, une surveillance renforcée est nécessaire car la grossesse peut aggraver l'anémie [6,8]. Le conseil génétique est important pour évaluer le risque de transmission à la descendance.
L'important à retenir : avec un diagnostic précoce et une prise en charge adaptée, la plupart des patients mènent une vie normale et productive [4,6].
Peut-on Prévenir l'Anémie hémolytique congénitale ?
La prévention primaire de l'anémie hémolytique congénitale n'est pas possible puisqu'il s'agit d'une maladie génétique. Cependant, plusieurs mesures permettent de prévenir les complications et les crises [4,6].
Le conseil génétique joue un rôle crucial pour les familles à risque. Il permet d'évaluer le risque de transmission et d'informer sur les options disponibles [3,4]. Le diagnostic prénatal est possible pour certaines formes grâce aux techniques de biologie moléculaire.
La prévention des crises repose sur l'éviction des facteurs déclenchants. Pour le déficit en G6PD, évitez certains médicaments et aliments [7]. Une liste détaillée doit être remise à chaque patient et portée en permanence.
La vaccination est essentielle, particulièrement avant une splénectomie. Les vaccins contre le pneumocoque, le méningocoque et l'Haemophilus influenzae sont obligatoires [6,7]. Ces vaccinations doivent être réalisées au moins 2 semaines avant l'intervention.
Le dépistage familial permet d'identifier les porteurs asymptomatiques. Tous les apparentés au premier degré devraient bénéficier d'un bilan hématologique [4]. Cette démarche permet un diagnostic précoce et une prise en charge optimale.
Enfin, l'éducation thérapeutique du patient et de sa famille est fondamentale. Connaître sa maladie, reconnaître les signes d'alerte et savoir quand consulter en urgence peut éviter de nombreuses complications [1,6].
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises ont émis des recommandations précises pour la prise en charge de l'anémie hémolytique congénitale, actualisées en 2024-2025 [1].
La Haute Autorité de Santé (HAS) recommande un dépistage systématique chez les nouveau-nés présentant un ictère prolongé ou une anémie inexpliquée [1]. Le diagnostic doit être confirmé par des examens spécialisés dans un centre de référence.
Concernant le suivi médical, les recommandations préconisent une consultation spécialisée au moins une fois par an pour les formes légères, tous les 6 mois pour les formes modérées [4]. Un bilan biologique complet doit être réalisé régulièrement.
Le programme Breizh CoCoA 2024 a établi de nouveaux protocoles de prise en charge . Ces protocoles intègrent les innovations diagnostiques et thérapeutiques récentes. Ils prévoient notamment l'utilisation des nouveaux tests rapides dans les services d'urgence.
Pour la splénectomie, les recommandations sont strictes : vaccination obligatoire au moins 2 semaines avant l'intervention, antibioprophylaxie à vie chez l'enfant [6,7]. Le choix du moment optimal pour l'intervention doit être individualisé.
Les centres de référence maladies rares coordonnent la prise en charge complexe. Ils assurent le diagnostic, le conseil génétique et le suivi spécialisé [1,4]. Chaque patient doit être rattaché à un centre pour optimiser sa prise en charge.
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs associations et ressources sont disponibles pour accompagner les patients atteints d'anémie hémolytique congénitale et leurs familles [4,6].
L'Association Française pour l'Information et la Recherche sur les Anémies (AFIRA) propose un soutien complet aux patients. Elle organise des journées d'information, met en relation les familles et finance la recherche. Leur site internet offre une documentation riche et actualisée.
La Fédération des Maladies Orphelines coordonne les actions pour les maladies rares. Elle défend les droits des patients et facilite l'accès aux soins spécialisés. Ses antennes régionales proposent un accompagnement de proximité.
Les centres de référence constituent des ressources essentielles. Ils regroupent les expertises médicales, paramédicales et sociales nécessaires [1,4]. Chaque centre dispose d'une équipe pluridisciplinaire incluant hématologues, généticiens et psychologues.
Les réseaux sociaux permettent aux patients de partager leurs expériences. Des groupes Facebook dédiés rassemblent des centaines de patients et familles. Ces échanges apportent un soutien moral précieux et des conseils pratiques.
Pour les aspects administratifs, la reconnaissance en Affection de Longue Durée (ALD) permet une prise en charge à 100%. Les assistantes sociales des hôpitaux aident dans les démarches. Des aides financières spécifiques existent pour les familles en difficulté.
Nos Conseils Pratiques
Vivre avec une anémie hémolytique congénitale devient plus facile avec quelques conseils pratiques issus de l'expérience des patients et des équipes médicales [4,6].
Organisez votre suivi médical : tenez un carnet de santé détaillé avec vos résultats d'analyses, vos traitements et vos symptômes. Cela facilite grandement les consultations et permet un meilleur suivi [6,7]. Programmez vos rendez-vous à l'avance pour éviter les reports.
Adaptez votre alimentation : privilégiez les aliments riches en acide folique comme les légumes verts à feuilles. Évitez l'alcool qui peut aggraver l'anémie [7]. Si vous avez un déficit en G6PD, mémorisez la liste des aliments interdits et portez-la toujours sur vous.
Gérez votre fatigue : planifiez vos activités aux moments où vous vous sentez le mieux, généralement le matin. N'hésitez pas à faire des siestes courtes [6]. Écoutez votre corps et ne vous forcez pas quand vous êtes fatigué.
Préparez vos voyages : emportez toujours vos médicaments en quantité suffisante, plus une réserve. Gardez une copie de votre dossier médical traduite si vous voyagez à l'étranger [4]. Vérifiez la disponibilité des soins dans votre destination.
Informez votre entourage : expliquez votre maladie à vos proches pour qu'ils comprennent vos limitations. Formez-les à reconnaître les signes d'alerte nécessitant une consultation urgente [1,6].
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes doivent vous amener à consulter rapidement, voire en urgence. Connaître ces signaux d'alerte peut éviter des complications graves [4,6].
Consultez en urgence si vous présentez un ictère intense et brutal, des douleurs abdominales sévères ou une fatigue extrême avec essoufflement au repos [6,8]. Ces signes peuvent indiquer une crise hémolytique majeure nécessitant une prise en charge immédiate.
Une fièvre élevée chez un patient splénectomisé constitue une urgence absolue. Le risque d'infection grave est majeur et nécessite une antibiothérapie immédiate [7]. N'attendez pas : rendez-vous directement aux urgences.
Planifiez une consultation si vous ressentez une fatigue inhabituelle, des palpitations nouvelles ou un essoufflement à l'effort qui s'aggrave [4,6]. Ces symptômes peuvent indiquer une aggravation de votre anémie.
Avant tout voyage ou intervention chirurgicale, consultez votre hématologue. Il pourra adapter votre traitement et prendre les précautions nécessaires [6,7]. Certaines anesthésies ou médicaments peuvent déclencher une hémolyse.
En cas de grossesse, un suivi spécialisé est indispensable dès le début. L'anémie peut s'aggraver et nécessiter des adaptations thérapeutiques [8]. Le suivi conjoint obstétricien-hématologue optimise les résultats.
N'hésitez jamais à contacter votre équipe médicale en cas de doute. Il vaut mieux une consultation de trop qu'une complication évitable [1,4].
Questions Fréquentes
L'anémie hémolytique congénitale est-elle héréditaire ?
Oui, c'est une maladie génétique qui se transmet des parents aux enfants selon différents modes de transmission. Le risque de transmission varie selon la forme spécifique de la maladie.
Peut-on guérir de cette maladie ?
Il n'existe pas encore de traitement curatif définitif, mais les thérapies géniques en développement sont prometteuses. Les traitements actuels permettent de contrôler efficacement les symptômes.
La splénectomie est-elle obligatoire ?
Non, elle n'est recommandée que pour les formes sévères avec anémie importante ou complications. La décision doit être individualisée selon chaque patient.
Puis-je faire du sport ?
Oui, l'activité physique adaptée est même recommandée. Évitez simplement les sports de contact si votre rate est volumineuse et adaptez l'intensité à votre tolérance.
Cette maladie affecte-t-elle l'espérance de vie ?
Pour la plupart des formes, l'espérance de vie est normale avec une prise en charge adaptée. Les formes sévères bénéficient grandement des traitements modernes.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Épidémie d'infections à Parvovirus B19. Santé Publique France. 2024-2025.Lien
- [2] Diagnostic rapide de la drépanocytose. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [3] Breizh CoCoA 2024. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [4] Livret des Etudes 2024-2025 - faculté de pharmacie de nancy. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [5] SPTB Gene - GeneCards | SPTB1 Protein. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [7] P Boutard, M Leporrier. Anémies hémolytiques congénitales, à l'exception des hémoglobinopathies.Lien
- [8] C Goudet. Porphyries érythrocytaires congénitales: une série de 19 cas français de formes périnatales sévères. 2022.Lien
- [15] Revue générale des anémies hémolytiques. MSD Manuals.Lien
- [16] Diagnostic des anémies hémolytiques. SNFMI.Lien
- [17] Anémie hémolytique auto-immune de l'enfant : deux entités. Vidal.Lien
Publications scientifiques
- [PDF][PDF] Anémies hémolytiques congénitales, à l'exception des hémoglobinopathies [PDF]
- Porphyries érythrocytaires congénitales: une série de 19 cas français de formes périnatales sévères (2022)
- Les Atteintes oculaires de la rubéole congénitale chez les enfants de 0 à 1 an Au CHU IOTA de Bamako (2024)[PDF]
- Premier cas de maladie de Günther traitée par allogreffe de moelle osseuse chez un adulte (2023)
- [PDF][PDF] SEMINAIRE DE SPECIALISATION [PDF]
Ressources web
- Revue générale des anémies hémolytiques (msdmanuals.com)
Diagnostic de l'anémie hémolytique · Frottis périphérique et nombre de réticulocytes · Bilirubine sérique (indirecte), déshydrogénase lactique (LDH) et ...
- Diagnostic des anémies hémolytiques (snfmi.org)
• Traitement le plus souvent nécessaire ... Diagnostic. Cytométrie de flux. (test EMA). Ektacytométrie. Génétique. Cytométrie de flux. Ektacytométrie. Génétique.
- Anémie hémolytique auto-immune de l'enfant : deux entités ... (vidal.fr)
7 sept. 2023 — L'enfant et ses parents doivent être informés des signes de poussée d'anémie hémolytique : urines rouges, pâleur, ictère, douleurs abdominales ...
- Anémie hémolytique auto-immune - Troubles du sang (msdmanuals.com)
L'anémie hémolytique auto-immune est confirmée lorsque les examens sanguins détectent une augmentation de certains anticorps, liés aux globules rouges (test d' ...
- Les symptômes et le diagnostic de l'anémie (ameli.fr)
Les symptômes de l'anémie · pâleur, bien visible à l'intérieur des paupières, au niveau des ongles et des lèvres ; · essoufflement à l'effort puis au repos ; ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
