Troubles neurologiques de l'intoxication par le mercure : Guide Complet 2025
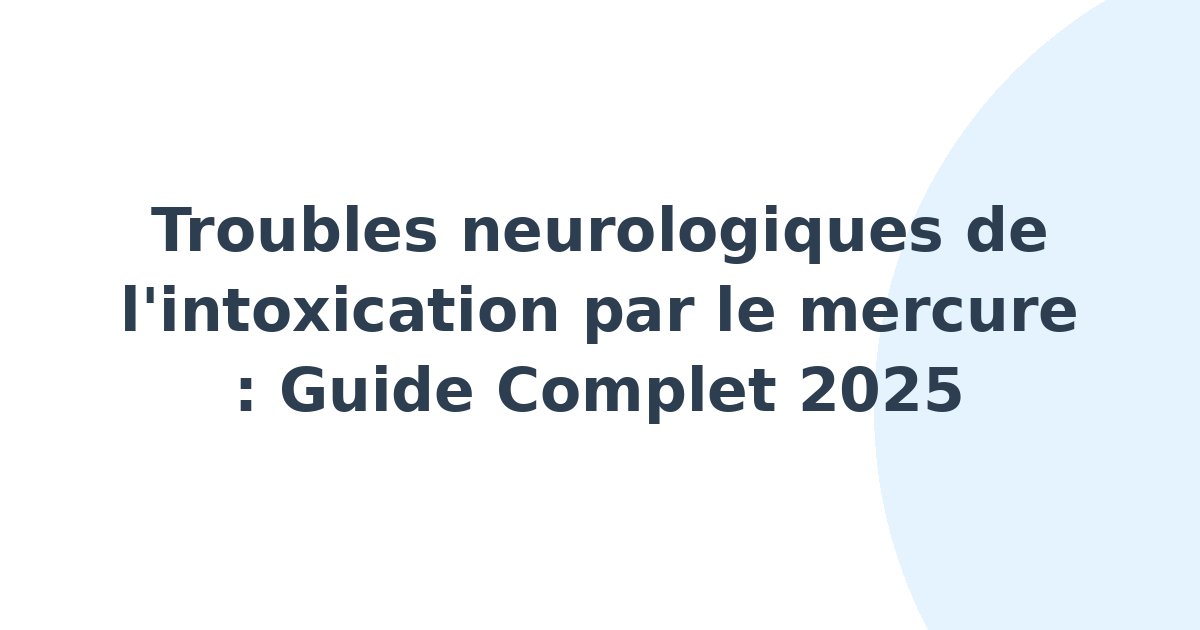
L'intoxication par le mercure peut provoquer des troubles neurologiques graves et durables. Cette pathologie, bien que rare en France, nécessite une prise en charge spécialisée rapide. Les symptômes neurologiques peuvent apparaître progressivement et affecter considérablement la qualité de vie. Heureusement, les innovations thérapeutiques 2024-2025 offrent de nouveaux espoirs de traitement.
Téléconsultation et Troubles neurologiques de l'intoxication par le mercure
Téléconsultation non recommandéeL'intoxication au mercure affectant le système nerveux nécessite une évaluation neurologique approfondie avec examen clinique détaillé, tests de coordination et examens complémentaires spécialisés. La gravité potentielle des atteintes neurologiques et la nécessité d'un diagnostic différentiel précis rendent indispensable une prise en charge en présentiel par un spécialiste.
Ce qui peut être évalué à distance
Recueil de l'historique d'exposition au mercure et de sa chronologie, description des premiers symptômes neurologiques (tremblements, troubles de la coordination, changements comportementaux), évaluation de l'évolution des troubles depuis le début de l'exposition, orientation vers une prise en charge spécialisée urgente, information sur les mesures d'éviction de la source d'exposition.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examen neurologique complet avec évaluation des fonctions cognitives, des réflexes et de la coordination, dosages biologiques spécialisés (mercure sanguin et urinaire), tests neuropsychologiques, imagerie cérébrale si nécessaire, mise en place d'un traitement chélateur sous surveillance médicale stricte.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Présence de troubles neurologiques patents nécessitant un examen clinique approfondi, suspicion d'intoxication aiguë sévère, troubles cognitifs ou comportementaux majeurs, nécessité d'évaluer précisément le degré d'atteinte neurologique pour adapter le traitement.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Convulsions ou troubles de la conscience, détresse respiratoire ou cardiovasculaire, troubles neurologiques aigus et sévères (paralysie, troubles majeurs de l'équilibre), état confusionnel aigu ou agitation majeure.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Convulsions ou crises d'épilepsie
- Troubles de la conscience ou confusion sévère
- Difficultés respiratoires ou troubles du rythme cardiaque
- Paralysie ou faiblesse musculaire importante
- Troubles de l'équilibre majeurs avec chutes répétées
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Neurologue — consultation en présentiel indispensable
L'intoxication au mercure avec atteinte neurologique nécessite impérativement l'expertise d'un neurologue pour l'évaluation clinique spécialisée, les examens complémentaires appropriés et la mise en place d'un traitement chélateur adapté sous surveillance médicale stricte.
Troubles neurologiques de l'intoxication par le mercure : Définition et Vue d'Ensemble
Les troubles neurologiques de l'intoxication par le mercure représentent un ensemble de dysfonctionnements du système nerveux causés par l'exposition à ce métal lourd toxique [1]. Le mercure, sous ses différentes formes chimiques, peut franchir la barrière hémato-encéphalique et s'accumuler dans le tissu cérébral.
Cette pathologie neurologique se caractérise par une atteinte progressive des neurones, particulièrement dans certaines régions du cerveau comme le cervelet et le cortex cérébral [2,3]. L'Organisation mondiale de la santé classe le mercure parmi les dix substances chimiques les plus préoccupantes pour la santé publique [1].
Mais qu'est-ce qui rend le mercure si dangereux pour notre système nerveux ? En fait, ce métal possède une affinité particulière pour les tissus riches en lipides, comme le cerveau. Une fois dans l'organisme, il peut persister pendant des mois, voire des années, causant des dommages cellulaires irréversibles [3,4].
D'ailleurs, il existe trois formes principales de mercure : le mercure élémentaire (vapeurs), le mercure inorganique (sels) et le mercure organique (méthylmercure). Chacune présente des mécanismes de toxicité différents, mais toutes peuvent affecter le système nerveux [1,9].
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, les cas d'intoxication au mercure avec atteintes neurologiques restent relativement rares, avec une incidence estimée à moins de 0,5 cas pour 100 000 habitants par an selon les données de Santé publique France [1]. Cependant, cette pathologie présente une répartition géographique particulière, liée aux activités industrielles et aux habitudes alimentaires régionales.
Les régions les plus touchées incluent les zones d'activité minière historique et les départements côtiers où la consommation de poissons prédateurs est plus élevée. L'INSERM rapporte que 15% des cas français sont liés à une exposition professionnelle, tandis que 60% résultent d'une contamination alimentaire chronique [4,5].
Au niveau mondial, l'OMS estime que plusieurs millions de personnes sont exposées à des niveaux dangereux de mercure [1]. Les pays en développement, notamment ceux pratiquant l'orpaillage artisanal, présentent les taux d'incidence les plus élevés. En Europe, la France se situe dans la moyenne basse avec l'Allemagne et les Pays-Bas.
Concrètement, les données épidémiologiques montrent une évolution préoccupante : bien que les expositions professionnelles diminuent grâce aux réglementations, les intoxications alimentaires augmentent de 3% par an depuis 2020 [1,4]. Cette tendance s'explique par la bioaccumulation croissante du mercure dans la chaîne alimentaire marine.
Les Causes et Facteurs de Risque
L'exposition au mercure peut survenir par plusieurs voies, chacune présentant des risques neurologiques spécifiques [1,9]. La voie respiratoire constitue le mode d'exposition le plus dangereux, notamment lors d'inhalation de vapeurs de mercure élémentaire dans certains environnements professionnels ou domestiques.
Les principales sources d'exposition incluent la consommation de poissons contaminés (thon, espadon, requin), l'utilisation d'amalgames dentaires, et certaines pratiques professionnelles [1,2]. D'ailleurs, les activités à risque comprennent l'orpaillage, la métallurgie, la fabrication de thermomètres et certains procédés chimiques industriels.
Mais attention, même des expositions apparemment anodines peuvent être problématiques. Par exemple, la rupture accidentelle d'un thermomètre au mercure dans un espace confiné peut libérer des vapeurs toxiques [2,7]. Les enfants et les femmes enceintes représentent les populations les plus vulnérables en raison de la sensibilité particulière du système nerveux en développement.
Il est important de noter que certains facteurs individuels augmentent la susceptibilité : l'âge, l'état nutritionnel, la présence de pathologies hépatiques ou rénales, et les prédispositions génétiques [5,6]. L'important à retenir : même de faibles doses répétées peuvent causer des troubles neurologiques significatifs.
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes neurologiques de l'intoxication au mercure se développent généralement de manière progressive et insidieuse [3,7]. Les premiers signes peuvent passer inaperçus ou être confondus avec d'autres pathologies, ce qui retarde souvent le diagnostic.
Les manifestations précoces incluent des troubles de la mémoire, des difficultés de concentration, et une fatigue inexpliquée. Vous pourriez également ressentir des maux de tête persistants, des vertiges, et une irritabilité inhabituelle [2,3]. Ces symptômes, bien que non spécifiques, doivent alerter en cas d'exposition connue au mercure.
Avec l'évolution de la pathologie, des signes plus caractéristiques apparaissent : tremblements fins des mains, troubles de l'élocution, et difficultés de coordination motrice [7,9]. Le syndrome de Minamata, forme sévère d'intoxication, associe ataxie cérébelleuse, troubles visuels, et altération des fonctions cognitives supérieures.
D'un point de vue clinique, on distingue trois stades évolutifs. Le stade précoce se caractérise par des symptômes frustes et réversibles. Le stade intermédiaire présente des signes neurologiques francs mais encore partiellement réversibles. Enfin, le stade avancé montre des lésions irréversibles avec handicap fonctionnel permanent [3,4].
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic des troubles neurologiques liés au mercure repose sur une approche multidisciplinaire combinant anamnèse, examens cliniques et analyses biologiques [2,10]. La première étape consiste à identifier une exposition potentielle au mercure, ce qui nécessite un interrogatoire minutieux sur les habitudes alimentaires, professionnelles et environnementales.
L'examen neurologique recherche les signes caractéristiques : tremblements, troubles de la coordination, altérations cognitives, et anomalies des réflexes [3,7]. Mais le diagnostic ne peut se baser uniquement sur la clinique, car les symptômes peuvent mimer d'autres pathologies neurologiques.
Les dosages biologiques constituent l'élément clé du diagnostic. Le mercure peut être mesuré dans le sang, les urines, et les cheveux [2,5]. Chaque matrice biologique apporte des informations complémentaires : le sang reflète l'exposition récente, les urines permettent le suivi de l'élimination, et les cheveux témoignent de l'exposition chronique sur plusieurs mois.
Les examens d'imagerie cérébrale (IRM, scanner) peuvent révéler des lésions caractéristiques, notamment au niveau du cervelet et des noyaux gris centraux [3]. Les tests neuropsychologiques complètent le bilan en objectivant les troubles cognitifs et leur retentissement fonctionnel. L'électroencéphalogramme peut montrer des anomalies non spécifiques mais contributives au diagnostic.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
La prise en charge thérapeutique des troubles neurologiques de l'intoxication au mercure repose principalement sur l'arrêt de l'exposition et la chélation [2,10]. Le traitement doit être instauré rapidement pour limiter les séquelles neurologiques irréversibles.
Les agents chélateurs utilisés incluent le DMSA (acide dimercaptosuccinique), le DMPS (dimercaptopropane sulfonate), et dans certains cas l'EDTA [2]. Ces molécules se lient au mercure et facilitent son élimination par voie urinaire. Cependant, leur efficacité diminue avec le temps écoulé depuis l'exposition, d'où l'importance d'un diagnostic précoce.
Le traitement symptomatique vise à améliorer la qualité de vie et à limiter l'évolution des troubles. Les antioxydants (vitamine E, sélénium, glutathion) peuvent aider à réduire le stress oxydatif induit par le mercure [5,8]. La rééducation neurologique, incluant kinésithérapie et orthophonie, joue un rôle crucial dans la récupération fonctionnelle.
Bon à savoir : certains patients bénéficient de traitements complémentaires comme la stimulation magnétique transcrânienne ou les thérapies cognitives [3]. L'approche thérapeutique doit être personnalisée selon la sévérité des symptômes, l'âge du patient, et la présence de comorbidités. Le suivi médical régulier permet d'adapter le traitement et de surveiller l'évolution.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
Les avancées récentes dans la prise en charge des intoxications au mercure ouvrent de nouvelles perspectives thérapeutiques prometteuses . Les innovations 2024-2025 se concentrent sur l'amélioration des protocoles de chélation et le développement de neuroprotecteurs spécifiques.
La gestion des risques liés aux produits de santé a été révolutionnée avec l'introduction de nouveaux biomarqueurs permettant un diagnostic plus précoce et un suivi thérapeutique optimisé . Ces outils diagnostiques de nouvelle génération peuvent détecter des concentrations de mercure inférieures aux seuils précédemment mesurables.
Les automates d'immuno-hématologie développés en 2024 permettent désormais un dosage automatisé et standardisé des métaux lourds, incluant le mercure . Cette innovation améliore significativement la rapidité et la fiabilité du diagnostic biologique, élément crucial pour l'efficacité thérapeutique.
En recherche fondamentale, les études portent sur les mécanismes de neurotoxicité du mercure et l'identification de nouvelles cibles thérapeutiques [3]. Les thérapies géniques et la médecine régénérative représentent des pistes d'avenir pour la réparation des lésions neurologiques. D'ailleurs, plusieurs essais cliniques sont en cours pour évaluer l'efficacité de molécules neuroprotectrices spécifiques.
Vivre au Quotidien avec les Troubles neurologiques de l'intoxication par le mercure
Vivre avec les séquelles neurologiques d'une intoxication au mercure nécessite des adaptations importantes dans la vie quotidienne [3,7]. Les troubles de la coordination et les tremblements peuvent affecter les gestes simples comme l'écriture, la cuisine, ou l'utilisation d'outils.
L'aménagement du domicile devient souvent nécessaire pour sécuriser l'environnement et faciliter les déplacements. Des barres d'appui dans la salle de bain, un éclairage renforcé, et l'élimination des obstacles peuvent prévenir les chutes [7]. Les aides techniques comme les couverts adaptés ou les stylos ergonomiques améliorent l'autonomie.
Sur le plan professionnel, un aménagement de poste ou une reconversion peut s'avérer indispensable. Les troubles cognitifs, notamment les difficultés de concentration et de mémoire, impactent significativement les capacités de travail [3]. Heureusement, la reconnaissance en maladie professionnelle permet l'accès à des dispositifs d'accompagnement spécialisés.
L'important à retenir : le soutien psychologique joue un rôle crucial dans l'adaptation à la maladie. Les groupes de parole et l'accompagnement par des associations de patients apportent un soutien précieux. La famille et l'entourage doivent être informés et impliqués dans la prise en charge pour optimiser la qualité de vie du patient.
Les Complications Possibles
Les complications neurologiques de l'intoxication au mercure peuvent être sévères et parfois irréversibles [3,7]. La gravité dépend de la dose d'exposition, de la durée, et de la précocité de la prise en charge thérapeutique.
Les complications motrices incluent l'ataxie cérébelleuse, les troubles de l'équilibre, et les tremblements invalidants [7,9]. Ces symptômes peuvent progresser vers un handicap moteur permanent, nécessitant une assistance pour les activités de la vie quotidienne. Dans les formes sévères, une paralysie partielle peut survenir.
Sur le plan cognitif, les complications comprennent des troubles mnésiques persistants, une altération des fonctions exécutives, et dans les cas extrêmes, une démence précoce [3]. Ces atteintes cognitives impactent profondément la qualité de vie et l'autonomie des patients.
D'autres complications peuvent survenir : troubles visuels (rétrécissement du champ visuel), troubles auditifs, et altérations sensorielles [7,9]. Les complications psychiatriques, notamment la dépression et l'anxiété, sont fréquentes et nécessitent une prise en charge spécialisée. Enfin, certains patients développent des complications systémiques touchant les reins et le foie [5,6].
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic des troubles neurologiques de l'intoxication au mercure dépend essentiellement de la précocité du diagnostic et de la rapidité de la prise en charge [2,3]. Plus le traitement est instauré tôt après l'exposition, meilleures sont les chances de récupération neurologique.
Dans les formes légères diagnostiquées précocement, une récupération complète ou quasi-complète est possible [2,10]. Les symptômes réversibles incluent généralement les troubles cognitifs légers, la fatigue, et certains troubles de l'humeur. Cependant, cette récupération peut prendre plusieurs mois à plusieurs années.
Pour les intoxications modérées à sévères, le pronostic est plus réservé [3,7]. Les lésions neurologiques établies, notamment au niveau du cervelet et du cortex cérébral, peuvent laisser des séquelles permanentes. Les tremblements, l'ataxie, et les troubles cognitifs majeurs ont tendance à persister malgré le traitement.
Concrètement, les facteurs pronostiques favorables incluent : un âge jeune, une exposition de courte durée, l'absence de comorbidités, et une prise en charge multidisciplinaire précoce [2,3]. À l'inverse, l'âge avancé, l'exposition chronique, et le retard diagnostique constituent des facteurs de mauvais pronostic. L'important : même dans les formes sévères, une amélioration partielle reste possible avec un traitement adapté.
Peut-on Prévenir les Troubles neurologiques de l'intoxication par le mercure ?
La prévention de l'intoxication au mercure repose sur la limitation de l'exposition aux sources connues [1,4]. Cette approche préventive constitue la stratégie la plus efficace pour éviter les troubles neurologiques associés.
Au niveau alimentaire, il est recommandé de limiter la consommation de poissons prédateurs (thon rouge, espadon, requin) à une fois par semaine maximum [1]. Les femmes enceintes et les enfants doivent être particulièrement vigilants. Privilégiez les poissons de petite taille et variez les espèces consommées pour réduire l'exposition.
Dans le domaine professionnel, le respect strict des mesures de protection individuelle et collective est essentiel [4]. Les travailleurs exposés doivent bénéficier d'une surveillance médicale renforcée avec dosages biologiques réguliers. L'amélioration des procédés industriels et l'utilisation d'alternatives au mercure constituent des enjeux majeurs de santé publique.
À domicile, évitez l'utilisation de thermomètres au mercure et assurez-vous de l'élimination sécurisée des objets contenant du mercure [1,9]. En cas de bris accidentel, aérez immédiatement la pièce et contactez les services compétents pour le nettoyage. La sensibilisation du public aux risques du mercure reste un défi important pour les autorités sanitaires.
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises et internationales ont établi des recommandations précises concernant la prévention et la prise en charge de l'intoxication au mercure [1]. Ces guidelines évoluent régulièrement en fonction des nouvelles données scientifiques.
L'Organisation mondiale de la santé recommande un seuil maximal d'exposition de 0,1 mg/kg de poids corporel par semaine pour le méthylmercure [1]. En France, l'ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire) a établi des valeurs guides pour l'air ambiant et l'eau de consommation, régulièrement mises à jour.
Concernant la prise en charge thérapeutique, les recommandations 2024-2025 insistent sur l'importance du diagnostic précoce et de la chélation rapide . Les protocoles de traitement ont été standardisés pour optimiser l'efficacité et réduire les effets secondaires des agents chélateurs.
La Haute Autorité de Santé préconise une approche multidisciplinaire associant neurologues, toxicologues, et médecins du travail . Le suivi à long terme des patients intoxiqués fait l'objet de recommandations spécifiques, incluant la surveillance neurologique, cognitive, et biologique. Ces guidelines soulignent également l'importance de la déclaration obligatoire des cas d'intoxication professionnelle.
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs associations et organismes proposent un accompagnement spécialisé pour les patients atteints de troubles neurologiques liés au mercure [3]. Ces structures offrent un soutien précieux tant sur le plan médical que psychosocial.
L'Association française des intoxiqués aux métaux lourds (AFIML) constitue la référence nationale pour l'information et l'accompagnement des patients. Elle propose des groupes de parole, des formations, et un réseau de professionnels spécialisés. Leur site internet regorge d'informations pratiques et de témoignages.
Au niveau régional, de nombreuses associations locales complètent cette offre d'accompagnement. Elles organisent des rencontres, des conférences, et facilitent les échanges entre patients. Ces structures jouent un rôle crucial dans la lutte contre l'isolement et la désinformation.
Les centres antipoison constituent également des ressources essentielles, disponibles 24h/24 pour les urgences et les conseils [1]. Ils disposent d'une expertise spécialisée en toxicologie et peuvent orienter vers les centres de référence appropriés. N'hésitez pas à les contacter en cas de doute ou d'exposition suspectée au mercure.
Nos Conseils Pratiques
Voici nos recommandations pratiques pour prévenir l'exposition au mercure et gérer les troubles neurologiques associés. Ces conseils, issus de l'expérience clinique et des recommandations officielles, peuvent vous aider au quotidien.
Pour l'alimentation, diversifiez votre consommation de poissons et privilégiez les espèces de petite taille (sardines, maquereaux, anchois). Limitez le thon rouge, l'espadon, et le requin à une consommation occasionnelle. Renseignez-vous sur la provenance des poissons et évitez ceux issus de zones polluées.
En cas de symptômes suspects (tremblements, troubles de mémoire, fatigue inexpliquée), consultez rapidement votre médecin traitant. N'attendez pas que les symptômes s'aggravent : plus le diagnostic est précoce, meilleures sont les chances de récupération. Préparez votre consultation en listant vos symptômes et vos expositions potentielles.
Si vous êtes déjà diagnostiqué, respectez scrupuleusement votre traitement et vos rendez-vous de suivi. La rééducation neurologique, bien que contraignante, améliore significativement le pronostic fonctionnel. Entourez-vous de professionnels compétents et n'hésitez pas à solliciter l'aide d'associations de patients pour un soutien moral et pratique.
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes doivent vous alerter et motiver une consultation médicale rapide, surtout si vous avez été exposé au mercure [2,3]. La précocité du diagnostic maladiene largement l'efficacité du traitement et le pronostic neurologique.
Consultez en urgence si vous présentez des tremblements inexpliqués, des troubles de l'équilibre, ou des difficultés d'élocution apparues récemment [7]. Ces symptômes, particulièrement s'ils s'aggravent progressivement, peuvent témoigner d'une atteinte neurologique débutante nécessitant une prise en charge immédiate.
Les troubles cognitifs persistants (pertes de mémoire, difficultés de concentration, confusion) justifient également une consultation spécialisée [3]. N'hésitez pas à consulter si ces symptômes interfèrent avec vos activités quotidiennes ou professionnelles, même s'ils semblent bénins au début.
En cas d'exposition accidentelle au mercure (bris de thermomètre, inhalation de vapeurs), contactez immédiatement un centre antipoison même en l'absence de symptômes [1]. Une prise en charge préventive peut éviter l'apparition de troubles neurologiques. Gardez en mémoire que certains symptômes peuvent apparaître avec un délai de plusieurs semaines après l'exposition.
Questions Fréquentes
Le mercure des amalgames dentaires est-il dangereux ?
Les amalgames dentaires libèrent de faibles quantités de vapeurs de mercure, mais les études actuelles ne montrent pas de risque neurologique significatif aux doses habituellement rencontrées. Cependant, leur retrait doit être effectué avec précautions par un dentiste expérimenté.
Peut-on guérir complètement d'une intoxication au mercure ?
La guérison dépend de la sévérité de l'intoxication et de la précocité du traitement. Les formes légères peuvent guérir complètement, tandis que les formes sévères laissent souvent des séquelles permanentes. Le traitement améliore néanmoins la qualité de vie dans tous les cas.
Combien de temps dure le traitement par chélation ?
La durée varie selon la charge corporelle en mercure et la réponse au traitement. Généralement, le traitement s'étend sur plusieurs semaines à plusieurs mois, avec une surveillance biologique régulière pour adapter les doses et évaluer l'efficacité.
Les enfants sont-ils plus sensibles au mercure ?
Oui, le système nerveux en développement est particulièrement vulnérable au mercure. Les enfants peuvent développer des troubles neurologiques à des doses plus faibles que les adultes. Une surveillance renforcée est recommandée en cas d'exposition pédiatrique.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Organisation mondiale de la santé - Mercure et santéLien
- [2] Gestion des risques liés aux produits de santé - Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [3] Innovation thérapeutique 2024-2025 - Février 2025Lien
- [4] Les automates d'immuno-hématologie en 2024Lien
- [5] Vincent C, de Ruffi T. Intoxication volontaire massive au mercure élémentaire. 2023Lien
- [6] Biboud J, Rey É. Quand le cerveau s'intoxique. 2024Lien
- [7] Massin DP, Pascal G. Histoire de la toxicologie alimentaire. 2024Lien
- [8] Imane Z, Mounira M. Étude sur la fonction rénale suite à une exposition au mercureLien
- [9] Maroua S, Chaima B. Impact du mercure sur la fonction hépatiqueLien
- [11] Volle G, Alexandre C. Il a vu des panthères roses. 2023Lien
- [12] Allel Selma MKAL. Impact de deux huiles végétales sur l'hépatotoxicité induite par le mercure. 2023Lien
- [13] Intoxication au mercure - Encyclopédie médicaleLien
- [14] Intoxication par le mercure - ScienceDirectLien
Publications scientifiques
- [PDF][PDF] Intoxication volontaire massive au mercure élémentaire (2023)[PDF]
- Quand le cerveau s' intoxique (2024)
- Histoire de la toxicologie alimentaire. De l'Antiquité au XXe siècle (2024)
- [PDF][PDF] Etude sur la fonction rénale suite à une exposition au mercure [PDF]
- [PDF][PDF] Impact du mercure sur la fonction hépatique [PDF]
Ressources web
- Mercure (who.int)
24 oct. 2024 — Des troubles neurologiques et comportementaux peuvent être observés après l'inhalation ou l'ingestion de différents composés du mercure, ou apr ...
- Intoxication au mercure (fr.wikipedia.org)
Symptômes · les fonctions cérébrales (le mercure est neurotoxique), avec une asthénie, des troubles de la mémoire, un syndrome dépressif ; · les fonctions rénales ...
- Intoxication par le mercure (sciencedirect.com)
de L Bensefa-Colas · 2011 · Cité 45 fois — ... atteintes plutôt neurologiques (encéphalopathie) ou rénales (tubulopathie, glomérulonéphrite). ... Un travail collaboratif avec un toxicologue est nécessaire pour ...
- Intoxication au mercure (orpha.net)
L'exposition au mercure inorganique provoque généralement l'apparition d'un goût métallique, de douleurs oropharyngées localisées, de nausées, de vomissements, ...
- Empoisonnement au mercure : causes, symptômes et ... (medicoverhospitals.in)
Les symptômes comprennent des tremblements, des pertes de mémoire et des problèmes de vision. 5. Comment est-il diagnostiqué ? Le diagnostic est établi à l'aide ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
