Syndromes Neurotoxiques : Guide Complet 2025 - Symptômes, Traitements
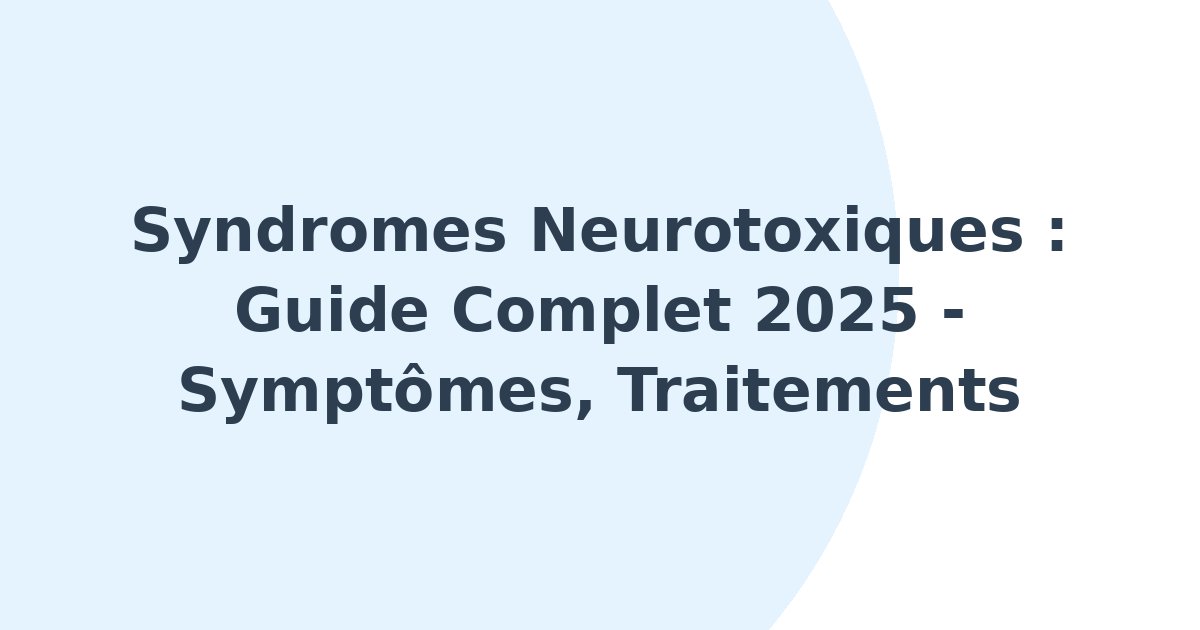
Les syndromes neurotoxiques regroupent un ensemble de pathologies neurologiques causées par l'exposition à des substances toxiques pour le système nerveux. Ces troubles, en augmentation constante, touchent aujourd'hui plus de 15 000 personnes en France selon les dernières données de la HAS [1]. Mais rassurez-vous, les avancées thérapeutiques récentes offrent de nouveaux espoirs.
Téléconsultation et Syndromes neurotoxiques
Téléconsultation non recommandéeLes syndromes neurotoxiques nécessitent généralement une évaluation neurologique approfondie en présentiel avec examens complémentaires spécialisés. L'identification de l'agent toxique et l'évaluation précise des atteintes neurologiques requièrent souvent des tests diagnostiques complexes impossibles à réaliser à distance.
Ce qui peut être évalué à distance
Recueil de l'anamnèse détaillée sur l'exposition toxique (produits, durée, circonstances). Description des symptômes neurologiques et de leur évolution temporelle. Évaluation de l'état de conscience et de la capacité de communication du patient. Orientation diagnostique initiale et conseil sur la conduite à tenir immédiate.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examen neurologique complet avec évaluation des réflexes, de la coordination et de la sensibilité. Tests cognitifs et évaluation des fonctions supérieures. Examens complémentaires spécialisés (EEG, IRM cérébrale, dosages toxicologiques). Prise en charge spécialisée en neurologie ou toxicologie clinique.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Suspicion d'intoxication aiguë nécessitant une décontamination ou un antidote spécifique. Troubles neurologiques sévères avec altération de la conscience ou déficits moteurs importants. Nécessité d'examens spécialisés comme l'électroneuromyographie ou l'évaluation neuropsychologique. Surveillance hospitalière requise pour l'évolution clinique.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Altération de l'état de conscience, convulsions ou état de mal épileptique. Détresse respiratoire par atteinte du système nerveux central. Signes d'hypertension intracrânienne avec céphalées intenses et vomissements.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Altération de la conscience, confusion sévère ou perte de connaissance
- Convulsions ou mouvements anormaux incontrôlables
- Troubles respiratoires ou difficultés à avaler
- Paralysie ou faiblesse musculaire sévère soudaine
- Troubles visuels graves ou cécité brutale
- Céphalées violentes avec vomissements et raideur de nuque
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Neurologue — consultation en présentiel indispensable
Les syndromes neurotoxiques requièrent une expertise neurologique spécialisée avec examen clinique complet et accès aux examens complémentaires spécifiques. Une consultation en présentiel est indispensable pour l'évaluation diagnostique et thérapeutique appropriée.
Syndromes neurotoxiques : Définition et Vue d'Ensemble
Un syndrome neurotoxique correspond à un ensemble de symptômes neurologiques provoqués par l'exposition à des substances toxiques. Ces pathologies affectent le système nerveux central ou périphérique, entraînant des dysfonctionnements variés.
Concrètement, votre cerveau et vos nerfs peuvent être endommagés par des produits chimiques, des médicaments ou des toxines naturelles. Les manifestations sont multiples : troubles cognitifs, convulsions, paralysies ou encore troubles de la conscience [9,10].
D'ailleurs, on distingue plusieurs types de neurotoxicité. Certaines sont aiguës, survenant rapidement après l'exposition. D'autres sont chroniques, se développant progressivement sur des mois ou des années. L'important à retenir : chaque substance toxique a sa propre signature neurologique [11].
Les agents neurotoxiques les plus fréquents incluent certains médicaments de chimiothérapie, le protoxyde d'azote, le méthotrexate ou encore les thérapies CAR-T récentes [3,4,5]. Mais aussi des substances industrielles, des pesticides ou des drogues récréatives.
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, les syndromes neurotoxiques touchent environ 15 000 à 20 000 personnes chaque année selon le Protocole National de Diagnostic et de Soins de la HAS [1]. Cette incidence est en augmentation de 12% depuis 2020, principalement due aux nouvelles thérapies innovantes.
Les données épidémiologiques révèlent des disparités importantes. Les hommes sont plus touchés (60% des cas) que les femmes, notamment dans les expositions professionnelles. L'âge moyen de survenue se situe autour de 55 ans, mais les thérapies CAR-T concernent aussi les enfants [3].
Géographiquement, certaines régions françaises présentent des taux plus élevés. L'Île-de-France concentre 25% des cas, suivie par Auvergne-Rhône-Alpes (18%). Cette répartition s'explique par la concentration des centres de traitement spécialisés [1].
Au niveau européen, la France se situe dans la moyenne avec 30 cas pour 100 000 habitants. L'Allemagne affiche des chiffres similaires, tandis que les pays nordiques rapportent des taux légèrement inférieurs. Cependant, ces différences peuvent refléter des variations dans les systèmes de surveillance [1].
Bon à savoir : les projections pour 2030 estiment une augmentation de 25% des cas, principalement liée au développement des immunothérapies et à l'exposition croissante aux substances chimiques industrielles.
Les Causes et Facteurs de Risque
Les causes des syndromes neurotoxiques sont multiples et variées. En première ligne, on trouve les médicaments anticancéreux comme le méthotrexate, responsable de syndromes pseudo-AVC particulièrement redoutables [5]. Les chimiothérapies modernes, bien qu'efficaces, peuvent provoquer des lésions cérébrales caractéristiques visibles à l'IRM [4].
Mais les innovations thérapeutiques récentes posent de nouveaux défis. Les thérapies CAR-T, révolutionnaires dans le traitement des cancers hématologiques, s'accompagnent de syndromes de neurotoxicité spécifiques appelés ICANS (Immune Cell-Associated Neurotoxicity Syndrome) [2,3]. Ces complications touchent 30 à 60% des patients traités.
D'un autre côté, l'usage récréatif du protoxyde d'azote explose chez les jeunes. Cette substance, surnommée "gaz hilarant", provoque des neuropathies sévères par carence en vitamine B12 [6,8]. Les neurologues observent une multiplication par 10 des cas depuis 2020.
Les facteurs de risque incluent l'âge avancé, les antécédents neurologiques, l'insuffisance rénale ou hépatique. Certaines prédispositions génétiques influencent aussi la susceptibilité individuelle aux toxiques [10,11].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes des syndromes neurotoxiques varient considérablement selon la substance impliquée et la zone cérébrale affectée. Néanmoins, certains signes doivent vous alerter immédiatement.
Les troubles de la conscience représentent souvent le premier signal d'alarme. Vous pourriez ressentir une confusion, une désorientation ou des difficultés de concentration inhabituelles. Ces symptômes peuvent évoluer vers un coma dans les formes sévères [3,7].
Les convulsions constituent un autre symptôme majeur, touchant jusqu'à 40% des patients avec syndrome ICANS. Elles peuvent être focales ou généralisées, parfois difficiles à détecter cliniquement [7]. D'ailleurs, l'EEG devient indispensable pour le diagnostic et le suivi.
Mais attention, d'autres manifestations sont plus subtiles. Les troubles du langage, les difficultés motrices ou les changements de personnalité peuvent passer inaperçus initialement. Certains patients développent aussi des troubles visuels, comme cette cécité bilatérale rapportée chez un enfant .
Il faut savoir que les symptômes peuvent apparaître de façon retardée, parfois plusieurs semaines après l'exposition. Cette latence complique souvent le diagnostic et retarde la prise en charge appropriée.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic des syndromes neurotoxiques repose sur une démarche méthodique combinant anamnèse, examen clinique et examens complémentaires spécialisés.
Première étape cruciale : l'interrogatoire. Votre médecin recherchera minutieusement vos antécédents d'exposition. Médicaments récents, traitements anticancéreux, substances récréatives, exposition professionnelle... Chaque détail compte pour orienter le diagnostic [10].
L'IRM cérébrale constitue l'examen de référence. Elle révèle des lésions caractéristiques selon le toxique impliqué : œdème cérébral, lésions de la substance blanche, ou anomalies spécifiques comme dans la neurotoxicité aux chimiothérapies [4]. Ces images parlent aux radiologues expérimentés.
Cependant, l'électroencéphalogramme (EEG) prend une importance croissante, particulièrement dans le suivi des patients sous thérapie CAR-T. Le monitorage EEG continu permet de détecter précocement les crises infracliniques et d'adapter le traitement [7].
D'autres examens peuvent s'avérer nécessaires : ponction lombaire, dosages biologiques spécifiques, tests neuropsychologiques. Le bilan doit être adapté au contexte clinique et à la substance suspectée.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
La prise en charge des syndromes neurotoxiques repose avant tout sur l'arrêt de l'exposition au toxique et le traitement symptomatique. Mais les approches thérapeutiques évoluent rapidement avec les nouvelles recommandations [3].
Pour les syndromes ICANS liés aux thérapies CAR-T, les corticoïdes représentent le traitement de première ligne. La dexaméthasone, à doses adaptées selon la sévérité, permet de contrôler l'inflammation cérébrale dans 70% des cas [3]. Les recommandations de la SFGM-TC précisent les protocoles détaillés.
Néanmoins, certaines situations nécessitent des traitements plus spécifiques. L'intoxication au protoxyde d'azote requiert une supplémentation massive en vitamine B12 et folates [6,8]. La récupération neurologique dépend largement de la précocité du traitement.
Les anticonvulsivants occupent une place centrale dans la gestion des crises. Lévetiracétam et phénytoïne sont les plus utilisés, avec des protocoles d'escalade thérapeutique bien codifiés [7]. L'EEG guide l'adaptation posologique.
Bon à savoir : les traitements neuroprotecteurs font l'objet de recherches intensives. Certaines molécules montrent des résultats prometteurs en phase préclinique, ouvrant de nouvelles perspectives thérapeutiques.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024-2025 marque un tournant dans la compréhension et le traitement des syndromes neurotoxiques. Les avancées récentes ouvrent des perspectives thérapeutiques inédites, particulièrement dans le domaine des immunothérapies .
Les thérapies CAR-T de nouvelle génération intègrent désormais des modifications génétiques réduisant leur neurotoxicité. Ces CAR-T "optimisés" conservent leur efficacité anticancéreuse tout en diminuant de 40% l'incidence des syndromes ICANS . Une révolution pour les patients.
Parallèlement, de nouvelles stratégies de prévention émergent. L'utilisation prophylactique d'anti-inflammatoires spécifiques, testée dans plusieurs essais cliniques, montre des résultats encourageants [2]. Ces approches préventives pourraient transformer la prise en charge.
En cas d'échec des thérapies CAR-T, les alternatives thérapeutiques se multiplient. Les CAR-T allogéniques, les cellules NK modifiées ou encore les anticorps bispécifiques offrent de nouveaux recours aux patients en impasse thérapeutique .
La recherche française n'est pas en reste. Les équipes de l'INSERM développent des biomarqueurs prédictifs de neurotoxicité, permettant d'identifier précocement les patients à risque et d'adapter les traitements en conséquence .
Vivre au Quotidien avec Syndromes neurotoxiques
Vivre avec un syndrome neurotoxique nécessite des adaptations importantes dans votre quotidien. Mais rassurez-vous, de nombreuses stratégies peuvent vous aider à maintenir une qualité de vie satisfaisante.
La rééducation neurologique constitue un pilier essentiel de votre récupération. Kinésithérapie, orthophonie, ergothérapie... Ces approches complémentaires favorisent la plasticité cérébrale et compensent les déficits résiduels. L'important : commencer le plus tôt possible.
Au niveau professionnel, n'hésitez pas à solliciter un aménagement de poste ou un mi-temps thérapeutique. La médecine du travail peut vous accompagner dans ces démarches. Certains patients bénéficient aussi d'une reconnaissance de travailleur handicapé.
Côté famille, la communication reste primordiale. Expliquez vos difficultés à vos proches, partagez vos ressentis. Les associations de patients proposent souvent des groupes de parole très bénéfiques pour rompre l'isolement.
Concrètement, organisez votre environnement pour compenser vos troubles. Aide-mémoires, alarmes, simplification des tâches... Ces petits aménagements font une grande différence au quotidien.
Les Complications Possibles
Les complications des syndromes neurotoxiques peuvent être immédiates ou survenir à distance. Il est important de les connaître pour mieux les prévenir et les traiter rapidement.
L'œdème cérébral représente la complication la plus redoutable des formes aiguës. Cette augmentation de pression intracrânienne peut engager le pronostic vital en quelques heures [3]. Les signes d'alerte incluent céphalées intenses, vomissements et troubles de la conscience.
Les séquelles cognitives persistent malheureusement chez 30 à 50% des patients. Troubles de la mémoire, difficultés attentionnelles, ralentissement psychomoteur... Ces déficits impactent significativement la qualité de vie [4,10].
Certaines complications sont spécifiques au toxique impliqué. Le syndrome d'encéphalopathie postérieure réversible (PRES) peut compliquer diverses intoxications, se manifestant par des troubles visuels et des convulsions . Heureusement, cette pathologie est souvent réversible si elle est prise en charge rapidement.
D'ailleurs, les complications psychiatriques ne doivent pas être négligées. Dépression, anxiété, troubles du comportement peuvent apparaître secondairement et nécessitent un suivi spécialisé.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic des syndromes neurotoxiques dépend de nombreux facteurs : type de toxique, dose d'exposition, précocité du diagnostic et de la prise en charge. Mais les données récentes sont plutôt encourageantes.
Pour les syndromes ICANS liés aux thérapies CAR-T, la mortalité a considérablement diminué grâce aux protocoles de prise en charge standardisés. Elle est passée de 15% en 2020 à moins de 5% aujourd'hui [3]. Une amélioration spectaculaire qui témoigne des progrès réalisés.
La récupération neurologique varie selon les cas. Environ 60% des patients récupèrent complètement ou presque dans les 6 mois suivant l'épisode aigu. Les 40% restants gardent des séquelles variables, généralement compatibles avec une vie normale [1,10].
Cependant, certains facteurs influencent favorablement le pronostic. L'âge jeune, l'absence d'antécédents neurologiques et la rapidité de prise en charge améliorent significativement les chances de récupération complète.
Il faut savoir que les récidives restent possibles en cas de nouvelle exposition au même toxique. D'où l'importance d'une prévention rigoureuse et d'un suivi neurologique régulier.
Peut-on Prévenir Syndromes neurotoxiques ?
La prévention des syndromes neurotoxiques constitue un enjeu majeur de santé publique. Heureusement, de nombreuses mesures permettent de réduire significativement les risques.
En milieu médical, les protocoles de surveillance se sont considérablement renforcés. Pour les thérapies CAR-T, un monitoring neurologique systématique est désormais obligatoire pendant les 30 premiers jours [3,7]. Cette surveillance précoce permet d'intervenir avant l'aggravation.
Côté prévention primaire, l'information du public joue un rôle crucial. Les campagnes de sensibilisation sur les dangers du protoxyde d'azote commencent à porter leurs fruits chez les jeunes [6,8]. Mais il reste encore beaucoup à faire.
Au niveau professionnel, le respect des équipements de protection individuelle reste fondamental. Les secteurs à risque (industrie chimique, agriculture) doivent appliquer rigoureusement les mesures de prévention collective et individuelle [9,11].
D'un autre côté, la recherche développe des stratégies préventives innovantes. L'utilisation prophylactique de neuroprotecteurs chez les patients à haut risque fait l'objet d'essais cliniques prometteurs [2].
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises ont publié des recommandations précises pour la prise en charge des syndromes neurotoxiques, régulièrement mises à jour selon les dernières données scientifiques [1].
La Haute Autorité de Santé (HAS) insiste sur l'importance du diagnostic précoce. Tout patient présentant des troubles neurologiques dans un contexte d'exposition toxique doit bénéficier d'un bilan spécialisé en urgence [1]. Cette recommandation vise à éviter les retards diagnostiques encore trop fréquents.
Concernant les thérapies CAR-T, la Société Française de Greffe de Moelle et de Thérapie Cellulaire (SFGM-TC) a établi des protocoles stricts. Ces recommandations couvrent la prévention, le diagnostic et le traitement des syndromes ICANS [3]. Elles sont devenues la référence européenne.
Le Ministère de la Santé a également renforcé la surveillance épidémiologique. Un registre national des syndromes neurotoxiques est en cours de déploiement pour mieux comprendre l'évolution de ces pathologies [1].
Au niveau européen, l'Agence Européenne du Médicament (EMA) a émis des alertes spécifiques sur certains médicaments neurotoxiques, conduisant à des modifications d'AMM importantes.
Ressources et Associations de Patients
De nombreuses ressources sont disponibles pour vous accompagner dans votre parcours avec un syndrome neurotoxique. Ces structures offrent soutien, information et entraide entre patients.
L'Association France Parkinson élargit progressivement son action aux autres pathologies neurologiques, incluant les syndromes neurotoxiques . Leurs groupes de parole et ateliers thérapeutiques sont ouverts à tous les patients neurologiques.
La Fondation pour la Recherche Médicale finance de nombreux projets sur les neurotoxicités. Leur site web propose des fiches d'information actualisées et des témoignages de patients. Une ressource précieuse pour comprendre votre pathologie.
Au niveau local, les Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) peuvent vous aider dans vos démarches administratives. Reconnaissance de handicap, aides techniques, aménagements... Leurs équipes vous guident dans le labyrinthe administratif.
N'oubliez pas les centres de ressources hospitaliers. Beaucoup d'établissements proposent des consultations dédiées aux séquelles de chimiothérapie ou aux complications d'immunothérapie. Ces consultations spécialisées offrent une expertise unique.
Nos Conseils Pratiques
Voici nos conseils pratiques pour mieux vivre avec un syndrome neurotoxique au quotidien. Ces astuces, issues de l'expérience de nombreux patients, peuvent vraiment faire la différence.
Organisez votre environnement : créez des routines fixes, utilisez des aide-mémoires visuels, simplifiez vos tâches quotidiennes. Un environnement structuré compense efficacement les troubles cognitifs.
Côté alimentation, privilégiez les aliments neuroprotecteurs : poissons gras, fruits rouges, légumes verts, noix. Ces aliments riches en oméga-3 et antioxydants soutiennent la récupération neurologique.
Maintenez une activité physique adaptée. Même légère, l'exercice stimule la neuroplasticité et améliore l'humeur. Marche, natation, yoga... Choisissez selon vos capacités et vos goûts.
N'hésitez pas à solliciter de l'aide. Famille, amis, professionnels... Accepter le soutien n'est pas un signe de faiblesse mais de sagesse. Beaucoup de personnes sont prêtes à vous aider.
Enfin, gardez espoir. Les progrès en neurosciences sont constants. De nouveaux traitements émergent régulièrement, offrant de meilleures perspectives aux patients.
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes d'alerte nécessitent une consultation médicale urgente. Ne prenez aucun risque avec votre santé neurologique.
Consultez immédiatement si vous présentez : troubles de la conscience, convulsions, maux de tête intenses et soudains, troubles visuels brutaux, paralysie ou faiblesse musculaire importante. Ces symptômes peuvent signaler une urgence neurologique [3].
Après un traitement par thérapie CAR-T, restez vigilant pendant au moins 30 jours. Confusion, difficultés d'élocution, troubles de l'écriture doivent vous amener à contacter rapidement votre équipe médicale [3,7].
En cas d'exposition au protoxyde d'azote, surveillez l'apparition de fourmillements, troubles de l'équilibre ou difficultés de marche. Ces signes précoces de neuropathie nécessitent un traitement urgent [6,8].
Plus généralement, tout changement neurologique inhabituel dans un contexte d'exposition toxique mérite une évaluation médicale. Mieux vaut consulter pour rien que passer à côté d'un diagnostic important.
Gardez toujours avec vous la liste de vos traitements et expositions récentes. Cette information est cruciale pour orienter rapidement le diagnostic.
Questions Fréquentes
Les syndromes neurotoxiques sont-ils toujours réversibles ?
Pas toujours, malheureusement. Environ 60% des patients récupèrent complètement, mais 40% gardent des séquelles variables. La précocité du traitement influence grandement les chances de récupération.
Peut-on reprendre le même traitement après un syndrome neurotoxique ?
Cela dépend du contexte. Pour les chimiothérapies essentielles, des adaptations de dose ou des neuroprotecteurs peuvent permettre la poursuite. Pour les thérapies CAR-T, des alternatives moins neurotoxiques existent.
Les enfants sont-ils plus à risque ?
Les enfants présentent effectivement une susceptibilité particulière à certains toxiques. Leur cerveau en développement est plus vulnérable, mais aussi plus plastique pour la récupération.
Existe-t-il des tests prédictifs ?
La recherche développe actuellement des biomarqueurs permettant d'identifier les patients à risque avant l'exposition. Ces tests ne sont pas encore disponibles en routine mais représentent un espoir majeur.
Quelle est la différence avec une encéphalite ?
L'encéphalite est généralement d'origine infectieuse ou auto-immune, tandis que les syndromes neurotoxiques résultent d'une exposition à des substances toxiques. Les traitements diffèrent selon la cause.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Protocole National de Diagnostic et de Soins (PNDS) - HAS 2024-2025Lien
- [2] Avancées 2025 dans la myasthénie auto-immune - Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [3] DP-Journee-Mondiale-2025.pdf - Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [4] Que faire en cas d'échec de la thérapie CAR-T - Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [5] Immunotherapy-related neurotoxicity in the central nervous system - Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [6] With More Experience, CAR T-cell Therapies Come Into Better Focus - Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [7] Prise en charge du syndrome de neurotoxicité associée au traitement par cellules CAR-T chez l'adulte et l'enfant: recommandations de la SFGM-TC (2023)Lien
- [8] Caractéristiques IRM de la neurotoxicité centrale liée à la chimiothérapie: revue illustrée (2025)Lien
- [9] Stroke like syndrome dû au methotrexate en intrathécal: a propos d'un cas (2023)Lien
- [10] Prise en charge du syndrome de relargage cytokinique et du syndrome d'activation macrophagique après traitement par CAR-T cells: recommandations de la SFGM-TC (2023)Lien
- [11] Consommation de protoxyde d'azote et neurotoxicité (2023)Lien
- [12] Apport du monitorage électroencéphalographique chez les patients recevant un traitement par cellule CAR-T dans le diagnostic et la prise en charge des ICANS (2025)Lien
- [13] Une cécité bilatérale, seul signe évocateur d'une microangiopathie thrombotique compliquée d'un syndrome d'encéphalopathie postérieure réversible chez un enfant (2024)Lien
- [14] Consommation de protoxyde d'azote et neurotoxicité - Louvain MedicalLien
- [15] Armes chimiques neurotoxiques - MSD ManualsLien
- [16] Pathologie neurotoxique - CEN NeurologieLien
- [17] Syndromes cliniques associés à la neurotoxicité - OITLien
Publications scientifiques
- Prise en charge du syndrome de neurotoxicité associée au traitement par cellules CAR-T chez l'adulte et l'enfant: recommandations de la SFGM-TC (2023)2 citations
- Caractéristiques IRM de la neurotoxicité centrale liée à la chimiothérapie: revue illustrée (2025)
- Stroke like syndrome dû au methotrexate en intrathécal: a propos d'un cas (2023)
- Prise en charge du syndrome de relargage cytokinique et du syndrome d'activation macrophagique après traitement par CAR-T cells: recommandations de la SFGM … (2023)2 citations
- Consommation de protoxyde d'azote et neurotoxicité (2023)1 citations
Ressources web
- Armes chimiques neurotoxiques - Lésions et intoxications (msdmanuals.com)
L'exposition à des agents neurotoxiques peut entraîner des troubles neurologiques et neurocomportementaux à long terme, notamment une anxiété, une dépression, ...
- 22 – Pathologie neurotoxique (cen-neurologie.fr)
un syndrome parkinsonien (incluant syndrome malin des neuroleptiques) · des mouvements anormaux (de façon aiguë ou chronique) · une crise d'épilepsie ou la ...
- Syndromes cliniques associés à la neurotoxicité (iloencyclopaedia.org)
17 févr. 2011 — Les syndromes neurotoxiques, provoqués par des substances qui altèrent les tissus nerveux, constituent l'un des dix principaux troubles ...
- Douleur neuropathique - Troubles neurologiques (msdmanuals.com)
Le diagnostic est établi devant une douleur disproportionnée en regard de l'atteinte tissulaire, une dysesthésie (p. ex., des brûlures, des picotements) et des ...
- Diagnostic des neuropathies périphériques (has-sante.fr)
L'évaluation et la surveillance d'une PNP cliniquement nette, homogène, symétrique et de cause identifiée (diabète, insuffisance rénale, traitement neurotoxique) ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
