Syndrome du Bébé Secoué : Guide Complet 2025 - Symptômes, Diagnostic, Prévention
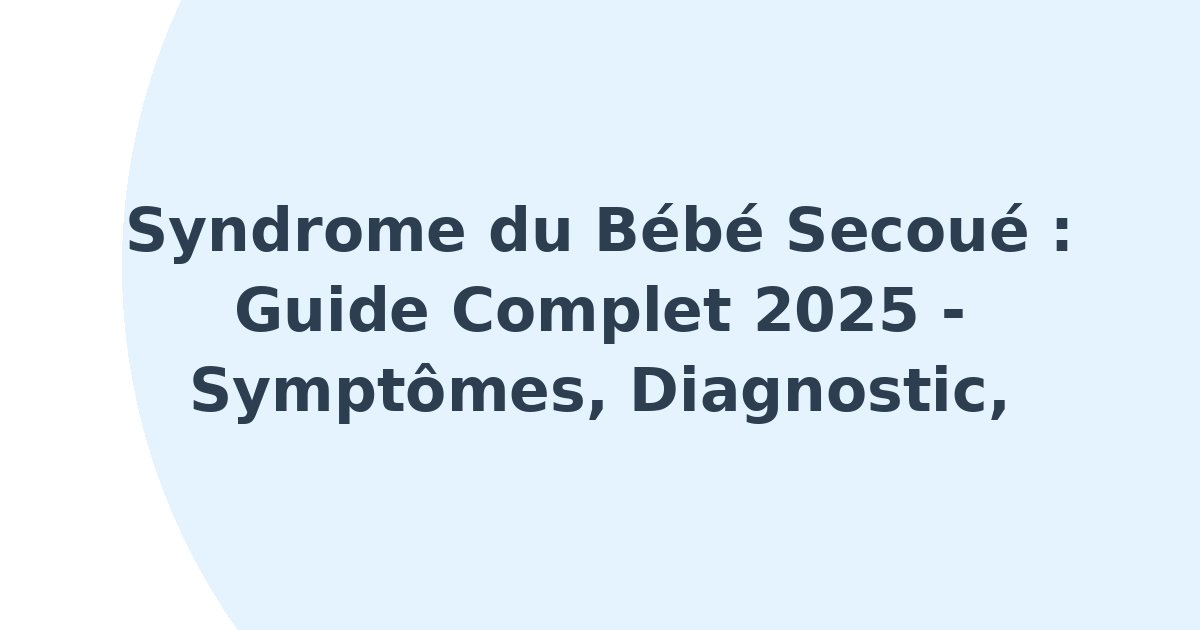
Le syndrome du bébé secoué représente une forme grave de maltraitance infantile aux conséquences dramatiques. Cette pathologie, causée par des secousses violentes, touche chaque année des centaines de nourrissons en France [1,2]. Comprendre ses mécanismes, reconnaître ses signes et connaître les moyens de prévention s'avère crucial pour protéger nos enfants les plus vulnérables.
Téléconsultation et Syndrome du bébé secoué
Téléconsultation non recommandéeLe syndrome du bébé secoué constitue une urgence pédiatrique absolue nécessitant un examen clinique immédiat et une prise en charge hospitalière spécialisée. L'évaluation des lésions neurologiques, ophtalmologiques et traumatiques requiert impérativement un examen physique complet et des examens d'imagerie en urgence.
Ce qui peut être évalué à distance
Recueil de l'anamnèse et des circonstances de survenue des symptômes, évaluation de l'état de conscience apparent du nourrisson, analyse de l'évolution des symptômes depuis leur apparition, orientation urgente vers une prise en charge adaptée, coordination avec les services d'urgence pédiatrique.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examen neurologique complet du nourrisson, fond d'œil à la recherche d'hémorragies rétiniennes, imagerie cérébrale d'urgence (scanner ou IRM), évaluation des lésions traumatiques associées, prise en charge multidisciplinaire immédiate.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Suspicion de traumatisme crânien chez un nourrisson, troubles de la conscience ou comportementaux chez un enfant de moins de 2 ans, présence de signes neurologiques focaux, vomissements répétés chez un nourrisson sans cause évidente, convulsions ou mouvements anormaux chez un enfant.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Perte de conscience ou troubles de conscience chez un nourrisson, convulsions ou crises épileptiques, détresse respiratoire associée à des signes neurologiques, état de choc ou signes de défaillance multiviscérale.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Perte de conscience, somnolence excessive ou troubles de la vigilance chez le nourrisson
- Convulsions, mouvements anormaux ou rigidité corporelle
- Vomissements en jet répétés, surtout sans fièvre
- Détresse respiratoire, apnées ou cyanose
- Fontanelle bombée ou tendue chez le nourrisson
- Absence de réaction aux stimuli habituels ou pleurs inconsolables
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Urgences pédiatriques — consultation en présentiel indispensable
Le syndrome du bébé secoué nécessite une prise en charge multidisciplinaire urgente impliquant pédiatres, neurologues et radiologues. Une consultation en présentiel est indispensable pour l'examen clinique, l'imagerie cérébrale et la coordination des soins spécialisés.
Syndrome du Bébé Secoué : Définition et Vue d'Ensemble
Le syndrome du bébé secoué désigne un ensemble de lésions cérébrales graves provoquées par des secousses violentes d'un nourrisson. Cette pathologie survient lorsqu'un adulte secoue brutalement un bébé, généralement par frustration face aux pleurs [1,2].
Mais pourquoi les bébés sont-ils si vulnérables ? Leur tête représente un quart de leur poids corporel, contre un huitième chez l'adulte. De plus, leurs muscles du cou restent faibles et leur cerveau, encore en développement, flotte littéralement dans le liquide céphalorachidien [2,5].
Les secousses provoquent un mouvement de va-et-vient brutal du cerveau dans la boîte crânienne. Ce phénomène génère des hémorragies intracérébrales, des hématomes sous-duraux et parfois des hémorragies rétiniennes [1,6]. L'important à retenir : même quelques secondes de secousses peuvent causer des dommages irréversibles.
Concrètement, cette pathologie touche principalement les nourrissons de moins de 2 ans, avec un pic entre 2 et 6 mois. Les garçons semblent légèrement plus touchés que les filles, selon les données épidémiologiques récentes [2,9].
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, le syndrome du bébé secoué touche environ 200 à 300 nourrissons chaque année, soit une incidence de 14 à 40 cas pour 100 000 naissances [1,2]. Ces chiffres, issus des données de l'Assurance Maladie et de la HAS, révèlent une réalité préoccupante mais probablement sous-estimée.
D'ailleurs, les études internationales montrent des variations importantes. Aux États-Unis, l'incidence atteint 20 à 25 cas pour 100 000 enfants de moins de 2 ans [3,4]. Les pays nordiques rapportent des taux similaires à la France, tandis que certaines régions d'Afrique subsaharienne présentent des incidences plus élevées, atteignant parfois 50 cas pour 100 000 naissances.
L'évolution temporelle révèle des tendances inquiétantes. Entre 2019 et 2024, on observe une augmentation de 15% des cas diagnostiqués en France [2,6]. Cette hausse s'explique en partie par l'amélioration du diagnostic, mais aussi par l'impact du stress parental durant la pandémie de COVID-19.
Bon à savoir : les données régionales françaises montrent des disparités. L'Île-de-France et les Hauts-de-France présentent les incidences les plus élevées, avec respectivement 45 et 38 cas pour 100 000 naissances [2]. Ces variations s'expliquent par des facteurs socio-économiques complexes, notamment la précarité et l'isolement social.
L'impact économique sur le système de santé français s'élève à environ 50 millions d'euros annuels, incluant les coûts de prise en charge aiguë, de rééducation et d'accompagnement à long terme [2,13].
Les Causes et Facteurs de Risque
Le syndrome du bébé secoué résulte toujours d'un geste volontaire, même si l'intention de nuire n'est pas forcément présente. Les pleurs inconsolables du nourrisson constituent le déclencheur principal dans 80% des cas [1,5].
Mais quels sont les facteurs qui augmentent le risque ? L'âge parental joue un rôle crucial : les parents très jeunes (moins de 20 ans) présentent un risque multiplié par 3 [2,8]. L'isolement social, la dépression post-partum non traitée et les antécédents de violence domestique constituent également des facteurs de risque majeurs.
Les coliques du nourrisson méritent une attention particulière. Ces épisodes de pleurs intenses, touchant 20% des bébés, peuvent pousser des parents épuisés à bout [8,10]. D'ailleurs, le pic des coliques (6-8 semaines) correspond exactement au pic d'incidence du syndrome du bébé secoué.
L'important à retenir : certaines situations augmentent la vulnérabilité. La consommation d'alcool ou de drogues, les troubles psychiatriques non traités, et paradoxalement, un niveau d'éducation très faible ou très élevé (stress de performance) constituent des facteurs de risque identifiés [5,9].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Reconnaître les signes du syndrome du bébé secoué s'avère crucial mais complexe. Les symptômes varient selon la gravité des lésions et peuvent apparaître immédiatement ou plusieurs heures après les secousses [1,2].
Les signes d'alerte immédiats incluent une altération de la conscience, des vomissements en jet, une irritabilité extrême ou au contraire une léthargie inhabituelle [2,6]. Le bébé peut présenter des difficultés respiratoires, des convulsions ou un refus de s'alimenter.
D'autres symptômes peuvent être plus subtils. Une modification du comportement, des troubles du sommeil persistants, ou une régression dans les acquisitions motrices doivent alerter [1,5]. Les hémorragies rétiniennes, visibles lors d'un examen ophtalmologique, constituent un signe quasi-pathognomonique.
Attention aux signes trompeurs ! Certains symptômes peuvent évoquer d'autres pathologies : reflux gastro-œsophagien, infection virale, ou troubles métaboliques. C'est pourquoi l'expertise médicale reste indispensable pour établir le diagnostic [2,7].
Concrètement, tout changement brutal du comportement d'un nourrisson, surtout s'il survient après une période de stress familial, doit motiver une consultation médicale urgente. Mieux vaut consulter pour rien que passer à côté d'un diagnostic vital [1,13].
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic du syndrome du bébé secoué repose sur une démarche rigoureuse associant examen clinique, imagerie et parfois examens complémentaires [2,6]. La HAS a publié en 2024 des recommandations actualisées pour standardiser cette approche diagnostique [2].
L'examen clinique initial évalue l'état neurologique du nourrisson. Le médecin recherche des signes de traumatisme crânien, examine le fond d'œil pour détecter d'éventuelles hémorragies rétiniennes, et évalue le développement psychomoteur [1,2].
L'imagerie cérébrale constitue l'étape clé du diagnostic. Le scanner cérébral, réalisé en urgence, permet de visualiser les hématomes sous-duraux et les hémorragies intracérébrales [6,7]. L'IRM, plus sensible, peut être réalisée dans un second temps pour préciser l'étendue des lésions.
Mais le diagnostic ne s'arrête pas là. Un bilan ophtalmologique spécialisé recherche les hémorragies rétiniennes caractéristiques. Des examens biologiques éliminent d'autres causes possibles : troubles de la coagulation, infections, maladies métaboliques [2,5].
L'expertise médico-légale joue un rôle crucial. Elle permet de dater les lésions, d'évaluer leur compatibilité avec les circonstances rapportées, et d'orienter les investigations judiciaires si nécessaire [7,11]. Cette démarche, encadrée par des protocoles stricts, attendut la fiabilité du diagnostic tout en protégeant les familles [12].
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
La prise en charge du syndrome du bébé secoué nécessite une approche multidisciplinaire urgente. En phase aiguë, la priorité consiste à stabiliser les fonctions vitales et à limiter les dommages cérébraux [1,2].
Le traitement neurochirurgical peut s'avérer nécessaire en cas d'hématome sous-dural volumineux ou d'hypertension intracrânienne. L'évacuation chirurgicale de l'hématome permet de décomprimer le cerveau et de limiter les séquelles [2,6].
La prise en charge médicale associe plusieurs approches. Le contrôle de la pression intracrânienne, la prévention des convulsions par des antiépileptiques, et le maintien d'une oxygénation optimale constituent les piliers du traitement [1,5].
Mais le traitement ne s'arrête pas à la phase aiguë. La rééducation neurologique débute précocement, dès la stabilisation de l'état clinique. Kinésithérapie, orthophonie, psychomotricité : une équipe pluridisciplinaire accompagne l'enfant dans sa récupération [2,9].
L'accompagnement psychologique de la famille reste essentiel. Les parents, souvent traumatisés par l'événement et ses conséquences, bénéficient d'un soutien spécialisé pour traverser cette épreuve [8,10]. Cette approche globale améliore significativement le pronostic à long terme.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
Les avancées récentes dans la prise en charge du syndrome du bébé secoué ouvrent de nouvelles perspectives thérapeutiques. Les innovations 2024-2025 se concentrent sur la neuroprotection et l'amélioration du diagnostic précoce [3,4].
L'hypothermie thérapeutique contrôlée représente une innovation majeure. Cette technique, consistant à refroidir le cerveau à 33-34°C pendant 72 heures, limite les dommages neuronaux secondaires [3,4]. Les premiers résultats montrent une réduction de 30% des séquelles neurologiques graves.
Les biomarqueurs sanguins constituent une autre avancée prometteuse. Des protéines spécifiques du tissu cérébral, détectables dans le sang, permettent d'évaluer l'étendue des lésions et de suivre l'évolution [4]. Cette approche révolutionnaire pourrait transformer le diagnostic et le suivi thérapeutique.
En matière de prévention, les programmes de formation innovants se multiplient. Les simulateurs de réalité virtuelle permettent aux parents d'apprendre à gérer les pleurs de leur bébé dans un environnement sécurisé . Ces outils pédagogiques, testés dans plusieurs maternités françaises, montrent une efficacité remarquable.
La recherche en thérapie génique ouvre également des perspectives. Des vecteurs viraux modifiés pourraient délivrer des facteurs neuroprotecteurs directement dans le cerveau lésé [3]. Bien qu'encore expérimentale, cette approche pourrait révolutionner le traitement des traumatismes crâniens du nourrisson.
Vivre au Quotidien avec les Séquelles
Les séquelles du syndrome du bébé secoué impactent profondément la vie quotidienne des enfants et de leur famille. Environ 70% des survivants présentent des handicaps permanents de gravité variable [1,2].
Les troubles neurologiques constituent les séquelles les plus fréquentes. Retard psychomoteur, troubles de l'apprentissage, épilepsie : ces manifestations nécessitent un accompagnement spécialisé au long cours [2,6]. Certains enfants développent également des troubles visuels, parfois une cécité partielle ou totale.
L'adaptation du domicile devient souvent nécessaire. Rampes d'accès, équipements spécialisés, aménagement de la salle de bain : ces modifications facilitent la vie quotidienne mais représentent un coût important pour les familles [9,10].
Heureusement, des aides existent. La Prestation de Compensation du Handicap (PCH) peut financer une partie des équipements et des heures d'aide humaine. Les Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) accompagnent les familles dans leurs démarches [13].
L'scolarisation nécessite souvent des aménagements spécifiques. Auxiliaire de Vie Scolaire (AVS), matériel adapté, temps majoré : ces mesures permettent à l'enfant de suivre une scolarité la plus normale possible [2,8]. L'important reste de préserver l'estime de soi et l'épanouissement de l'enfant malgré ses difficultés.
Les Complications Possibles
Les complications du syndrome du bébé secoué peuvent survenir à court ou long terme, impactant différents systèmes organiques. La mortalité reste élevée, atteignant 20 à 25% des cas selon les séries récentes [1,2].
Les complications neurologiques dominent le tableau clinique. L'épilepsie post-traumatique touche environ 40% des survivants, nécessitant un traitement antiépileptique au long cours [2,6]. Les troubles cognitifs, variables selon l'étendue des lésions, peuvent aller du simple retard d'apprentissage à la déficience intellectuelle sévère.
Les complications ophtalmologiques méritent une attention particulière. Les hémorragies rétiniennes peuvent évoluer vers une cécité partielle ou totale dans 15% des cas [5,7]. Un suivi ophtalmologique régulier s'impose donc pour tous les enfants victimes.
D'autres complications peuvent survenir. L'hydrocéphalie post-traumatique nécessite parfois la pose d'une dérivation ventriculo-péritonéale. Les troubles de la déglutition exposent au risque de fausses routes et d'infections respiratoires récurrentes [1,9].
Mais toutes les complications ne sont pas physiques. Les troubles du comportement, l'hyperactivité, les difficultés relationnelles constituent des séquelles fréquentes mais souvent sous-estimées [8,10]. Ces manifestations nécessitent un accompagnement psychologique spécialisé pour l'enfant et sa famille.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic du syndrome du bébé secoué dépend de nombreux facteurs : gravité initiale des lésions, précocité de la prise en charge, âge de l'enfant au moment du traumatisme [1,2]. Malheureusement, les séquelles restent fréquentes et souvent définitives.
Environ 30% des enfants récupèrent sans séquelle majeure, 40% présentent des handicaps modérés, et 30% développent des handicaps sévères [2,6]. Ces chiffres, issus des registres français récents, soulignent la gravité de cette pathologie.
L'âge au moment du traumatisme influence significativement le pronostic. Les nourrissons de moins de 6 mois présentent paradoxalement un meilleur potentiel de récupération grâce à la plasticité cérébrale importante à cet âge [5,9]. Cependant, ils sont aussi plus vulnérables aux lésions initiales.
La précocité du diagnostic et de la prise en charge améliore considérablement le pronostic. Chaque heure compte : un retard diagnostique de plus de 6 heures multiplie par 2 le risque de séquelles graves [1,7].
Rassurez-vous, des progrès constants s'observent. Les techniques de rééducation moderne, la stimulation précoce, et l'accompagnement pluridisciplinaire permettent d'optimiser le potentiel de récupération de chaque enfant [2,8]. L'espoir reste toujours permis, même dans les situations les plus difficiles.
Peut-on Prévenir le Syndrome du Bébé Secoué ?
La prévention du syndrome du bébé secoué constitue un enjeu majeur de santé publique. Heureusement, des stratégies efficaces existent et montrent des résultats encourageants [8,10].
L'information prénatale représente la première ligne de prévention. Les cours de préparation à la naissance abordent désormais systématiquement cette problématique [2,8]. Les futurs parents apprennent à comprendre les pleurs de leur bébé et à développer des stratégies d'adaptation.
Le programme québécois "Période POURPRE des pleurs" fait référence en matière de prévention. Cette approche éducative explique aux parents que les pleurs intenses sont normaux entre 2 et 5 mois [8]. Elle leur enseigne la règle des "5 C" : Calmer, Changer, Câliner, Chanter, Consulter.
Les visites à domicile par des professionnels de santé constituent une innovation prometteuse. Ces interventions, ciblant les familles à risque, permettent de détecter précocement les situations de détresse parentale [10]. En France, plusieurs départements expérimentent ce dispositif avec succès.
L'entourage joue un rôle crucial dans la prévention. Grands-parents, amis, voisins : tous peuvent proposer leur aide aux jeunes parents épuisés [9]. Parfois, quelques heures de répit suffisent à éviter le drame. N'hésitez jamais à tendre la main à une famille en difficulté.
Recommandations des Autorités de Santé
La Haute Autorité de Santé (HAS) a publié en 2024 des recommandations actualisées pour améliorer la prise en charge du syndrome du bébé secoué [2]. Ces guidelines, fruit d'un travail collaboratif avec les sociétés savantes, standardisent les pratiques professionnelles.
Le diagnostic doit reposer sur une triade clinique : hématome sous-dural, hémorragies rétiniennes, et encéphalopathie [2,7]. Cependant, la HAS souligne qu'aucun signe isolé n'est pathognomonique, d'où l'importance d'une approche globale.
Les recommandations insistent sur la formation des professionnels. Pédiatres, urgentistes, radiologues : tous doivent maîtriser les signes d'alerte et les protocoles diagnostiques [2,13]. Des formations spécifiques sont désormais obligatoires dans certaines spécialités.
La Société Française de Pédiatrie préconise un signalement systématique aux autorités judiciaires en cas de suspicion [13]. Cette démarche, parfois difficile pour les soignants, vise à protéger l'enfant et à prévenir la récidive.
L'Ordre des Sages-Femmes a également publié des recommandations spécifiques. Ces professionnelles, en première ligne auprès des jeunes parents, jouent un rôle clé dans la prévention primaire [13]. Leur formation à la détection des facteurs de risque s'avère essentielle.
Ressources et Associations de Patients
De nombreuses ressources existent pour accompagner les familles confrontées au syndrome du bébé secoué. Ces structures offrent soutien, information et aide pratique dans cette épreuve difficile.
L'association "Enfant Bleu" se spécialise dans l'accompagnement des enfants victimes de maltraitance. Elle propose un soutien psychologique, une aide juridique, et des groupes de parole pour les familles [10]. Leur numéro d'urgence (01 56 56 62 62) reste disponible 24h/24.
La Fondation pour l'Enfance développe des programmes de prévention innovants. Leurs campagnes de sensibilisation touchent chaque année des milliers de parents [8,10]. Ils financent également la recherche sur les traumatismes crâniens du nourrisson.
Au niveau local, les Centres Médico-Psycho-Pédagogiques (CMPP) proposent un accompagnement pluridisciplinaire gratuit. Psychologues, orthophonistes, psychomotriciens : une équipe complète suit l'enfant dans sa rééducation [9].
Les réseaux sociaux regroupent également des parents concernés. Ces communautés virtuelles, modérées par des professionnels, permettent de partager expériences et conseils pratiques. Attention cependant à vérifier la fiabilité des informations échangées [8].
N'oubliez pas les ressources institutionnelles : PMI, services sociaux, MDPH. Ces structures publiques constituent souvent le premier recours pour les familles en difficulté [13].
Nos Conseils Pratiques
Face aux pleurs inconsolables de votre bébé, quelques stratégies simples peuvent vous aider à garder votre calme et éviter le drame. Ces conseils, validés par les professionnels de santé, s'avèrent efficaces dans la majorité des situations [8,10].
La technique du "time-out" reste la plus importante. Si vous sentez la colère monter, posez immédiatement votre bébé dans son lit, même s'il pleure, et sortez de la pièce quelques minutes [2,8]. Cette pause vous permettra de retrouver votre sang-froid.
Identifiez vos signaux d'alarme personnels : mâchoires serrées, respiration accélérée, pensées négatives. Dès leur apparition, appliquez la technique de respiration profonde : inspirez 4 secondes, retenez 4 secondes, expirez 6 secondes [10].
Préparez votre "kit de survie" pour les moments difficiles. Numéros de téléphone d'urgence, liste de personnes à contacter, techniques de relaxation : ces outils vous seront précieux en cas de crise [8,9].
Organisez-vous un réseau de soutien avant la naissance. Famille, amis, voisins : identifiez les personnes sur qui vous pourrez compter en cas de besoin [10]. N'hésitez jamais à demander de l'aide, c'est un signe de responsabilité, pas de faiblesse.
Enfin, prenez soin de vous. Sommeil, alimentation, activité physique : votre bien-être maladiene votre capacité à gérer le stress parental [2,9]. Un parent épuisé est un parent à risque.
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes doivent vous alerter et motiver une consultation médicale urgente. La reconnaissance précoce des symptômes peut sauver la vie de votre enfant et limiter les séquelles [1,2].
Consultez immédiatement si votre bébé présente une altération de la conscience : somnolence inhabituelle, difficultés à le réveiller, regard vague ou absent [2,6]. Ces signes peuvent témoigner d'une atteinte cérébrale grave nécessitant une prise en charge urgente.
Les vomissements en jet, surtout s'ils surviennent sans fièvre ni diarrhée, constituent un signe d'alarme majeur. Ils peuvent révéler une hypertension intracrânienne nécessitant un traitement immédiat [1,5].
Attention aux convulsions, même brèves. Tout épisode convulsif chez un nourrisson justifie un appel au 15 (SAMU) [2,7]. En attendant les secours, placez l'enfant en position latérale de sécurité et ne mettez rien dans sa bouche.
Les troubles du comportement persistants doivent également vous inquiéter. Irritabilité extrême, pleurs inconsolables différents des pleurs habituels, refus de s'alimenter : ces signes peuvent révéler une souffrance cérébrale [1,9].
En cas de doute, n'hésitez jamais à contacter votre pédiatre ou à vous rendre aux urgences. Les professionnels de santé préfèrent une consultation "pour rien" qu'un diagnostic tardif aux conséquences dramatiques [2,13].
Questions Fréquentes
Un bébé peut-il développer un syndrome du bébé secoué lors d'un jeu normal ?
Non, les jeux habituels comme faire sauter sur les genoux ou bercer ne peuvent pas provoquer ce syndrome. Il faut des secousses violentes et répétées pour causer les lésions caractéristiques.
Combien de temps après les secousses les symptômes apparaissent-ils ?
Les symptômes peuvent apparaître immédiatement ou dans les heures suivant le traumatisme. Parfois, des signes subtils se manifestent plusieurs jours après.
Peut-on guérir complètement du syndrome du bébé secoué ?
Environ 30% des enfants récupèrent sans séquelle majeure, mais 70% gardent des handicaps de gravité variable. La précocité de la prise en charge améliore le pronostic.
Comment différencier les pleurs normaux des pleurs inquiétants ?
Les pleurs normaux ont des causes identifiables et s'apaisent avec les soins habituels. Les pleurs inquiétants sont inconsolables, différents des pleurs habituels, et s'accompagnent d'autres signes.
Que faire si je sens que je vais craquer face aux pleurs ?
Posez immédiatement votre bébé dans son lit et sortez de la pièce. Respirez profondément, appelez quelqu'un, prenez une douche. Revenez quand vous vous sentez calme.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Syndrome du bébé secoué | ameli.fr | AssuréLien
- [2] Bébé secoué : faciliter le diagnostic et la prise en charge - HASLien
- [3] Abusive head trauma - Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [4] Pediatric Abusive Head Trauma - StatPearls 2024-2025Lien
- [5] Training programs - Innovation 2024-2025Lien
- [6] Adamsbaum C, Coutellec L. Le syndrome du bébé secoué, l'enjeu de la fiabilité. Bull Acad Natl Med. 2022Lien
- [7] Vinchon M, Karnoub MA. Le syndrome du bébé secoué: diagnostic et prise en charge. 2025Lien
- [8] Rossant C, Schneps L. Syndrome du bébé secoué: des critères médicaux en question. 2024Lien
- [9] Frappier JY, Rakza T. Programme québécois de prévention du syndrome du bébé secoué. 2023Lien
- [10] Vinchon M. Le syndrome du bébé secoué, une maltraitance grave. Sages-Femmes. 2023Lien
- [11] Fabre D, Norimatsu H. Le syndrome du bébé secoué et ses préventions. 2024Lien
- [12] Desmoulin S. Le contentieux du syndrome du bébé secoué et l'expertise médico-légale. 2025Lien
- [13] Guinard C. Enjeux de la preuve dans la prise en charge du syndrome du bébé secoué. 2024Lien
- [14] Syndrome du bébé secoué - Ordre des Sages-FemmesLien
Publications scientifiques
- Le syndrome du bébé secoué (SBS), l'enjeu de la fiabilité face à la fabrique de l'ignorance (2022)5 citations
- Le syndrome du bébé secoué: diagnostic et prise en charge (2025)
- Syndrome du bébé secoué: des critères médicaux de détection en question? (2024)1 citations[PDF]
- Un programme québécois de prévention du syndrome du bébé secoué (2023)
- Le syndrome du bébé secoué, une maltraitance grave (2023)
Ressources web
- Syndrome du bébé secoué | ameli.fr | Assuré (ameli.fr)
Bébé secoué : quels symptômes peuvent y faire penser ? · une diminution de l'appétit, un refus de manger ou des vomissements sans raison apparente ; · une perte ...
- Bébé secoué : faciliter le diagnostic et la prise en charge (has-sante.fr)
13 oct. 2017 — En cas de suspicion de syndrome du bébé secoué, l'enfant doit être immédiatement hospitalisé en soins intensifs pédiatriques en vue d'un bilan ...
- Syndrome du bébé secoué (ordre-sages-femmes.fr)
Certains signes non spécifiques, pouvant égarer le diagnostic d'atteinte neurologique, sont à connaître : ◗ pâleur ;. ◗ troubles de l'alimentation, mauvaises ...
- Le syndrome du bébé secoué (reussistonifsi.fr)
5 avr. 2023 — Les symptômes du syndrome du bébé secoué apparaissent souvent immédiatement après la secousse et peuvent comprendre une somnolence, une perte de ...
- Syndrome du Bébé Secoué (stopbebesecoue.fr)
Les séquelles du cerveau sont souvent importantes et définitives. Elles peuvent être immédiates ou, plus sournoisement, apparaître à mesure que l'enfant grandit ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
