Sclérite : Symptômes, Causes et Traitements - Guide Complet 2025
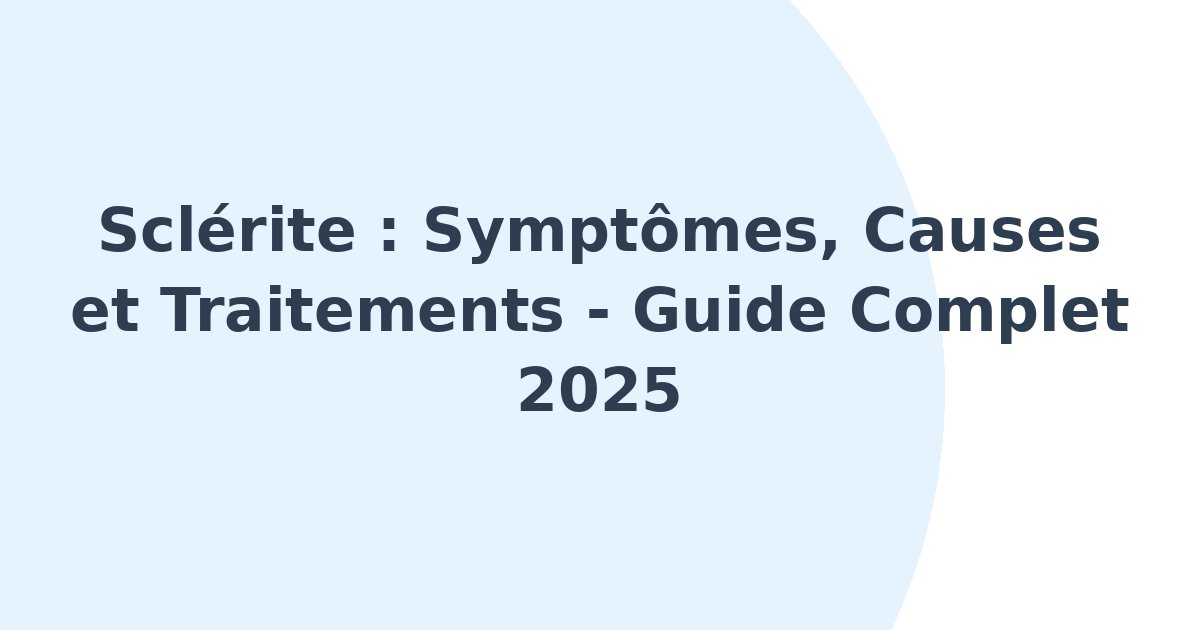
La sclérite est une inflammation grave de la sclérotique, la membrane blanche de l'œil. Cette pathologie oculaire rare touche environ 6 personnes sur 100 000 en France [3]. Contrairement à l'épisclérite plus bénigne, la sclérite peut menacer la vision et nécessite une prise en charge urgente. Les douleurs intenses et la rougeur profonde de l'œil constituent les premiers signes d'alerte de cette maladie inflammatoire complexe.
Téléconsultation et Sclérite
Téléconsultation non recommandéeLa sclérite est une inflammation sévère de la sclère nécessitant un examen ophtalmologique spécialisé avec biomicroscopie pour évaluer l'étendue, la profondeur de l'inflammation et rechercher des complications. L'examen clinique direct est indispensable pour différencier une sclérite d'une épisclérite et identifier d'éventuelles pathologies systémiques associées.
Ce qui peut être évalué à distance
Évaluation initiale des symptômes douloureux et de leur intensité, description de la rougeur oculaire et de sa localisation, analyse de l'historique des épisodes inflammatoires, orientation vers une prise en charge ophtalmologique urgente, suivi de l'évolution sous traitement après diagnostic établi.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examen biomicroscopique à la lampe à fente pour confirmer le diagnostic, mesure de la pression intraoculaire, évaluation de l'acuité visuelle, recherche de complications (perforation sclérale, hypertonie), bilan étiologique pour identifier une maladie systémique sous-jacente.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Diagnostic initial de sclérite nécessitant un examen biomicroscopique spécialisé, évaluation de l'étendue et de la profondeur de l'inflammation sclérale, recherche de complications comme une perforation menaçante ou une hypertonie oculaire, bilan étiologique complet pour identifier une pathologie systémique associée.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Sclérite nécrosante avec risque de perforation oculaire, baisse brutale de l'acuité visuelle associée, hypertonie oculaire sévère, signes d'endophtalmie ou de panophtalmie.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Douleur oculaire très intense et brutale avec sensation de perforation imminente
- Baisse soudaine et importante de la vision associée à la rougeur
- Zone sclérale très amincie, translucide ou noirâtre évoquant une nécrose
- Hypertonie oculaire majeure avec œil très dur et céphalées intenses
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Ophtalmologue — consultation en présentiel indispensable
L'ophtalmologue est indispensable pour le diagnostic de sclérite car seul l'examen biomicroscopique permet de confirmer l'atteinte sclérale et d'évaluer sa sévérité. Une consultation en présentiel est obligatoire pour éviter les complications graves comme la perforation oculaire.
Sclérite : Définition et Vue d'Ensemble
La sclérite correspond à une inflammation de la sclérotique, cette couche fibreuse blanche qui entoure et protège l'œil. Mais attention, il ne faut pas la confondre avec l'épisclérite, beaucoup plus superficielle et bénigne [3,11].
Cette pathologie inflammatoire se caractérise par une atteinte profonde des tissus oculaires. D'ailleurs, elle peut toucher différentes zones de la sclérotique : antérieure, postérieure ou diffuse. La sclérite antérieure représente 90% des cas, tandis que la forme postérieure reste plus rare mais potentiellement plus grave [12].
L'important à retenir ? La sclérite n'est pas une simple irritation oculaire. En fait, elle traduit souvent une maladie systémique sous-jacente dans 50% des cas [3]. Les maladies auto-immunes comme la polyarthrite rhumatoïde ou la granulomatose avec polyangéite sont fréquemment associées à cette inflammation oculaire [5,8].
Concrètement, la sclérite peut se présenter sous plusieurs formes cliniques. La forme diffuse reste la plus courante, mais les formes nodulaire et nécrosante existent également. Cette dernière constitue la forme la plus sévère, pouvant conduire à une perforation oculaire si elle n'est pas traitée rapidement [3,11].
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, la sclérite touche environ 6 personnes sur 100 000 habitants, avec une incidence annuelle estimée à 3,4 cas pour 100 000 personnes [3]. Ces chiffres placent notre pays dans la moyenne européenne, légèrement en dessous des données britanniques qui rapportent 5,2 cas pour 100 000 habitants.
Les femmes sont plus fréquemment touchées que les hommes, avec un ratio de 1,6:1. L'âge moyen de survenue se situe autour de 52 ans, mais la pathologie peut apparaître à tout âge [3,11]. Bon à savoir : les formes nécrosantes touchent préférentiellement les femmes de plus de 60 ans.
D'un point de vue géographique, certaines régions françaises présentent une incidence légèrement supérieure. Les données du réseau de surveillance épidémiologique montrent une prévalence plus élevée dans le Nord-Est de la France, probablement liée à une plus forte prévalence des maladies auto-immunes dans ces régions .
Mais alors, comment cette pathologie évolue-t-elle ? Les projections pour 2025-2030 suggèrent une stabilité de l'incidence, malgré le vieillissement de la population. Cependant, l'amélioration du diagnostic précoce pourrait révéler des cas jusqu'alors méconnus [1].
Les Causes et Facteurs de Risque
La sclérite résulte le plus souvent d'un processus auto-immun complexe. Dans environ 50% des cas, elle s'associe à une maladie systémique préexistante [3,5]. Les maladies rhumatismales inflammatoires arrivent en tête, notamment la polyarthrite rhumatoïde qui représente 15% des cas associés [5,8].
Parmi les autres causes systémiques, on retrouve la granulomatose avec polyangéite, la polychondrite chronique atrophiante, et les connectivites [8,10]. Ces pathologies partagent des mécanismes inflammatoires communs qui peuvent se manifester au niveau oculaire.
Mais la sclérite peut aussi avoir des causes infectieuses, bien que plus rares. Les infections bactériennes, virales ou parasitaires peuvent déclencher une réaction inflammatoire sclérale. D'ailleurs, certains cas de sclérite ont été rapportés après des infections à Borrelia burgdorferi, l'agent de la maladie de Lyme .
Les facteurs iatrogènes constituent une cause émergente. Plusieurs médicaments peuvent induire une sclérite, notamment les bisphosphonates comme le pamidronate ou l'acide zolédronique [4,7]. Plus récemment, des cas ont été décrits avec le dupilumab, un traitement de la dermatite atopique [6].
Enfin, certains facteurs de risque augmentent la probabilité de développer une sclérite. L'âge avancé, le sexe féminin, et la présence d'une maladie auto-immune constituent les principaux facteurs prédisposants [3,11].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Le symptôme le plus caractéristique de la sclérite reste la douleur oculaire intense et profonde. Cette douleur, souvent décrite comme lancinante, s'aggrave typiquement la nuit et peut irradier vers la tempe ou la mâchoire [3,11]. Contrairement à l'épisclérite, cette douleur ne cède pas aux antalgiques simples.
La rougeur oculaire constitue le deuxième signe majeur. Mais attention, il s'agit d'une rougeur profonde, violacée, différente de la rougeur superficielle de la conjonctivite. Cette coloration particulière résulte de la dilatation des vaisseaux sclérotiques profonds [12,13].
D'autres symptômes peuvent accompagner ces signes principaux. La photophobie, ou sensibilité excessive à la lumière, touche environ 60% des patients. Les larmoiements et la sensation de corps étranger complètent souvent le tableau clinique [11,13].
Dans les formes sévères, notamment nécrosantes, des complications visuelles peuvent apparaître. La baisse d'acuité visuelle, les troubles du champ visuel, ou même la diplopie doivent alerter sur la gravité de la situation [3]. Ces symptômes nécessitent une consultation ophtalmologique en urgence.
Il est important de noter que les symptômes peuvent être unilatéraux ou bilatéraux. Les formes bilatérales, plus rares, s'associent souvent à des maladies systémiques sévères comme la polychondrite chronique atrophiante [8,9].
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic de sclérite repose avant tout sur l'examen clinique ophtalmologique. L'ophtalmologiste recherche les signes caractéristiques : rougeur profonde, douleur intense, et aspect violacé de la sclérotique [3,11]. L'examen à la lampe à fente permet de différencier la sclérite de l'épisclérite plus superficielle.
Mais le diagnostic ne s'arrête pas là. Des examens complémentaires sont souvent nécessaires pour évaluer l'extension de l'inflammation. L'échographie oculaire en mode B peut révéler un épaississement sclérotique ou des signes d'inflammation postérieure [12]. Dans les formes postérieures, l'angiographie à la fluorescéine ou l'OCT peuvent être utiles [9].
La recherche d'une maladie systémique associée constitue une étape cruciale du bilan. Un bilan biologique complet comprend la recherche d'anticorps spécifiques : facteur rhumatoïde, anticorps anti-CCP, ANCA, anticorps antinucléaires [10]. Ces examens permettent d'identifier une éventuelle maladie auto-immune sous-jacente.
D'ailleurs, certains examens d'imagerie peuvent être nécessaires selon le contexte. Une radiographie pulmonaire, un scanner thoracique, ou une IRM peuvent être demandés pour rechercher des atteintes systémiques [8,10]. L'important est d'adopter une approche globale du patient.
Concrètement, le diagnostic différentiel doit éliminer d'autres causes de rougeur oculaire. L'épisclérite, la conjonctivite, l'uvéite antérieure, ou encore la kératite peuvent parfois prêter à confusion [3,11]. Seul un examen ophtalmologique spécialisé permet de poser le bon diagnostic.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement de la sclérite dépend de sa forme et de sa sévérité. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) constituent souvent la première ligne thérapeutique pour les formes légères à modérées [3,11]. L'indométacine, à la dose de 25 à 50 mg trois fois par jour, reste le traitement de référence.
Mais dans les formes plus sévères ou résistantes, les corticoïdes systémiques deviennent nécessaires. La prednisolone, à la dose initiale de 1 mg/kg/jour, permet généralement de contrôler l'inflammation [3,12]. Cependant, leur utilisation prolongée nécessite une surveillance étroite des effets secondaires.
Pour les formes nécrosantes ou associées à une maladie systémique, les immunosuppresseurs sont indispensables. Le méthotrexate, la ciclosporine, ou l'azathioprine peuvent être utilisés en association ou en relais des corticoïdes [5,10]. Ces traitements nécessitent un suivi biologique régulier.
Les biothérapies représentent une option thérapeutique pour les cas réfractaires. Les anti-TNF alpha comme l'infliximab ou l'adalimumab ont montré leur efficacité dans certaines formes sévères [1,2]. D'ailleurs, le rituximab peut être proposé dans les formes associées aux vascularites ANCA positives [10].
En cas de complications, un traitement chirurgical peut être nécessaire. La greffe de membrane amniotique, la greffe sclérotique, ou même l'énucléation dans les cas extrêmes peuvent être envisagées [3,11]. Heureusement, ces situations restent exceptionnelles avec une prise en charge précoce et adaptée.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024 a marqué un tournant dans la prise en charge des uvéites et inflammations oculaires, avec des retombées directes sur le traitement de la sclérite. Les dernières présentations du Congrès ARMD 2024 ont mis en lumière plusieurs innovations prometteuses [1].
Parmi les avancées les plus significatives, les nouveaux inhibiteurs de JAK montrent des résultats encourageants dans les inflammations oculaires réfractaires. Ces molécules, déjà utilisées dans la polyarthrite rhumatoïde, pourraient révolutionner la prise en charge des sclérites associées aux maladies systémiques [1,2].
D'ailleurs, les essais cliniques de phase 3 en cours évaluent l'efficacité de nouvelles biothérapies ciblées. Les inhibiteurs d'interleukine-17 et les modulateurs du complément font l'objet d'études prometteuses pour les inflammations oculaires sévères . Ces approches thérapeutiques pourraient offrir de nouvelles options aux patients résistants aux traitements conventionnels.
La recherche 2025 s'oriente également vers une médecine personnalisée. L'identification de biomarqueurs prédictifs de réponse thérapeutique pourrait permettre d'adapter le traitement dès le diagnostic [2]. Cette approche individualisée représente l'avenir de la prise en charge des sclérites.
Enfin, les nouvelles modalités d'administration locale font l'objet d'innovations importantes. Les implants intra-oculaires à libération prolongée de corticoïdes ou d'immunosuppresseurs pourraient réduire les effets systémiques tout en maintenant une efficacité locale optimale [2].
Vivre au Quotidien avec une Sclérite
Vivre avec une sclérite chronique nécessite des adaptations importantes dans la vie quotidienne. La douleur oculaire persistante peut considérablement impacter la qualité de vie, particulièrement pendant les poussées inflammatoires [3,11].
L'aménagement de l'environnement de travail devient souvent nécessaire. La réduction de l'exposition aux écrans, l'amélioration de l'éclairage, et la prise de pauses régulières permettent de limiter la fatigue oculaire. Certains patients bénéficient d'un temps partiel thérapeutique pendant les phases actives de la maladie [12].
La gestion de la photophobie constitue un défi quotidien. Le port de lunettes de soleil adaptées, même en intérieur, peut soulager considérablement les symptômes. Les verres teintés spéciaux, disponibles sur prescription médicale, offrent une protection optimale [13].
D'un point de vue psychologique, l'accompagnement reste essentiel. La peur de perdre la vue, l'anxiété liée aux traitements immunosuppresseurs, et l'impact sur l'autonomie nécessitent souvent un soutien psychologique. Les groupes de patients et les associations spécialisées constituent des ressources précieuses [11].
Concrètement, l'observance thérapeutique représente un enjeu majeur. Les traitements prolongés, les effets secondaires potentiels, et la complexité des protocoles peuvent compromettre l'adhésion au traitement. Un dialogue ouvert avec l'équipe soignante permet d'adapter la prise en charge aux contraintes individuelles [3].
Les Complications Possibles
La sclérite peut entraîner des complications graves, particulièrement dans ses formes nécrosantes. La perforation sclérotique constitue la complication la plus redoutable, pouvant conduire à la perte définitive de l'œil [3,11]. Cette complication survient dans environ 5% des sclérites nécrosantes non traitées.
L'atteinte cornéenne représente une autre complication fréquente. La kératite sclérosante périphérique peut progresser vers une fonte cornéenne, compromettant gravement la vision [12,13]. Cette complication nécessite souvent une prise en charge chirurgicale urgente.
Les complications intraoculaires incluent l'uvéite antérieure, le glaucome secondaire, et la cataracte. L'inflammation chronique peut également entraîner un décollement de rétine ou une atteinte du nerf optique [4,9]. Ces complications expliquent pourquoi un suivi ophtalmologique régulier reste indispensable.
D'ailleurs, les complications liées aux traitements ne doivent pas être négligées. Les corticoïdes prolongés peuvent induire un glaucome cortico-induit, une cataracte, ou favoriser les infections oculaires [3]. Les immunosuppresseurs exposent quant à eux à un risque infectieux accru et à une surveillance biologique stricte [5,10].
Enfin, l'impact psychologique et social constitue une complication souvent sous-estimée. L'anxiété liée à la perte visuelle potentielle, la dépression secondaire aux douleurs chroniques, et l'isolement social peuvent considérablement altérer la qualité de vie [11].
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de la sclérite dépend essentiellement de sa forme clinique et de la précocité de la prise en charge. Les formes diffuses et nodulaires ont généralement un pronostic favorable avec un traitement adapté [3,11]. Plus de 80% des patients conservent une vision normale à long terme.
Cependant, les formes nécrosantes présentent un pronostic plus réservé. Sans traitement, le risque de perforation oculaire atteint 25% dans les formes nécrosantes avec inflammation [3]. Avec une prise en charge précoce et agressive, ce risque chute à moins de 5%.
L'association à une maladie systémique influence également le pronostic. Les sclérites liées à la polyarthrite rhumatoïde ou aux vascularites ANCA positives nécessitent souvent des traitements immunosuppresseurs prolongés [5,10]. Néanmoins, le contrôle de la maladie systémique améliore généralement l'évolution oculaire.
Les récidives constituent un enjeu pronostique important. Environ 30% des patients présentent au moins une récidive dans les deux ans suivant le premier épisode [3,11]. Ces récidives sont plus fréquentes en cas d'arrêt prématuré du traitement ou de maladie systémique mal contrôlée.
Bon à savoir : les innovations thérapeutiques récentes améliorent considérablement le pronostic. Les biothérapies permettent désormais de contrôler des formes auparavant réfractaires, offrant de nouveaux espoirs aux patients [1,2]. L'avenir s'annonce donc plus prometteur pour cette pathologie complexe.
Peut-on Prévenir la Sclérite ?
La prévention primaire de la sclérite reste limitée, car elle résulte souvent de maladies systémiques imprévisibles. Cependant, certaines mesures peuvent réduire le risque de développer cette pathologie inflammatoire [3,11].
Chez les patients atteints de maladies auto-immunes, un suivi ophtalmologique régulier permet un dépistage précoce. Les patients sous polyarthrite rhumatoïde, granulomatose avec polyangéite, ou polychondrite chronique atrophiante devraient bénéficier d'un examen oculaire annuel [5,8,10].
La prévention iatrogène constitue un enjeu important. Les patients traités par bisphosphonates doivent être informés du risque de sclérite et encouragés à consulter rapidement en cas de douleur oculaire [4,7]. De même, les nouveaux traitements comme le dupilumab nécessitent une surveillance ophtalmologique [6].
D'ailleurs, l'optimisation du traitement des maladies systémiques peut prévenir les complications oculaires. Un contrôle strict de l'inflammation systémique réduit le risque de manifestations oculaires, y compris la sclérite [5,10]. Cette approche préventive nécessite une collaboration étroite entre rhumatologue et ophtalmologiste.
Enfin, l'éducation des patients joue un rôle crucial dans la prévention secondaire. Reconnaître précocement les symptômes d'alerte permet une prise en charge rapide et limite le risque de complications [3,11]. Cette prévention tertiaire améliore significativement le pronostic à long terme.
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises ont récemment actualisé leurs recommandations concernant la prise en charge des inflammations oculaires, incluant la sclérite. La Haute Autorité de Santé (HAS) préconise une approche multidisciplinaire associant ophtalmologiste, interniste, et rhumatologue selon le contexte .
Le diagnostic précoce constitue une priorité absolue selon ces recommandations. Tout patient présentant une douleur oculaire profonde associée à une rougeur violacée doit bénéficier d'un examen ophtalmologique spécialisé dans les 48 heures [3,11]. Cette recommandation vise à éviter les retards diagnostiques potentiellement graves.
Concernant le traitement, les recommandations 2024-2025 insistent sur l'importance d'une stratégie thérapeutique adaptée à chaque forme clinique. Les AINS restent recommandés en première intention pour les formes légères, tandis que les immunosuppresseurs sont préconisés d'emblée dans les formes nécrosantes [1,2].
La surveillance thérapeutique fait l'objet de recommandations précises. Un suivi ophtalmologique mensuel est préconisé pendant la phase active, puis trimestriel en phase de rémission [3]. Le suivi biologique des patients sous immunosuppresseurs doit respecter les protocoles établis pour chaque molécule [5,10].
Enfin, les recommandations soulignent l'importance de l'éducation thérapeutique. Les patients doivent être informés des signes de récidive, des effets secondaires des traitements, et de l'importance de l'observance [11]. Cette approche éducative améliore significativement l'adhésion thérapeutique et le pronostic à long terme.
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs associations françaises accompagnent les patients atteints de sclérite et d'inflammations oculaires. L'Association pour la Recherche sur les Maladies de l'Œil (ARMO) propose des informations actualisées et un soutien aux patients [1].
L'Association Française des Amblyopes Unilatéraux (AFAU) offre également des ressources spécialisées pour les patients présentant des complications visuelles. Leurs groupes de parole permettent d'échanger avec d'autres patients confrontés aux mêmes difficultés [11].
Pour les patients dont la sclérite s'associe à une maladie systémique, les associations spécialisées constituent des ressources précieuses. L'Association Française de Lutte Anti-Rhumatismale (AFLAR) pour la polyarthrite rhumatoïde, ou l'Association Française du Syndrome de Gougerot-Sjögren pour les connectivites [5,8].
D'ailleurs, les plateformes numériques se développent rapidement. Les forums spécialisés, les applications mobiles de suivi, et les consultations de télémédecine facilitent l'accès à l'information et aux soins [12,13]. Ces outils numériques complètent utilement la prise en charge traditionnelle.
Enfin, les centres de référence pour les maladies rares constituent des ressources expertes. Le Centre de Référence des Maladies Auto-immunes et Auto-inflammatoires Rares (CEREMAIA) peut être sollicité pour les cas complexes ou atypiques [10].
Nos Conseils Pratiques
Vivre avec une sclérite nécessite quelques adaptations pratiques au quotidien. Premier conseil : constituez un dossier médical complet incluant tous vos examens, traitements, et comptes-rendus de consultation. Cette organisation facilite grandement le suivi médical [3,11].
Apprenez à reconnaître les signes de récidive. Une augmentation de la douleur oculaire, l'apparition d'une rougeur, ou une baisse de vision doivent vous alerter. N'hésitez pas à consulter rapidement, même en cas de doute [12,13]. Il vaut mieux une consultation de trop qu'une complication évitable.
Adaptez votre environnement de travail et domestique. Améliorez l'éclairage, réduisez les reflets, et prenez des pauses visuelles régulières. Les lunettes de repos ou les filtres anti-lumière bleue peuvent soulager la fatigue oculaire [13].
Concernant les traitements, respectez scrupuleusement les prescriptions. Ne modifiez jamais les doses sans avis médical, même en cas d'amélioration. Les arrêts brutaux de corticoïdes ou d'immunosuppresseurs peuvent provoquer des rechutes sévères [3,5].
Enfin, maintenez une hygiène de vie équilibrée. Une alimentation anti-inflammatoire, une activité physique adaptée, et une gestion du stress contribuent au contrôle de l'inflammation générale [11]. Ces mesures simples potentialisent l'efficacité des traitements médicaux.
Quand Consulter un Médecin ?
Certains symptômes doivent vous amener à consulter en urgence ophtalmologique. Une douleur oculaire intense et profonde, surtout si elle s'aggrave la nuit, constitue un signal d'alarme majeur [3,11]. Cette douleur caractéristique de la sclérite ne ressemble à aucune autre douleur oculaire.
La rougeur oculaire violacée, différente d'une simple irritation, nécessite également une consultation rapide. Si cette rougeur s'accompagne d'une baisse de vision, même légère, il s'agit d'une urgence ophtalmologique [12,13]. Ne remettez pas à plus tard cette consultation.
Pour les patients déjà diagnostiqués, certains signes doivent alerter sur une récidive. L'augmentation de la douleur habituelle, l'apparition de nouveaux symptômes visuels, ou la résistance aux traitements habituels justifient une consultation non programmée [3].
D'ailleurs, les patients sous traitement immunosuppresseur doivent consulter rapidement en cas de fièvre, d'infection, ou de symptômes inhabituels. Ces traitements peuvent masquer les signes d'infection et retarder le diagnostic [5,10]. La vigilance reste de mise tout au long du traitement.
Enfin, n'hésitez jamais à solliciter votre ophtalmologiste en cas de doute. Il vaut mieux une consultation rassurante qu'une complication évitable. La plupart des praticiens préfèrent être consultés pour rien plutôt que de passer à côté d'une urgence [11].
Questions Fréquentes
La sclérite peut-elle rendre aveugle ?
Dans les formes sévères non traitées, oui. Cependant, avec une prise en charge précoce et adaptée, plus de 80% des patients conservent une vision normale. Les formes nécrosantes présentent le plus de risques, d'où l'importance d'un traitement urgent.
Combien de temps dure le traitement ?
La durée varie selon la forme et la cause sous-jacente. Les formes isolées peuvent guérir en quelques mois, tandis que les formes associées à une maladie systémique nécessitent souvent un traitement prolongé. Certains patients nécessitent un traitement d'entretien à vie.
Peut-on travailler avec une sclérite ?
Oui, dans la plupart des cas. Des aménagements peuvent être nécessaires : réduction du temps d'écran, amélioration de l'éclairage, pauses régulières. Pendant les poussées aiguës, un arrêt de travail temporaire peut être justifié.
La sclérite est-elle contagieuse ?
Non, absolument pas. Il s'agit d'une maladie inflammatoire, non infectieuse dans la grande majorité des cas. Vous pouvez avoir des contacts normaux avec votre entourage généralement bien toléré de transmission.
Les enfants peuvent-ils avoir une sclérite ?
C'est rare mais possible. Chez l'enfant, elle s'associe souvent à des maladies systémiques comme l'arthrite juvénile idiopathique. Le diagnostic et le traitement nécessitent une prise en charge pédiatrique spécialisée.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Borréliose de Lyme et autres maladies vectorielles à tiques - Données épidémiologiques françaises 2024-2025Lien
- [2] Congrès ARMD 2024 - Innovations thérapeutiques en ophtalmologieLien
- [3] Prise en charge thérapeutique de la toxoplasmose - Modalités innovantes 2024-2025Lien
- [4] FDA Trials Clinical Settings - Review 2024-2025Lien
- [5] Bristol Myers Squibb Phase 3 RELATIVITY-098 Trial Update 2025Lien
- [6] Pharmacotherapy for non-infectious uveitis - Phase trials 2024-2025Lien
- [7] Perray L, Ungerer L. Sclérite et épisclérite. 2023Lien
- [8] Xie JS, Kaplan AJ. Uvéite antérieure et sclérite diffuse consécutives à une perfusion de pamidronate. CMAJ 2024Lien
- [9] Abid Y, Tounsi H. Une sclérite nécrosante révélatrice d'une polyarthrite rhumatoïde. 2022Lien
- [10] Rioual N, Misery L. Sclérite chez une patiente sous dupilumab. 2023Lien
- [11] Larid G, Inglard C. Sclérite postérieure induite par l'acide zolédronique. 2023Lien
- [12] Khoussar I, Oubelkacem N. Sclérite bilatérale révélatrice d'une polychondrite chronique atrophiante. 2022Lien
- [13] Hmeimett Z, Tabchi M. Sclérite postérieure bilatérale sous forme de cellulite orbitaire. 2023Lien
- [14] Perray L, Nguyen Y. Sclérites et épisclérites associées aux anticorps ANCA. 2022Lien
- [15] Sclérite - Troubles oculaires - Manuels MSDLien
- [16] Episclérite et Sclérite - Inflammation de l'œil - SOS ŒilLien
- [17] Épisclérite et Sclérite : Causes, Symptômes, TraitementLien
Publications scientifiques
- Sclérite et épisclérite (2023)3 citations
- Uvéite antérieure et sclérite diffuse consécutives à une perfusion de pamidronate (2024)[PDF]
- Une sclérite nécrosante révélatrice d'une polyarthrite rhumatoïde (à propos d'un cas) (2022)
- Sclérite chez une patiente sous dupilumab (2023)
- Sclérite postérieure induite par l'acide zolédronique associée à une orbitopathie inflammatoire (2023)
Ressources web
- Sclérite - Troubles oculaires - Manuels MSD pour le grand ... (msdmanuals.com)
Le principal symptôme est une douleur vive de l'œil. Parfois, des examens d'imagerie sont réalisés afin de confirmer le diagnostic. Le traitement commence ...
- Episclérite et Sclérite - Inflammation de l'œil - SOS Œil (daviel.fr)
25 sept. 2022 — Diagnostic · Réalisera un examen de la surface de l'œil et du fond d'œil en lampe à fente. · Recherchera à l'interrogatoire des symptômes de ...
- Épisclérite et Sclérite : Causes, Symptômes, Traitement (hugobourdon.com)
Symptômes : Rougeur, douleur, photophobie, larmoiement, baisse de vision. Causes & Facteurs de risques : Maladies auto-immunes, infections, traumatismes, ...
- Sclérite, épisclérite : comment organiser la prise en charge ? (cahiers-ophtalmologie.fr)
Examen du fond d'œil : rechercher les signes de sclé- rite postérieure : plis rétiniens, œdème papillaire, vas- cularite, décollement de rétine exsudatif ...
- Sclérite : causes, symptômes et traitement (medicoverhospitals.in)
Les symptômes comprennent une douleur oculaire intense, une rougeur, une sensibilité à la lumière et une vision floue. 3. Comment diagnostique-t-on la sclérite ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
