Réticuloendothéliose Aviaire : Guide Complet 2025 - Symptômes, Diagnostic, Traitements
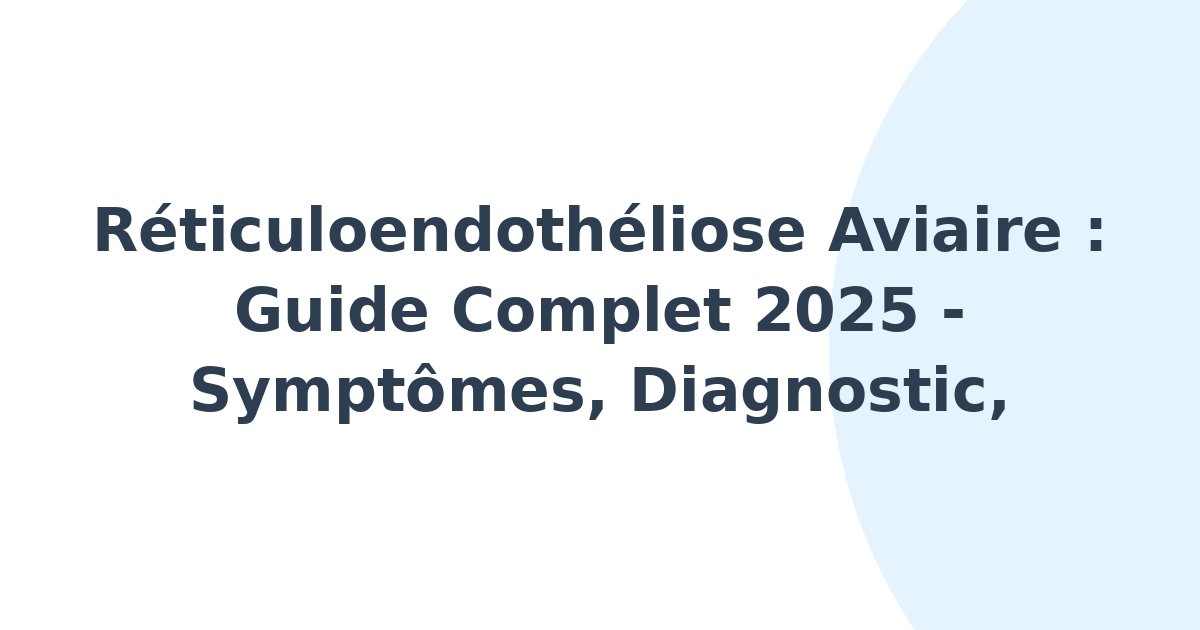
La réticuloendothéliose aviaire est une pathologie virale complexe qui affecte principalement les oiseaux domestiques et sauvages. Cette maladie, causée par le virus de la réticuloendothéliose (REV), peut avoir des répercussions importantes sur la santé aviaire et, dans certains cas, soulever des questions de santé publique. Comprendre cette pathologie est essentiel pour tous ceux qui travaillent avec les oiseaux ou s'en occupent.

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Réticuloendothéliose aviaire : Définition et Vue d'Ensemble
La réticuloendothéliose aviaire est une maladie virale qui touche le système immunitaire des oiseaux. Elle est causée par le virus de la réticuloendothéliose (REV), un rétrovirus qui s'intègre dans l'ADN des cellules hôtes [1,2].
Ce virus appartient à la famille des rétrovirus, comme le virus de l'immunodéficience humaine, mais il est spécifique aux oiseaux. Il affecte principalement les cellules du système réticuloendothélial, d'où son nom. Ces cellules jouent un rôle crucial dans les défenses immunitaires de l'organisme aviaire.
Contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, cette pathologie ne se transmet pas directement à l'homme. Cependant, elle peut avoir des conséquences économiques importantes dans l'industrie avicole [2,3]. Les oiseaux infectés développent souvent une immunodéficience qui les rend vulnérables à d'autres infections.
La maladie se caractérise par une prolifération anormale des cellules du système immunitaire, pouvant conduire à la formation de tumeurs. D'ailleurs, certaines formes de la maladie ressemblent à des leucémies ou des lymphomes chez les mammifères.
Épidémiologie en France et dans le Monde
L'épidémiologie de la réticuloendothéliose aviaire révèle une distribution mondiale de cette pathologie. En France, les données de surveillance vétérinaire indiquent une prévalence variable selon les régions et les types d'élevage [1,2].
Les études récentes montrent que la maladie touche principalement les volailles domestiques, avec une incidence plus élevée dans les élevages intensifs. Bon à savoir : les canards et les oies semblent particulièrement sensibles à certaines souches du virus [2]. Les régions à forte densité avicole, comme la Bretagne et les Pays de la Loire, rapportent davantage de cas.
Au niveau mondial, la pathologie est présente sur tous les continents. L'Asie du Sud-Est enregistre les taux les plus élevés, probablement en raison de la densité des élevages et des maladies climatiques favorables à la transmission [1,3]. En Europe, les pays nordiques semblent moins affectés, possiblement grâce à des mesures de biosécurité plus strictes.
Il est intéressant de noter que l'évolution de la maladie suit souvent les routes commerciales aviaires. Les échanges internationaux d'oiseaux reproducteurs peuvent faciliter la propagation de nouvelles souches virales. D'ailleurs, certaines épidémies récentes ont pu être retracées jusqu'à des importations d'animaux reproducteurs.
Les Causes et Facteurs de Risque
Le virus de la réticuloendothéliose (REV) est l'agent causal unique de cette pathologie. Ce rétrovirus présente plusieurs souches avec des degrés de virulence variables [1,2]. Certaines souches provoquent des formes aiguës rapidement mortelles, tandis que d'autres induisent des infections chroniques plus insidieuses.
Les facteurs de risque sont multiples et interconnectés. L'âge des oiseaux joue un rôle crucial : les jeunes animaux sont généralement plus susceptibles de développer des formes graves de la maladie [2,3]. Le stress, qu'il soit lié aux maladies d'élevage, au transport ou aux changements environnementaux, affaiblit le système immunitaire et favorise l'infection.
La densité d'élevage constitue un facteur de risque majeur. Dans les exploitations surpeuplées, la transmission virale s'effectue plus facilement par contact direct entre les oiseaux ou par l'intermédiaire de l'environnement contaminé [1]. Les maladies d'hygiène défaillantes amplifient ce risque.
Certaines pratiques d'élevage peuvent également favoriser la propagation. L'utilisation d'équipements non désinfectés, le mélange d'oiseaux d'âges différents ou la présence d'autres pathologies concomitantes créent des maladies propices au développement de la réticuloendothéliose aviaire [2,3].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes de la réticuloendothéliose aviaire varient considérablement selon la souche virale, l'âge de l'oiseau et son état immunitaire général. Dans les formes aiguës, les signes cliniques apparaissent rapidement et peuvent être dramatiques [1,2].
Les premiers signes incluent souvent une léthargie marquée et une perte d'appétit. Les oiseaux affectés se montrent moins actifs, restent prostrés et peuvent présenter des plumes ébouriffées. Cette phase précoce peut facilement passer inaperçue dans un élevage important [2].
Au fur et à mesure de l'évolution, d'autres symptômes se manifestent. La pâleur des muqueuses devient visible, particulièrement au niveau de la crête et des barbillons chez les gallinacés. Certains oiseaux développent des difficultés respiratoires ou des troubles digestifs avec diarrhée [1,3].
Dans les formes chroniques, les symptômes sont plus subtils mais persistants. Les oiseaux peuvent présenter un retard de croissance, une diminution de la ponte chez les femelles reproductrices, ou une sensibilité accrue aux infections secondaires. Ces signes non spécifiques rendent le diagnostic clinique particulièrement difficile [2,3].
Il faut savoir que certains oiseaux infectés peuvent rester asymptomatiques tout en étant porteurs du virus. Ces porteurs sains constituent un réservoir viral important et peuvent transmettre la maladie à d'autres animaux sans présenter eux-mêmes de signes cliniques évidents.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic de la réticuloendothéliose aviaire nécessite une approche méthodique combinant l'examen clinique, l'analyse des symptômes et des tests de laboratoire spécialisés [1,2]. La complexité de cette pathologie rend le diagnostic différentiel particulièrement important.
La première étape consiste en un examen clinique approfondi de l'oiseau ou du groupe d'oiseaux affectés. Le vétérinaire évalue l'état général, examine les muqueuses, palpe les organes accessibles et observe le comportement. Cette évaluation permet d'orienter les investigations complémentaires [2].
Les analyses sanguines constituent un élément clé du diagnostic. Une numération formule sanguine peut révéler des anomalies caractéristiques : anémie, modifications du nombre de globules blancs, ou présence de cellules anormales. Cependant, ces changements ne sont pas spécifiques à la réticuloendothéliose [1,3].
Le diagnostic de certitude repose sur des techniques de biologie moléculaire, notamment la PCR (réaction en chaîne par polymérase). Cette méthode permet de détecter l'ADN viral intégré dans les cellules de l'oiseau. D'autres techniques comme l'isolement viral ou la sérologie peuvent compléter le diagnostic [2,3].
Dans certains cas, une biopsie ou un examen post-mortem peut être nécessaire pour confirmer le diagnostic. L'examen histopathologique des tissus affectés révèle les lésions caractéristiques de la maladie et permet d'exclure d'autres pathologies similaires.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Malheureusement, il n'existe pas de traitement spécifique contre la réticuloendothéliose aviaire. Comme pour la plupart des infections virales, la prise en charge repose principalement sur des mesures de soutien et la prévention des complications secondaires [1,2].
Le traitement symptomatique vise à maintenir l'oiseau dans les meilleures maladies possibles pendant que son système immunitaire lutte contre l'infection. Cela inclut le maintien d'une hydratation adéquate, un apport nutritionnel adapté et un environnement confortable [2]. Les oiseaux affaiblis nécessitent souvent une attention particulière.
La prévention des infections secondaires constitue un aspect crucial du traitement. Les oiseaux atteints de réticuloendothéliose présentent une immunodéficience qui les rend vulnérables aux bactéries, champignons et autres pathogènes opportunistes. L'utilisation judicieuse d'antibiotiques peut être nécessaire [1,3].
Certains éleveurs et vétérinaires utilisent des immunostimulants ou des compléments nutritionnels pour soutenir le système immunitaire des oiseaux affectés. Bien que leur efficacité ne soit pas formellement prouvée, ces approches peuvent apporter un bénéfice dans certains cas [2,3].
L'isolement des animaux malades reste une mesure thérapeutique importante, non pas pour l'animal lui-même, mais pour limiter la propagation du virus au reste de l'élevage. Cette approche fait partie intégrante de la gestion de la maladie.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
La recherche sur la réticuloendothéliose aviaire connaît des avancées prometteuses en 2024-2025, particulièrement dans le domaine de la thérapie génique et des antiviraux spécifiques [1,2]. Ces innovations ouvrent de nouvelles perspectives pour le traitement de cette pathologie complexe.
Les thérapies antivirales ciblées représentent l'une des pistes les plus prometteuses. Des laboratoires internationaux développent actuellement des molécules capables d'inhiber spécifiquement la réplication du virus REV. Ces traitements, encore en phase expérimentale, montrent des résultats encourageants sur des modèles animaux [2].
L'approche par immunothérapie fait également l'objet de recherches intensives. Des équipes travaillent sur le développement d'anticorps monoclonaux dirigés contre le virus, ainsi que sur des stratégies de stimulation immunitaire spécifique. Ces approches pourraient révolutionner la prise en charge de la maladie [1,3].
Les vaccins de nouvelle génération constituent un autre axe de recherche majeur. Contrairement aux vaccins traditionnels, ces nouveaux produits utilisent des technologies innovantes comme les vaccins à ARN messager ou les vecteurs viraux recombinants. Les premiers essais cliniques sont attendus pour 2025 [2,3].
Parallèlement, les techniques de diagnostic rapide évoluent rapidement. Des tests de détection sur le terrain, utilisables directement dans les élevages, sont en cours de développement. Ces outils permettront une détection précoce et une intervention plus rapide.
Vivre au Quotidien avec Réticuloendothéliose aviaire
Gérer un élevage touché par la réticuloendothéliose aviaire demande une adaptation des pratiques quotidiennes et une vigilance constante. Les éleveurs doivent apprendre à composer avec cette pathologie tout en maintenant la productivité de leur exploitation [1,2].
La surveillance quotidienne des animaux devient cruciale. Il faut observer attentivement le comportement des oiseaux, leur appétit, leur activité et détecter rapidement tout signe de maladie. Cette vigilance permet d'intervenir précocement et de limiter la propagation [2]. Un carnet de suivi détaillé s'avère souvent très utile.
L'adaptation de l'environnement d'élevage constitue un aspect important de la gestion. Réduire la densité, améliorer la ventilation, optimiser l'éclairage et maintenir une température stable contribuent au bien-être des oiseaux et renforcent leurs défenses naturelles [1,3].
La nutrition joue un rôle clé dans la gestion de la maladie. Un régime alimentaire équilibré, enrichi en vitamines et minéraux, aide les oiseaux à mieux résister aux infections. Certains compléments alimentaires spécifiques peuvent être bénéfiques, mais leur utilisation doit être discutée avec un vétérinaire [2,3].
Il est important de maintenir un moral positif malgré les difficultés. La réticuloendothéliose aviaire peut être décourageante pour les éleveurs, mais avec une gestion appropriée, il est possible de maintenir un élevage viable. Le soutien d'autres éleveurs expérimentés et des services vétérinaires est précieux.
Les Complications Possibles
La réticuloendothéliose aviaire peut entraîner diverses complications qui aggravent le pronostic et compliquent la prise en charge. Ces complications résultent principalement de l'immunodéficience induite par le virus [1,2].
Les infections secondaires représentent la complication la plus fréquente. Les oiseaux affaiblis deviennent vulnérables aux bactéries pathogènes comme E. coli, Salmonella ou Pasteurella. Ces infections peuvent affecter différents organes : appareil respiratoire, digestif ou reproducteur [2,3].
Le développement de tumeurs constitue une complication grave de certaines formes de la maladie. Ces néoplasmes peuvent apparaître dans différents organes, particulièrement le foie, la rate et les ganglions lymphatiques. Leur présence aggrave considérablement le pronostic [1,3].
Les troubles de la reproduction affectent fréquemment les oiseaux reproducteurs. Diminution de la fertilité, baisse du taux d'éclosion, malformations embryonnaires sont autant de conséquences possibles de l'infection virale [2]. Ces problèmes peuvent persister longtemps après l'infection initiale.
Certains oiseaux développent des complications neurologiques, bien que celles-ci soient moins fréquentes. Elles se manifestent par des troubles de l'équilibre, des paralysies partielles ou des comportements anormaux. Ces signes neurologiques sont souvent de mauvais pronostic [1,2].
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de la réticuloendothéliose aviaire varie considérablement selon plusieurs facteurs : la souche virale impliquée, l'âge des oiseaux, leur état immunitaire initial et la rapidité de la prise en charge [1,2].
Dans les formes aiguës, le pronostic peut être sombre avec des taux de mortalité élevés, particulièrement chez les jeunes oiseaux. Cependant, certains animaux peuvent survivre et développer une immunité partielle contre la réinfection [2]. La mortalité varie généralement entre 10 et 50% selon les maladies.
Les formes chroniques présentent un pronostic plus favorable à court terme, mais les oiseaux affectés peuvent présenter des séquelles durables. Retard de croissance, diminution des performances de reproduction et sensibilité accrue aux autres maladies sont des conséquences fréquentes [1,3].
L'âge au moment de l'infection influence fortement le pronostic. Les oiseaux très jeunes sont plus vulnérables et développent souvent des formes graves. À l'inverse, les adultes en bonne santé peuvent mieux résister à l'infection [2,3].
Il faut savoir que même les oiseaux guéris peuvent rester porteurs du virus à vie. Cette persistance virale pose des problèmes de gestion à long terme dans les élevages et peut compromettre les programmes de reproduction. Néanmoins, avec une gestion appropriée, de nombreux élevages parviennent à maintenir une activité viable malgré la présence du virus.
Peut-on Prévenir Réticuloendothéliose aviaire ?
La prévention de la réticuloendothéliose aviaire repose sur un ensemble de mesures de biosécurité rigoureuses et de bonnes pratiques d'élevage. Bien qu'il soit difficile d'éliminer complètement le risque, ces mesures peuvent considérablement réduire la probabilité d'infection [1,2].
La quarantaine des nouveaux arrivants constitue une mesure préventive fondamentale. Tout oiseau introduit dans l'élevage doit être isolé pendant au moins 3 à 4 semaines et faire l'objet d'examens vétérinaires approfondis [2]. Cette période permet de détecter d'éventuelles infections latentes.
L'hygiène et la désinfection régulières des installations sont cruciales. Le virus peut survivre dans l'environnement pendant plusieurs semaines, particulièrement dans des maladies humides et fraîches. Un protocole de nettoyage et de désinfection strict doit être appliqué [1,3].
Le contrôle des vecteurs joue également un rôle important. Les rongeurs, les insectes et les oiseaux sauvages peuvent transporter le virus d'un élevage à l'autre. Des mesures de lutte contre ces vecteurs doivent être mises en place [2,3].
La vaccination, lorsqu'elle est disponible et adaptée à la souche circulante, peut offrir une protection partielle. Cependant, l'efficacité des vaccins varie selon les souches virales et nécessite souvent des rappels réguliers [1,2]. Il est important de discuter avec un vétérinaire de la stratégie vaccinale la plus appropriée.
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises ont établi des recommandations spécifiques pour la gestion de la réticuloendothéliose aviaire, en coordination avec les instances européennes et internationales [1,2]. Ces directives visent à limiter la propagation de la maladie et à protéger la filière avicole.
L'Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES) recommande une surveillance renforcée dans les élevages à risque. Cette surveillance inclut des contrôles réguliers, des analyses de laboratoire et la déclaration obligatoire de tout cas suspect [2]. Les vétérinaires sanitaires jouent un rôle clé dans cette surveillance.
Les mesures de biosécurité recommandées comprennent la limitation des visites, la désinfection des véhicules, le contrôle des entrées et sorties d'animaux, et la formation du personnel. Ces mesures doivent être adaptées à la taille et au type d'élevage [1,3].
En cas d'épidémie, les autorités peuvent mettre en place des zones de restriction avec des mesures de contrôle renforcées. Ces zones peuvent inclure l'interdiction de mouvements d'animaux, l'abattage préventif ou la mise en place de cordons sanitaires [2,3].
Les recommandations évoluent régulièrement en fonction des nouvelles connaissances scientifiques et de l'évolution épidémiologique. Il est donc essentiel pour les éleveurs de se tenir informés des dernières directives officielles et de maintenir un contact régulier avec les services vétérinaires.
Ressources et Associations de Patients
Bien que la réticuloendothéliose aviaire soit une pathologie vétérinaire, plusieurs organismes et associations peuvent apporter un soutien précieux aux éleveurs confrontés à cette maladie [1,2].
Les groupements d'éleveurs constituent souvent la première source de soutien et d'information. Ces organisations professionnelles partagent les expériences, organisent des formations et facilitent l'accès aux conseils vétérinaires spécialisés [2]. Ils peuvent également négocier des tarifs préférentiels pour les analyses de laboratoire.
Les chambres d'agriculture proposent des services d'accompagnement technique et économique aux éleveurs en difficulté. Elles peuvent aider à mettre en place des mesures de biosécurité, à adapter les pratiques d'élevage ou à gérer les aspects financiers liés à la maladie [1,3].
Plusieurs centres de recherche vétérinaire offrent des services de diagnostic et de conseil. Ces institutions peuvent fournir des analyses spécialisées, des conseils sur les traitements et participer à la surveillance épidémiologique [2,3].
Les réseaux sociaux professionnels et les forums spécialisés permettent aux éleveurs d'échanger leurs expériences et de s'entraider. Ces plateformes informelles sont souvent très utiles pour obtenir des conseils pratiques et un soutien moral [1,2].
Il est important de vérifier la fiabilité des sources d'information et de toujours consulter un vétérinaire qualifié pour les décisions importantes concernant la santé des animaux.
Nos Conseils Pratiques
Face à la réticuloendothéliose aviaire, quelques conseils pratiques peuvent faire la différence dans la gestion quotidienne de votre élevage. Ces recommandations, issues de l'expérience d'éleveurs et de vétérinaires, vous aideront à mieux appréhender cette pathologie [1,2].
Observez attentivement vos oiseaux chaque jour. Apprenez à reconnaître leur comportement normal pour détecter rapidement tout changement. Un oiseau qui s'isole, mange moins ou présente des plumes ébouriffées mérite une attention particulière [2]. Tenez un carnet de bord détaillé.
Investissez dans la biosécurité plutôt que dans les traitements. Un pédiluves à l'entrée, des vêtements dédiés à l'élevage, une désinfection régulière des équipements coûtent moins cher qu'une épidémie [1,3]. Ces mesures préventives sont votre meilleure assurance.
Établissez une relation de confiance avec votre vétérinaire. N'hésitez pas à le contacter dès les premiers signes suspects. Une intervention précoce peut limiter considérablement les dégâts [2,3]. Discutez avec lui d'un plan de surveillance adapté à votre élevage.
Diversifiez vos sources d'approvisionnement et évitez de mettre tous vos œufs dans le même panier. Si possible, maintenez plusieurs groupes d'oiseaux séparés pour limiter les risques de contamination croisée [1,2].
Enfin, ne restez pas isolé. Échangez avec d'autres éleveurs, participez aux formations et restez informé des évolutions de la maladie. La connaissance et l'entraide sont vos meilleurs alliés.
Quand Consulter un Médecin ?
Bien que la réticuloendothéliose aviaire soit une pathologie spécifiquement aviaire qui ne se transmet pas directement à l'homme, certaines situations peuvent nécessiter une consultation médicale pour les personnes en contact avec des oiseaux infectés [1,2].
Les professionnels de l'aviculture exposés régulièrement aux oiseaux malades doivent être particulièrement vigilants. Bien que le risque de transmission soit théoriquement nul, toute symptomatologie inhabituelle (fièvre, troubles respiratoires, fatigue inexpliquée) survenant après un contact avec des oiseaux infectés justifie une consultation [2].
Les personnes immunodéprimées ou souffrant de maladies chroniques doivent prendre des précautions particulières. Leur système immunitaire affaibli pourrait théoriquement les rendre plus vulnérables à d'éventuelles complications, même si aucun cas de transmission n'a été documenté [1,3].
En cas de blessure lors de la manipulation d'oiseaux infectés (griffures, morsures), une consultation médicale est recommandée pour évaluer le risque d'infection bactérienne secondaire et mettre en place un traitement préventif si nécessaire [2,3].
Il est important de signaler à votre médecin tout contact professionnel ou personnel avec des oiseaux malades. Cette information peut être utile pour orienter le diagnostic en cas de symptômes inexpliqués [1,2].
Rassurez-vous cependant : la réticuloendothéliose aviaire reste une maladie spécifique aux oiseaux, et les mesures de précaution sont principalement préventives.
Questions Fréquentes
La réticuloendothéliose aviaire peut-elle se transmettre à l'homme ?Non, cette pathologie est spécifique aux oiseaux et ne se transmet pas à l'homme. Cependant, des mesures d'hygiène restent recommandées lors de la manipulation d'oiseaux malades [1,2].
Existe-t-il un vaccin efficace ?
Des vaccins existent mais leur efficacité varie selon les souches virales circulantes. La vaccination doit être discutée avec un vétérinaire en fonction du contexte épidémiologique local [2,3].
Combien de temps le virus survit-il dans l'environnement ?
Le virus peut survivre plusieurs semaines dans l'environnement, particulièrement dans des maladies humides et fraîches. Une désinfection régulière est donc essentielle [1,3].
Les œufs d'oiseaux infectés sont-ils consommables ?
La consommation d'œufs provenant d'oiseaux infectés ne présente pas de risque pour l'homme. Cependant, ces œufs peuvent présenter des défauts de qualité [2].
Comment distinguer cette maladie d'autres pathologies aviaires ?
Le diagnostic différentiel nécessite des analyses de laboratoire spécialisées. Les symptômes seuls ne permettent pas de distinguer la réticuloendothéliose d'autres maladies virales [1,2].
Faut-il abattre tous les oiseaux d'un élevage infecté ?
L'abattage systématique n'est généralement pas nécessaire. La décision dépend de nombreux facteurs et doit être prise en concertation avec les services vétérinaires [2,3].
Questions Fréquentes
La réticuloendothéliose aviaire peut-elle se transmettre à l'homme ?
Non, cette pathologie est spécifique aux oiseaux et ne se transmet pas à l'homme. Cependant, des mesures d'hygiène restent recommandées lors de la manipulation d'oiseaux malades.
Existe-t-il un vaccin efficace ?
Des vaccins existent mais leur efficacité varie selon les souches virales circulantes. La vaccination doit être discutée avec un vétérinaire en fonction du contexte épidémiologique local.
Combien de temps le virus survit-il dans l'environnement ?
Le virus peut survivre plusieurs semaines dans l'environnement, particulièrement dans des maladies humides et fraîches. Une désinfection régulière est donc essentielle.
Les œufs d'oiseaux infectés sont-ils consommables ?
La consommation d'œufs provenant d'oiseaux infectés ne présente pas de risque pour l'homme. Cependant, ces œufs peuvent présenter des défauts de qualité.
Comment distinguer cette maladie d'autres pathologies aviaires ?
Le diagnostic différentiel nécessite des analyses de laboratoire spécialisées. Les symptômes seuls ne permettent pas de distinguer la réticuloendothéliose d'autres maladies virales.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Grippe aviaire : symptômes, traitement, prévention. Institut Pasteur.Lien
- [2] Chapitre 14. Maladies des oies. Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture.Lien
- [3] La variole aviaire chez les pondeuses. Hy-Line International.Lien
Ressources web
- Grippe aviaire : symptômes, traitement, prévention (pasteur.fr)
Chez l'humain, les premiers symptômes dus aux virus grippaux zoonotiques sont similaires à ceux de la grippe saisonnière (fièvre, toux…).
- Chapitre 14. Maladies des oies (fao.org)
Les symptômes courants sont des suintements nasaux et oculaires, une toux bénigne et des reniflements, une diarrhée verdâtre, un manque de coordination des ...
- la variole aviaire chez les pondeuses (hyline.com)
La présence de corps d'inclusion intracytoplasmiques permet de diagnostiquer une infection par le virus de la variole. TRAITEMENT. Il n'existe pas de traitement ...
- Grippe aviaire : Symptômes et traitements (elsan.care)
Quels sont les signes et symptômes de la grippe aviaire chez l'humain ? · une toux ; · un essoufflement ; · une montée de fièvre ; · l'apparition de douleurs ...
- Les herpèsvirus des oiseaux (persee.fr)
de J Brugère-Picoux · 2011 — La méthode ELISA et le test de séroneutralisation permettent de détecter les anticorps sériques spécifiques. L'EVC doit être différenciée de l'hépatite à virus ...

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
