Leucose Aviaire : Guide Complet 2025 - Symptômes, Traitements et Innovations
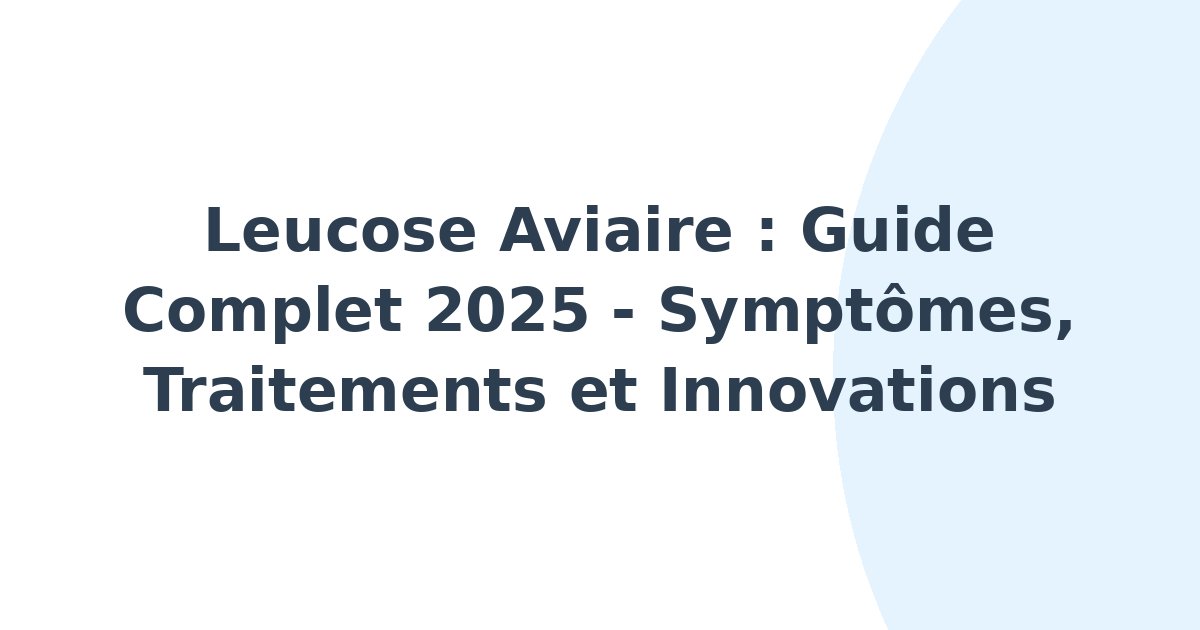
La leucose aviaire représente une pathologie virale complexe qui touche principalement les volailles, mais dont la compréhension est essentielle pour la santé publique vétérinaire. Cette maladie, causée par le virus de la leucose aviaire (ALV), suscite un intérêt croissant en raison de ses implications économiques et sanitaires. Découvrons ensemble les aspects essentiels de cette pathologie, des dernières innovations thérapeutiques aux stratégies de prévention les plus efficaces.
Téléconsultation et Leucose aviaire
Téléconsultation non recommandéeLa leucose aviaire est une maladie virale oncogène touchant exclusivement les oiseaux et ne peut donc pas affecter l'homme. Cette pathologie vétérinaire nécessite une prise en charge spécialisée par un vétérinaire aviaire avec examens complémentaires spécifiques (biopsie, histologie, tests virologiques) impossibles à réaliser en téléconsultation.
Ce qui peut être évalué à distance
Discussion préliminaire sur les symptômes observés chez l'oiseau (masses, troubles locomoteurs, amaigrissement), évaluation de l'urgence de la situation, orientation vers un vétérinaire aviaire spécialisé, conseils sur les mesures d'isolement de l'animal malade.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examen clinique complet de l'oiseau par un vétérinaire, biopsie des masses tumorales pour confirmation histologique, tests virologiques spécifiques, évaluation de l'extension des lésions néoplasiques, mise en place du traitement adapté.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Confirmation diagnostique par biopsie et examen histologique, évaluation de l'extension tumorale nécessitant un examen clinique complet, mise en place de protocoles thérapeutiques spécialisés, euthanasie médicalisée si nécessaire.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Détresse respiratoire aiguë de l'oiseau, paralysie soudaine des membres, hémorragies importantes, état de choc ou coma de l'animal.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Détresse respiratoire sévère de l'oiseau avec halètement
- Paralysie brutale des membres ou des ailes
- Hémorragies importantes ou saignements persistants
- État de prostration extrême ou coma de l'animal
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Vétérinaire spécialisé en médecine aviaire — consultation en présentiel indispensable
La leucose aviaire étant une pathologie vétérinaire complexe nécessitant des examens diagnostiques spécialisés et une prise en charge thérapeutique adaptée, seul un vétérinaire aviaire peut assurer le diagnostic et le traitement appropriés.
Leucose Aviaire : Définition et Vue d'Ensemble
La leucose aviaire constitue une maladie virale oncogène qui affecte principalement les volailles domestiques et sauvages. Cette pathologie, provoquée par le virus de la leucose aviaire (ALV), appartient à la famille des rétrovirus [5]. Le virus s'intègre dans l'ADN des cellules hôtes, provoquant des transformations cellulaires qui peuvent conduire au développement de tumeurs.
Il existe plusieurs sous-types du virus ALV, classés de A à J selon leurs propriétés antigéniques et leur tropisme cellulaire [6]. Le sous-type J (ALV-J) est particulièrement préoccupant car il présente une capacité accrue à induire des tumeurs et à se transmettre horizontalement entre les oiseaux. Cette variante a émergé dans les années 1990 et continue de poser des défis significatifs à l'industrie avicole mondiale.
La leucose aviaire se caractérise par sa capacité à rester latente pendant de longues périodes avant de se manifester cliniquement. Cette particularité rend le diagnostic précoce particulièrement difficile et complique les stratégies de contrôle. D'ailleurs, certains oiseaux peuvent être porteurs asymptomatiques tout en transmettant le virus à leur descendance ou à d'autres individus de leur environnement [7].
Épidémiologie en France et dans le Monde
L'épidémiologie de la leucose aviaire révèle des disparités importantes selon les régions géographiques et les systèmes d'élevage. En France, la prévalence de cette pathologie dans les élevages commerciaux a considérablement diminué grâce aux programmes de surveillance et d'éradication mis en place depuis les années 1980 [6]. Cependant, des foyers sporadiques continuent d'être détectés, particulièrement dans les élevages de type familial ou les populations d'oiseaux ornementaux.
Au niveau mondial, la situation épidémiologique varie considérablement. Les pays développés ont généralement réussi à contrôler efficacement la maladie dans leurs élevages commerciaux, tandis que certaines régions d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Sud continuent de signaler des taux de prévalence élevés [1]. Cette disparité s'explique principalement par les différences dans les capacités de surveillance, les ressources disponibles pour les programmes de contrôle et les pratiques d'élevage locales.
Les données récentes indiquent que le sous-type ALV-J représente désormais la forme prédominante dans de nombreuses régions, remplaçant progressivement les autres sous-types [2]. Cette évolution épidémiologique soulève de nouveaux défis, car ALV-J présente des caractéristiques pathogéniques distinctes et peut infecter des lignées cellulaires résistantes aux autres sous-types du virus.
Les Causes et Facteurs de Risque
Le virus de la leucose aviaire constitue l'agent étiologique unique de cette pathologie, mais plusieurs facteurs influencent sa transmission et son expression clinique. La transmission peut s'effectuer de manière verticale, de la poule reproductrice à sa descendance via l'œuf, ou horizontalement entre oiseaux par contact direct ou indirect [5]. La salive, les fèces et les sécrétions respiratoires représentent les principales voies de dissémination du virus.
Certains facteurs génétiques prédisposent les oiseaux à l'infection. Les lignées génétiques dépourvues du gène de résistance endogène ev21 se montrent particulièrement susceptibles à l'infection par ALV-J [6]. Cette susceptibilité génétique explique pourquoi certaines souches de volailles présentent des taux d'infection plus élevés que d'autres, même dans des maladies d'exposition similaires.
Les maladies d'élevage jouent également un rôle déterminant dans la propagation de la maladie. La densité élevée d'animaux, les maladies d'hygiène défaillantes et le stress chronique favorisent la transmission virale [7]. En outre, l'âge des oiseaux influence leur susceptibilité : les jeunes poussins se révèlent généralement plus vulnérables à l'infection que les adultes, bien que ces derniers puissent développer des tumeurs après une période d'incubation prolongée.
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les manifestations cliniques de la leucose aviaire varient considérablement selon le sous-type viral impliqué, l'âge de l'oiseau et la durée d'évolution de l'infection. Dans sa forme classique, la maladie se caractérise par le développement de tumeurs dans divers organes, particulièrement la bourse de Fabricius, le foie, la rate et les reins [6]. Ces tumeurs peuvent rester asymptomatiques pendant de longues périodes avant de provoquer des signes cliniques évidents.
Les symptômes généraux incluent une perte de poids progressive, une diminution de l'appétit et un affaiblissement général de l'oiseau. Vous pourriez observer une pâleur des muqueuses, une augmentation du volume abdominal due à l'hépatomégalie ou à la splénomégalie, et parfois des difficultés respiratoires si les tumeurs compriment les voies aériennes [5]. La ponte peut également être affectée chez les poules pondeuses, avec une diminution significative de la production d'œufs.
Il est important de noter que de nombreux oiseaux infectés restent asymptomatiques tout au long de leur vie, ne développant jamais de tumeurs cliniquement détectables. Cette forme subclinique de la maladie pose des défis particuliers pour le diagnostic et le contrôle, car ces animaux peuvent continuer à transmettre le virus sans présenter de signes évidents d'infection [7]. D'ailleurs, certains oiseaux peuvent présenter des symptômes non spécifiques qui peuvent être confondus avec d'autres pathologies aviaires.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic de la leucose aviaire nécessite une approche méthodique combinant l'examen clinique, les analyses de laboratoire et parfois l'examen anatomopathologique. La première étape consiste en une évaluation clinique approfondie de l'oiseau, incluant la palpation abdominale pour détecter d'éventuelles masses tumorales et l'examen des muqueuses pour identifier une possible anémie [5].
Les tests sérologiques représentent l'outil diagnostic de référence pour détecter les anticorps dirigés contre le virus ALV. Le test ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) permet de détecter spécifiquement les anticorps anti-ALV-J, offrant une sensibilité et une spécificité élevées [5]. Ces tests peuvent être réalisés sur sérum sanguin ou sur jaune d'œuf, cette dernière option étant particulièrement utile pour le dépistage des reproducteurs.
L'isolement viral et les techniques de biologie moléculaire, notamment la PCR (Polymerase Chain Reaction), permettent de confirmer la présence du virus et d'identifier le sous-type impliqué [6]. Ces méthodes s'avèrent particulièrement précieuses pour le diagnostic précoce et la caractérisation des souches virales. En cas de suspicion de tumeurs, l'examen histopathologique des tissus affectés peut révéler les caractéristiques typiques des lymphomes associés à la leucose aviaire.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Actuellement, il n'existe pas de traitement curatif spécifique pour la leucose aviaire. La prise en charge se concentre principalement sur les mesures de soutien et la prévention de la propagation de l'infection [6]. Cette absence de thérapie spécifique s'explique par la nature rétrovirale de l'agent pathogène, qui s'intègre de manière permanente dans le génome de l'hôte.
Les soins palliatifs peuvent inclure l'administration d'anti-inflammatoires pour réduire l'inconfort associé aux tumeurs, ainsi que des suppléments nutritionnels pour maintenir l'état corporel de l'oiseau [7]. Cependant, ces mesures ne modifient pas l'évolution naturelle de la maladie et ne permettent pas d'éliminer le virus de l'organisme infecté.
La stratégie thérapeutique principale repose sur la prévention et le contrôle de l'infection au niveau du cheptel. Cela implique l'identification et l'élimination des animaux infectés, la désinfection des installations et la mise en place de mesures de biosécurité strictes [5]. Ces approches préventives se révèlent beaucoup plus efficaces que toute tentative de traitement individuel des animaux malades.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
Les avancées récentes dans la lutte contre la leucose aviaire ouvrent de nouvelles perspectives prometteuses. Les stratégies d'éradication accélérée développées en 2024-2025 intègrent des approches innovantes combinant la sélection génétique assistée par marqueurs et les technologies de diagnostic de nouvelle génération [1]. Ces méthodes permettent d'identifier plus rapidement les animaux résistants et de les intégrer dans les programmes de reproduction.
L'isolement et la caractérisation de virus aviaires recombinants représentent une autre avancée majeure de 2025 [2]. Ces recherches permettent de mieux comprendre les mécanismes de recombinaison virale et d'anticiper l'émergence de nouvelles variantes pathogènes. Cette connaissance approfondie des processus évolutifs du virus contribue au développement de stratégies de surveillance plus efficaces.
Le 9ème Congrès International Vétérinaire Avicole de 2025 a mis en lumière plusieurs innovations thérapeutiques prometteuses . Parmi celles-ci, l'édition génomique CRISPR-Cas9 appliquée à la création de lignées aviaires résistantes suscite un intérêt particulier [3]. Cette technologie permet d'introduire des modifications génétiques précises pour conférer une résistance naturelle au virus, ouvrant la voie à des solutions durables et respectueuses de l'environnement.
Vivre au Quotidien avec Leucose Aviaire
Bien que la leucose aviaire affecte principalement les volailles, sa gestion au quotidien implique des considérations importantes pour les éleveurs et les propriétaires d'oiseaux. La surveillance régulière des animaux devient une routine essentielle, nécessitant une observation attentive des signes cliniques et des changements comportementaux [6]. Cette vigilance constante permet de détecter précocement toute évolution de la maladie.
L'adaptation de l'environnement d'élevage constitue un aspect crucial de la gestion quotidienne. Il faut maintenir des maladies d'hygiène irréprochables, assurer une ventilation adéquate et contrôler la densité d'animaux pour limiter le stress et réduire les risques de transmission [7]. Ces mesures, bien qu'exigeantes, contribuent significativement à améliorer le bien-être des oiseaux et à ralentir la progression de l'infection.
La gestion nutritionnelle revêt également une importance particulière. Les oiseaux infectés peuvent bénéficier d'une alimentation enrichie en vitamines et en antioxydants pour soutenir leur système immunitaire [5]. Cependant, il est important de comprendre que ces mesures de soutien ne constituent pas un traitement curatif mais visent à améliorer la qualité de vie des animaux affectés.
Les Complications Possibles
La leucose aviaire peut entraîner diverses complications qui aggravent le pronostic et compliquent la prise en charge des animaux affectés. Les tumeurs développées dans les organes vitaux représentent la complication la plus fréquente et la plus grave [6]. Lorsque ces masses tumorales atteignent une taille importante, elles peuvent comprimer les structures adjacentes et perturber le fonctionnement normal des organes.
L'immunosuppression constitue une autre complication majeure de cette pathologie. Le virus ALV affecte le système immunitaire de l'hôte, rendant les oiseaux infectés plus susceptibles aux infections secondaires bactériennes, virales ou parasitaires [5]. Cette vulnérabilité accrue peut conduire à des infections opportunistes qui compliquent davantage l'état clinique de l'animal et accélèrent son déclin.
Les complications reproductives méritent également une attention particulière. Chez les reproducteurs infectés, la transmission verticale du virus à la descendance peut atteindre des taux élevés, perpétuant ainsi l'infection dans le cheptel [7]. De plus, la fertilité et l'éclosabilité des œufs peuvent être affectées, entraînant des pertes économiques significatives pour les éleveurs. Ces complications soulignent l'importance d'une détection précoce et d'une gestion appropriée de la maladie.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de la leucose aviaire varie considérablement selon plusieurs facteurs, notamment le sous-type viral impliqué, l'âge de l'oiseau au moment de l'infection et la présence de facteurs génétiques de résistance [6]. Dans la majorité des cas, les oiseaux infectés par ALV-J développent des tumeurs dans un délai de 6 à 24 mois après l'infection initiale, ce qui conduit généralement à un pronostic défavorable.
Cependant, il est important de noter qu'une proportion significative d'oiseaux infectés peut rester asymptomatique pendant de longues périodes, voire toute leur vie [5]. Ces animaux porteurs asymptomatiques peuvent maintenir une productivité normale tout en continuant à excréter le virus dans leur environnement. Cette variabilité dans l'expression clinique de la maladie rend l'évaluation pronostique particulièrement complexe.
L'évolution récente des connaissances sur les mécanismes de résistance génétique offre de nouvelles perspectives d'amélioration du pronostic [7]. Les programmes de sélection génétique visant à introduire des gènes de résistance dans les populations aviaires commerciales montrent des résultats prometteurs. Ces avancées laissent espérer qu'à terme, la susceptibilité à la leucose aviaire pourra être considérablement réduite grâce à des approches préventives basées sur la génétique.
Peut-on Prévenir Leucose Aviaire ?
La prévention de la leucose aviaire repose sur une approche multifactorielle intégrant des mesures de biosécurité, de sélection génétique et de surveillance épidémiologique [1]. Les programmes d'éradication mis en place dans de nombreux pays développés ont démontré l'efficacité de ces stratégies préventives lorsqu'elles sont appliquées de manière systématique et rigoureuse.
La sélection génétique constitue l'un des outils préventifs les plus prometteurs. L'identification et l'utilisation de lignées aviaires porteuses de gènes de résistance naturelle au virus ALV permettent de réduire significativement l'incidence de la maladie [3]. Ces approches génétiques, combinées aux technologies d'édition génomique modernes, ouvrent la voie à la création de populations aviaires naturellement résistantes à l'infection.
Les mesures de biosécurité traditionnelles conservent toute leur importance dans la prévention de la leucose aviaire. Cela inclut la quarantaine des nouveaux animaux, la désinfection régulière des installations, le contrôle des vecteurs potentiels et la limitation des contacts entre différents groupes d'oiseaux [6]. L'application stricte de ces protocoles, associée à un programme de surveillance sérologique régulier, permet de maintenir le statut sanitaire des élevages et de détecter précocement toute introduction du virus [7].
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires vétérinaires françaises et européennes ont établi des recommandations précises pour la gestion de la leucose aviaire dans les élevages commerciaux et familiaux [6]. Ces directives s'appuient sur les dernières avancées scientifiques et l'expérience acquise dans les programmes de contrôle nationaux et internationaux.
La surveillance sérologique constitue le pilier central des recommandations officielles. Les autorités préconisent la réalisation de tests sérologiques réguliers sur les reproducteurs, avec une fréquence adaptée au niveau de risque de chaque élevage [5]. Cette surveillance permet de détecter précocement l'introduction du virus et de mettre en place rapidement les mesures de contrôle appropriées.
Les recommandations insistent également sur l'importance de la traçabilité et de la certification sanitaire des animaux reproducteurs [7]. Les échanges commerciaux d'oiseaux reproducteurs doivent s'accompagner de attendues sanitaires attestant de l'absence d'infection par le virus ALV. Cette approche préventive vise à éviter la dissémination de la maladie entre les différents sites d'élevage et régions géographiques.
Enfin, les autorités encouragent la formation continue des éleveurs et des vétérinaires sur les aspects épidémiologiques et diagnostiques de la leucose aviaire [4]. Cette formation permet d'améliorer la détection précoce des cas suspects et d'optimiser l'efficacité des mesures de contrôle mises en place.
Ressources et Associations de Patients
Bien que la leucose aviaire affecte principalement les volailles, plusieurs organisations professionnelles et scientifiques offrent des ressources précieuses pour les éleveurs et les vétérinaires confrontés à cette pathologie [6]. Ces structures jouent un rôle essentiel dans la diffusion des connaissances et le soutien aux professionnels du secteur avicole.
Les Groupements de Défense Sanitaire (GDS) régionaux constituent la première ressource de proximité pour les éleveurs français [7]. Ces organismes proposent des services de conseil, de formation et d'accompagnement dans la mise en place de mesures préventives. Ils facilitent également l'accès aux tests de diagnostic et coordonnent les actions de surveillance épidémiologique au niveau territorial.
Au niveau international, plusieurs organisations scientifiques spécialisées en pathologie aviaire publient régulièrement des guides techniques et des recommandations actualisées . Ces ressources permettent aux professionnels de rester informés des dernières avancées en matière de diagnostic, de prévention et de contrôle de la leucose aviaire. L'accès à ces informations scientifiques de qualité s'avère crucial pour maintenir l'efficacité des stratégies de lutte contre cette pathologie.
Nos Conseils Pratiques
La gestion efficace de la leucose aviaire nécessite l'adoption de pratiques rigoureuses adaptées à chaque contexte d'élevage. Voici nos recommandations essentielles pour minimiser les risques d'infection et optimiser la santé de vos volailles [5].
Établissez un protocole de biosécurité strict incluant la désinfection systématique des équipements, le contrôle des accès aux zones d'élevage et la quarantaine obligatoire des nouveaux animaux. Ces mesures, bien qu'exigeantes, constituent votre première ligne de défense contre l'introduction du virus [6]. N'hésitez pas à solliciter l'aide de votre vétérinaire pour adapter ces protocoles à votre situation spécifique.
Investissez dans un programme de surveillance sérologique régulier, même si vos animaux paraissent en bonne santé. La détection précoce de l'infection permet d'intervenir rapidement et de limiter sa propagation [7]. Tenez un registre détaillé de tous les tests effectués et des résultats obtenus, ces informations s'avéreront précieuses pour le suivi épidémiologique de votre élevage.
Privilégiez l'acquisition d'animaux reproducteurs issus d'élevages certifiés indemnes de leucose aviaire. Cette précaution, bien que représentant un investissement initial plus important, vous évitera de nombreuses complications futures et contribuera à la pérennité de votre activité d'élevage.
Quand Consulter un Médecin ?
Dans le contexte de la leucose aviaire, la consultation vétérinaire revêt une importance cruciale pour la santé de vos volailles et la pérennité de votre élevage. Contactez immédiatement votre vétérinaire si vous observez des signes cliniques suspects chez vos oiseaux [6].
Les signaux d'alarme incluent une perte de poids inexpliquée, une diminution de l'appétit, un affaiblissement général ou des modifications du comportement habituel de vos volailles. Une baisse significative de la production d'œufs chez les pondeuses doit également vous alerter [5]. Ces symptômes, bien que non spécifiques, peuvent indiquer la présence d'une infection virale nécessitant une investigation approfondie.
N'attendez pas l'apparition de signes cliniques évidents pour consulter. Une consultation préventive annuelle avec réalisation de tests sérologiques permet de détecter précocement une éventuelle infection et d'adapter en conséquence vos pratiques d'élevage [7]. Cette approche proactive s'avère généralement plus économique et plus efficace que la gestion curative des cas cliniques déclarés.
En cas de mortalité anormale dans votre élevage, même si elle semble liée à d'autres causes, une consultation vétérinaire s'impose. Le diagnostic différentiel de la leucose aviaire avec d'autres pathologies aviaires nécessite l'expertise d'un professionnel qualifié et l'utilisation de techniques diagnostiques spécialisées.
Questions Fréquentes
La leucose aviaire peut-elle se transmettre à l'homme ?
Non, la leucose aviaire est spécifique aux oiseaux et ne présente aucun risque de transmission à l'homme. Cette pathologie virale reste confinée aux espèces aviaires.
Combien de temps le virus peut-il survivre dans l'environnement ?
Le virus ALV est relativement fragile dans l'environnement extérieur. Il peut survivre quelques jours à température ambiante mais est rapidement inactivé par la dessiccation et les désinfectants.
Existe-t-il un vaccin contre la leucose aviaire ?
Actuellement, il n'existe pas de vaccin commercial efficace contre la leucose aviaire. Les recherches se concentrent sur le développement de lignées génétiquement résistantes.
Les œufs d'oiseaux infectés sont-ils consommables ?
Les œufs pondus par des oiseaux infectés ne présentent pas de risque pour la consommation humaine, mais ils peuvent contenir le virus et contribuer à la transmission verticale.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Promising strategies for accelerating the eradication of avian leukosisLien
- [2] Isolation and characterization of a recombinant avian leukosis virusLien
- [3] The 9th International Veterinary Poultry CongressLien
- [4] Édition génomique et OGMs: avancées récentes pour le contrôle des maladies infectieusesLien
- [10] Les vaccins aujourd'hui chez l'animal: bases technologiques, pratiques et sociologiquesLien
- [12] Virus de la leucose aviaire (ALV) : Test ALV-J AbLien
- [13] Maladies virales aviairesLien
- [14] La leucoseLien
Publications scientifiques
- [HTML][HTML] Édition génomique et OGMs: quelles différences? avancées récentes pour le contrôle des maladies infectieuses (2023)
- Étude structurale et fonctionnelle de la protéine Pr55Gag du VIH-1 en association avec le signal d'encapsidation de l'ARN génomique (2023)[PDF]
- Décryptage du mécanisme d'action antivirale de TRIM5α (2024)[PDF]
- [HTML][HTML] L'univers des oncogènes: un bond dans la compréhension des cancers (2023)
- Contribution au génotypage et au pathotypage de souches vaccinales et issues du terrain de l'avibimavirus de la bursite infectieuse aviaire (2023)
Ressources web
- Virus de la leucose aviaire (ALV) : Test ALV-J Ab (idexx.fr)
Sur le plan clinique, ALV-J cause principalement la leucose myéloïde, avec une fréquence variable de tumeurs parmi les lignées de poulets.
- Page 1 MALADIES VIRALES AVIAIRES 10. ... (dmipfmv.ulg.ac.be)
Signes cliniques. ▫ La période d'incubation varie de 4 à 7 jours. ▫ apathiques, ils ne bougent pas. ▫ paupières oedémateuses et restant fermées.
- La leucose (gds-poitou-charentes.fr)
L'incubation varie de 1 à 3 semaines et les symptômes débutent par des signes classiques : hyperthermie, abattement, jetage, larmoiement, photophobie. Les ...
- Leucose du chat : symptômes, diagnostic, traitement et rôle du ... (vet-h24-urgence.fr)
Quels sont les symptômes de la leucose féline ? · Signes généraux : fièvre, abattement, déshydratation, perte de poids, possible état de choc. · Signes cardio- ...
- Introduction à la médecine des volailles de basse-cour (lafeber.com)
28 nov. 2012 — La leucose lymphoïde est une infection rétrovirale qui cause des tumeurs chez les poulets de 14 semaines et plus. L'incidence de la leucose ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
