Panleucopénie féline : Guide Complet 2025 - Symptômes, Traitements et Prévention
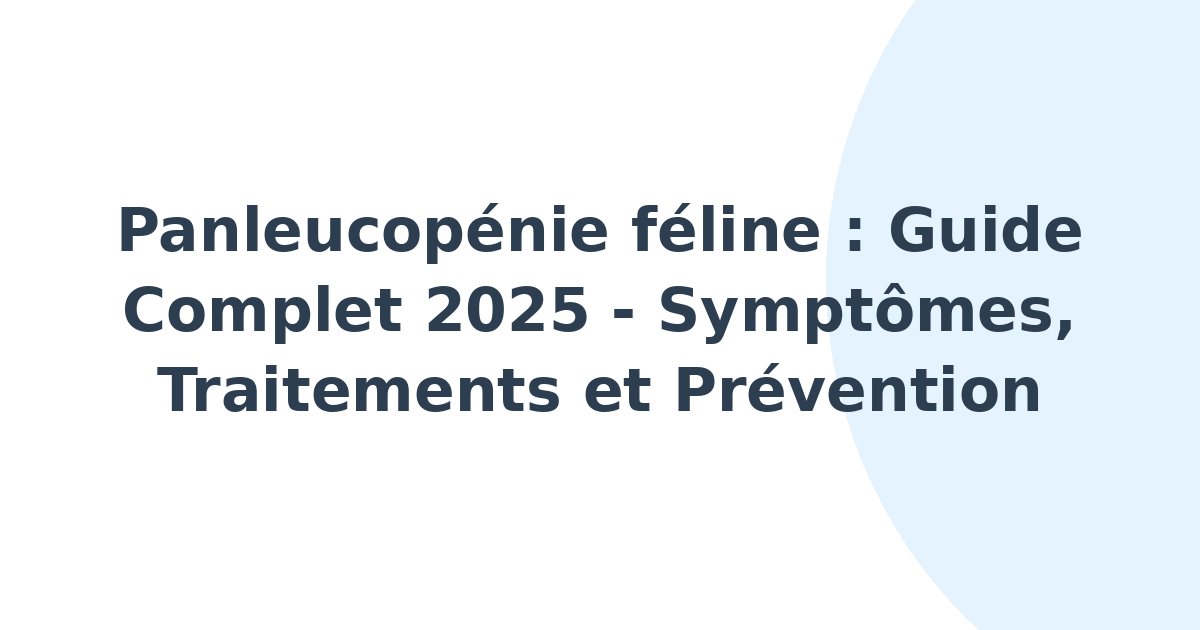
La panleucopénie féline, aussi appelée typhus du chat, représente l'une des maladies virales les plus redoutables chez nos compagnons félins. Cette pathologie, causée par le parvovirus félin, touche principalement les chatons non vaccinés et peut avoir des conséquences dramatiques. Heureusement, les avancées récentes en matière de diagnostic et de traitement offrent de nouveaux espoirs. Découvrons ensemble cette maladie complexe mais désormais mieux comprise.
Téléconsultation et Panleucopénie féline
Téléconsultation non recommandéeLa panleucopénie féline est une maladie virale grave du chat nécessitant un diagnostic vétérinaire urgent et une prise en charge spécialisée immédiate. Cette pathologie animale relève exclusivement de la médecine vétérinaire et ne peut être évaluée par téléconsultation médicale humaine.
Ce qui peut être évalué à distance
Cette pathologie ne relève pas de la médecine humaine mais de la médecine vétérinaire. Aucune évaluation médicale humaine n'est pertinente pour cette condition qui affecte exclusivement les félins.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Consultation vétérinaire d'urgence obligatoire pour diagnostic et traitement. Examens sanguins spécialisés indispensables. Prise en charge hospitalière vétérinaire souvent nécessaire. Traitement de soutien intensif requis.
Cette pathologie concerne les animaux de compagnie. Pour votre chat, contactez immédiatement un vétérinaire ou une clinique vétérinaire d'urgence.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Toute suspicion de panleucopénie féline nécessite une consultation vétérinaire immédiate. Diagnostic par tests sanguins spécialisés obligatoire. Évaluation de la déshydratation et de l'état général impossible à distance. Mise en place d'un traitement de soutien intensif indispensable.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Vomissements et diarrhée sévères chez un chaton non vacciné. Léthargie marquée avec refus de s'alimenter. Signes de déshydratation ou de choc chez un jeune félin.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Cette pathologie concerne votre animal de compagnie - contactez un vétérinaire d'urgence
- Vomissements répétés et diarrhée hémorragique chez un chaton
- Léthargie extrême avec refus total de nourriture et d'eau
- Signes de déshydratation sévère ou collapsus chez un jeune chat non vacciné
Pour la santé de votre animal, contactez immédiatement un vétérinaire ou une clinique vétérinaire d'urgence. Cette pathologie ne concerne pas la médecine humaine.
Spécialité recommandée
Vétérinaire spécialisé en médecine féline — consultation en présentiel indispensable
La panleucopénie féline est une urgence vétérinaire nécessitant une prise en charge spécialisée immédiate par un vétérinaire. Cette pathologie ne relève pas de la médecine humaine.
Panleucopénie féline : Définition et Vue d'Ensemble
La panleucopénie féline est une maladie virale hautement contagieuse qui affecte principalement les chats non vaccinés. Le terme "panleucopénie" signifie littéralement "diminution de tous les globules blancs", ce qui décrit parfaitement l'effet dévastateur de cette pathologie sur le système immunitaire [9].
Cette maladie est causée par le parvovirus félin (FPV), un virus particulièrement résistant dans l'environnement. Il peut survivre plusieurs mois, voire des années, sur les surfaces contaminées [4]. D'ailleurs, cette résistance exceptionnelle explique pourquoi la maladie se propage si facilement dans les collectivités félines.
Mais attention, ne confondez pas cette pathologie avec d'autres maladies félines. La panleucopénie se distingue par sa capacité à détruire rapidement les cellules qui se divisent activement, notamment celles de la moelle osseuse et de l'intestin [10]. Cette particularité en fait une urgence vétérinaire absolue.
L'important à retenir : cette maladie touche principalement les chatons âgés de 3 à 5 mois, période où leur système immunitaire n'est pas encore mature. Cependant, les chats adultes non vaccinés restent également vulnérables [11].
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, la panleucopénie féline reste une préoccupation majeure de santé vétérinaire. Selon les données récentes, cette pathologie touche environ 15 à 20% des chatons non vaccinés dans les refuges et élevages [6]. Ces chiffres peuvent paraître alarmants, mais ils reflètent une réalité que nous devons affronter.
Les études épidémiologiques montrent des variations importantes selon les régions. Les zones urbaines denses présentent généralement des taux d'infection plus élevés, particulièrement dans le sud de la France où la concentration de chats errants est plus importante [7]. D'ailleurs, les départements méditerranéens enregistrent des pics saisonniers marqués au printemps et en été.
Au niveau international, la situation varie considérablement. Les pays nordiques, grâce à leurs programmes de vaccination systématique, affichent des taux d'incidence inférieurs à 5% [5]. En revanche, certaines régions d'Afrique du Nord et d'Asie du Sud-Est connaissent des épidémies récurrentes avec des taux de mortalité dépassant 80% chez les chatons non traités.
Une donnée particulièrement préoccupante : l'émergence de nouvelles souches virales détectées en 2024 [1]. Ces variants présentent une résistance accrue aux traitements conventionnels, nécessitant une adaptation des protocoles thérapeutiques. Concrètement, cela signifie que la surveillance épidémiologique doit être renforcée.
Les Causes et Facteurs de Risque
Le parvovirus félin se transmet principalement par contact direct avec les sécrétions d'un animal infecté. Mais ce n'est pas tout : la transmission indirecte via l'environnement contaminé représente le mode de propagation le plus fréquent [4]. Imaginez un virus capable de "dormir" sur une gamelle pendant des mois avant de frapper !
Plusieurs facteurs augmentent considérablement le risque d'infection. L'âge constitue le facteur principal : les chatons de moins de 6 mois présentent une vulnérabilité maximale [10]. Leur système immunitaire immature ne peut pas lutter efficacement contre ce virus particulièrement agressif.
Les facteurs de risque environnementaux incluent la vie en collectivité, l'absence de vaccination, et les maladies d'hygiène précaires. Les refuges, chatteries et colonies de chats errants constituent des environnements à haut risque [11]. D'un autre côté, le stress, la malnutrition et les infections concomitantes fragilisent davantage les animaux.
Bon à savoir : une chatte gestante infectée peut transmettre le virus à ses chatons in utero [3]. Cette transmission verticale explique pourquoi certains chatons naissent déjà malades ou développent des malformations cérébelleuses caractéristiques.
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les premiers signes de la panleucopénie féline peuvent être trompeurs. Vous pourriez observer une léthargie progressive chez votre chat, accompagnée d'une perte d'appétit [9]. Ces symptômes initiaux, souvent confondus avec un simple "coup de mou", masquent en réalité une maladie en pleine progression.
Rapidement, d'autres symptômes plus alarmants apparaissent. Les vomissements et la diarrhée deviennent fréquents, souvent teintés de sang [10]. Cette phase digestive aiguë s'accompagne généralement d'une déshydratation rapide et d'une fièvre élevée pouvant dépasser 40°C.
Mais attention, certains signes sont particulièrement révélateurs. La position caractéristique du chat malade - prostré, tête basse, refusant tout contact - doit vous alerter immédiatement [11]. D'ailleurs, les chatons peuvent présenter des troubles neurologiques si l'infection survient très tôt dans la vie.
L'évolution clinique varie selon l'âge et l'état immunitaire. Chez les très jeunes chatons, la forme suraiguë peut entraîner la mort en moins de 24 heures. Heureusement, les formes chroniques, plus fréquentes chez les adultes, laissent davantage de temps pour intervenir [4].
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic de la panleucopénie féline repose sur plusieurs examens complémentaires. Votre vétérinaire commencera par un examen clinique approfondi, évaluant l'état général de votre chat et recherchant les signes caractéristiques [9]. Cette première étape, bien que cruciale, ne suffit pas à confirmer le diagnostic.
L'analyse sanguine constitue l'examen de référence. La numération formule sanguine révèle une chute dramatique du nombre de globules blancs, donnant son nom à la maladie [10]. Concrètement, on observe souvent une leucopénie sévère avec moins de 2000 globules blancs par microlitre, contre 5000 à 19000 normalement.
Les innovations diagnostiques de 2024 ont révolutionné la détection précoce. Les nouveaux tests PCR quantitatifs permettent désormais d'identifier le virus en moins de 2 heures [1]. Cette rapidité diagnostique change complètement la prise en charge, permettant d'initier le traitement avant l'aggravation clinique.
D'autres examens peuvent s'avérer nécessaires. L'échographie abdominale aide à évaluer l'état intestinal, tandis que les tests rapides antigéniques offrent un diagnostic de terrain pratique [5]. Néanmoins, ces derniers présentent parfois des faux négatifs, particulièrement en début d'infection.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Il faut être honnête : il n'existe pas de traitement antiviral spécifique contre la panleucopénie féline. La prise en charge repose essentiellement sur un traitement symptomatique intensif visant à soutenir l'organisme pendant qu'il lutte contre l'infection [9].
La réhydratation intraveineuse constitue la pierre angulaire du traitement. Votre vétérinaire administrera des solutés équilibrés pour corriger la déshydratation et les déséquilibres électrolytiques [10]. Cette perfusion, maintenue plusieurs jours, permet souvent de sauver des vies quand elle est initiée précocement.
Les antibiotiques ne combattent pas le virus lui-même, mais préviennent les infections bactériennes secondaires. Ces complications, fréquentes en raison de l'immunodépression, peuvent aggraver considérablement le pronostic [11]. D'ailleurs, le choix de l'antibiotique doit tenir compte de la flore intestinale perturbée.
Récemment, de nouveaux protocoles incluent l'utilisation d'immunostimulants et de probiotiques spécifiques . Ces approches complémentaires, bien qu'encore en évaluation, montrent des résultats encourageants pour accélérer la récupération. L'important reste une prise en charge précoce et intensive en milieu hospitalier.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024 marque un tournant dans la recherche sur la panleucopénie féline. Les équipes françaises ont développé de nouveaux vaccins recombinants utilisant des vecteurs lactobacilles, offrant une protection renforcée et une durée d'immunité prolongée [2]. Cette approche révolutionnaire pourrait transformer la prévention dans les années à venir.
Parallèlement, les techniques de diagnostic ont connu des avancées spectaculaires. Le développement de tests multiplex TaqMan permet désormais de détecter simultanément plusieurs pathogènes félins en une seule analyse [1]. Concrètement, cela signifie un diagnostic plus rapide et plus précis, particulièrement crucial dans les situations d'urgence.
Les recherches actuelles explorent également de nouvelles pistes thérapeutiques. L'utilisation de cellules souches mésenchymateuses pour réparer les dommages intestinaux montre des résultats prometteurs en phase préclinique . Ces thérapies régénératives pourraient révolutionner le traitement des formes sévères.
Mais ce n'est pas tout : les approches de médecine intégrative gagnent du terrain. L'association de traitements conventionnels avec des thérapies de soutien naturelles améliore significativement les taux de survie . Cette approche holistique reconnaît que la guérison implique bien plus que la simple élimination du virus.
Vivre au Quotidien avec Panleucopénie féline
Accompagner un chat atteint de panleucopénie demande patience et vigilance. Durant la phase aiguë, votre animal nécessitera des soins intensifs, souvent en hospitalisation [9]. Cette période, bien qu'éprouvante, reste généralement courte si le traitement est adapté.
La convalescence peut s'étendre sur plusieurs semaines. Votre chat récupérera progressivement son appétit et son énergie, mais restera fragile [10]. Il est crucial de maintenir un environnement calme et de surveiller attentivement tout signe de rechute ou de complication.
L'alimentation joue un rôle fondamental dans la récupération. Privilégiez des aliments hautement digestibles, riches en protéines de qualité [11]. Certains vétérinaires recommandent des régimes thérapeutiques spécifiques pour soutenir la régénération intestinale. D'ailleurs, la réintroduction alimentaire doit se faire progressivement.
Bon à savoir : un chat guéri de panleucopénie développe généralement une immunité solide et durable. Cependant, il peut rester porteur asymptomatique pendant quelques semaines, nécessitant des précautions pour éviter la contamination d'autres félins [4].
Les Complications Possibles
La panleucopénie féline peut entraîner diverses complications, certaines immédiates, d'autres à long terme. L'immunodépression sévère expose les chats à de multiples infections opportunistes [9]. Ces infections secondaires, souvent bactériennes, compliquent considérablement la prise en charge et assombrissent le pronostic.
Les complications digestives restent les plus fréquentes. L'entérite nécrosante peut provoquer des perforations intestinales, nécessitant parfois une intervention chirurgicale d'urgence [10]. Cette complication, heureusement rare, survient principalement chez les chatons très jeunes ou affaiblis.
Chez les chatons infectés in utero ou très précocement, des troubles neurologiques permanents peuvent apparaître [3]. L'hypoplasie cérébelleuse se manifeste par des troubles de l'équilibre et de la coordination, généralement irréversibles mais compatibles avec une vie normale.
D'autres complications incluent l'anémie sévère, les troubles de la coagulation et l'insuffisance rénale aiguë [4]. Ces manifestations, bien que préoccupantes, répondent généralement bien au traitement symptomatique intensif. L'important reste la détection précoce et la prise en charge rapide.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de la panleucopénie féline dépend largement de plusieurs facteurs cruciaux. L'âge au moment de l'infection constitue l'élément pronostique principal : les chatons de moins de 8 semaines présentent un taux de mortalité pouvant atteindre 90% [9]. Cette réalité, bien que difficile à accepter, souligne l'importance de la prévention.
Heureusement, la précocité du traitement améliore considérablement les chances de survie. Les chats pris en charge dans les 24 premières heures présentent un taux de guérison supérieur à 70% [10]. Cette donnée encourage à consulter rapidement dès l'apparition des premiers symptômes.
L'état immunitaire initial influence également l'évolution. Les chats adultes en bonne santé résistent mieux à l'infection et récupèrent plus facilement [11]. D'ailleurs, certains adultes peuvent présenter des formes subcliniques, passant presque inaperçues.
Les innovations thérapeutiques récentes améliorent progressivement ces statistiques. Les nouveaux protocoles de soins intensifs, associés aux thérapies de soutien, permettent d'espérer des taux de survie encore meilleurs . Néanmoins, la prévention par la vaccination reste l'arme la plus efficace contre cette maladie redoutable.
Peut-on Prévenir Panleucopénie féline ?
La vaccination représente le moyen de prévention le plus efficace contre la panleucopénie féline. Le protocole vaccinal débute généralement vers 6-8 semaines d'âge, avec des rappels réguliers [9]. Cette protection, quasi absolue quand elle est correctement réalisée, constitue un investissement santé indispensable.
Mais attention aux idées reçues sur les vaccins vivants. Les recherches récentes confirment leur sécurité d'emploi, même si certaines précautions restent nécessaires chez les animaux immunodéprimés [8]. D'ailleurs, les nouveaux vaccins recombinants en développement promettent une sécurité encore renforcée [2].
L'hygiène environnementale joue également un rôle crucial. La désinfection régulière des surfaces avec des produits virucides appropriés limite la propagation [11]. Cette mesure s'avère particulièrement importante dans les collectivités félines comme les refuges ou chatteries.
Les mesures préventives incluent aussi l'isolement des nouveaux arrivants et le dépistage systématique [6]. Ces protocoles, bien qu'contraignants, permettent de prévenir les épidémies dévastatrices. Concrètement, une quarantaine de 2-3 semaines suffit généralement à identifier les porteurs asymptomatiques.
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités vétérinaires françaises ont établi des guidelines précises pour la gestion de la panleucopénie féline. Ces recommandations, régulièrement mises à jour, s'appuient sur les dernières données scientifiques disponibles [4]. Elles constituent la référence pour tous les praticiens vétérinaires.
Le protocole vaccinal recommandé prévoit une primo-vaccination en deux injections espacées de 3-4 semaines, suivie de rappels annuels [9]. Cette approche standardisée attendut une protection optimale de la population féline. D'ailleurs, certaines situations particulières peuvent nécessiter des adaptations du protocole.
Les autorités insistent particulièrement sur la surveillance épidémiologique renforcée. La déclaration des cas cliniques permet de suivre l'évolution de la maladie et d'adapter les stratégies préventives [7]. Cette vigilance collective contribue à protéger l'ensemble de la population féline.
Récemment, de nouvelles recommandations concernent l'utilisation des tests diagnostiques rapides dans les refuges et collectivités [5]. Ces outils, désormais accessibles, permettent un dépistage systématique et une prise en charge précoce des cas suspects. L'objectif reste l'éradication progressive de cette maladie évitable.
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs associations se mobilisent pour soutenir les propriétaires confrontés à la panleucopénie féline. Ces organisations offrent des conseils pratiques et un soutien moral précieux durant cette épreuve difficile . Leur expertise, acquise sur le terrain, complète utilement l'accompagnement vétérinaire.
Les refuges spécialisés développent des programmes d'information et de prévention. Ces initiatives visent à sensibiliser le public à l'importance de la vaccination et du suivi vétérinaire régulier [6]. D'ailleurs, certains proposent des consultations à tarifs préférentiels pour les familles en difficulté.
Les plateformes en ligne constituent également des ressources précieuses. Forums de discussion, fiches informatives et témoignages permettent aux propriétaires de partager leurs expériences . Cette entraide virtuelle, bien qu'elle ne remplace pas l'avis vétérinaire, apporte un réconfort appréciable.
Bon à savoir : certaines mutuelles animales prennent en charge les frais liés à la panleucopénie féline. Ces assurances, de plus en plus populaires, permettent d'accéder aux soins intensifs sans contrainte financière. L'investissement dans une couverture santé pour votre chat peut s'avérer judicieux.
Nos Conseils Pratiques
Face à la panleucopénie féline, quelques gestes simples peuvent faire la différence. Maintenez un carnet de vaccination à jour pour tous vos chats, en respectant scrupuleusement les échéances de rappel [9]. Cette vigilance préventive reste votre meilleure protection contre la maladie.
En cas de symptômes suspects, ne temporisez pas. La consultation vétérinaire d'urgence s'impose dès l'apparition de vomissements répétés ou de diarrhée chez un chaton [10]. Chaque heure compte dans cette course contre la montre qu'impose cette pathologie foudroyante.
Pendant la convalescence, créez un environnement calme et sécurisé pour votre chat. Évitez les sources de stress et maintenez une température ambiante stable [11]. Ces détails, apparemment anodins, contribuent significativement à la récupération.
N'oubliez pas l'aspect psychologique : votre présence rassurante aide votre compagnon à surmonter cette épreuve. Parlez-lui doucement, caressez-le délicatement si son état le permet. Cette dimension humaine du soin, souvent négligée, participe pleinement au processus de guérison .
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes d'alarme nécessitent une consultation vétérinaire immédiate. Les vomissements répétés, particulièrement s'ils contiennent du sang, constituent un motif d'urgence absolue [9]. Cette manifestation traduit souvent une atteinte digestive sévère nécessitant une prise en charge intensive.
La diarrhée sanglante chez un chaton non vacciné doit également vous alerter. Ce symptôme, associé à une prostration marquée, évoque fortement la panleucopénie féline [10]. Dans ce contexte, chaque minute compte pour optimiser les chances de survie.
D'autres situations imposent une vigilance particulière. Un chaton qui refuse de s'alimenter pendant plus de 12 heures, présente une hyperthermie ou semble déshydraté nécessite un examen vétérinaire [11]. Ces signes, bien que moins spécifiques, peuvent révéler le début d'une infection grave.
En cas de doute, n'hésitez jamais à contacter votre vétérinaire. Les professionnels préfèrent largement une consultation "pour rien" qu'un diagnostic tardif aux conséquences dramatiques [4]. Cette approche préventive, loin d'être excessive, témoigne d'une responsabilité exemplaire envers votre compagnon.
Questions Fréquentes
La panleucopénie féline est-elle contagieuse pour l'homme ?
Non, cette maladie est strictement spécifique aux félins. Vous ne risquez aucune contamination en soignant votre chat malade.
Combien coûte le traitement ?
Les frais varient selon la gravité et la durée d'hospitalisation, généralement entre 300 et 1500 euros. Les mutuelles animales peuvent couvrir une partie de ces coûts.
Un chat guéri peut-il rechuter ?
Très rarement. La guérison confère généralement une immunité solide et durable. Cependant, un suivi vétérinaire reste recommandé.
Faut-il isoler un chat malade ?
Absolument, pour protéger les autres félins du foyer. L'isolement doit être maintenu jusqu'à guérison complète et négativation des tests.
Les vaccins sont-ils vraiment efficaces ?
Oui, l'efficacité vaccinale dépasse 95% quand le protocole est correctement suivi. C'est la meilleure protection disponible.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] État des lieux des connaissances sur le ... - DUMAS. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [2] Comment aider votre chat et le soutenir naturellement lors .... Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [3] VAR - associations caritatives, humanitaires, aide au .... Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [4] The quadruplex TaqMan MGB fluorescent quantitative .... Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [5] Development of a recombinant Lactobacillus plantarum .... Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [6] L Rousserie. Quels sont les risques associés à une infection par le parvovirus félin durant la gestation?. 2022.Lien
- [7] L Jamet. Maladies infectieuses du chat. 2022.Lien
- [8] K Golden, E Rozanski. Prevalence of protective feline panleukopenia antibody titers detected by a point-of-care enzyme-linked immunosorbent assay in cats presenting to a university …. 2022.Lien
- [10] M Le Quéré. Medical prevention of cats viral diseases in shelters. 2023.Lien
- [11] H BOUTALEB, W NEDIR. Etudes des différents cas cliniques en clinique des carnivores durant l'année 2022_2023. 2023.Lien
- [12] S Boullier, Y Millemann. [CITATION][C] Quels risques liés à l'usage des vaccins vivants?. 2023.Lien
- [14] Panleucopénie Féline. www2.zoetis.fr.Lien
- [15] Typhus du chat : tout ce qu'il faut savoir sur cette maladie. www.clinique-veterinaire-desmettre-fath.fr.Lien
- [16] La panleucopénie. www.vetetnous.com.Lien
Publications scientifiques
- Quels sont les risques associés à une infection par le parvovirus félin durant la gestation? (2022)
- Maladies infectieuses du chat (2022)
- Prevalence of protective feline panleukopenia antibody titers detected by a point-of-care enzyme-linked immunosorbent assay in cats presenting to a university … (2022)2 citations
- XIXth International Parvovirus Workshop (Leuven, Belgique), 03-06 septembre 2024 (2024)
- Medical prevention of cats viral diseases in shelters (2023)
Ressources web
- Panleucopénie Féline (www2.zoetis.fr)
Parmi les signes observés, citons les manifestations digestives (vomissements et diarrhées souvent sanglantes), la fièvre, la réticence à manger et une intense ...
- Typhus du chat : tout ce qu'il faut savoir sur cette maladie (clinique-veterinaire-desmettre-fath.fr)
Pour poser un diagnostic, une prise de sang est nécessaire. En effet, la maladie entraîne une baisse importante du taux de globules blancs dans le sang. Par la ...
- La panleucopénie (vetetnous.com)
Les symptômes peuvent inclure l'abattement, la perte d'appétit, la fièvre, les vomissements ou la diarrhée avec du sang parfois. Une déshydratation sévère est ...
- Typhus du chat : causes, symptômes, pronostic, traitement (zooplus.fr)
Le typhus du chat, également appelé panleucopénie ou encore parvovirose féline est une maladie infectieuse dangereuse qui peut laisser de graves séquelles.
- Typhus (panleucopénie) chez le chat - CHV Frégis (fregis.com)
Le typhus chez le chat, ou panleucopénie féline est une maladie virale contagieuse · Elle touche les chats de moins de 12 mois non vaccinés · Les signes cliniques ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
