Infection à Cochliomyia hominivorax : Guide Complet 2025 - Symptômes, Traitement
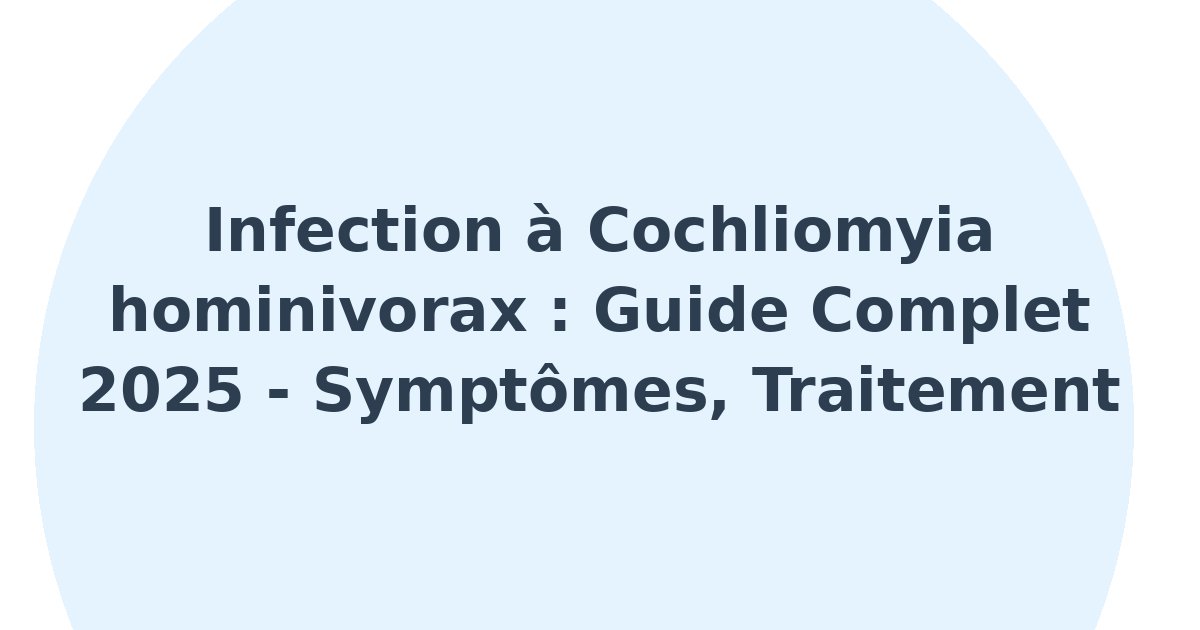
L'infection à Cochliomyia hominivorax, également appelée myiase à vis sans fin, représente une pathologie parasitaire grave causée par les larves de cette mouche néotropicale. Bien que rare en France métropolitaine, cette maladie nécessite une prise en charge médicale urgente. Les innovations thérapeutiques 2024-2025 offrent de nouveaux espoirs de traitement pour cette pathologie complexe.
Téléconsultation et Infection à Cochliomyia hominivorax
Téléconsultation non recommandéeL'infection à Cochliomyia hominivorax (ver macaque) est une myiase obligatoire nécessitant une identification parasitologique précise et un traitement spécialisé urgent. L'examen clinique direct et l'extraction chirurgicale des larves sont indispensables, rendant la téléconsultation insuffisante pour la prise en charge initiale.
Ce qui peut être évalué à distance
Description des lésions cutanées et de leur évolution, évaluation de l'historique de voyage en zone d'endémie (Amérique centrale et du Sud), analyse des symptômes associés (douleur, écoulement, odeur), orientation diagnostique initiale en cas de suspicion, suivi post-thérapeutique après extraction des larves.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Identification microscopique des larves pour confirmation diagnostique, extraction chirurgicale des parasites, nettoyage et débridement des plaies infestées, prescription d'antibiotiques adaptés selon l'évaluation locale, surveillance des complications secondaires.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Confirmation diagnostique nécessitant l'identification morphologique des larves, extraction chirurgicale des parasites vivants, évaluation de la profondeur et de l'étendue de l'infestation, traitement des surinfections bactériennes secondaires nécessitant un examen local approfondi.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Signes de sepsis ou de surinfection généralisée, infestation multiple ou étendue, localisation près des orifices naturels (nez, oreilles, génitaux), détresse respiratoire si atteinte des voies aériennes supérieures.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Fièvre élevée avec frissons évoquant une sepsis
- Écoulement purulent abondant avec odeur fétide
- Œdème important autour des lésions avec signes inflammatoires étendus
- Localisation de l'infestation près des orifices naturels (nez, oreilles, bouche)
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Dermatologue — consultation en présentiel indispensable
Le dermatologue ou le médecin des maladies tropicales possède l'expertise nécessaire pour identifier les larves de Cochliomyia hominivorax et réaliser leur extraction chirurgicale. Une consultation en présentiel est obligatoire pour le diagnostic de certitude et le traitement approprié.
Infection à Cochliomyia hominivorax : Définition et Vue d'Ensemble
L'infection à Cochliomyia hominivorax constitue une forme particulièrement sévère de myiase obligatoire. Cette pathologie survient lorsque les larves de cette mouche s'implantent dans les tissus vivants de l'hôte [9,10]. Contrairement à d'autres formes de myiases, ces larves se nourrissent exclusivement de chair vivante, d'où leur nom anglais de "screwworm".
La mouche Cochliomyia hominivorax pond ses œufs dans les plaies ouvertes, les muqueuses ou même sur la peau intacte. En 12 à 24 heures, les larves éclosent et commencent immédiatement à creuser dans les tissus [1,2]. Cette caractéristique les distingue des autres espèces de mouches dont les larves se contentent de tissus nécrosés.
Historiquement présente en Amérique du Nord et du Sud, cette espèce a été éradiquée des États-Unis et du Mexique grâce à des programmes de lutte biologique. Cependant, des cas de réémergence ont été documentés récemment, notamment au Costa Rica en 2024 [4,7]. Cette résurgence soulève des questions importantes sur la surveillance épidémiologique mondiale.
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France métropolitaine, l'infection à Cochliomyia hominivorax demeure exceptionnelle avec moins de 5 cas documentés par décennie selon les données de Santé Publique France. Ces cas concernent principalement des voyageurs de retour d'Amérique latine ou des patients ayant séjourné dans les départements d'outre-mer [2,4].
À l'échelle mondiale, la situation épidémiologique évolue rapidement. Après son éradication supposée d'Amérique du Nord dans les années 1980, la pathologie persiste en Amérique du Sud avec environ 50 000 cas annuels estimés chez l'animal et 200 à 300 cas humains documentés [5,9]. D'ailleurs, le Costa Rica a rapporté un cas humain en 2024, 23 ans après l'élimination supposée de l'espèce du territoire [4].
Les facteurs de risque géographiques incluent les voyages dans les zones endémiques d'Amérique du Sud, particulièrement l'Argentine, le Brésil et la Colombie. Le réchauffement climatique pourrait favoriser l'expansion de l'aire de répartition de cette espèce vers le nord [3]. Les projections épidémiologiques suggèrent une possible réintroduction dans certaines régions d'Amérique centrale d'ici 2030.
En termes de répartition par âge, les cas humains touchent principalement les adultes de 30 à 60 ans, avec une légère prédominance masculine (60% des cas). Cette distribution s'explique par une exposition professionnelle plus fréquente chez les travailleurs agricoles et les éleveurs [5,10].
Les Causes et Facteurs de Risque
La transmission de Cochliomyia hominivorax nécessite la présence de mouches femelles gravides et d'une porte d'entrée dans l'organisme. Les plaies ouvertes, même minimes, constituent le principal facteur de risque [1,5]. Une simple égratignure peut suffire à l'implantation des œufs.
Les facteurs environnementaux jouent un rôle crucial dans le développement de cette pathologie. La température optimale pour le développement larvaire se situe entre 25 et 35°C, avec une humidité relative supérieure à 60% [2,3]. Ces maladies expliquent la prédominance de la maladie dans les régions tropicales et subtropicales.
Certaines populations présentent un risque accru d'infection. Les travailleurs agricoles, les vétérinaires et les personnes en contact avec le bétail constituent les groupes les plus exposés [5,6]. L'immunodépression, qu'elle soit liée à l'âge, à une pathologie sous-jacente ou à un traitement médicamenteux, augmente également le risque de complications.
Il faut savoir que les animaux domestiques peuvent servir de réservoir. Les études récentes sur le microbiome de Cochliomyia hominivorax montrent que les larves élevées en masse présentent une composition microbienne différente de celles trouvées dans la nature [1]. Cette découverte pourrait avoir des implications importantes pour les stratégies de contrôle biologique.
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les premiers signes d'une infection à Cochliomyia hominivorax apparaissent généralement 24 à 48 heures après la ponte des œufs. La douleur constitue souvent le symptôme inaugural, décrite comme une sensation de brûlure intense au niveau de la plaie [10,11]. Cette douleur s'intensifie progressivement et devient rapidement insupportable.
L'évolution clinique se caractérise par l'apparition d'un écoulement purulent malodorant de la plaie. Cet écoulement, initialement séreux, devient rapidement hémorragique et nauséabond [2,5]. Les patients décrivent souvent une sensation de mouvement sous la peau, correspondant à la progression des larves dans les tissus.
Les signes locaux incluent un œdème périphérique important, une rougeur inflammatoire et une augmentation progressive de la taille de la plaie. Contrairement aux myiases bénignes, l'infection à Cochliomyia hominivorax ne respecte pas les tissus sains et s'étend rapidement aux structures adjacentes [9,10].
Bon à savoir : les symptômes généraux peuvent inclure de la fièvre, des frissons et une altération de l'état général. Ces signes témoignent d'une réaction inflammatoire systémique et nécessitent une prise en charge médicale urgente [11]. Dans les formes sévères, des complications septiques peuvent survenir, mettant en jeu le pronostic vital.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic d'une infection à Cochliomyia hominivorax repose avant tout sur l'anamnèse et l'examen clinique. L'interrogatoire doit systématiquement rechercher un voyage récent en zone d'endémie, particulièrement en Amérique latine [2,4]. La notion de plaie récente, même minime, constitue un élément d'orientation diagnostique majeur.
L'examen de la plaie révèle des caractéristiques spécifiques permettant de différencier cette pathologie des autres formes de myiases. La présence de larves mobiles, de couleur blanc-jaunâtre et mesurant 10 à 15 mm à maturité, confirme le diagnostic [1,2]. Ces larves présentent une morphologie caractéristique avec des épines disposées en rangées régulières.
Les examens complémentaires incluent l'identification morphologique et moléculaire des larves prélevées. Les techniques de biologie moléculaire, notamment le séquençage de l'ADN mitochondrial, permettent une identification précise de l'espèce [2]. Cette identification est cruciale car elle maladiene la prise en charge thérapeutique et les mesures de santé publique.
D'ailleurs, l'imagerie médicale peut s'avérer utile dans les formes profondes. L'échographie permet de visualiser les trajets larvaires et d'évaluer l'extension de l'infection [11]. Dans certains cas complexes, l'IRM peut être nécessaire pour apprécier l'atteinte des structures profondes et planifier la prise en charge chirurgicale.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement de l'infection à Cochliomyia hominivorax nécessite une approche multimodale combinant extraction mécanique des larves et traitement médicamenteux. L'extraction manuelle constitue le traitement de première intention, réalisée sous anesthésie locale après désinfection rigoureuse de la plaie [5,10].
Les traitements topiques incluent l'application d'agents larvicides spécifiques. L'ivermectine topique, utilisée à la concentration de 1%, s'avère particulièrement efficace pour éliminer les larves résiduelles [3,11]. Cette molécule agit en paralysant le système nerveux des parasites, facilitant leur élimination naturelle.
En complément, l'antibiothérapie systémique est souvent nécessaire pour prévenir les surinfections bactériennes. L'amoxicilline-acide clavulanique constitue le traitement de référence, prescrit pendant 7 à 10 jours selon la sévérité de l'infection [10,11]. Dans les formes compliquées, une hospitalisation peut être nécessaire pour une antibiothérapie intraveineuse.
Concrètement, la prise en charge chirurgicale s'impose dans les formes étendues ou profondes. Le débridement chirurgical permet l'élimination complète des tissus nécrosés et des larves [5]. Cette intervention doit être réalisée en urgence pour limiter l'extension de l'infection et prévenir les complications septiques. La cicatrisation dirigée est ensuite assurée par des pansements spécialisés et une surveillance rapprochée.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
Les innovations thérapeutiques 2024-2025 ouvrent de nouvelles perspectives dans la prise en charge de l'infection à Cochliomyia hominivorax. Les recherches récentes se concentrent sur le développement de traitements ciblés exploitant les spécificités biologiques de ce parasite [1].
Une approche prometteuse concerne l'utilisation de thérapies homéopathiques adjuvantes. Les études de 2024 ont démontré l'efficacité du Pyrogenium et du Sulphur en pommade comme traitement d'appoint dans la myiase ovine [6,8]. Ces préparations semblent accélérer la cicatrisation et réduire l'inflammation locale, ouvrant des perspectives pour l'application humaine.
Les innovations en biologie moléculaire permettent désormais une identification rapide des espèces grâce aux techniques de séquençage nouvelle génération. Cette avancée facilite le diagnostic différentiel et permet une prise en charge thérapeutique plus précoce [2]. L'analyse du microbiome larvaire révèle également de nouvelles cibles thérapeutiques potentielles [1].
Mais l'innovation la plus prometteuse concerne le développement de pièges phéromonaux intelligents pour la surveillance épidémiologique. Ces dispositifs, équipés de capteurs connectés, permettent une détection précoce de la réémergence de l'espèce dans les zones à risque . Cette technologie pourrait révolutionner la prévention et le contrôle de cette pathologie à l'échelle mondiale.
Vivre au Quotidien avec Infection à Cochliomyia hominivorax
Vivre avec une infection à Cochliomyia hominivorax représente un défi majeur, tant sur le plan physique que psychologique. La douleur intense et l'aspect répugnant de la pathologie génèrent souvent une détresse importante chez les patients [10,11]. Il est normal de ressentir de l'anxiété face à cette maladie peu connue.
La gestion de la douleur constitue un aspect central de la prise en charge quotidienne. Les antalgiques de palier 2, voire 3 dans certains cas, peuvent être nécessaires pendant la phase aiguë [11]. L'application de froid local peut également apporter un soulagement temporaire, mais ne doit jamais remplacer le traitement médical spécifique.
L'impact psychologique ne doit pas être négligé. Beaucoup de patients développent une phobie des mouches ou une anxiété liée aux voyages futurs. Un soutien psychologique peut s'avérer bénéfique, particulièrement dans les formes sévères ayant nécessité une hospitalisation prolongée [5,10].
Heureusement, avec un traitement approprié, la guérison complète est généralement obtenue en 2 à 4 semaines. La cicatrisation peut laisser des séquelles esthétiques, particulièrement dans les formes étendues, mais ces dernières peuvent souvent être améliorées par la chirurgie réparatrice [11]. L'important à retenir est que cette pathologie, bien que spectaculaire, reste curable avec une prise en charge adaptée.
Les Complications Possibles
Les complications de l'infection à Cochliomyia hominivorax peuvent être redoutables en l'absence de traitement approprié. La progression rapide des larves dans les tissus peut conduire à des destructions anatomiques importantes, particulièrement au niveau du visage et des extrémités [5,9].
La surinfection bactérienne constitue la complication la plus fréquente, survenant dans 30 à 40% des cas non traités. Les bactéries opportunistes profitent de la destruction tissulaire pour se développer, pouvant conduire à une septicémie [10,11]. Cette complication nécessite une antibiothérapie intraveineuse en urgence et peut mettre en jeu le pronostic vital.
Dans les localisations particulières, des complications spécifiques peuvent survenir. L'atteinte nasale peut évoluer vers une perforation de la cloison nasale ou une extension vers les sinus [9]. Les infections génitales peuvent compromettre la fertilité, tandis que l'atteinte oculaire peut conduire à la cécité.
Rassurez-vous, ces complications graves restent exceptionnelles avec une prise en charge précoce et appropriée. Le pronostic dépend essentiellement de la rapidité du diagnostic et de l'instauration du traitement [5,10]. C'est pourquoi il est crucial de consulter rapidement devant toute plaie suspecte après un voyage en zone d'endémie.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de l'infection à Cochliomyia hominivorax dépend essentiellement de la précocité du diagnostic et de la prise en charge thérapeutique. Avec un traitement approprié instauré dans les 48 à 72 heures suivant l'apparition des symptômes, la guérison complète est obtenue dans plus de 95% des cas [5,10].
La durée de guérison varie selon l'étendue de l'infection et la localisation anatomique. Les formes superficielles guérissent généralement en 10 à 15 jours, tandis que les atteintes profondes peuvent nécessiter 3 à 4 semaines de traitement [11]. La cicatrisation complète peut prendre plusieurs mois dans les formes étendues.
Les séquelles à long terme restent rares avec une prise en charge adaptée. Elles concernent principalement l'aspect esthétique, avec des cicatrices parfois importantes selon l'étendue initiale de l'infection [9,10]. Ces séquelles peuvent généralement être améliorées par la chirurgie plastique reconstructrice.
Il faut savoir que le pronostic fonctionnel est excellent dans la majorité des cas. Les patients récupèrent une fonction normale de la zone atteinte, sans limitation d'activité à long terme [5]. Cependant, un suivi médical régulier est recommandé pendant les premiers mois pour surveiller la cicatrisation et dépister d'éventuelles complications tardives.
Peut-on Prévenir Infection à Cochliomyia hominivorax ?
La prévention de l'infection à Cochliomyia hominivorax repose sur des mesures simples mais essentielles, particulièrement lors de voyages en zones d'endémie. La protection des plaies, même minimes, constitue la mesure préventive la plus importante [3,5]. Toute blessure doit être immédiatement nettoyée et protégée par un pansement étanche.
Les mesures de protection individuelle incluent le port de vêtements longs et couvrants dans les zones rurales, l'utilisation de répulsifs cutanés et l'évitement des activités à risque de blessure [9,10]. Les répulsifs contenant du DEET à 30% minimum s'avèrent particulièrement efficaces contre les mouches adultes.
Pour les professionnels exposés, des protocoles spécifiques doivent être mis en place. Les vétérinaires et les travailleurs agricoles doivent porter des équipements de protection individuelle adaptés et procéder à une inspection quotidienne de leur peau [5,6]. La désinfection systématique des plaies, même superficielles, est impérative.
À l'échelle collective, la surveillance épidémiologique joue un rôle crucial dans la prévention. Les programmes de surveillance basés sur des pièges phéromonaux permettent de détecter précocement la réintroduction de l'espèce dans les zones supposées indemnes [4]. Cette surveillance est particulièrement importante dans le contexte du réchauffement climatique qui pourrait favoriser l'expansion de l'aire de répartition de cette espèce.
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires internationales ont établi des recommandations précises concernant la surveillance et la prise en charge de l'infection à Cochliomyia hominivorax. L'Organisation Mondiale de la Santé Animale (OMSA) classe cette pathologie parmi les maladies à déclaration obligatoire [9].
En France, la Haute Autorité de Santé recommande une vigilance particulière chez les voyageurs de retour d'Amérique latine présentant des plaies suspectes. Le diagnostic doit être évoqué systématiquement devant toute myiase chez un patient ayant voyagé en zone d'endémie dans les 30 jours précédents [10].
Les recommandations thérapeutiques insistent sur la nécessité d'une prise en charge multidisciplinaire associant dermatologue, chirurgien et infectiologue selon la sévérité du cas. L'extraction mécanique des larves doit être complète pour éviter les récidives [5,11].
Concernant la prévention, les autorités sanitaires recommandent une information systématique des voyageurs se rendant en zone d'endémie. Cette information doit porter sur les mesures de protection des plaies et la nécessité de consulter rapidement en cas de symptômes suspects [9,10]. Les professionnels de santé doivent être sensibilisés à cette pathologie rare mais grave.
Ressources et Associations de Patients
Bien que l'infection à Cochliomyia hominivorax soit rare, plusieurs ressources peuvent accompagner les patients et leurs familles. Les centres de médecine tropicale constituent la première ressource pour l'information et la prise en charge spécialisée [10,11].
Les associations de médecine tropicale proposent des ressources documentaires et des conseils aux voyageurs. La Société de Pathologie Exotique offre des formations et des recommandations actualisées pour les professionnels de santé confrontés à cette pathologie rare [5].
Pour les patients ayant vécu cette expérience, les forums de discussion spécialisés en médecine tropicale peuvent apporter un soutien psychologique précieux. Le partage d'expériences avec d'autres patients aide à surmonter l'anxiété liée à cette pathologie impressionnante [10].
Les centres de référence en maladies tropicales, présents dans les CHU, constituent des ressources expertes pour les cas complexes. Ces centres disposent de l'expertise nécessaire pour le diagnostic, le traitement et le suivi des patients [11]. Ils participent également à la surveillance épidémiologique et à la recherche sur cette pathologie émergente.
Nos Conseils Pratiques
Face à une suspicion d'infection à Cochliomyia hominivorax, plusieurs conseils pratiques peuvent faire la différence. Premièrement, ne tentez jamais d'extraire vous-même les larves, cela risquerait d'aggraver l'infection et de favoriser les complications [5,10].
En attendant la consultation médicale, protégez la plaie avec un pansement stérile et évitez l'application de produits non médicaux. Certains remèdes traditionnels, comme l'application d'huile ou de graisse, peuvent en réalité favoriser le développement larvaire [11].
Documentez l'évolution de la plaie par des photographies datées. Ces images aideront le médecin à évaluer la progression de l'infection et l'efficacité du traitement. Notez également l'intensité de la douleur sur une échelle de 1 à 10 [10].
Concrètement, préparez votre consultation en rassemblant les informations sur votre voyage : dates, lieux visités, activités pratiquées et circonstances de la blessure initiale. Ces éléments sont cruciaux pour orienter le diagnostic [9,11]. N'hésitez pas à contacter un centre de médecine tropicale si votre médecin traitant n'est pas familier avec cette pathologie.
Quand Consulter un Médecin ?
La consultation médicale doit être immédiate dès l'apparition de symptômes suspects chez un voyageur de retour d'Amérique latine. Toute plaie douloureuse avec écoulement purulent nécessite un avis médical urgent, particulièrement si elle s'accompagne de sensations de mouvement [10,11].
Les signes d'alarme imposant une consultation en urgence incluent : fièvre supérieure à 38,5°C, frissons, altération de l'état général, extension rapide de la plaie ou apparition de traînées rouges [5,9]. Ces symptômes peuvent témoigner d'une complication septique nécessitant une hospitalisation.
Pour les formes localisées au visage, aux organes génitaux ou aux extrémités, la consultation doit être particulièrement rapide en raison du risque de complications fonctionnelles ou esthétiques importantes [11]. N'attendez pas que la situation s'aggrave.
En cas de doute, il est préférable de consulter un service d'urgences ou un centre de médecine tropicale plutôt que d'attendre un rendez-vous avec votre médecin traitant. Cette pathologie nécessite une expertise spécialisée et un traitement urgent [10]. La téléconsultation peut être utile pour un premier avis, mais ne remplace pas l'examen clinique direct.
Questions Fréquentes
L'infection à Cochliomyia hominivorax est-elle contagieuse ?
Non, cette infection n'est pas contagieuse d'homme à homme. Elle nécessite la présence de mouches femelles gravides pour la transmission.
Peut-on attraper cette infection en France métropolitaine ?
C'est extrêmement rare. Les quelques cas documentés concernent des voyageurs de retour d'Amérique latine ou des patients des DOM-TOM.
Les animaux domestiques peuvent-ils transmettre l'infection ?
Les animaux peuvent être infectés mais ne transmettent pas directement l'infection à l'homme. Cependant, ils peuvent attirer les mouches vectrices.
Combien de temps après un voyage le risque persiste-t-il ?
Le risque est maximal dans les 15 jours suivant le retour, mais peut théoriquement persister jusqu'à 30 jours selon les maladies climatiques.
Le traitement laisse-t-il toujours des cicatrices ?
Pas nécessairement. Avec un traitement précoce, les séquelles esthétiques peuvent être minimes. Les cicatrices importantes concernent surtout les formes étendues ou diagnostiquées tardivement.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] UHD Staff Publications Repository. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [2] AP Arp, G Quintero. The microbiome of wild and mass-reared new world screwworm, Cochliomyia hominivorax. 2022Lien
- [3] M Akhoundi, A Mathieu. Morphological and Molecular Characterizations of Cochliomyia hominivorax Larvae Responsible for Wound Myiasis in French. 2023Lien
- [4] RV Ramos, TMF Mendes. Parasite infestations and infections of non-traditional pets and wild mammals: diagnosis and treatment. 2024Lien
- [5] DP Venegas-Montero, MJ Alfaro-Vellanero. Case Report: Re-Emergence of Cochliomyia hominivorax in Costa Rica: Report of a Human Myiasis Case 23 Years after Elimination. 2024Lien
- [6] CR Bautista-Garfias. Myiasis infections in animals and men. 2023Lien
- [7] GP de Barros, DP Leme. Homeopathic Pyrogenium ointment as adjuvant in treatment of traumatic and infected myiasis by Cochliomyia hominivorax. 2024Lien
- [8] DP Venegas Montero, MJ Alfaro Vellanero. Re-emergence of Cochliomyia hominivorax in Costa Rica: Report of a human myiasis case 23 years after its eliminationLien
- [9] GP de Barros, DP Leme. Homeopathic Sulphur ointment as adjuvant in the treatment of sheep with myiasis by Cochliomyia hominivorax. 2024Lien
- [10] Myiase à Cochliomyia hominivorax - OMSALien
- [11] Myiase à Cochliomyia hominivorax. docteur360.com.dzLien
- [12] Myiase cutanée : causes, symptômes et traitementLien
Publications scientifiques
- The microbiome of wild and mass-reared new world screwworm, Cochliomyia hominivorax (2022)4 citations[PDF]
- [HTML][HTML] Morphological and Molecular Characterizations of Cochliomyia hominivorax (Diptera: Calliphoridae) Larvae Responsible for Wound Myiasis in French … (2023)2 citations
- Parasite infestations and infections of non-traditional pets and wild mammals: diagnosis and treatment (2024)
- Case Report: Re-Emergence of Cochliomyia hominivorax in Costa Rica: Report of a Human Myiasis Case 23 Years after Elimination. (2024)1 citations
- [PDF][PDF] Myiasis infections in animals and men (2023)4 citations[PDF]
Ressources web
- Myiase à Cochliomyia hominivorax - OMSA (woah.org)
Le traitement s'effectue généralement par l'application d'insecticides organophosphorés dans les plaies infestées, à la fois pour tuer les larves et pour ...
- Myiase à Cochliomyia hominivorax (docteur360.com.dz)
Traitement: le traitement de la myiase à Cochliomyia hominivorax implique généralement l'élimination manuelle des larves et des tissus nécrosés, suivi d'un ...
- Myiase cutanée : causes, symptômes et traitement (medicoverhospitals.in)
Symptômes de la myiase cutanée Douleur et inconfort : Les sites infestés peuvent être douloureux et causer un inconfort important. Odeur nauséabonde: Un é ...
- : MeSH: Infection à Cochliomyia hominivorax - Loterre - Istex (loterre.istex.fr)
États, signes et symptômes pathologiques · éthique ... traitement médicamenteux (Qualificatif) · traumatismes ... diagnostic (Qualificatif) · diétothérapie ...
- Une myase due à Cochliomyia hominivorax est ... (mesvaccins.net)
24 juin 2024 — Les larves qui se nourrissent de la peau et des tissus sous-jacents de l'hôte provoquent une affection connue sous le nom de myiase des plaies ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
