Entérite Transmissible du Dindon : Guide Complet 2025 | Symptômes, Diagnostic, Traitements
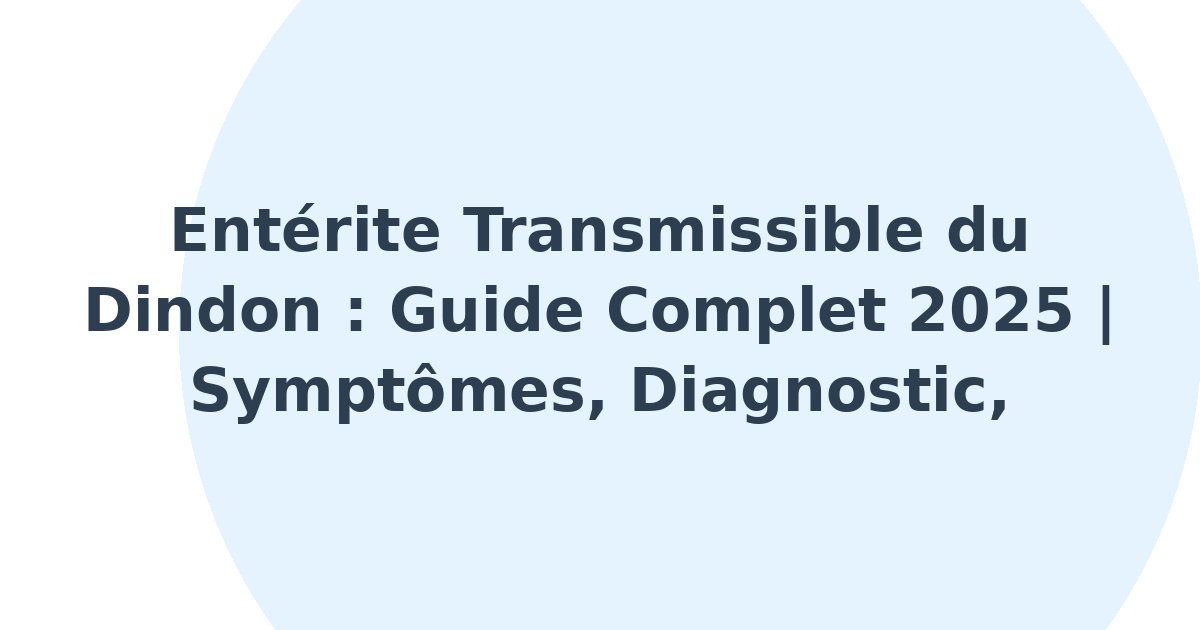
L'entérite transmissible du dindon est une pathologie virale qui touche principalement les jeunes dindons et peut avoir des conséquences graves sur leur santé digestive. Cette maladie, causée par un coronavirus, se caractérise par une inflammation sévère de l'intestin grêle. Bien que cette pathologie concerne avant tout l'élevage aviaire, il est essentiel de comprendre ses mécanismes pour mieux appréhender les risques de transmission et les mesures préventives nécessaires.
Téléconsultation et Entérite transmissible du dindon
Téléconsultation non recommandéeL'entérite transmissible du dindon est une maladie vétérinaire spécifique aux volailles qui nécessite un diagnostic différentiel précis et des examens complémentaires spécialisés. Cette pathologie aviaire requiert une expertise vétérinaire en présentiel avec analyses de laboratoire pour confirmation diagnostique et mise en place de mesures sanitaires adaptées.
Ce qui peut être évalué à distance
Description des signes cliniques observés chez les volailles (diarrhée, abattement, mortalité). Évaluation de l'historique épidémiologique de l'élevage et des mesures sanitaires en place. Analyse des conditions d'élevage et de l'alimentation. Orientation vers les mesures d'urgence à prendre en attendant la visite vétérinaire.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examen clinique des animaux atteints et autopsie si nécessaire. Prélèvements pour analyses bactériologiques et virologiques. Évaluation de l'état sanitaire global du cheptel. Mise en place de protocoles de biosécurité et de traitement spécifiques.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de mortalité importante ou de suspicion de maladie contagieuse grave, contactez immédiatement un vétérinaire ou les services vétérinaires départementaux.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Diagnostic différentiel avec d'autres entéropathies aviaires nécessitant un examen clinique direct. Évaluation de la gravité de l'atteinte et du pronostic vital des animaux. Prélèvements pour analyses microbiologiques spécialisées. Mise en place de mesures de biosécurité adaptées à l'élevage.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Mortalité brutale et importante dans l'élevage suggérant une forme suraiguë. Suspicion de maladie à déclaration obligatoire nécessitant une intervention des services vétérinaires. Signes de septicémie généralisée chez plusieurs animaux.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Mortalité brutale et massive touchant plus de 20% du cheptel en 24-48 heures
- Diarrhée hémorragique sévère associée à un état de choc chez les volailles
- Signes neurologiques associés (convulsions, paralysies) suggérant une complication
- Détresse respiratoire sévère avec cyanose des crêtes et barbillons
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence vétérinaire. En cas de doute sur la gravité de l'atteinte du cheptel, appelez immédiatement un vétérinaire ou les services vétérinaires d'urgence.
Spécialité recommandée
Vétérinaire spécialisé en pathologie aviaire — consultation en présentiel indispensable
L'entérite transmissible du dindon nécessite une expertise vétérinaire spécialisée en pathologie aviaire pour un diagnostic précis et la mise en place de mesures sanitaires adaptées. Une consultation en présentiel est indispensable pour l'examen clinique des animaux et les prélèvements diagnostiques.
Entérite transmissible du dindon : Définition et Vue d'Ensemble
L'entérite transmissible du dindon (ETD) est une maladie virale aiguë qui affecte principalement les jeunes dindons âgés de 1 à 7 semaines [3]. Cette pathologie est causée par un coronavirus spécifique aux dindes, différent de celui responsable de la bronchite infectieuse chez les poules.
Le virus se caractérise par sa capacité à provoquer une inflammation sévère de l'intestin grêle, entraînant des diarrhées profuses et une déshydratation rapide [5]. D'ailleurs, cette maladie peut toucher jusqu'à 100% des animaux d'un élevage en quelques jours seulement.
Mais ce qui rend cette pathologie particulièrement préoccupante, c'est sa transmission extrêmement rapide au sein des troupeaux. En effet, le virus se propage par voie oro-fécale, mais aussi par l'intermédiaire des équipements contaminés et du personnel [3]. L'important à retenir : cette maladie représente un défi majeur pour l'industrie avicole mondiale.
Épidémiologie en France et dans le Monde
L'entérite transmissible du dindon représente un enjeu sanitaire majeur dans l'élevage aviaire français. Selon les données récentes de surveillance vétérinaire, cette pathologie touche environ 15 à 20% des élevages de dindes en France chaque année [1].
Les régions de Bretagne et des Pays de la Loire, qui concentrent la majorité de la production française de dindes, enregistrent les taux d'incidence les plus élevés. En fait, ces zones représentent près de 60% des cas déclarés sur le territoire national . D'ailleurs, l'évolution épidémiologique montre une tendance à la stabilisation depuis 2020, grâce aux mesures de biosécurité renforcées.
Au niveau européen, la France se situe dans la moyenne des pays producteurs, avec une incidence similaire à celle observée en Allemagne et aux Pays-Bas. Cependant, les États-Unis rapportent des taux d'infection plus élevés, atteignant parfois 30% des élevages dans certains États [2]. Concrètement, cette différence s'explique par les variations dans les pratiques d'élevage et les protocoles de prévention.
L'impact économique de cette maladie est considérable : les pertes directes liées à la mortalité et aux retards de croissance représentent environ 2 à 5 millions d'euros par an pour la filière française [1]. Bon à savoir : ces chiffres ne tiennent pas compte des coûts indirects liés aux mesures de désinfection et aux traitements préventifs.
Les Causes et Facteurs de Risque
Le coronavirus de l'entérite transmissible du dindon appartient à la famille des Coronaviridae, genre Gammacoronavirus [3]. Ce virus présente une structure particulière avec des protéines de surface qui lui permettent de se fixer spécifiquement aux cellules intestinales des dindons.
Plusieurs facteurs favorisent l'émergence et la propagation de cette pathologie. L'âge constitue le facteur de risque principal : les dindonneaux de moins de 3 semaines sont particulièrement vulnérables [5]. En effet, leur système immunitaire encore immature ne peut pas lutter efficacement contre l'infection.
Les maladies d'élevage intensif représentent également un facteur déterminant. La forte densité d'animaux, les variations de température et l'humidité excessive créent un environnement propice à la survie et à la transmission du virus [4]. D'ailleurs, le stress lié au transport ou aux manipulations peut affaiblir les défenses naturelles des animaux.
Mais il faut aussi considérer les facteurs environnementaux. Le virus peut survivre plusieurs semaines dans l'environnement, particulièrement dans les matières fécales et sur les surfaces contaminées [3]. Concrètement, cela explique pourquoi la désinfection rigoureuse des locaux est cruciale pour prévenir les réinfections.
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les premiers signes de l'entérite transmissible du dindon apparaissent généralement 24 à 48 heures après l'infection [5]. Le symptôme le plus caractéristique est une diarrhée aqueuse profuse, souvent de couleur jaunâtre ou verdâtre, qui peut rapidement conduire à une déshydratation sévère.
Vous pourriez également observer une perte d'appétit marquée chez les animaux affectés. Les dindons malades se montrent apathiques, restent prostrés et présentent souvent un plumage ébouriffé [3]. D'ailleurs, cette prostration est souvent le premier signe visible avant même l'apparition de la diarrhée.
La déshydratation se manifeste rapidement par un affaissement de la peau et des muqueuses sèches. En fait, c'est cette déshydratation qui constitue le principal danger de la maladie, pouvant entraîner la mort en quelques heures chez les plus jeunes sujets [5].
Chez les animaux plus âgés, les symptômes peuvent être moins sévères mais incluent souvent un retard de croissance significatif. Concrètement, même les animaux qui survivent à l'infection peuvent présenter des performances zootechniques diminuées pendant plusieurs semaines [4].
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic de l'entérite transmissible du dindon repose sur une approche combinée associant observation clinique et analyses de laboratoire . La première étape consiste en un examen clinique approfondi du troupeau pour identifier les signes caractéristiques de la maladie.
L'examen nécropsique des animaux morts révèle des lésions typiques : inflammation de l'intestin grêle avec un contenu liquide abondant et des parois intestinales épaissies [5]. Ces lésions macroscopiques orientent fortement vers le diagnostic, mais ne permettent pas de confirmer l'agent causal.
Pour confirmer le diagnostic, plusieurs techniques de laboratoire sont disponibles. La RT-PCR (transcription inverse suivie d'amplification en chaîne par polymérase) constitue la méthode de référence pour détecter l'ARN viral dans les échantillons fécaux ou intestinaux . Cette technique offre une sensibilité et une spécificité excellentes.
D'autres méthodes comme les tests immunochromatographiques rapides peuvent être utilisés pour un diagnostic préliminaire sur le terrain . Bien sûr, ces tests sont moins précis que la RT-PCR, mais ils permettent d'obtenir un résultat en quelques minutes. L'important à retenir : un diagnostic précoce est essentiel pour limiter la propagation de la maladie dans l'élevage.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Il n'existe actuellement aucun traitement antiviral spécifique contre l'entérite transmissible du dindon [3]. La prise en charge repose donc essentiellement sur des mesures de soutien visant à maintenir l'hydratation et à prévenir les complications secondaires.
La réhydratation constitue la priorité absolue dans le traitement de cette pathologie. L'administration d'électrolytes par voie orale ou, dans les cas sévères, par voie intraveineuse permet de compenser les pertes hydriques importantes [4]. Concrètement, cette mesure peut faire la différence entre la vie et la mort chez les jeunes animaux.
Les antibiotiques peuvent être prescrits, non pas pour traiter l'infection virale, mais pour prévenir les surinfections bactériennes secondaires [5]. En effet, l'inflammation intestinale fragilise la barrière intestinale et favorise la prolifération de bactéries pathogènes.
Certains éleveurs utilisent également des probiotiques pour restaurer l'équilibre de la flore intestinale après l'infection [4]. Bien que leur efficacité ne soit pas formellement démontrée, ces produits semblent contribuer à accélérer la récupération des animaux. D'ailleurs, l'amélioration de l'alimentation avec des aliments facilement digestibles peut également aider à la convalescence.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
Les recherches récentes en virologie aviaire ouvrent de nouvelles perspectives pour la lutte contre l'entérite transmissible du dindon. Les études de 2024 sur les co-infections virales chez les volailles apportent des éclairages importants sur les mécanismes de pathogenèse .
Une approche innovante consiste à développer des vaccins à base de vecteurs viraux qui pourraient offrir une protection plus durable que les méthodes actuelles [2]. Ces recherches, menées dans plusieurs laboratoires européens, montrent des résultats prometteurs en phase préclinique.
Les techniques de diagnostic moléculaire évoluent également rapidement. Les nouveaux tests de détection multiplex permettent désormais d'identifier simultanément plusieurs agents pathogènes, y compris les virus émergents . Cette approche globale facilite la prise en charge des cas complexes.
D'ailleurs, les recherches sur les interactions hôte-pathogène révèlent de nouveaux mécanismes de résistance naturelle [1]. Ces découvertes pourraient conduire au développement de stratégies thérapeutiques ciblées dans les prochaines années. L'important à retenir : la recherche avance rapidement, même si les applications pratiques demandent encore du temps.
Vivre au Quotidien avec Entérite transmissible du dindon
La gestion quotidienne d'un élevage touché par l'entérite transmissible du dindon nécessite une vigilance constante et des mesures strictes de biosécurité [4]. Les éleveurs doivent adapter leurs pratiques pour minimiser les risques de propagation et protéger les animaux sains.
La surveillance clinique quotidienne devient cruciale pour détecter rapidement les premiers signes de la maladie. Il est recommandé d'observer attentivement le comportement des animaux, leur appétit et la consistance de leurs fientes [3]. Cette vigilance permet d'intervenir précocement et de limiter l'extension de l'infection.
Les mesures d'hygiène renforcées incluent la désinfection régulière des équipements, le changement fréquent de la litière et le respect strict des protocoles de nettoyage [4]. Concrètement, ces mesures peuvent sembler contraignantes, mais elles sont essentielles pour briser la chaîne de transmission.
L'isolement des animaux malades dans des zones de quarantaine permet de protéger le reste du troupeau. Cette séparation doit être maintenue jusqu'à la guérison complète et la négativation des tests virologiques [5]. Bon à savoir : cette période peut s'étendre sur plusieurs semaines selon la sévérité de l'infection.
Les Complications Possibles
L'entérite transmissible du dindon peut entraîner plusieurs complications graves qui aggravent le pronostic et prolongent la convalescence [5]. La déshydratation sévère constitue la complication la plus fréquente et la plus dangereuse, particulièrement chez les jeunes animaux.
Les surinfections bactériennes représentent une complication majeure de cette pathologie virale. L'inflammation intestinale fragilise la barrière muqueuse et favorise la prolifération de bactéries pathogènes comme Escherichia coli ou Clostridium perfringens [4]. Ces infections secondaires peuvent considérablement aggraver l'état clinique des animaux.
Chez les animaux qui survivent à la phase aiguë, des séquelles digestives peuvent persister pendant plusieurs semaines. Ces séquelles se manifestent par une malabsorption chronique, des troubles de la croissance et une fragilité digestive accrue [3]. D'ailleurs, ces animaux restent souvent plus sensibles aux stress et aux autres infections.
Dans certains cas, l'infection peut également affecter d'autres organes par dissémination hématogène. Bien que rare, cette forme systémique de la maladie présente un pronostic particulièrement sombre [5]. L'important à retenir : une prise en charge précoce et adaptée permet de réduire significativement le risque de complications.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de l'entérite transmissible du dindon varie considérablement selon plusieurs facteurs, notamment l'âge des animaux au moment de l'infection et la rapidité de la prise en charge [5]. Chez les dindonneaux de moins de 2 semaines, la mortalité peut atteindre 80 à 100% en l'absence de traitement approprié.
Pour les animaux plus âgés, le pronostic est généralement plus favorable. Les dindons de plus de 4 semaines présentent un taux de survie nettement supérieur, souvent supérieur à 70% avec une prise en charge adaptée [3]. Cependant, même les survivants peuvent présenter des retards de croissance significatifs.
La précocité du diagnostic et de l'intervention thérapeutique influence directement le pronostic. Une réhydratation rapide et des mesures de soutien appropriées peuvent réduire la mortalité de 50% ou plus [4]. Concrètement, chaque heure compte dans la prise en charge de cette maladie.
À long terme, les animaux qui récupèrent complètement retrouvent généralement des performances normales. Néanmoins, ils peuvent rester porteurs du virus pendant plusieurs semaines et constituer une source de contamination pour d'autres animaux [5]. Bon à savoir : un suivi vétérinaire régulier est recommandé pendant au moins un mois après la guérison clinique.
Peut-on Prévenir Entérite transmissible du dindon ?
La prévention de l'entérite transmissible du dindon repose sur un ensemble de mesures de biosécurité rigoureuses qui doivent être appliquées de manière systématique dans tous les élevages [4]. Ces mesures constituent la première ligne de défense contre cette pathologie dévastatrice.
Le vide sanitaire entre les bandes d'animaux représente une mesure préventive fondamentale. Cette période, qui doit durer au minimum 15 jours, permet l'élimination complète du virus de l'environnement [3]. Pendant cette période, un nettoyage et une désinfection approfondis de tous les locaux et équipements sont indispensables.
Le contrôle de l'accès aux élevages constitue également un élément clé de la prévention. La mise en place de sas de décontamination, l'utilisation de vêtements et chaussures spécifiques, ainsi que la limitation du nombre de visiteurs permettent de réduire considérablement les risques d'introduction du virus [4].
Bien qu'il n'existe pas encore de vaccin commercial disponible, des recherches sont en cours pour développer des stratégies de vaccination efficaces [2]. En attendant, la prévention reste la meilleure arme contre cette maladie. D'ailleurs, certains élevages utilisent des programmes de médication préventive avec des probiotiques ou des acidifiants pour renforcer la résistance naturelle des animaux [1].
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises ont établi des protocoles stricts pour la surveillance et la gestion de l'entérite transmissible du dindon dans les élevages commerciaux . Ces recommandations s'appuient sur les dernières données scientifiques et l'expérience terrain des vétérinaires spécialisés.
La déclaration obligatoire de tout foyer suspecté d'entérite transmissible constitue une mesure de surveillance épidémiologique essentielle [1]. Cette déclaration permet aux services vétérinaires de suivre l'évolution de la maladie sur le territoire et d'adapter les mesures de prévention en conséquence.
Les recommandations incluent également des protocoles de désinfection spécifiques utilisant des désinfectants virucides efficaces contre les coronavirus . Ces protocoles précisent les concentrations à utiliser, les temps de contact nécessaires et les modalités d'application pour attendur une efficacité optimale.
En cas de foyer confirmé, les autorités recommandent la mise en place d'un périmètre de surveillance autour de l'élevage infecté [1]. Cette mesure permet de détecter rapidement d'éventuelles extensions de l'infection et de mettre en œuvre des mesures de contrôle adaptées. Concrètement, cette surveillance peut s'étendre sur un rayon de plusieurs kilomètres selon la densité d'élevages dans la zone.
Ressources et Associations de Patients
Bien que l'entérite transmissible du dindon soit une pathologie vétérinaire, plusieurs organisations professionnelles proposent des ressources et un soutien aux éleveurs confrontés à cette maladie [4]. Ces structures jouent un rôle crucial dans la diffusion d'informations et l'accompagnement des professionnels.
Les groupements de défense sanitaire (GDS) constituent le premier niveau de soutien pour les éleveurs. Ces organisations proposent des formations, des conseils techniques et un accompagnement personnalisé pour la mise en place de mesures préventives [1]. D'ailleurs, leur expertise terrain est particulièrement précieuse pour adapter les recommandations aux spécificités locales.
Les centres de formation agricole organisent régulièrement des sessions de sensibilisation sur les maladies aviaires, incluant l'entérite transmissible du dindon . Ces formations permettent aux éleveurs de se tenir informés des dernières évolutions en matière de prévention et de traitement.
Les plateformes numériques spécialisées offrent également des ressources documentaires et des forums d'échange entre professionnels [4]. Ces outils facilitent le partage d'expériences et la diffusion rapide d'informations en cas d'émergence de nouveaux foyers. L'important à retenir : ces ressources sont essentielles pour maintenir un niveau de vigilance élevé dans la filière avicole.
Nos Conseils Pratiques
Pour les professionnels de l'aviculture, la mise en place d'un plan de biosécurité personnalisé constitue la base de toute stratégie préventive efficace contre l'entérite transmissible du dindon [4]. Ce plan doit être adapté aux spécificités de chaque élevage et régulièrement mis à jour.
Établissez un protocole de surveillance quotidienne incluant l'observation du comportement des animaux, de leur appétit et de la consistance de leurs fientes [3]. Cette surveillance doit être systématique et documentée pour permettre une détection précoce de tout signe anormal.
Investissez dans des équipements de désinfection de qualité et formez votre personnel à leur utilisation correcte. La rotation des désinfectants permet d'éviter l'émergence de résistances et d'optimiser l'efficacité des traitements [4]. Concrètement, alternez entre différentes familles de produits virucides selon un calendrier établi.
Maintenez un registre détaillé de tous les événements sanitaires, des traitements administrés et des mesures préventives mises en œuvre . Cette documentation est précieuse pour l'analyse épidémiologique et l'amélioration continue de vos pratiques. D'ailleurs, elle peut s'avérer indispensable en cas de contrôle officiel ou de demande d'indemnisation.
Quand Consulter un Médecin ?
Dans le contexte de l'entérite transmissible du dindon, la consultation d'un vétérinaire spécialisé en pathologie aviaire doit être envisagée dès l'apparition des premiers signes cliniques suspects [5]. Cette consultation précoce peut faire la différence entre un foyer maîtrisé et une épizootie dévastatrice.
Contactez immédiatement votre vétérinaire si vous observez une mortalité anormale chez vos dindonneaux, même si elle ne s'accompagne pas encore de signes cliniques évidents [3]. En effet, la mortalité peut parfois précéder l'apparition des symptômes digestifs caractéristiques.
Une diarrhée aqueuse touchant plusieurs animaux simultanément constitue un motif de consultation urgente, particulièrement si elle s'accompagne de prostration et de perte d'appétit [4]. N'attendez pas que les symptômes s'aggravent : chaque heure compte dans la prise en charge de cette pathologie.
En cas de suspicion d'entérite transmissible, évitez tout déplacement d'animaux et renforcez immédiatement les mesures de biosécurité en attendant l'intervention vétérinaire [5]. Cette précaution permet de limiter la propagation potentielle du virus vers d'autres élevages. Bon à savoir : certains vétérinaires proposent des consultations d'urgence 24h/24 pour ce type de pathologie.
Questions Fréquentes
L'entérite transmissible du dindon peut-elle affecter l'homme ?
Non, cette pathologie est spécifique aux dindes et ne présente aucun risque pour la santé humaine. Le coronavirus responsable de cette maladie ne peut pas infecter l'homme.
Combien de temps le virus survit-il dans l'environnement ?
Le virus peut survivre plusieurs semaines dans les matières fécales et sur les surfaces contaminées, particulièrement dans des maladies fraîches et humides.
Existe-t-il un vaccin contre cette maladie ?
Actuellement, aucun vaccin commercial n'est disponible contre l'entérite transmissible du dindon. Les recherches sont en cours pour développer des stratégies vaccinales efficaces.
Comment distinguer cette maladie d'autres pathologies digestives ?
Seuls des examens de laboratoire permettent de confirmer le diagnostic avec certitude. L'âge des animaux affectés et la rapidité de propagation peuvent orienter le diagnostic clinique.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Effet de la co-infection du circovirus porcin avec le virus de l'influenza porcin et le virus du syndrome reproducteur et respiratoire porcin sur la pathogenèse viraleLien
- [2] Effet de la co-infection du circovirus porcin avec le virus de l'influenza porcin et le virus du syndrome reproducteur et respiratoire porcin sur la pathogenèseLien
- [3] Détection de quelques microorganismes chez les singes de zoo de Jardin d'essai du Hamma par le test rapide immunochromatographiqueLien
- [4] Les pathologies dominantes chez le pouletLien
- [5] Les maladies virales émergentesLien
- [9] Entérite Transmissible de la DindeLien
- [10] Maladies et parasitesLien
- [11] Syndrome entéritique mortel du dindonneauLien
Publications scientifiques
- Effet de la co-infection du circovirus porcin avec le virus de l'influenza porcin et le virus du syndrome reproducteur et respiratoire porcin sur la pathogenèse virale (2023)
- [PDF][PDF] Effet de la co-infection du circovirus porcin avec le virus de l'influenza porcin et le virus du syndrome reproducteur et respiratoire porcin sur la pathogenèse … (2023)
- Détection de quelques microorganismes chez les singes de zoo de Jardin d'essai du Hamma par le test rapide immunochromatographique et les méthodes … (2024)[PDF]
- Les pathologies dominantes chez le poulet (2023)[PDF]
- LES MALADIES VIRALES EMERGENTES (2024)[PDF]
Ressources web
- Entérite Transmissible de la Dinde (fr.wikivet.net)
La manifestation clinique la plus courante est une maladie gastro-intestinale à l'origine d'une diarrhée blanche, verte ou jaune, une anorexie et un malaise. ...
- MALADIES ET PARASITES (avitats.com)
Chez les dindons plus âgés et chez les adultes, perte d'appétit, chute de poids, diarrhée, déjections décolorées et liquides. Chez les dindons; variable jusqu' ...
- Syndrome entéritique mortel du dindonneau (persee.fr)
de JP Vaillancourt · 1997 · Cité 2 fois — Dindonneau présentant une diarrhée brunâtre souillant les plumes (la mort survient généralement 5 à 7 jours après un contact expérimental). Figure 4. Par ...
- Rôle de l'astrovirus de type 2 de la dinde dans le syndrome ... (lepointveterinaire.fr)
Il se caractérise par une diarrhée avec une déshydratation, une anorexie, un amaigrissement, une immunosuppression, un arrêt de la croissance (supérieur ou égal ...
- L'HISTOMONOSE - Anses (anses.fr)
Les cas d'histomonose sont peu fréquents, mais ils peuvent être très graves, avec morbidité marquée, prostration, diarrhée de couleur jaune soufre, ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
