Infections à Hepadnaviridae : Guide Complet 2025 - Symptômes, Traitements
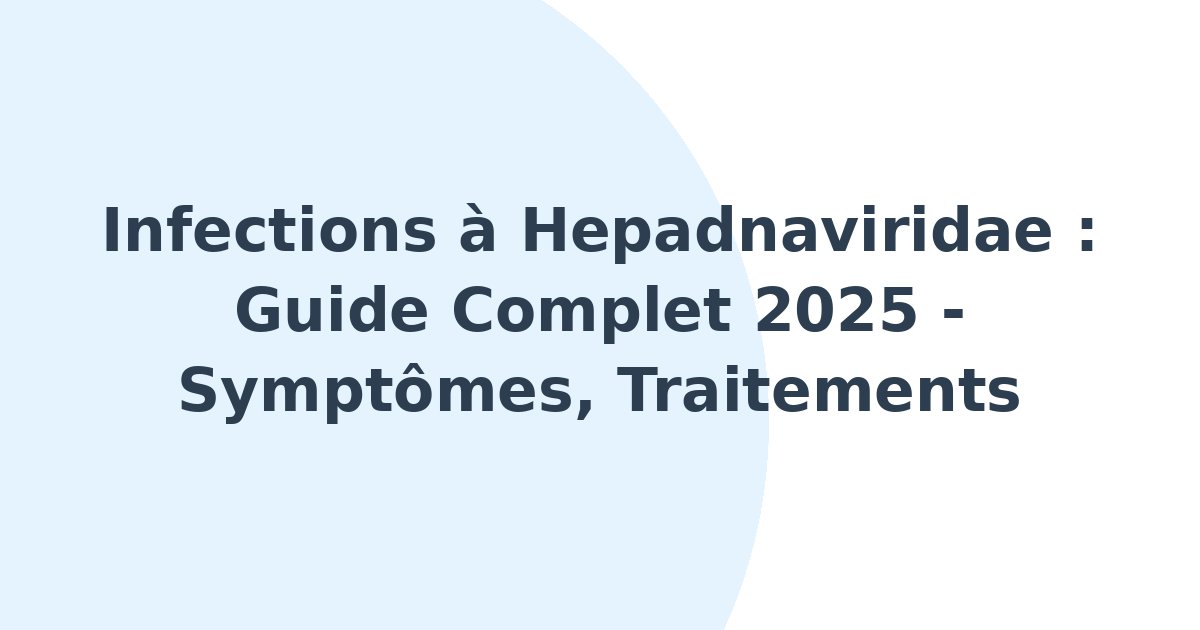
Les infections à Hepadnaviridae, principalement représentées par l'hépatite B, touchent plus de 280 000 personnes en France selon Santé Publique France [1,2]. Cette pathologie virale chronique peut évoluer silencieusement pendant des années. Heureusement, les avancées thérapeutiques récentes offrent de nouveaux espoirs aux patients [4,5].
Téléconsultation et Infections à Hepadnaviridae
Téléconsultation non recommandéeLes infections à Hepadnaviridae (principalement hépatite B) nécessitent généralement une évaluation clinique complète avec examens biologiques spécialisés pour le diagnostic et le suivi. La complexité du diagnostic différentiel, l'évaluation de l'état hépatique et la mise en place d'un traitement antiviral spécialisé requièrent une prise en charge en présentiel par un spécialiste.
Ce qui peut être évalué à distance
Recueil de l'histoire clinique et des facteurs de risque d'exposition au virus de l'hépatite B, évaluation des symptômes généraux comme la fatigue ou l'inconfort abdominal, analyse des résultats biologiques déjà disponibles, orientation vers les examens complémentaires nécessaires, suivi de l'observance thérapeutique chez les patients déjà diagnostiqués.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examen physique hépatique avec palpation abdominale, prescription et interprétation des sérologies spécifiques (antigènes HBs, anticorps anti-HBc, ADN viral), évaluation de la fibrose hépatique par examens spécialisés, mise en place d'un traitement antiviral adapté nécessitant une surveillance rapprochée.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Suspicion d'hépatite aiguë nécessitant un examen clinique complet et des examens biologiques urgents, évaluation de complications hépatiques comme l'ascite ou l'encéphalopathie, mise en place d'un traitement antiviral nécessitant une surveillance spécialisée, évaluation d'une co-infection VIH ou hépatite C associée.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Signes d'hépatite fulminante avec confusion ou troubles de la conscience, jaunisse intense avec douleurs abdominales sévères, signes de décompensation hépatique avec ascite ou œdèmes des membres inférieurs.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Jaunisse intense avec confusion, désorientation ou troubles de la conscience
- Douleurs abdominales intenses et persistantes dans l'hypocondre droit
- Vomissements incoercibles empêchant toute alimentation
- Gonflement abdominal rapide avec essoufflement (ascite)
- Saignements anormaux ou ecchymoses multiples spontanées
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Hépato-gastroentérologue — consultation en présentiel indispensable
Les infections à Hepadnaviridae nécessitent une expertise spécialisée en hépatologie pour le diagnostic précis, l'évaluation de la charge virale et la mise en place d'un traitement antiviral adapté. Une consultation en présentiel est indispensable pour l'examen clinique hépatique et la prescription des examens biologiques spécialisés.
Infections à Hepadnaviridae : Définition et Vue d'Ensemble
Les infections à Hepadnaviridae regroupent les pathologies causées par une famille de virus à ADN qui s'attaquent principalement au foie. Le représentant le plus connu ? Le virus de l'hépatite B (VHB), responsable de la grande majorité des cas humains [6,11].
Ces virus ont une particularité fascinante : ils utilisent une enzyme appelée transcriptase inverse pour se reproduire, un mécanisme qu'ils partagent avec les rétrovirus. Mais contrairement à ces derniers, les Hepadnaviridae possèdent un génome à ADN double brin [7]. Cette caractéristique unique explique en partie leur capacité à établir des infections chroniques.
D'ailleurs, la famille des Hepadnaviridae ne se limite pas aux humains. On retrouve des virus similaires chez de nombreux animaux : canards, marmottes, écureuils terrestres, et même récemment chez les chats domestiques [8]. Ces découvertes permettent aux chercheurs de mieux comprendre l'évolution et les mécanismes de ces pathologies.
L'important à retenir ? Ces infections peuvent rester silencieuses pendant des décennies. C'est pourquoi on les surnomme parfois les "tueurs silencieux" du foie. Mais rassurez-vous, des traitements efficaces existent aujourd'hui [9].
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, la situation épidémiologique des infections à Hepadnaviridae révèle des chiffres préoccupants mais en amélioration. Selon les dernières données de Santé Publique France, environ 280 000 à 300 000 personnes vivent avec une hépatite B chronique sur notre territoire [1,2]. Cela représente une prévalence d'environ 0,65% de la population adulte.
Mais ces chiffres cachent des disparités importantes. Les régions d'outre-mer affichent des taux nettement supérieurs : jusqu'à 2,1% en Guyane et 1,8% à Mayotte. En métropole, l'Île-de-France concentre le plus grand nombre de cas, principalement en raison des flux migratoires en provenance de zones d'endémie [1].
L'évolution temporelle montre une tendance encourageante. Grâce à la vaccination obligatoire instaurée en 1994, l'incidence chez les jeunes a chuté de 85% en vingt ans. Chez les 15-24 ans, on ne compte plus que 0,1% de porteurs chroniques, contre 0,8% dans les années 1990 [2].
À l'échelle mondiale, les chiffres restent alarmants. L'Organisation mondiale de la santé estime que 296 millions de personnes vivent avec une hépatite B chronique, causant environ 820 000 décès annuels [4]. L'Afrique subsaharienne et l'Asie de l'Est concentrent 68% des cas mondiaux.
Concrètement, cela signifie qu'une personne sur 30 dans le monde est porteuse du virus. En Europe, la France se situe dans la moyenne basse avec ses 0,65%, loin derrière certains pays de l'Est où la prévalence dépasse 2% [4].
Les Causes et Facteurs de Risque
Le virus de l'hépatite B se transmet exclusivement par contact avec du sang ou des liquides biologiques infectés. Contrairement aux idées reçues, il ne se transmet pas par la salive, les éternuements ou les contacts sociaux normaux [3,13].
Les principales voies de transmission incluent les rapports sexuels non protégés, le partage de matériel d'injection (seringues, aiguilles), les soins médicaux avec du matériel mal stérilisé, et la transmission de la mère à l'enfant pendant l'accouchement. Cette dernière voie représente encore 40% des nouvelles infections dans le monde [4].
Certaines populations présentent un risque accru. Les personnes originaires de zones d'endémie (Afrique subsaharienne, Asie du Sud-Est), les hommes ayant des rapports avec des hommes, les usagers de drogues injectables, et les professionnels de santé constituent les groupes les plus exposés [1,13].
Il faut savoir que le virus de l'hépatite B est 50 à 100 fois plus contagieux que le VIH. Il peut survivre jusqu'à 7 jours à l'air libre sur des surfaces contaminées. Cette résistance exceptionnelle explique pourquoi des transmissions peuvent survenir dans des contextes apparemment anodins [14].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
La grande majorité des infections à Hepadnaviridae évoluent silencieusement. En fait, 70% des personnes infectées ne présentent aucun symptôme pendant des années, voire des décennies [3,9]. Cette absence de signes cliniques explique pourquoi tant de personnes ignorent leur statut.
Quand des symptômes apparaissent, ils ressemblent souvent à ceux d'une grippe banale. Vous pourriez ressentir une fatigue persistante, des douleurs articulaires, des maux de tête, ou encore une perte d'appétit. Ces signes non spécifiques passent souvent inaperçus [3,13].
Les symptômes plus caractéristiques surviennent lors des poussées aiguës ou en cas de complications. L'ictère (jaunissement de la peau et des yeux) constitue le signe le plus évocateur, accompagné d'urines foncées et de selles décolorées. Des douleurs dans la région du foie (sous les côtes droites) peuvent également apparaître [3].
Mais attention, l'absence de symptômes ne signifie pas l'absence de dégâts. Le virus continue de se multiplier et peut endommager progressivement le foie. C'est pourquoi les médecins insistent sur l'importance du dépistage, même en l'absence de signes cliniques [9].
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic des infections à Hepadnaviridae repose sur une série d'analyses sanguines spécifiques. La première étape consiste à rechercher les marqueurs viraux : antigène HBs, anticorps anti-HBc, et anticorps anti-HBs. Cette combinaison permet de déterminer si vous êtes infecté, guéri, ou vacciné [3,14].
Si l'infection est confirmée, votre médecin prescrira des examens complémentaires. La charge virale (quantité de virus dans le sang) et le génotypage (identification de la souche virale) orientent le choix thérapeutique. Ces analyses sont devenues plus précises grâce aux nouvelles techniques de séquençage [12].
L'évaluation de l'état du foie constitue l'étape suivante. Les transaminases (ALAT, ASAT) reflètent l'inflammation hépatique, tandis que l'échographie abdominale visualise la structure du foie. En cas d'anomalies, une biopsie hépatique ou un FibroScan peuvent être nécessaires [3].
Bon à savoir : les tests rapides de dépistage, disponibles en pharmacie depuis 2022, permettent un diagnostic en 15 minutes. Bien qu'ils ne remplacent pas les analyses de laboratoire, ils constituent un premier pas vers le diagnostic [13].
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement des infections à Hepadnaviridae a considérablement évolué ces dernières années. Les analogues nucléosidiques comme l'entécavir et le ténofovir constituent aujourd'hui la référence thérapeutique. Ces médicaments bloquent la réplication virale et permettent de contrôler l'infection dans plus de 95% des cas [9,11].
L'objectif principal ? Réduire la charge virale à un niveau indétectable et normaliser les transaminases. Cela permet de prévenir l'évolution vers la cirrhose et le cancer du foie. Mais attention, ces traitements ne guérissent pas définitivement l'infection : ils la contrôlent [9].
Pour certains patients, l'interféron pégylé reste une option intéressante. Ce traitement immunomodulateur, administré par injection, peut permettre une guérison fonctionnelle chez 20 à 30% des patients. Cependant, ses effets secondaires importants limitent son utilisation [11].
La durée du traitement varie selon le profil de chaque patient. Certains devront prendre leurs médicaments à vie, d'autres pourront les arrêter après plusieurs années de contrôle viral. Cette décision se prend toujours en concertation avec votre hépatologue [9].
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024-2025 marque un tournant dans le traitement des infections à Hepadnaviridae. Le bepirovirsen, un oligonucléotide antisens, montre des résultats prometteurs dans les essais cliniques de phase 2. Ce médicament innovant cible directement l'ARN viral et pourrait permettre une guérison fonctionnelle chez un plus grand nombre de patients [5].
Les thérapies combinées représentent une autre voie d'avenir. L'association d'analogues nucléosidiques avec des immunomodulateurs ou des inhibiteurs d'entrée virale fait l'objet d'études intensives. L'objectif ? Obtenir une guérison complète, pas seulement un contrôle de l'infection [4,5].
La recherche sur les technologies d'édition génique progresse également. Les systèmes CRISPR-Cas9 pourraient théoriquement éliminer l'ADN viral intégré dans les cellules hépatiques. Bien que ces approches restent expérimentales, elles ouvrent des perspectives révolutionnaires .
D'ailleurs, les nouvelles plateformes de diagnostic moléculaire permettent désormais un suivi plus précis de l'évolution virale. Le séquençage en temps réel aide les cliniciens à adapter les traitements selon les mutations virales détectées [12].
Vivre au Quotidien avec Infections à Hepadnaviridae
Recevoir un diagnostic d'infection à Hepadnaviridae bouleverse souvent la vie quotidienne. Mais rassurez-vous, des millions de personnes dans le monde mènent une vie normale avec cette pathologie. L'important ? Adopter quelques habitudes simples et maintenir un suivi médical régulier [9].
Côté alimentation, aucun régime strict n'est nécessaire. Cependant, limitez l'alcool qui peut aggraver les lésions hépatiques. Une alimentation équilibrée, riche en fruits et légumes, soutient naturellement votre foie. L'exercice physique régulier améliore également votre bien-être général [13].
La question de la transmission préoccupe souvent les patients. Vous pouvez partager vos repas, embrasser vos proches, et avoir une vie sociale normale. Seuls les contacts avec le sang nécessitent des précautions : utilisez vos propres objets de toilette (rasoir, brosse à dents) et informez vos partenaires sexuels [3,13].
Sur le plan professionnel, la plupart des métiers restent accessibles. Seules certaines professions médicales peuvent nécessiter des aménagements spécifiques. N'hésitez pas à en parler avec la médecine du travail si besoin [13].
Les Complications Possibles
Sans traitement approprié, les infections à Hepadnaviridae peuvent évoluer vers des complications graves. La cirrhose hépatique représente le risque principal, touchant 15 à 20% des patients non traités après 20 ans d'évolution. Cette fibrose extensive du foie peut compromettre ses fonctions vitales [9,10].
Le carcinome hépatocellulaire (cancer du foie) constitue la complication la plus redoutée. Les patients cirrhotiques présentent un risque annuel de 2 à 5% de développer cette tumeur maligne. D'ailleurs, l'hépatite B chronique multiplie par 100 le risque de cancer hépatique par rapport à la population générale [10].
Mais ces complications ne sont pas une fatalité. Les traitements antiviraux modernes réduisent drastiquement ces risques. Une étude récente montre que le traitement précoce diminue de 78% le risque de cirrhose et de 65% celui de cancer du foie [9].
D'autres complications peuvent survenir : insuffisance hépatique aiguë lors des réactivations virales, atteintes rénales liées aux traitements, ou encore manifestations extra-hépatiques (arthralgies, éruptions cutanées). Heureusement, ces situations restent rares avec une prise en charge adaptée [9].
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic des infections à Hepadnaviridae s'est considérablement amélioré avec l'avènement des traitements antiviraux efficaces. Aujourd'hui, un patient diagnostiqué précocement et correctement traité a une espérance de vie quasi normale [9,11].
Plusieurs facteurs influencent l'évolution de la maladie. L'âge au moment de l'infection joue un rôle crucial : les infections acquises dans l'enfance évoluent plus souvent vers la chronicité (90% des cas) que celles contractées à l'âge adulte (5 à 10%). Le génotype viral influence également la réponse au traitement [6,11].
Les marqueurs biologiques permettent d'évaluer le pronostic. Un taux d'antigène HBs élevé, une charge virale importante, ou des transaminases perturbées signalent une infection active nécessitant un traitement. À l'inverse, des marqueurs stables suggèrent une infection contrôlée [9].
Concrètement, que peut-on espérer ? Avec un traitement adapté, 95% des patients atteignent une charge virale indétectable en deux ans. La normalisation des transaminases survient chez 70% d'entre eux. Ces résultats se maintiennent tant que le traitement est poursuivi [9,11].
Peut-on Prévenir Infections à Hepadnaviridae ?
La prévention des infections à Hepadnaviridae repose principalement sur la vaccination. Le vaccin contre l'hépatite B, disponible depuis 1982, offre une protection de plus de 95% et constitue l'une des plus grandes réussites de la médecine préventive [1,2].
En France, la vaccination est obligatoire depuis 1994 pour tous les nourrissons. Le schéma comprend trois injections : à 2, 4 et 11 mois. Cette stratégie a permis de réduire drastiquement l'incidence chez les jeunes générations [2]. Pour les adultes non vaccinés, un rattrapage reste possible à tout âge.
Certaines populations bénéficient d'une vaccination prioritaire : professionnels de santé, personnes dialysées, voyageurs vers des zones d'endémie, entourage de personnes infectées. La vaccination post-exposition, dans les 48 heures suivant un contact à risque, peut également prévenir l'infection [1,13].
Au-delà de la vaccination, les mesures de prévention comportementale restent essentielles. Utilisation de préservatifs, matériel d'injection à usage unique, stérilisation correcte du matériel médical : ces gestes simples sauvent des vies [13,14].
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises ont établi des recommandations précises pour la prise en charge des infections à Hepadnaviridae. La Haute Autorité de Santé (HAS) préconise un dépistage systématique chez les populations à risque et un suivi régulier des patients infectés [1,2].
Le dépistage doit être proposé aux femmes enceintes, aux donneurs de sang, aux personnes originaires de zones d'endémie, et aux partenaires de personnes infectées. Cette stratégie ciblée permet d'identifier les cas méconnus et de prévenir les transmissions [1].
Pour le suivi des patients chroniques, les recommandations prévoient une consultation spécialisée tous les 6 mois avec bilan biologique complet. Une échographie hépatique annuelle permet de dépister précocement les complications. Ces mesures de surveillance ont prouvé leur efficacité pour améliorer le pronostic [2].
Santé Publique France coordonne également les actions de prévention. Les campagnes d'information, la surveillance épidémiologique, et la promotion de la vaccination constituent les piliers de cette stratégie nationale [1,2].
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs associations accompagnent les personnes touchées par les infections à Hepadnaviridae en France. SOS Hépatites Fédération, présente dans toute la France, propose information, soutien et défense des droits des patients. Leurs permanences téléphoniques et leurs groupes de parole constituent une aide précieuse.
L'Association Française pour l'Étude du Foie (AFEF) développe des outils d'information destinés aux patients. Leurs brochures explicatives et leurs sites web offrent des contenus validés scientifiquement, accessibles au grand public.
Au niveau européen, l'European Liver Patients Association (ELPA) coordonne les actions de plaidoyer et facilite les échanges d'expériences entre pays. Cette dimension internationale enrichit les ressources disponibles pour les patients français.
Les plateformes numériques se développent également. Applications mobiles de suivi, forums de discussion modérés, téléconsultations : ces nouveaux outils complètent l'accompagnement traditionnel et répondent aux attentes d'une population de plus en plus connectée.
Nos Conseils Pratiques
Vivre avec une infection à Hepadnaviridae nécessite quelques adaptations simples mais importantes. Premier conseil : respectez scrupuleusement votre traitement. L'observance thérapeutique maladiene le succès du contrôle viral. Utilisez des rappels sur votre téléphone si nécessaire.
Adoptez une hygiène de vie saine. Évitez l'alcool qui aggrave les lésions hépatiques, maintenez un poids normal, et pratiquez une activité physique régulière. Ces mesures simples potentialisent l'efficacité de votre traitement.
Informez tous vos professionnels de santé de votre statut. Dentiste, chirurgien, médecin généraliste : ils doivent connaître votre infection pour adapter leurs pratiques et éviter les interactions médicamenteuses.
Protégez votre entourage sans vous isoler. Utilisez vos propres objets de toilette, pratiquez des rapports sexuels protégés avec de nouveaux partenaires, et encouragez vos proches à se faire vacciner. Ces gestes responsables préservent vos relations tout en limitant les risques de transmission.
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes d'alerte doivent vous amener à consulter rapidement. L'apparition d'un ictère (jaunissement de la peau et des yeux), de douleurs abdominales intenses, ou d'une fatigue extrême peut signaler une poussée évolutive nécessitant une prise en charge urgente [3,9].
Si vous présentez des facteurs de risque d'infection à Hepadnaviridae, n'attendez pas l'apparition de symptômes pour consulter. Rapports sexuels non protégés, partage de matériel d'injection, voyage en zone d'endémie : ces situations justifient un dépistage préventif [13].
Pour les patients déjà diagnostiqués, respectez le calendrier de suivi établi par votre médecin. Les consultations régulières permettent d'adapter le traitement et de dépister précocement les complications. Ne reportez jamais ces rendez-vous, même si vous vous sentez bien [9].
En cas de projet de grossesse, une consultation préconceptionnelle s'impose. Les femmes infectées nécessitent un suivi spécialisé pour prévenir la transmission materno-fœtale. Des mesures préventives efficaces existent et doivent être mises en place dès le début de la grossesse [1,13].
Questions Fréquentes
Peut-on guérir définitivement de l'hépatite B ?
La guérison complète reste rare (moins de 1% par an), mais les traitements actuels permettent un contrôle durable de l'infection. Les nouvelles thérapies en développement visent à augmenter ce taux de guérison.
L'hépatite B se transmet-elle par la salive ?
Non, contrairement aux idées reçues, le virus ne se transmet pas par la salive, les baisers, ou les contacts sociaux normaux. Seuls les contacts avec le sang et certains liquides biologiques sont à risque.
Faut-il suivre un régime alimentaire particulier ?
Aucun régime strict n'est nécessaire. Cependant, limitez l'alcool et adoptez une alimentation équilibrée pour préserver votre foie. L'exercice physique régulier est également bénéfique.
Peut-on avoir des enfants quand on a l'hépatite B ?
Oui, avec un suivi médical approprié. La transmission mère-enfant peut être prévenue par la vaccination et l'administration d'immunoglobulines au nouveau-né.
Les traitements ont-ils des effets secondaires ?
Les analogues nucléosidiques sont généralement bien tolérés. Des effets secondaires mineurs (maux de tête, fatigue) peuvent survenir mais restent rares. Votre médecin adaptera le traitement si nécessaire.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Prévalence des hépatites B. Santé Publique France. 2024-2025.Lien
- [2] Prévalence des hépatites B. Santé Publique France. 2024-2025.Lien
- [3] Les symptômes, le diagnostic et l'évolution de l'hépatite B. www.ameli.fr.Lien
- [4] Global prevalence, treatment, and prevention of hepatitis B. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [5] Efficacy and Safety of Bepirovirsen in Chronic Hepatitis B. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [6] Conditions and Diseases - MedTech-Tracker. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [7] Modern views on the role of X gene of the hepatitis B virus (Hepadnaviridae: Orthohepadnavirus: Hepatitis B virus) in the pathogenesis of the infection it causes. 2022.Lien
- [8] Comparison of Genomes of the Hepadnaviridae Family. 2024.Lien
- [9] Human hepatoma HepG2 cells are susceptible to infection by domestic cat hepadnavirus. 2025.Lien
- [11] Toward a better understanding of chronic hepatitis B virus infection. 2024.Lien
- [12] Chronic Viral Infections and Hepatic Oncogenesis.Lien
- [13] Updates on HBV Infection. 2022.Lien
- [14] Evolutional transition of HBV genome during the persistent infection determined by single-molecule real-time sequencing. 2023.Lien
- [15] Hepatite B : Symptômes, Dépistage et Traitement. www.cerballiance.fr.Lien
- [16] Virus de l'hépatite B (VHB). www.sfm-microbiologie.org.Lien
Publications scientifiques
- Modern views on the role of X gene of the hepatitis B virus (Hepadnaviridae: Orthohepadnavirus: Hepatitis B virus) in the pathogenesis of the infection it causes (2022)1 citations
- Comparison of Genomes of the Hepadnaviridae Family (2024)[PDF]
- Human hepatoma HepG2 cells are susceptible to infection by domestic cat hepadnavirus (2025)
- … IMMEDIATELY FOLLOWING VIRAL INVASION AND IN ACUTE HEPATITIS IN THE WOODCHUCK HEPATITIS VIRUS MODEL OF HEPATITIS B VIRUS INFECTIONS (2023)
- Toward a better understanding of chronic hepatitis B virus infection (2024)2 citations
Ressources web
- Les symptômes, le diagnostic et l'évolution de l'hépatite B (ameli.fr)
Fièvre, nausées et vomissements, perte d'appétit, douleurs musculaires et articulaires peuvent être aussi les premiers signes de l'hépatite virale B aiguë. ...
- Hepatite B : Symptômes, Dépistage et Traitement (cerballiance.fr)
Cependant, elle peut s'accompagner de symptômes tels que : jaunisse, fatigue, perte d'appétit, douleurs abdominales, nausées et/ou vomissements. D'autres sympt ...
- Virus de l'hépatite B (VHB) (sfm-microbiologie.org)
Le virus de l'hépatite B (VHB) est un virus hépatotrope, capable d'établir des infections aiguës, des insuffisances hépatiques aiguës (ALF, ...
- Hépatite B (inspq.qc.ca)
22 janv. 2024 — Diagnostic. Des marqueurs sérologiques spécifiques sont nécessaires pour diagnostiquer une infection au VHB. L'antigène de surface de l'hépatite ...
- Hépatite B - symptômes, causes, traitements et prévention (vidal.fr)
2 janv. 2024 — L'hépatite B est une maladie du foie causée par un virus qui se transmet essentiellement par relations sexuelles ou par contact avec du sang ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
